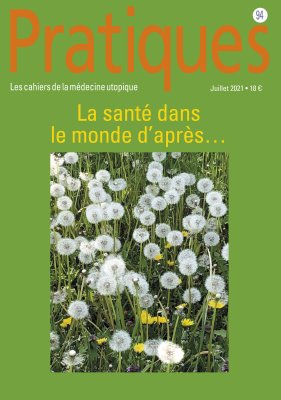Frédéric Pierru
Chercheur en sciences sociales, CNRS-CERAPS
J’ai souvent été perplexe, même parfois très critique à l’égard des exercices de pensée qui ont connu une véritable efflorescence durant le premier confinement. Oh, certes, j’ai bien compris que quitte à être embastillé chez moi dans un contexte inédit, une partie du temps pouvait être consacrée à l’examen des causes de la catastrophe et à l’identification des « solutions » qui permettraient de prévenir sa répétition. Toutefois, de telles entreprises ont eu tendance à tomber dans ce que le sociologue Pierre Bourdieu désignait, pour la critiquer résolument, comme « l’illusion scolastique » : « Je voulais en effet pousser la critique (au sens de Kant) de la raison savante jusqu’à un point que les mises en question laissent d’ordinaire intouché et tenter d’expliciter les présupposés inscrits dans la situation de skholè, temps libre et libéré des urgences du monde qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences et au monde. » [1] En un sens, pendant le confinement, en dehors des premiers de corvée – la précision est cruciale –, de nombreuses personnes ont pu s’adonner aux plaisirs de la philosophie et de la politique en chambre. Cela n’est certes pas condamnable, voire est louable, mais à condition de ne pas perdre de vue les nombreuses limites de l’exercice. Confectionner un plan détaillé de réforme du système de santé, aussi cohérent qu’ambitieux, est un utile exercice de pensée, mais sauf à tomber dans l’idéalisme le plus naïf – « il n’existe aucune force intrinsèque des idées vraies » disait à peu près Spinoza –, il y a loin du fichier Word à la mise en œuvre. Il n’est pas interdit de réfléchir aux moyens et façons d’empuissantiser les idées ainsi élaborées, de leur donner une force sociale et politique.
C’est ici que le discours sociologique peut être aride et décevant. Pourquoi ? Parce que le sociologue s’intéresse aux « faits sociaux », c’est-à-dire à toutes ces institutions, matérielles ou « mentales » (les catégories de pensée), qui pèsent, et souvent très lourdement, sur les destins individuels et collectifs. Il n’est pas faux de dire qu’il s’intéresse d’abord aux « régularités qui, au surplus, prennent en défaut le sens commun qui s’imagine très souvent être beaucoup plus libre qu’il ne l’est vraiment ». Tout le monde connaît le travail de Bourdieu sur le destin scolaire selon l’origine sociale qui prenait à revers le discours sur la méritocratie scolaire. En matière de transformations des « systèmes de santé », toutes les enquêtes françaises et internationales ont montré que la stabilité, voire l’inertie, l’emportent sur le changement. Les lois de la pesanteur sociale, économique, politique s’y font durement sentir. Même la « dame de fer », Margaret Thatcher, s’est cassé les dents sur le National Health Service. Aux États-Unis, tous les projets d’instauration d’une couverture maladie universelle « à l’européenne » se sont fracassés sur la puissance conjointe de l’industrie de l’assurance et de la puissante Association médicale américaine. En France, où l’exécutif est l’un des plus puissants du monde occidental, il faut des circonstances exceptionnelles pour faire bouger de façon substantielle le système de santé. Ainsi, il aura fallu une crise politique majeure (liée à la décolonisation) et l’instauration d’une nouvelle constitution pour réussir à impulser la réforme de l’hôpital en 1958. C’est dans ce contexte qu’il a été possible de contourner l’opposition des syndicats de médecins libéraux à l’instauration du conventionnement avec la Sécurité sociale. De même, c’est la crise sociale et politique de mai 1968 qui va permettre de surmonter la gestion malthusienne de la démographie médicale par les porte-parole de la médecine, hantés qu’ils étaient par la peur de la « pléthore ». Dans les conjonctures plus ordinaires, si changement il y a, il est graduel, « incrémental » disent les politistes, et s’étale sur des décennies. Ainsi, par exemple, la création des « agences régionales de santé » était « actée » dans la réflexion administrative en 1993, dans le cadre d’un rapport du Commissariat général au plan demeuré célèbre. Pourtant, il aura fallu attendre 2009 pour qu’elle ne s’opérationnalise dans une loi. On pourrait prendre quantité d’autres exemples, comme celui de la réforme du financement des hôpitaux, objet d’une réflexion administrative au long cours amorcée dans la seconde moitié des années 1970 qui trouvera sa concrétisation en 2004 et l’instauration de la tarification à l’activité (T2A).
Les « décideurs », politiques et administratifs, le savent : réformer le système de santé, c’est commencer à creuser un mur avec ses seuls ongles. Les contraintes y sont multiformes. Il y a d’abord les puissants groupes d’intérêt, à commencer par ceux de la profession médicale. On ne peut pas réformer la médecine de premier recours contre les syndicats de médecins libéraux. La médecine hospitalière s’est montrée moins résistante, même si les contestations ont eu tendance à se multiplier depuis 2009. Les fédérations hospitalières jouent un grand rôle dans l’élaboration des politiques hospitalières. Il y a aussi l’industrie pharmaceutique, prompte à menacer de délocalisations ou à priver les malades français de telle innovation pharmaceutique si elle n’obtient pas les prix voulus. Dans un pays gangrené par la désindustrialisation et le chômage structurel de 10 %, de telles menaces pèsent lourdement. Plus généralement, ce sont toutes les industries de santé qui profitent de ce contexte en se faisant valoir comme des « atouts » décisifs pour la « compétitivité » de l’économie française.
Dans ce concert des puissants, les groupes qui promeuvent une vision alternative des politiques de santé, davantage centrée sur la prévention et les soins de premier recours, sont inéluctablement marginalisés. Si la médecine est utopique, c’est d’abord sur le plan politique ! Pourtant, depuis les années 1970, ce ne sont pas les réflexions novatrices qui ont manqué : de la dénonciation de la « Némésis médicale » par Ivan Illich à celle de « l’invasion pharmaceutique » par Jean-Pierre Dupuy et Serge Karsenty, en passant par les revendications du Syndicat de la médecine générale et de la revue Pratiques, l’histoire intellectuelle de la contestation des pratiques dominantes du système de soins est fort riche. Les sociologues n’ont d’ailleurs pas été les derniers à promouvoir des formats organisationnels et des pratiques novateurs, aux côtés des professionnels du soin, paramédicaux en particulier. Ils ont été souvent épaulés par les premières associations de malades dans leurs revendications en faveur de la « démocratie sanitaire ». Ils ont obtenu des résultats, mais bien en retrait des ambitieuses conceptions initiales : donner quelques strapontins à des professionnels de la représentation des malades et des usagers n’a pas suffi à faire contrepoids à la dynamique de centralisation et de verticalisation de la « gouvernance » du système de santé. Une fois de plus, s’il y a innovation, elle est à la marge et elle n’est tolérée que si elle ne remet pas en cause les rapports de force et de sens qui forment l’armature du monde sanitaire.
Nous ne voudrions pas désespérer Billancourt, ou plutôt Ségur, mais les contraintes ne sont pas que politiques, elles sont aussi institutionnelles et, bien sûr, économiques. Les cultures et les routines professionnelles des innombrables métiers de la santé sont des choses bien réelles. Ceux qui ont cru « réinventer » en chambre l’administration de la santé avec les Agences régionales de santé (ARS) en savent quelque chose ! Difficile d’échapper aux discours sur la « contrainte budgétaire » et l’impérative réduction des déficits publics… Une innovation est d’autant plus viable politiquement qu’elle permet de faire des économies budgétaires.
Bref, on l’aura compris, du modèle de la réalité à la réalité du modèle, toujours pour parler comme Pierre Bourdieu, il y a un gouffre. Faire bouger les lignes nécessite une constance et une détermination sans faille, en plus d’un sens aiguisé de la stratégie. Face à ce constat désenchanteur, en tant qu’il est réaliste, deux options se présentent logiquement. La première est… le découragement et l’abandon aux lignes de force du système de santé. La seconde, pour les plus courageux, est celle de la défection individuelle et/ou collective afin d’échapper à ce que Frédéric Lordon a nommé « l’enfer des institutions » [2]. C’est le réflexe ZAD, ou avant lui, Lip. Quand on n’arrive pas à subvertir les rapports de force pour faire triompher ses idées, on peut être tenté de se créer une sorte de niche professionnelle. Las, cette stratégie trouve vite ses limites. En premier lieu, et toujours pour suivre Frédéric Lordon, elle est le fait de « virtuoses » dont la volonté et les qualités militantes sont exceptionnelles, en tout cas certainement pas généralisables à l’ensemble des acteurs du système de santé. Les membres du Syndicat de la médecine générale en savent quelque chose ! J’ai eu la chance d’être associé à une journée de réflexion organisée par ce syndicat sur les centres de santé. Le sociologue que je suis a été captivé par des propos de jeunes médecins affirmant : « Nous, on a décidé qu’il n’y aurait pas un écart de salaire de plus de un à deux entre les médecins et les autres professionnels ». Bravo ! Mille bravos même ! Mais force est de constater que ce type d’engagement est héroïque dans une société où tout porte au contraire à creuser les inégalités de revenus. La réalité est vite revenue au galop lorsqu’a été abordée la question de la viabilité économique des centres de santé dans un contexte où domine le paiement à l’acte. Difficile, en effet, de favoriser les collectifs soignants avec un mode de rémunération individuel qui favorise l’exercice en cabinet libéral.
La seconde limite est d’ordre logique : les innovations ne peuvent persister que si elles demeurent résiduelles ou périphériques. Dès qu’elles se déploient, qu’elles se généralisent, l’État, les groupes d’intérêt et les logiques institutionnelles ne tardent pas à se manifester, sur le mode de la réaction immunitaire dans le cas des greffes. Deux options se font alors jour : la neutralisation ou la récupération. La neutralisation vise à « tuer » l’innovation en rendant les institutions encore plus infernales qu’elles ne le sont déjà. L’histoire de l’hôpital ne manque pas d’exemples, comme le triste destin des « départements » initiés par Ralite, où médecins et paramédicaux élisaient, à égalité, leurs dirigeants. Cette innovation de gauche s’est immédiatement heurtée à la dénonciation de la « soviétisation » des hôpitaux par l’élite de la médecine hospitalière. De même, toutes les alternatives à la tarification à l’activité, favorables à un financement des établissements hospitaliers selon leur plus-value dans l’amélioration de l’état de santé du bassin d’attraction, ont été tuées dans l’œuf. Pour sortir du monde sanitaire, l’expérience des Lip a été consciemment tuée par le pouvoir, car il ne fallait pas qu’elle donne de mauvaises idées aux autres [3].
La récupération est proche de la neutralisation – on neutralise en récupérant –, mais elle est un peu plus élaborée, car elle suppose de présenter un visage bienveillant sinon accueillant, alors que l’on ne vise en fait qu’à renforcer les rapports de domination. Le « nouvel esprit du capitalisme » post-1968 a ainsi récupéré, à son profit, les revendications autogestionnaires des années 1970 [4]. Entre 1970 et 1975, l’ordre capitaliste a tremblé sur ses bases, car de nombreux (jeunes) « producteurs » ont exigé de devenir souverains sur la production, tant dans les moyens (les outils et les machines) que les produits (ce que l’on veut produire, avec quel niveau de qualité). L’élévation du niveau d’éducation a donc débouché sur la mise en crise de l’ordre hiérarchique-taylorien issu de l’après-guerre. Les jeunes salariés ont de plus en plus fait preuve d’indiscipline, voire d’insubordination [5]. Le capitalisme a récupéré ces fort légitimes aspirations à l’autonomie, à l’« authenticité », à l’« épanouissement » au travail pour intensifier l’exploitation des salariés dans leur dimension subjective. Il a joué la « critique artiste » (visant l’aliénation du travail à la chaîne) contre la « critique sociale » (visant l’exploitation économique des salariés) pour désarmer les deux : les salariés ont été sommés de devenir « autonomes » et « impliqués », c’est-à-dire à aller plus loin dans leur auto-exploitation, la subjectivité du travailleur étant désormais la nouvelle frontière de l’exploitation capitaliste [6]. À la fin, les salariés se retrouvent dépouillés des mots et des catégories pour penser et dénoncer leur situation face à la langue cotonneuse du néo-management. Tel est le terrible dilemme des innovateurs : rester à la marge pour préserver leur intégrité et donc être condamnés à l’innocuité ; être ralliés, « faire tache d’huile », mais risquer de se voir expropriés par les acteurs dominants.
Force est de constater que toutes les utopies relatives au « jour d’après » dans la santé ont été cruellement déçues. Le triste spectacle de la « guerre des vaccins » contre la Covid-19 en Europe et dans le monde, après celui des batailles de chiffonniers sur les tarmacs pour les masques procure un pénible dégrisement [7]. Censés devenir des « biens publics mondiaux », les vaccins ont été les objets de contrats aux clauses léonines entre Big Pharma, pourtant gorgé d’argent public, et les États. En Europe, la crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Commission européenne tourne au vinaigre autour des livraisons de vaccin d’Astra Zeneca. La « diplomatie des vaccins » entre la Chine, les États-Unis et la Russie fait rage. L’attrition des libertés publiques s’accélère alors que les futurs plans d’austérité budgétaire sont élaborés dans les coulisses secrètes des technostructures européennes et nationales. En résumé, le jour d’après risque d’être le jour d’avant, en pire.
D’une façon générale, on sait que les « crises » favorisent une « régression vers l’habitus » [8]. Autrement dit, quand les acteurs sont confrontés à l’incertitude radicale des « conjonctures fluides », ils ont tendance non pas à remettre en cause leurs habitudes et routines et à innover, mais plutôt à favoriser celles-ci pour s’orienter dans un monde devenu mouvant. Le résultat de cette interdépendance accrue – dans la séquence Covid-19, les acteurs médicaux, administratifs, politiques, industriels ne cessent de s’interpeller et de s’accuser – et de cette régression vers les habitus est assez imprévisible. Mais si je devais quitter ma réserve de savant, je « mettrais un billet » sur le renforcement des logiques qui étaient observables avant la survenue de la pandémie, car les crises sont, pas toujours mais souvent, conservatrices, pour ne pas dire réactionnaires. Restrictions des libertés publiques et individuelles, retour de l’austérité budgétaire, centralisation et technocratisation croissantes des politiques de santé, poids excessif des intérêts des acteurs industriels sur l’État : on n’en finirait pas de prolonger les tendances…
Pour autant, faut-il conclure que tous ces exercices de pensée pendant le confinement ont été vains ? Certainement pas ! Cette crise sanitaire a été un moment d’effervescence intellectuelle et politique qui a permis de faire émerger ou cristalliser des réflexions. La limite de l’exercice est sociologique : ce sont ceux qui sont les plus favorisés, du point de vue éducatif et économique, qui ont pu se livrer à ces exercices scolastiques. Toutefois, même les « premiers de corvée » soignants ont pu expérimenter une forme d’apesanteur sociale, le poids de la technostructure ayant été considérablement allégé : se sont expérimentées à nouveau des formes de souveraineté au travail, même si c’était dans l’urgence et sous fortes contraintes. Même le « pouvoir médical » est alors devenu moins pesant. De plus, l’hôpital public et les fonctionnaires qui y travaillent ont été célébrés, à rebours du dénigrement systématique du service public de la séquence antérieure. La dignité et la fierté retrouvées peuvent être lourdes de conséquences politiques. La crise de la Covid-19 a ainsi pu aiguiser les sentiments d’injustice au travail dont toutes les études montrent qu’ils sont en hausse dans le moyen terme.
Plus généralement, puisque j’écris ces lignes dans la revue Pratiques, Les cahiers de la médecine utopique, il faut souligner que l’utopie n’est jamais vaine. Dans un beau et court livre, l’historien Thomas Bouchet souligne la portée productive de l’utopie, emplie qu’elle est d’une charge critique [9]. Elle est ce hors-cadre qui permet de mettre en évidence la contingence, l’arbitraire du cadre, celui, par exemple, des décisions routinières dans le système de santé : « et s’il pouvait en être autrement ? ». La variation imaginaire de perspective permet d’allumer la mèche, à condition d’avoir vérifié de la brancher au baril de poudre.
On connaît la leçon, devenue poncif, de Jean Jaurès : « Le courage, c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel », autre façon de retrouver la notion de praxis du vieux Marx. L’un des problèmes de la gauche de transformation réside dans la division du travail social qui voit les petits (ou grands) producteurs intellectuels s’arroger le monopole de la production des idées, pensant, comme le Général de Gaulle, que « l’intendance – militante – suivra ». Toute une partie des chercheurs et universitaires ne s’embarrassent d’ailleurs même plus de la lancinante et épineuse question des effets politiques de leurs réflexions : il y a l’univers politique d’un côté, la tour d’ivoire académique de l’autre, avec ses obsessions pour la carrière et la notoriété dans « ce petit monde » (David Lodge) qu’est l’univers académique. D’autres, souvent très radicaux, pensent que l’extrémisme de leurs idées leur conférerait une force irrésistible : c’est le syndrome de l’avant-garde. Il s’agit pour eux d’éclairer des foules en attente de grille d’intelligibilité de leur malheur. Comme l’illustrent les vives polémiques actuelles autour de « l’intersectionnalité », la profonde intrication entre réflexion de sciences sociales et militantisme va souvent de pair avec un « effet club », c’est-à-dire un entre-soi intellectualo-militant, où les outrances des uns nourrissent les surenchères des autres, quitte à susciter l’indignation et l’opposition de la plus grande partie de la société qui ne se reconnaît en aucune façon dans des propos souvent obscurs mais surtout agressifs, voire revanchards. Ces deux options – le retour dans la tour d’ivoire, la pose de l’avant-garde radicale – ne nous semblent pas à la hauteur des défis économiques, sociaux, écologiques, sanitaires actuels. Certains sociologues, tel l’Américain, Michael Burawoy, plaident pour une « sociologie publique », où les sociologues et les acteurs de terrain mettraient en synergie expériences et réflexions, qui déboucherait à la fois sur le progrès de la connaissance scientifique et le surcroît d’efficacité des mobilisations des acteurs. Soit exactement le choix éditorial de la revue Pratiques. Produire collectivement les idées lui assure leur (relatif) empuissantement, au sens où, par bouche-à-oreille, celles-ci percolent dans des cercles concentriques de plus en plus – mais pas assez – larges. En résumé, il nous faut détourner la fameuse injonction au « pragmatisme », mot devenu synonyme de concessions, voire de démissions. Le pragmatisme, selon nous, consiste dans l’effort de jouer, en s’appuyant sur les idées, sur les limites de ce que les individus pensent crédible et faisable, afin de les inciter à procéder à des micro-déplacements qui, en s’accumulant, changent progressivement l’horizon d’attente d’une bien triste époque.