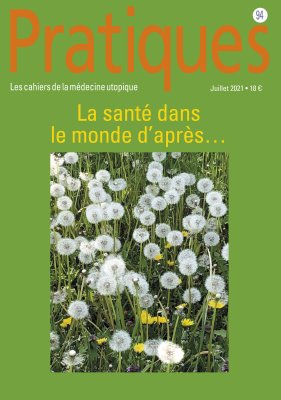Séverin Rinkel
Médecin généraliste à Arcachon
et Fethi Bretel
Psychiatre artisan à Sotteville-Lès-Rouen
On écrit beaucoup quand on est médecin. Des mots difformes et incompréhensibles en milieu de page, des phrases toutes faites et des politesses, des certificats descriptifs, des Cerfa, des noms de marques de labos avec une croix en dessous en guise de signature qui a trop vécu. Mais écrire dans le sens que connaissent les écrivains, écrire pour formuler une pensée ou un sentiment, avec la conviction de la puissance des mots ; écrire dans ce sens-là, on ne le fait jamais dans notre pratique.
À force de soigner les autres, à un rythme effréné, on finit parfois par s’oublier totalement. Et c’est bien dommage. Car tout médecin finit par se rendre compte que ce qui a eu le plus d’impact sur la souffrance de ses patients, ce ne sont pas les drogues prescrites, ni même les conseils avisés. Ce qui compte vraiment, c’est la relation de confiance qui s’établit entre le médecin et son patient. Et pour moi, Séverin, la qualité de cette relation dépend directement de l’état d’âme dans lequel se trouve le médecin, on pourrait même dire de sa capacité à compatir avec, voire aimer son prochain, bien que la connotation puisse paraître trop religieuse. Alors oui, les médecins devraient aussi prendre soin d’eux et ne pas oublier que la santé de leurs patients dépend un peu de la leur… Est-ce par pudeur qu’ils n’expriment pas leurs sentiments, par méconnaissance, ou peut-être la plupart d’entre eux ne ressent-elle plus ses affects ?
Il est temps de parler. Il est temps de traduire en mots ce que nombre de soignants ont vécu dans leur chair cette dernière année. Ces soignants que l’on bassinait depuis si longtemps à longueur de journaux télévisés, de revues de praticiens, d’éditoriaux de présidents de conseils de tous ordres, à coups de télémédecine, d’intelligence artificielle et d’efficience. L’efficience, la science de la rentabilité, le Graal du comptable, la nef sacrée du gestionnaire.
Ces soignants ont senti comme jamais l’immensité du fossé qui s’était creusé entre la réalité qu’ils allaient vivre et la « néo-médecine » qu’on leur avait concoctée, c’est-à-dire entièrement technicisée, sans visage et dépouillée. Et pourtant, le mal de vivre, les soignants le connaissent depuis longtemps. Cela fait un bail qu’on leur fait la morale en augmentant leur charge de travail tout en pointant leur manque d’organisation et de formation.
Cette « néo-médecine » est une médecine à flux tendu, une médecine ambulatoire, une médecine basée sur des preuves (scientifiques), tellement onéreuses à produire que seuls les puissants laboratoires pharmaceutiques en ont encore les moyens. Cette médecine scientiste nous est imposée par les puissances économiques, par l’intermédiaire de l’État capitaliste.
Ces pays riches qui donnent des leçons au reste du monde depuis tant d’années se trouvent pour la première fois peut-être face à un constat indiscutable et accablant : la pandémie de Covid, tout du moins dans ses débuts, a plus tué chez eux que chez les autres. Alors ils peuvent bien raconter ce qu’ils veulent, mais maintenant les rois sont nus. Ce modèle capitaliste nous dirige, nous déprime et finit par nous tuer, au sens propre. Bien que notre colère populaire soit légitime, elle se trouve bafouée par le pouvoir d’État qui la taxe de « complotisme ».
Voilà pourquoi j’ai décidé de prendre le temps d’écrire, comme une thérapie, comme un acte d’amour aussi. Dans le fond, c’est de l’amour pour mon prochain, mais dans la forme, je commence ma page comme un boxeur entre sur le ring. Pour être honnête, il a fallu qu’une rencontre arrive, ou plutôt des retrouvailles avec un vieil ami, pour que cette envie éclose.
- En effet, le secrétariat de la clinique (où j’exerce, moi Fethi, comme psychiatre salarié à temps partiel) me laisse récemment un message indiquant que « le docteur Rinkel avait tenté de me joindre », assorti de son numéro de téléphone. « Putain Séverin, ça fait un bail ! Comment m’as-tu retrouvé ? ». La dernière fois que nous nous étions parlé remonte à nos années de fac de médecine, au moment de nos choix d’orientation pour l’internat, l’année 2003.
Quelque vingt ans plus tard, je retrouve le même camarade au téléphone. Celui-ci me raconte qu’il vient d’assister à ma conférence gesticulée, publiée sur YouTube par Franck Lepage, militant de l’éducation populaire pour l’œuvre de qui nous nous découvrons une admiration commune.
C’est d’ailleurs au sein de son collectif associatif L’Ardeur que j’ai monté ma conférence gesticulée « Je ne suis pas là pour vous écouter, ou la démission de la psychiatrie face au capitalisme ». J’y retrace mon cheminement douloureux de psychiatre à contre-courant du tout-médicament, du tout-cerveau et du tout-sécuritaire et y livre l’analyse systémique que j’en ai tirée.
Or, tout comme Séverin, je pourrais dire que j’ai souffert d’avoir pratiqué la médecine avec humanité, au minimum avec déontologie, en résistant aux politiques du chiffre qui se sont imposées partout dans le monde de la santé (j’aurais pu m’arrêter après « monde »). Cette médecine est celle qui s’adresse au sujet qui souffre (sans préjuger de la cause de cette souffrance, pourtant systématiquement pensée comme organique dans notre culture médicale), qui prend soin de l’autre dans toute la complexité de sa dimension humaine (à la fois organique, psychique et socioculturelle) et, ce, de manière inconditionnelle. En matière de déontologie médicale, la référence du serment d’Hippocrate est bien connue : « Je ferai tout pour soulager les souffrances », pas pour « guérir les maladies » !
Et, tout comme lui aussi, ma pratique médicale m’a amené à penser la catégorie « santé », à partir du réel de la souffrance de nos patients, mais également de la nôtre en tant que praticiens, dans ce qu’elle recèle de politique et non de supposément scientifique. En effet, le terme est historiquement dérivé du latin « sanus » qui signifie « sain » (de corps et d’esprit). L’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle, la définit dans son acte constitutif de 1946 comme : « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Dès lors, qu’est-on si on n’est ni malade (atteint d’une maladie), ni en bonne santé ? Car le concept de « maladie » renvoie rigoureusement à une altération du fonctionnement physiologique de l’organisme, à moins de l’utiliser, comme en psychiatrie, au mieux métaphoriquement, au pire abusivement, pour catégoriser les maux humains.
La médecine, discipline empirique par excellence, s’adresse depuis toujours à des « patients », du grec « pathos », qui signifie « souffrance ». Le patient est donc avant tout un être qui souffre, pas a priori et nécessairement un être « malade ». Et c’est bien là le point essentiel : l’objet de la médecine a été détourné de la souffrance (nécessairement subjective, hétérogène, complexe, échappant à la logique scientifique) à la maladie (telle qu’elle est identifiée selon des protocoles diagnostiques et thérapeutiques codifiés, reproductibles et supposément basés sur des fondements scientifiques). Exit donc la dimension sociale et psychique des êtres souffrants et parlants. Ne cherchons surtout pas les causes de nos maux dans notre environnement social, puisqu’on vous dit que c’est dans l’organisme que ça se passe ! Même si rien de tel n’a jamais pu être prouvé au minimum dans le domaine de la psychiatrie.
Mon expérience clinique m’a enseigné que la souffrance passe toujours par le corps (qu’elle soit dite « psychique » ou « somatique », voire même « sociale »). Ce sont des sensations corporelles douloureuses ou inquiétantes qui nous alertent et n’ont le plus souvent rien à voir avec une quelconque altération organique. En revanche, quelles que soient les racines de notre souffrance, elle finit toujours par altérer notre vitalité. De là découle que l’on peut ne pas être atteint de maladie (organique), mais quand même souffrir (dans son corps donc) et perdre toute vitalité. C’est ce que l’on nomme communément l’état de dépression. Cet état qu’on voit se répandre comme une traînée de poudre dans la population générale (et plus particulièrement la jeunesse) à travers ce que la gestion politique de la crise Covid a généré comme isolement social, précarité, violence d’État, entrave à nos libertés, etc. Bref, quand le lien social est menacé à ce point-là.
Or, la « vitalité », ce n’est pas le « bien-être » promu par l’OMS, qui renvoie à la capacité d’adaptation de l’individu à son environnement, ainsi qu’à sa capacité productive. Bref, à une problématique individuelle et non collective. Or, si nous pouvons convenir que notre vitalité, donc notre santé, est ainsi mise en danger, au nom de la « sécuritaire sanitaire » (version contemporaine de la biopolitique dénoncée par Foucault en son temps), c’est bien dans notre organisation sociale qu’il va nous falloir trouver les moyens de soulager nos souffrances. La médecine n’y pourra rien toute seule. La vitalité, c’est le processus vital qui anime le corps, ce qu’Aristote a appelé « âme » du latin « anima ». Et c’est à cet endroit aussi que le terme « psyché » prend son origine. Il vient du grec « psukhê », qui signifie « âme », « esprit » (le souffle qui anime le corps). On pourrait ainsi dire que la « santé » est avant tout « psychique ». C’est la souffrance, qu’elle qu’en soit la cause, qui nuit à notre santé, en ce sens qu’elle porte atteinte à notre vitalité.
Fethi et moi étions tous deux étudiants au CHU de Kremlin Bicêtre (qu’on appelait « KB ») à Paris. À l’époque, nous étions jeunes, insouciants et rigolards. Nous étions fiers de faire partie de ce corps des médecins, l’« élite » des soignants dans le monde fermé et très hiérarchisé des grands hôpitaux parisiens. Les études de médecine toutefois, ce n’est pas la fête tous les jours. C’est à la dure, et dans une ambiance bien virile, qu’on élève les jeunes poulains. Pas question de se plaindre, on enchaîne les nuits de garde et le bachotage à la bibliothèque, les réunions (où nous nous faisions le plus souvent maltraiter) et les visites de service.
À l’époque, l’économie commençait à peine à pointer son nez dans le discours des professeurs d’université, nos références, nos idoles et nos bourreaux. Mais c’était encore peu perceptible et nous nous sentions à peine concernés par le sujet, qui nous paraissait presque incongru (la santé n’a-t-elle pas incommensurablement plus de valeur que l’argent ?).
Nous débutions naïfs et pleins d’idéaux, bien que dans la souffrance, mais avec la certitude d’avoir rencontré notre vocation initiale et la foi en un avenir prometteur, à l’abri du besoin. Puis, chacun d’entre nous a fait son chemin. Fethi est parti du côté de la psychiatrie hospitalière et moi de la médecine générale de ville. J’ai eu, rarement, des nouvelles de lui. J’ai su par des amis communs qu’il avait eu une mauvaise passe, une « dépression » m’avait-on dit. Ça m’avait touché. Je pensais souvent à lui, lui que je voyais sportif, humain et avec tant de joie de vivre ! De mon côté, j’ai traversé, comme beaucoup d’autres, des problèmes d’argent, de couple, de travail, des désillusions qui s’accumulent et finissent par vous donner la rage, puis vous faire craquer. Comment accepter une telle déconsidération de notre métier par l’État, quand on est censé faire partie de l’« élite » et exercer le « plus beau métier du monde » ?
De mon expérience de vie, je conçois désormais le burn-out comme le résultat de l’oppression croissante qu’exerce une formation socioprofessionnelle (qui se fixe pour objectif la rentabilité financière compétitive), sur un être humain (naturellement faillible). Celui-ci, figé par la peur, y obéit trop longtemps en même temps qu’il demeure sourd aux signaux d’alerte de son corps, lequel finit par lâcher. Pour moi, le « burn-out » est le point de rupture d’une colère sourde qui vous ronge insidieusement de l’intérieur. Quand on en sort, si l’on ne se trouve pas définitivement brisé, on se sent toujours aussi révolté, on a perdu le sens de l’humour souvent, mais la peur nous a quittés et il va falloir se lever tôt pour nous faire plier le genou une seconde fois.
Je reste persuadé que si nous n’étions pas passés, Fethi et moi, par cette épreuve, nous ne serions pas en train d’écrire ces lignes, et encore moins de tenter d’amener un espoir et des propositions pour nous sortir collectivement de ce qui est devenu une impasse, à savoir la liberté, voire même la possibilité d’exercer la médecine en France. Car c’est en ayant vécu cette souffrance que l’empathie a réellement pris toute son envergure dans ma pratique. Je dirais même qu’elle fonde désormais ma raison d’exercer la médecine.
Comme pour Fethi, c’est à partir de ma pratique médicale confrontée aux autorités d’État qu’est née ma rébellion. De surcroît, selon moi, deux mouvements majeurs sont venus dégrader notre pratique, et cela a pris son essor au début de nos études. D’une part, la montée en puissance des forces économiques a rapidement amené les médecins, le plus souvent complaisamment, à délivrer leurs soins en fonction de critères économiques plutôt que sanitaires. D’autre part, et parallèlement, la profession subit une déconsidération brutale dans l’opinion, que l’on peut certes juger méritée, mais qui est venue nuire aux relations de confiance entre les médecins et leurs patients dans la pratique clinique, au plus grand dam de la « santé ».
Le problème est éminemment politique, car il concerne un choix de société. On entend souvent qu’il faudrait « changer de cap ». Mais quel cap suivons-nous si ce n’est celui des intérêts d’une faible minorité de privilégiés ? Je crois qu’il faut se donner les moyens de nous en donner un collectivement, une espérance commune. Je me demande depuis longtemps jusqu’où le peuple supportera la violence de ces privilégiés. La destruction de notre corps par le pouvoir d’État semble désormais totalement admise. Nous allons tous devoir nous vacciner pour ne pas subir les restrictions liées au passeport vaccinal, quels qu’en soient les risques (y compris mortels). Les mutilations physiques subies par les Gilets Jaunes ont été assimilées par beaucoup à une réponse méritée pour ces « casseurs ». Pour ces « cassos » devrais-je dire ! Nous supportons de mieux en mieux notre état de dépression collective. Au chiffre des morts de la Covid et des lits de réanimation indisponibles s’ajouteront les chiffres insipides des suicides, des vies brisées, de tout ce qu’on veut, mais des chiffres, des mots qui n’ont plus de saveur et ne font plus sens pour personne. La falsification du langage commun par les communicants a javellisé nos esprits. Et le perfectionnement de la répression d’État a rendu nos corps meurtris et impuissants. J’ose encore croire à une issue par le vote pour nous sortir de là, à l’approche des échéances de 2022, mais ce sera probablement le dernier.
Selon moi, il faudrait imaginer une médecine qui sacraliserait le soin porté à l’autre, c’est-à-dire la relation entre le soigné et son soignant. Les progrès techniques doivent avant tout répondre à cet impératif. Cela ne peut se faire qu’à deux conditions. D’un côté, les décisions politiques sur la santé (et au-delà) devraient être libérées des griffes de la finance et de leurs lobbys, de l’autre, les soignants recouvrer leur souveraineté dans leur domaine. Depuis que nous sommes nés, Fethi et moi, le pays manque d’argent, l’enveloppe budgétaire est la limite toujours plus restreinte à toute espérance (et pour cause, c’était peu de temps avant le virage néolibéral des politiques publiques du début des années 1980). Notre Sécurité sociale ne cesse d’être démantelée. Et là, subitement, à la faveur de la crise de la Covid, nous découvrons que des sommes incommensurables peuvent être débloquées pour éviter la faillite du système libéral. On croit rêver… Ou plutôt cauchemarder !
- Si nous sommes tous deux désormais des médecins conscients des désastres produits par l’ordre néolibéral sur notre santé à tous, et qui ne céderont (plus) rien sur les exigences déontologiques du métier, nous avons aussi fait le constat amer que nombre de nos confrères y collaborent activement en reniant allègrement leur serment, quand la plupart des autres subissent en silence. Ce sont le plus souvent des médecins qui font la peau à d’autres dans les hôpitaux ! Mais tout bien considéré, est-ce si étonnant ? Les médecins n’ont-ils pas toujours appartenu à une classe sociale privilégiée (pour qui le maintien, voire l’accroissement, des privilèges est capital) ? N’ont-ils pas constamment intégré le pouvoir d’État, qui, dans notre pays, est capitaliste de (trop) longue date ? N’est-il pas cruellement ironique de comprendre que l’Ordre des médecins qui régit le droit d’exercer en France a été créé sous le régime de Vichy pour exclure les médecins juifs ou communistes ? Ou de voir notre ministre de la Santé, médecin de notre génération, mettre en œuvre sans vergogne l’achèvement de l’hôpital public quand il revendiquait des « moyens pour l’hôpital » en tant que représentant des internes lors des grèves de 2007 ?
Le capitalisme est à la fois la formation sociale qui détruit notre santé, qui nous rend malade en détériorant de manière toujours plus irrémédiable notre écosystème, et qui détourne la pratique médicale de sa déontologie fondatrice, tout en lui retirant les moyens d’exercer son art. En un mot, il détruit la vie. Car, si elle est historiquement d’abord une discipline clinique, la médecine a cherché à éclairer son art par la profusion des découvertes scientifiques, notamment à partir des Lumières. Mais l’ère de l’industrialisation au XIXe siècle a vu profondément s’ancrer le discours scientifique dans la médecine, et avec elle une conception strictement organiciste de son objet. Le néolibéralisme a achevé cette regrettable évolution en détruisant son essence clinique au profit d’une logique chiffrée, basée sur un discours scientiste servant les intérêts du capital. Il a inventé sous son règne l’Homme « robotisé », l’Homme « du XXIe siècle », et rêve désormais à l’Homme « augmenté » (qui n’est pas sans rappeler l’eugénisme d’Outre-Rhin de naguère).
Désormais, il n’y a plus de choix avec le capitalisme, comme l’écrit Hervé Kempf dans son livre Que crève le capitalisme, « ce sera lui ou nous ». Il est devenu vital d’en sortir comme le détaille Frédéric Lordon dans son livre Figures du communisme, pour qui il est devenu vain d’espérer de le faire dans le cadre des institutions du capitalisme (c’est-à-dire celui des urnes). Il les regroupe sous le terme de « démocratie bourgeoise », à savoir une société où tout peut être discuté, sauf le sacro-saint principe de propriété privée lucrative, et dans laquelle, après une parenthèse sociodémocrate désormais largement refermée, le capital dispose désormais des moyens de se passer de toute négociation avec le travail (et donc lui impose brutalement ses lois propres). Face à ce terrible constat, la santé, redéfinie comme le maintien de la vitalité des espèces vivantes dans un écosystème équilibré, n’a plus d’autre alternative que devenir révolutionnaire. Autrement, c’est incontestablement vers notre extinction que nous courrons collectivement, dont les événements climatiques extrêmes et, avec, les catastrophes industrielles à répétition, la montée des eaux par le réchauffement de la planète et l’accumulation des pandémies seront les vecteurs. Et si la « santé » aujourd’hui consistait simplement, mais radicalement, sans aucune concession à l’égard du capital, à prendre soin du vivant ? N’y aurait-il pas là de quoi fonder un renouveau de notre organisation de société tout entière, basée sur le principe primordial et inconditionnel de protection du vivant ?