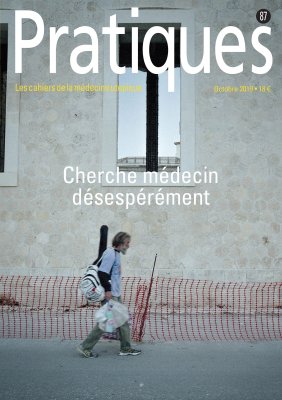Frédéric Pierru
Sociologue
Frédéric Pierru est un sociologue et politiste très engagé dans les questions de santé. Chercheur au CNRS, il considère son engagement dans l’espace public comme inhérent à sa fonction. Qu’est-ce qui le motive et le fait tenir ?
Frédéric Pierru : J’ai eu une enfance difficile, comme mes frères, d’où un certain sentiment d’injustice. Je suis né à Boulogne-sur-Mer dans une famille de classe moyenne inférieure (ou classe populaire supérieure)… Mes grands-parents sont d’origine populaire, mes arrières grands-parents encore plus, et mon père a démarré en bas de l’échelle de l’administration fiscale, fonctionnaire, donc avec le sens de l’État. Ma mère ne travaillait pas. Le manque de fric était un sujet de dispute permanent entre mes parents.
On était plutôt bons élèves, j’ai un frère jumeau qui est chercheur aussi, politiste au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)…
Boulogne-sur-Mer était une ville économiquement importante, un grand port de pêche avec un fort enracinement populaire. Je suis né au début des années soixante-dix et dans les années quatre-vingt – quatre-vingt-dix, j’ai vu cette ville péricliter économiquement du fait de sa désindustrialisation. La pêche est partie, les touristes anglais aussi et la montée de la précarité et des injustices sociales ont beaucoup compté aussi. Quand tu es issu des catégories populaires et que tu vis dans une ville qui connaît une forme de déclin, et donc des formes d’inégalités croissantes, ça te sensibilise. Moi j’allais au lycée public et comme mon père était le seul à travailler, on n’a pas pu faire une fac à Lille, donc on s’est inscrits à Amiens. Pour mon père, il fallait faire médecine ou droit… J’ai donc pris droit, mais cela ne m’emballait pas et, très vite, j’ai rencontré la sociologie. J’ai rencontré Bourdieu dès le DEUG (diplôme études universitaires générales) de droit à l’époque de La misère du monde. En fait, je me suis mis à le lire et me suis formé à la socio tout seul au lieu d’aller en cours de droit, ce qui ne m’a pas empêché d’avoir ma maîtrise de droit avec une mention très bien. C’est comme ça que j’ai bifurqué petit à petit vers la science politique. À l’époque, tu ne pouvais pas t’inscrire directement en Sciences po. Mon père ne voulait pas entendre parler des sciences sociales parce que la sociologie, pour lui, c’était le dépotoir des catégories populaires… Ma formation en sciences sociales est contemporaine du militantisme intellectuel de Bourdieu, qui reste ma référence majeure. Je fais donc deux maîtrises en même temps, en droit et en sciences politiques, j’ai les deux la même année, je fais mon service militaire et je m’inscris en DEA (diplôme d’études approfondies). Il se trouve qu’Amiens avait été une grande université de sciences politiques, mais au moment où j’y étais, c’était le déclin, tous les grands profs s’étaient barrés à Paris 1, à la Sorbonne etc. Je me suis inscrit avec Patrick Hassenteufel, qui était le seul un peu robuste. Au départ, je ne voulais pas du tout travailler sur la santé.
Je pense que c’est la rencontre d’une disposition et d’une opportunité. Hassenteufel venait d’écrire son livre Les médecins face à l’État aux presses de Sciences po et travaillait sur les politiques de santé. Moi je voulais plutôt travailler sur la délinquance juvénile, les enfants de catégories populaires face à la justice… Il m’a dit qu’il vaudrait mieux que je travaille sur la santé et il se trouve qu’il travaillait avec François-Xavier Schweyer, sociologue à L’École nationale de santé publique (ENSP), qui faisait une enquête sur l’histoire et la sociologie du corps des directeurs d’hôpital. Ils proposaient une bourse. Mon père, ne voulant pas trop financer les études, aurait préféré qu’on soit inspecteurs des impôts, le truc qui fait rêver… Moi qui l’avais vu toute ma jeunesse avec des dossiers fiscaux, c’était la dernière chose dont j’avais envie. Je crois d’ailleurs que je me suis totalement défini par rapport à ce côté anti intello. Mes parents ne lisaient pas, je ne suis pas du tout un héritier culturel, mon père lisait Picsou magazine et le Code général des impôts. Il le connaissait par cœur, c’était une star dans son domaine… J’ai un rapport au savoir émancipateur qui m’a permis de sortir de ce cercle familial là, mais c’est vraiment ma rencontre avec Bourdieu qui est importante. J’ai accepté la bourse et j’ai commencé à travailler sur un volet de l’enquête qui portait sur une formation au management des directeurs d’hôpital qui avait été mise en place à HEC et à l’ENSP. Je trouvais intéressante cette question : « Comment on transforme des fonctionnaires en managers ? » À l’époque, c’était Jean de Kervasdoué qui tentait de transformer des « traînes savates » de fonctionnaires poussiéreux, ronds de cuir, en managers modernes pour transformer l’hôpital en entreprise… C’était en 1987. Cela a été un échec parce que les directeurs étaient plutôt des gens du public, avec une formation universitaire en droit. C’est un cas d’école d’une conversion ratée. Ils disaient que cela ne correspondait pas du tout à leur demande, et c’était intéressant d’observer pourquoi ça ne prenait pas. C’était d’autant plus intéressant que quelques années plus tard, on allait reparler de l’hôpital entreprise et cette fois, la conversion managériale allait fonctionner. En quelque sorte, de Kervasdoué avait quinze, vingt ans d’avance… et il fallait attendre que la morphologie du corps se transforme, qu’ils recrutent plutôt à Sciences po Paris, côté Business School pour que cette conversion managériale s’opère. Cela avait d’ailleurs donné un premier papier académique qui avait été repris par la revue Problèmes économiques, ce qui était une sorte de consécration. C’était paru dans Politix.
J’ai eu mon DEA, puis une bourse pour ma thèse avec toutes les dispositions qui vont avec. J’ai beaucoup enseigné pendant dix ans, entre autres à l’Institut de formation des cadres de santé (IFCS) d’Amiens. C’était un public que j’aimais beaucoup. Ce qui était intéressant, c’est que ça réactivait ce que j’avais fait pendant mon DEA, c’est-à-dire comment on convertit des infirmiers et infirmières au management. Comment on en fait des cadres de santé. Certains avaient vraiment du mal à se mettre à ça, par exemple les psys et en fonction des spécialités, de l’âge, il y avait des variables sociales cachées. Chez les psys, c’était évident, elles étaient liées à la formation spécifique. Le rapport à l’institution scolaire, mais aussi au management, était très différent. J’ai mis du temps pour faire ma thèse et au bout de la quatrième année, j’en ai fait une deuxième, parce que je voulais comprendre comment s’étaient structurés les termes du débat public sur la santé au cours des quarante dernières années. Comment on était passé d’une lecture médicale du secteur à une lecture économique et, donc, plutôt une enquête sur les producteurs de ces catégories nouvelles à partir des années soixante-dix – quatre-vingt autour du thème de la conversion. Cette deuxième thèse s’est plutôt intéressée à la sociologie des récepteurs de ces catégories produites par les économistes de la santé, les gestionnaires. J’avais interrogé tous les rubricards de la presse nationale généraliste et spécialisée depuis 1956. Il y avait à la fois la genèse des deux catégories contemporaines de la santé : qu’est-ce qui fait qu’on a des routines intellectuelles et lexicales et, de l’autre côté, comment ces routines se sont élargies et ont gagné l’espace public pour parler du système de santé. Ça a donné lieu en 2007 à la publication de Hippocrate malade de ses réformes qui est la première partie de ma thèse, aux éditions du Croquant, collection Savoir/Agir fondées par Frédéric Lebaron, qui est un dauphin de Bourdieu. C’est une période particulière car ce bouquin a eu un écho important lié à la période Sarko. C’était une thèse un peu militante, une déconstruction des catégories mentales avec lesquelles on regarde aujourd’hui le système de santé ou le secteur médical. J’avais été recruté au CNRS un an avant, en 2006. Or 2007 c’est un contexte très polarisé. Sarko était très clivant, managérial, il avait un discours très agressif, néolibéral affiché, sur l’hôpital, il a lancé la révision générale des politiques publiques (RGPP), la loi hôpital santé territoire (HPST)… J’avais plutôt un profil de chercheur et je me suis retrouvé sollicité par les médias, moi le petit gars de Boulogne-sur-Mer… J’ai fait plusieurs émissions sur France culture, à Service public sur France inter. C’était une période de mobilisation, de politisation de la société française et le bouquin est devenu un objet politique et médiatique. Je ne me suis pas fait violence, même si je n’étais pas forcément à l’aise, petit à petit j’y ai pris goût. Parallèlement, je continuais mon boulot de chercheur. J’ai travaillé dans le cadre d’un travail collectif sur la loi HPST, les fusions. Je me suis découvert un talent de mobilisateur par mes propos. Quand tu commences à passer dans les médias, on te sollicite de partout. Au début, j’étais réticent, puis je me suis aperçu que ça me permettait de faire passer un certain nombre de messages politiques. Je restais encore assez académique du fait de mon activité de chercheur, mais ma visibilité publique militante n’a jamais nui à mon accès au terrain et aux hauts fonctionnaires. Je me suis intéressé à l’élaboration de la loi HPST et, en même temps, j’étais à l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) dans les services. Donc je faisais une enquête sur ceux qui élaboraient la loi HPST et, sur le terrain, j’ai vu la mobilisation hospitalo-universitaire prendre. J’avais la vue du haut, et la vue du bas et notamment toute cette mobilisation qui devait déboucher sur le mouvement de défense de l’hôpital public de Grimaldi et Granger. Je suis intervenu à une AG du Mouvement de défense de l’hôpital public (MDHP) parce que Grimaldi m’avait entendu à la radio, c’est comme ça qu’on s’est rencontrés. Cette exposition publique ne m’a pas fermé les portes des cabinets ministériels ni de la haute administration. Il n’y a qu’à Berçy où ça a frotté un peu, alors que je faisais une enquête sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et où mon interlocuteur qui l’élaborait m’avait « googlisé » et s’était montré un peu méfiant. Évidemment, mon « camp » était choisi dès le départ, je montrais patte blanche par mon travail de recherche sur ce sujet plutôt aride et, de l’autre côté, cet objet qu’était la mobilisation improbable de l’élite hospitalo-universitaire parisienne qui travaillait à l’AP-HP, qui n’a pas vraiment l’habitude de se mobiliser collectivement et surtout de faire une manifestation de rue. J’ai vu des patrons de l’AP-HP se faire expliquer comment organiser un cortège par des infirmières de la CGT, or, il y avait des patrons de droite. Donc c’était très intéressant de voir comment on construit une cause commune à partir d’un monde complètement balkanisé, traversé par des concurrences professionnelles entre professeur universitaire/praticien hospitalier et praticien hospitalier, entre médecine et chirurgie, entre médecins et paramédicaux. C’était le contexte très particulier de la Sarko RGPP. L’attelage MDHP est étonnant, entre un ex-trotskiste qui reconvertissait un savoir-faire militant et Bernard Granger qui était candidat à la présidence de la Commission médicale exécutive (CME) cette année. Il est psychiatre, il a d’abord été dans les syndicats de médecins libéraux, et on a découvert au cours du MDHP qu’il avait un des secteurs privés les plus importants de l’AP-HP. Tu avais là deux personnes qui n’étaient pas censées se parler… Dedans, il y avait des chirurgiens qui sont la frange la plus réac du corps médical et, de l’autre côté, des gens comme Lyon Caen, chef de neuro à la Pitié qui devait devenir le conseiller santé de Hollande. Moi ça m’a beaucoup intéressé ce moment-là, mais il se trouve que j’ai été un peu enrôlé dans mon objet… Peut-être que je ne demandais que ça. J’avais les dispositions militantes et critiques de la conversion managériale de l’hôpital, héritées de mes études antérieures et finalement Grimaldi m’a demandé de m’investir de plus en plus dans le MDHP, jusqu’au point de poser la question du statut du sociologue, lui-même embarqué dans son objet de recherche. Grimaldi est devenu un ami proche, Granger aussi, à l’époque il y avait aussi Tabuteau ce qui devait aboutir en 2011 au Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire dans lequel tu retrouves aussi Lyon Caen, une espèce de grand bourgeois soi-disant de gauche. Il y avait aussi François Bourdillon, qui est aujourd’hui directeur de Santé publique France, qui est la principale agence de sécurité sanitaire en France. On s’est réunis très régulièrement pendant un an dans la perspective des élections de 2012, on voulait élaborer un programme de santé clés en main. C’est important et c’est aussi la position de Pratiques, de ne pas être seulement dans la dénonciation. Bourdieu a participé à la réforme de l’école, il a fait un rapport, je trouvais important d’être sur le volet proposition qui est aussi très stimulant. On a fait un programme raisonnable et, en 2017, ce qui m’a plu chez Mélenchon, c’est la radicalité concrète. Il m’a dit, c’est bien, mais comment on y va ? Je trouve que les universitaires sont trop souvent dans le constat et quand on leur propose quelque chose de plus programmatique, ils sont secs. Le passage du constat académique à l’action politique chez eux, ne se fait pas. Mon époque, c’est quand même une période de dépolitisation et l’idée que le militantisme n’a rien à faire à l’université. Donc pour rester militant dans ce milieu-là, il faut vraiment avoir le feu… Je suis rare dans mon milieu…
- Les intellectuels se retranchent derrière la distance académique…
On me disait souvent : « Dans ta posture, cela pourrait poser un problème ». Mais je m’en suis toujours foutu, j’ai toujours gardé l’idée que les sciences sociales et la sociologie devaient permettre la réflexivité de la société. Durkheim disait : « La sociologie ne mériterait pas une heure de peine si elle ne permettait pas d’alléger les souffrances du monde » et tous les fondateurs de la sociologie du début du XXe siècle étaient engagés dans le mouvement solidariste, ils ont participé de l’avènement de la Sécurité sociale.
Et puis, pour moi, c’est tellement évident que je ne me pose même plus la question, je saisis les opportunités et cela m’a ouvert plein de terrains. Il faut dire qu’observer les élites du monde hospitalo-universitaire dans sa réalité concrète, si tu n’es pas membre du club, tu n’as pas ta carte. Cela m’a permis d’ouvrir des terrains sociologiques qui n’étaient pas envisageables. Je n’ai jamais vu d’opposition entre le travail académique et l’engagement public, à condition que l’engagement public repose sur un vrai travail empirique. Je dis ça parce qu’il y a une catégorie d’intellectuels qu’on voit beaucoup sur Médiapart par exemple, Corcuff, Fassin, qui ne font plus aucun terrain. Ce sont des journalistes intellectuels, qui ne produisent plus rien dans les revues académiques, on ne sait plus s’ils sont vraiment chercheurs. Moi, je suis au cœur du réacteur, je participe à des revues académiques centrales… Parce que le risque est de se faire absorber par le débat public, politique et petit à petit de délaisser le travail de terrain. Moi je prends plaisir dans les deux, je dirais que ces activités se fertilisent l’une l’autre. Donc cette opposition du chercheur et de l’engagement, c’est un truc que j’ai toujours trouvé assez stupide et puis si je restais uniquement dans le secteur académique, je m’ennuierais… Les colloques à sept avec toujours les mêmes gugusses spécialisés sur le sujet… Bof, moi j’ai besoin d’un bol d’air, c’est aussi mon côté anti intellectuel. Mais ça, c’est lié à mes origines populaires, je me méfie des gens qui parlotent dans les colloques…
Dans ma posture de sociologue engagé, je suis dans la continuité de mes premières amours bourdieusiennes, parce que pour moi la sociologie, c’était la rigueur empirique. En un sens, j’ai continué le truc du maître. Ma grande fierté, c’est d’avoir dirigé et publié deux numéros d’Actes de la recherche en sciences sociales qui est la revue de Bourdieu. Là je viens de publier dans la collection qu’il a créée, Raisons d’agir…
Je suis chercheur au CNRS. On est quand même un peu payés pour ça, pas seulement pour noircir du papier dans des revues académiques, ou rédiger des thèses que personne ne lira. Donc j’insiste sur ce point, il y a mon activité de chercheur et sa déclinaison sur l’engagement. Je ne peux pas cloisonner les deux, mais je fais toujours attention de rester au cœur de ma discipline.
Mon avantage, c’est qu’on est un des derniers pôles, peut-être pas pour longtemps puisqu’on parle de supprimer le CNRS et le corps des chercheurs, où on a l’autonomie pour le faire, la liberté de parole. Il n’y a plus beaucoup de pôles critiques dans la société, alors si les chercheurs publics du CNRS ne le font pas, je me demande d’où ça va partir… Les chercheurs qui s’enferment dans la tour d’ivoire académique, c’est une espèce de faute. Bien sûr, ça dépend sur quoi tu travailles, si tu travailles sur les réformes de la santé tu es quand même plus sollicité que ceux qui travaillent sur les chevaliers de l’an mille. Donc, en 2011, sort ce Manifeste, on en vend pas mal (15 000), après c’est le grand cirque de la campagne électorale, on est invités par les candidats, on s’est un peu divisé le travail.
En 2012, l’engagement, pour moi, c’était un engagement intellectuel dans l’espace public, ce n’était ni un engagement politique ni syndical. Puis, par Raison d’agir, je rencontre Mélenchon qui était sénateur et a invité la revue au sénat. Donc je rencontre le Parti de gauche et comme j’avais travaillé sur le Manifeste, je fais quelques fiches pour Mélenchon pour la campagne de 2012. Là encore, c’est le hasard et ça le refait en 2017. Mélenchon proposait d’entrer dans des choses programmatiques concrètes. J’ai essayé de faire passer le manifeste dans la campagne du Front de gauche. Entre 2012 et 2017, j’ai mené avec Grimaldi et Tabuteau une lutte contre les complémentaires santé parce qu’il y a eu l’accord national interprofessionnel (ANI) en 2013 avec la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise. C’était curieux de la part d’un gouvernement socialiste d’entériner le financement inégalitaire et inefficient en généralisant la complémentaire santé d’entreprise. En 2017 pendant tout ce combat qui devait se terminer avec La sociale, le film de Gilles Perret, l’idée était de regagner les cœurs et les têtes en faveur de la Sécu. On a sorti des articles, des tribunes en une du Parisien, des pétitions… Quand je pense à tous ces efforts… À Mélenchon, j’ai vendu l’idée du 100 % Sécu, il m’a dit : « OK, mais comment on fait ? » Avec un inspecteur général des affaires sociales (IGAS), un des rares fonctionnaires ancré à gauche, on a fait le chiffrage et cette campagne fut l’aboutissement des cinq années d’engagement en faveur de la Sécu. J’avais fait la tournée des mutuelles, la tournée des syndicats, j’en avais fait un thème de recherche. Hasard pour moi, Mélenchon était une sorte de fusée pour faire avancer ce projet. Le film La sociale sort en 2016. Fillon sort ses conneries en novembre 2016 sur la privatisation du petit risque, et Mélenchon part sur le 100 % Sécu à la même époque, alignement des astres… Tabuteau et Hirsch vont faire une tribune dans Le Monde sur le 100 % Sécu. Aujourd’hui, il y a plein de hauts fonctionnaires qui reprennent l’idée. Pierre-Louis Bras, une espèce de star de la haute fonction publique, président du Conseil d’orientation des retraites, vient de publier un article disant qu’il faut aller vers le 100 % Sécu. Tu vois, ça, c’est une de mes fiertés, quand Buzyn dit devant l’Assemblée nationale qu’il faut en finir avec l’hôpital entreprise et le tout T2A, je vois quand même une consécration de tous ceux qui l’ont critiqué, on n’était pas beaucoup… C’est au moins une victoire symbolique… parce que concrètement, on a perdu, c’est clair, mais on a quand même réussi à imposer dans le débat public un certain nombre d’idées qui ont lentement mûri, ce n’est donc pas totalement perdu.
En un sens, le fait d’avoir perdu un certain nombre de combats a peut-être préparé les formes de victoires futures. Alors il faut prendre des coups et ça demande une énorme énergie, mais l’engagement n’est pas seulement un coût, c’est aussi un temps gratifiant, une rétribution. C’est aussi parce qu’on est des déclassés par le haut qu’on garde une espèce de niaque. Ce côté marginal nous prédispose à une forme de lucidité, une disposition critique, on ne veut pas trahir le milieu d’origine et on ne veut pas totalement du milieu d’arrivée, ce qui se reconvertit dans des pulsions critiques. C’est comme ça qu’on tient, mais je ne crois pas qu’on ait le choix de s’engager ou non… Si on le posait à plat, on ne s’engagerait jamais. Je crois que sans ça, je m’emmerderais. En fait, il faut avoir un0e sorte de feu intérieur qu’on constate après coup ; donc on ne peut pas demander à tout le monde d’avoir le même engagement…
Propos recueillis par Anne Perraut Soliveres