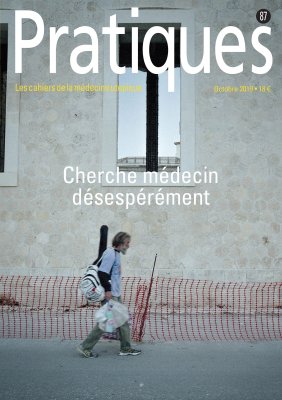Lecture critique présentée par Éric Bogaert
Psychiatre de secteur retraité
Je déclare avoir de l’intérêt pour le secteur psychiatrique mais pas pour les orientations de FondaMental.
Le contexte
Marion Leboyer est psychiatre, praticienne hospitalière professeure des universités, d’orientation neuroscientifique, responsable du pôle de psychiatrie et d’addictologie au Centre hospitalier universitaire Henri Mondor à Paris.
Pierre Michel-Llorca est psychiatre, praticien hospitalier professeur des universités, d’orientation neuroscientifique, responsable d’un service de psychiatrie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Sur la couverture du livre sont mentionnés la fondation FondaMental, dont ces deux psychiatres sont membres du comité de direction, directrice et responsable de la recherche pour la première, conseiller et coordinateur du réseau des centres experts schizophrénie de la fondation pour le second, et l’institut Montaigne, think tank présenté comme l’un des mécènes et partenaires de la fondation.
Outre ses partenaires fondateurs (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, Commissariat à l’énergie atomique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et trois universités parisiennes) et d’autres CHU et universités, figurent également parmi les partenaires de FondaMental une entreprise « leader du conseil en ingénierie et services R&D » (recherche et développement), un réseau de cliniques psychiatriques à but lucratif, un site « leader sur l’univers de la santé et l’univers féminin » ; une « holding » financière appartenant à une famille, un grand groupe industriel d’un avionneur (par ailleurs engagé dans la presse, l’informatique, l’immobilier, le vin de Bordeaux, la vente aux enchères d’œuvres d’art, la gestion de l’eau, des déchets de l’énergie, et dont le fondateur et son fils ont eu également une carrière politique), neuf des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde, et une kyrielle d’autres fondations et associations œuvrant dans le domaine de l’aide sociale ou le soutien à des personnes malades. C’est en quelque sorte un PPP (Partenariat public-privé), qui s’est donné quatre missions : le soin (« les centres experts FondaMental, étroitement associés à des projets de recherche d’envergure, ont pour ambition de promouvoir une médecine spécialisée en psychiatrie »), la recherche (« pour prendre de vitesse les maladies mentales et favoriser les grandes découvertes »), la formation(« pour que la révolution scientifique en marche – sic – améliore concrètement le quotidien des personnes atteintes de maladies mentales et de leurs proches »), et l’information (« briser les préjugés et alerter les décideurs »). Son financement provient pour 15 % de subventions et autres ressources publiques, 11 % de dons manuels et legs, 6 % d’autres produits divers et 68 % d’autres fonds privés.
L’institut Montaigne a été créé par Claude Bébéar, qui a dirigé Axa, premier groupe d’assurance français. Il a été à la manœuvre pour substituer les assurances privées à l’Assurance maladie. Il est président d’honneur d’Axa depuis 2008 et de l’institut Montaigne depuis 2015. Il a soutenu Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle de 2017.
FondaMental promeut une psychiatrie fondée sur les neurosciences.
L’institut Montaigne est d’orientation libérale.
Ce livre, écrit par deux psychiatres, est paru en septembre 2018, dans le même temps que le petit peuple des hôpitaux psychiatriques s’agitait, à faire la grève de la faim ou à se percher sur un toit d’hôpital, pour alerter sur l’asphyxie qui gagne en ces lieux. Dans un état d’urgence, donc, mais pas nécessairement à lire ce livre, et en tout cas indépendamment de celui-ci, qui ne fait que « récupérer » le travail militant des acteurs de terrain.
Sommaire
Avant même de commencer la lecture, le sommaire donne quelques indications.
L’entrée en matière est précautionneuse : un avant-propos de Nicolas Baverez qui au fond dit tout – de ce que les auteurs n’osent pas dire tout de go et que le livre va suggérer –, une introduction pour justifier ce livre par la souffrance que vit la psychiatrie contemporaine et préciser le combat qui anime les auteurs pour y proposer des remèdes par ce livre, puis un préambule qui pose l’actualité des maladies mentales et la diversité des abords de leurs soins.
Chapitre après chapitre, leur propos se déroule comme suit, en reprenant les mots mêmes des auteurs (repris en italique et entre guillemets).
Le sujet est abordé par un débat sur psychiatrie et santé mentale, qui passe par l’histoire de la psychiatrie puis sa contestation par l’antipsychiatrie. Et se poursuit par la description du dispositif, le secteur psychiatrique, « dédale » de structures empilées entre lesquelles les patients se perdent d’autant plus que les moyens limités ne permettent pas d’y assurer des délais d’admission réactifs, des conditions de séjour correctes ni des durées de soin suffisantes.
Les patients, justement, se plaignent de stigmatisation et de discrimination (deux mots pour désigner les deux revers de la même médaille), les « maux de la psychiatrie », du fait de représentations sociales « assassines » (le mot est là bien choisi) de la maladie mentale.
Retard au diagnostic, perte de chance pour les malades, voilà un enjeu des politiques publiques de santé.
Une fois le diagnostic posé trop tardivement, la prise en charge médicale (sans qu’on sache très bien s’il s’agit des soins psychiatriques ou somatiques – « quand la tête est coupée du corps » – ; probablement les deux) est de très mauvaise qualité, rendant compte d’une perte importante de qualité et de durée de vie des malades mentaux comparativement à la population générale. Le suicide est un symptôme de cette crise de la psychiatrie, mais « Laissons, nous médecins, les discussions philosophiques aux philosophes » (citation de « D. Castelnau »), il faut prévenir, et pour ce faire déstigmatiser et soutenir. Et « former, former, former... ».
L’attention est à porter surtout à ces populations fragiles : enfants, adolescents (besoins immenses, réponses insuffisantes, un accompagnement à poursuivre de la naissance à l’âge adulte, pour repérer facteurs de risque et signes d’alerte, prévenir), mais aussi personnes âgées, personnes en situation de précarité, détenus, et migrants.
Il est une spécificité délicate et complexe de la psychiatrie, c’est l’hospitalisation sous contrainte qui se heurte à la liberté individuelle, dans un difficile équilibre entre soins et sécurité. La constante augmentation de ces soins pose la question de l’amélioration de la prise en compte des droits des malades, et de la place des proches.
Sous la question « vous trouvez que nos vies coûtent trop cher ? » (qui n’est pas sans évoquer, ironie, un slogan de gauche, « l’humain d’abord », mais aussi, il est vrai, un autre, publicitaire, « parce que je le vaux bien ») est abordé le versant économique. La psychiatrie coûte 109 milliards d’euros par an : les maladies psychiatriques coûtent plus cher que le cancer ou les maladies cardio-vasculaires. De ce point de vue, la variable la plus accessible pour réduire ces coûts est le mode de tarification ; divers pays innovent pour plus de qualité et de coopération entre les acteurs du soin. Mais qui paie quoi ? il faut aussi examiner les réformes possibles du système social de prise en charge des dépenses sociales et sanitaires.
Comment font les autres ? Les Anglais responsabilisent les patients. Les Danois impliquent les municipalités. Les Australiens dotent les jeunes d’applications pour leurs smartphones. Les Suisses détectent les patients pour les traiter le plus tôt possible. Les Canadiens comptent sur le financement par leurs entreprises d’actions de mécénat pour lutter contre la stigmatisation par des campagnes de sensibilisation, améliorer la détection des maladies mentales et leur prévention par des services de soutien et d’assistance 24/24 et 7/7 dans le milieu professionnel, le financement d’organisations et établissements sanitaires, et de la recherche.
Cependant tout progrès ne proviendra que de la recherche. « L’enjeu des prochaines années est de permettre une recherche de précision prenant en compte l’ensemble des facteurs génétiques et environnementaux et s’appuyant sur l’usage des techniques de pointe et des nouvelles technologies ». Les trois obstacles essentiels au développement de la recherche en psychiatrie en France sont une faiblesse de l’épidémiologie, le sous-financement de la recherche académique, et une perte de vitesse des essais cliniques.
Dans cette « urgence d’agir pour 12 millions de Français », les auteurs présentent 25 propositions, en indiquant leur « source d’inspiration et d’espoir : la cancérologie ». Et cerise sur le gâteau, alors qu’il présidait le G7 en 2018, Justin Trudeau a « mis en avant » la santé mentale, que « pourrait appuyer » Emmanuel Macron qui présidera le G7 en 2019, en lançant une Global Initiative to Transform Mental Health (Initiative globale pour transformer la santé mentale) – je n’ai pas le sentiment qu’il en ait été question à Biarritz – !
Suivent les 25 propositions, qui s’articulent autour d’informer et déstigmatiser, améliorer le dépistage précoce, assurer des soins de qualité centrés sur les besoins des patients, promouvoir le rétablissement en pensant le parcours de vie, accompagner la transformation à l’œuvre grâce à la formation, et soutenir les espoirs de la recherche.
L’épilogue propose qu’à partir de cet état des lieux « la psychiatrie publique devenue un enfer » (citation de Daniel Zagury), se transforme de telle sorte qu’elle permette que le patient « pas encore guéri », soit « rétabli et maître de (son) destin ». Si cet objectif est consensuel, on peut avoir d’autres orientations sur les moyens d’y parvenir.
Les propositions
Elles sont pour certaines banales, relevant du bon sens, et d’ailleurs déjà en place ne nécessitant que d’être réellement prises au sérieux : « mener des campagnes d’information grand public pour changer le regard de l’opinion publique et lutter contre la stigmatisation » ; « mobiliser le dispositif national existant des " maisons des adolescents " pour organiser un repérage et une orientation précoces » ; « multiplier les équipes mobiles pour diminuer le recours à l’hospitalisation » ; « répondre aux besoins et aux attentes des familles, et leur donner une place dans le dispositif de prise en charge » ; « développer la formation aux psychothérapies » ; « accompagner le développement de la formation des usagers et des pairs-aidants en santé mentale » ; « développer une politique de recherche orientée par programmes et favorisant les partenariats entre recherche publique et privée ».
D’autres sont décevantes parce qu’elles sont déjà en place et n’ont pas fait leurs preuves, ou paraissent creuses et d’avance sans effet : « développer à l’attention des médecins généralistes des outils d’aide au repérage précoce » ; « faciliter l’accès aux soins en déployant et remboursant les thérapies adaptées » ; « mesurer la qualité des soins grâce à l’évaluation faite par les patients » ; « créer des filières de formation pour les case managers en santé mentale ».
Quelques-unes relèvent de vœux pieux ou d’une langue de bois : « développer l’accompagnement social et médico-social en repensant les dispositifs existants » ; « favoriser la création et le déploiement de case managers en psychiatrie pour améliorer la coordination des parcours sanitaire, médico-social et social des personnes atteintes de troubles psychiatriques » ; « accompagner et encourager les filières de formation du social et du médico-social spécialisées pour l’accompagnement des personnes en souffrance psychique ».
Certaines sont essentiellement financières : « agir sur le mode de financement pour accélérer la diffusion des pratiques innovantes en psychiatrie » ; « créer les conditions et incitations pour attirer des partenaires industriels ».
D’autres enfin sont anciennes et ne sont que des corrections d’erreurs politiques du passé : « allonger la durée de l’internat en psychiatrie à cinq ans et développer les spécialisations » ; « développer la surspécialisation d’infirmiers cliniciens spécialisés » — c’est-à-dire revenir sur la suppression de l’internat en psychiatrie et des infirmiers de secteur psychiatrique.
Ou relèvent d’un avant-gardisme de façade : « construire un portail web national interactif et accessible à tous » ; « développer et évaluer des dispositifs de e-santé pour donner un accès plus large aux thérapies psychosociales ».
En fait, elles sont souvent toutes un peu de tout ça à la fois.
Il en est quelques-unes d’intéressantes : « faire des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) et des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) une nouvelle porte d’entrée vers une prise en charge de proximité, globale et non stigmatisante des troubles psychiatriques » ; « assurer une prise en charge globale psychiatrique et somatique des patients par la mise en place de réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) » — mais elles ne sont pas très originales pour être défendues par certains professionnels et syndicats de professionnels, et auxquelles on pourrait ajouter l’application de mesures législatives existantes mais gênantes pour certains comme par exemple la mise en place de Conseils de santé mentale et leur reconnaissance effective et sans entraves.
Enfin, certaines semblent des pièces d’un puzzle éparpillées pour mieux cacher l’objet fini, redoutable : « mettre en place un opérateur pour définir et piloter une vision stratégique de la psychiatrie et de la santé mentale » ; « proposer un niveau de recours spécialisé, multidisciplinaire et personnalisé » ; « faciliter l’accès à des services et infrastructures d’excellence : cohortes, base de données, biobanques, plateformes technologiques » – qu’elles semblent profiler, ainsi que nous allons le voir.
Quelques commentaires, en reprenant les propos éparpillés dans les divers chapitres au gré du cheminement de pensée des auteurs, pour les commenter dans une organisation par mots-clés.
Il est indifféremment question de maladies mentales et de troubles mentaux. Ceux-ci seraient occultés et les personnes qui en souffrent en seraient stigmatisées parce qu’ils suscitent la peur. Sans doute, mais une autre hypothèse n’est pas envisagée. Et si ces troubles, assimilables à des variations de la « normalité » et de ce fait susceptibles d’être plus ou moins perçus en fonction de l’acceptation sociale de la misère et de la souffrance d’autrui (cf. les marginaux, les SDF, les précaires, dans les rues et la scène sociale), n’étaient pas occultés ou marginalisés mais banalisés, ou, pire, refoulés (pour éviter d’investir la disponibilité et les moyens adéquats à les traiter, et peut-être aussi de s’interroger sur l’humanité, la folie – celle d’autrui et la sienne –, et leurs rapports) ! De la même façon, l’« offre de soins médicaux » serait souvent disqualifiée, négligeant que tous les secteurs de l’offre sociale sont défaillants ; il faudrait probablement davantage parler de la considération portée à ces personnes par chacun et tous. Mais d’accord, considérons là l’offre de soins... à condition de considérer qu’elle-même n’est qu’un volet de la vie sociale, et dépendante ce celle-ci.
Un passage est exemplaire de l’ambiguïté des auteurs à ce sujet, bien en peine de poser une frontière entre maladie neuropsychiatrique et variations normales des émotions : « La proximité apparente des symptômes de la dépression avec des émotions dont nous faisons tous l’expérience au cours de notre vie (tristesse, découragement, désespoir) favorise la confusion entre dépression et " déprime " ou " coup de blues ". Dans un grand nombre de cas, la variation de ces émotions est normale et ne constitue pas un handicap au quotidien. La dépression, à la différence de ces émotions temporaires, est une maladie comme une autre et non le reflet d’une faiblesse de caractère. Elle peut durer quelques semaines, souvent plusieurs mois, parfois plusieurs années. Elle nécessite une prise en charge médicale et sa guérison n’est en rien une affaire de volonté ». Il y aurait donc des émotions normales, la déprime, et une maladie, la dépression. Et ces deux phénomènes n’auraient une proximité qu’apparente, alors qu’il s’agit des mêmes manifestations qui ne différeraient que par leur intensité et leur durée. La maladie comme excès de variations de la normalité, mais qu’est-ce que ce saut de l’une à l’autre ? Pourquoi en faire une maladie ? Ce serait donc une pathologie des émotions ? Les émotions sont-elles essentiellement, ou seulement, neurophysiologiques ?
En tout cas, ce serait « l’orientation neurologique de la psychiatrie qui tend à faire de la maladie mentale une maladie comme les autres, une maladie qui guérit ». Mais est-il nécessaire qu’il y ait une orientation neurologique pour tendre à faire de la maladie mentale une maladie comme une autre ? Ou une maladie qui peut guérir ?
Les auteurs concèdent brièvement que « la santé mentale... vise la promotion du bien-être psychique d’un individu. » Mais pour compléter aussitôt : « ce très vaste cadre conceptuel présente l’inconvénient de " dissoudre les troubles mentaux dans un problème beaucoup plus large, celui du mal-être, qui ne relève pas de la médecine mais d’une approche sociale " », reprenant les mots du sénateur A. Milon [1]. Il ne fallait pas rêver, il s’agissait là du bien-être, et de ses troubles psychiques qui ne relèvent que d’une approche sociale.
« Vivre avec un trouble psychiatrique, c’est à la fois en subir les symptômes et endurer les peurs et les préjugés associés à ce trouble au sein de la société », est-il aussi concédé. Et devoir, le mot n’est souvent pas trop fort en psychiatrie, en subir les multiples effets secondaires dans divers champs, du traitement, faudrait-il ajouter.
Une expérience sociale d’un « espace de sociabilité non stigmatisant orienté vers le retour à l’emploi... où les membres ne sont pas considérés comme des patients » est citée en exemple. Mais est-ce possible, et intéressant, de laisser (refouler, dénier) la maladie, de la laisser au vestiaire, ou ne faut-il pas malgré tout la considérer pour lui laisser une place, qu’elle prendra de toute façon, dans la vie sociale du patient. Lui permettre d’être, citoyen, malgré et avec la maladie.
« Force est de constater les limites de nos connaissances médicales » reconnaissent les auteurs. Certainement. Mais aussi, et ceci explique partiellement cela, la difficulté d’affirmer un diagnostic précis dans ces pathologies complexes portant sur des champs subjectifs de l’activité humaine (pensée et comportements). D’autant que ces diagnostics ne sont pas ensuite anodins pour le reste de la vie – et dans tous ses registres – de ces patients. Pour le dire dans le langage médical.
Dans leur épilogue, les auteurs mettent en exergue cet « éclairage puissant » d’un « survivant de la psychiatrie » : « dans le processus de rétablissement, il est essentiel de constituer sa personnalité indépendamment de la maladie mentale, parce qu’à partir du moment où vous ne faites plus qu’un avec la maladie, il n’y a plus personne à l’intérieur pour faire le travail de guérison ». Ah ça, cet « éclairage puissant » est certainement un point très important de clivage entre ces deux positions qui s’excluent – et ne se compromettent pas –, la maladie mentale est une maladie comme une autre, neuro-pathologique, étrangère au patient, et la folie est un trouble psychique, psychopathologique, visage derrière le tain de la psyché de chacun. Cette position neuro-pathologique suppose et introduit un hiatus, un clivage entre la personne et la maladie. C’est sûrement un point « fondamental » sur lequel s’appuie la discorde entre ces deux psychiatries, dont découlent nombre de conséquences.
Pour valider la possibilité de rémission en psychiatrie, ils citent Henri Ey : « Il n’est pas vrai que la schizophrénie soit installée fatalement dans l’’individu ni comme une loi génotypique de son destin, ni comme un virus inexpugnable, ni comme une lésion irréversible ; elle est bien plutôt une " forme de réaction " qui dans chaque individu met en jeu toutes les forces et les faiblesses de son être psychique [...] s’il arrive que le processus s’arrête ou que le malade en triomphe, on parle de " rémissions " ». Voilà qui semble obtenir l’agrément des auteurs, et qui est pourtant en contradiction avec la maladie étrangère à la personne, que promeuvent des auteurs.
Le cerveau, « nouvelle frontière de la médecine » ! Intéressant, de faire du cerveau une frontière ; les Pyrénées entre vérité et mensonge, ou psychisme et corps ? En tout cas, ce ne serait qu’une frontière. Ou, puisque ce n’est pas une simple ligne, un no man’s land ? Mais alors, où est l’homme, l’être qui choisit les mots et les actes par lesquels il s’exprime ? [2]
Cette propension à situer la psychiatrie dans la médecine les amène à regretter l’absence de « marqueurs de validité des diagnostics » et de « marqueurs de prédiction de la réponse thérapeutique ». Louable désir, mais Il faudrait avoir une discussion sur ce que signifierait une « validité » d’un diagnostic psychiatrique, et une « prédiction » de la réponse thérapeutique ? D’ailleurs, qu’en est-il en médecine somatique de ces assurances ? Il faudrait aussi discuter de cette histoire de marqueur. Qu’indique un marqueur, une « vérité », ou une particularité qui arrête l’attention d’un observateur au regard orienté par ses a priori ?
C’est probablement de ce même mouvement que les auteurs aspirent à ce que « deux professionnels de santé portent le même diagnostic devant un tableau clinique donné ». C’est comme pour les « bonnes pratiques », c’est comment faire en sorte que deux professionnels proposent le même traitement devant un tableau clinique. Tous pareils devant l’adversité ! Mais sommes-nous tous pareils devant la prospérité ? Et d’ailleurs, sommes-nous tous pareils ? Et pour un même diagnostic, deux chirurgiens ne posent pas la même indication opératoire, ni lorsqu’ils la posent malgré tout ne proposent la même voie d’abord, au même malade. Et en psychiatrie, ça se complique dès lors qu’il s’agit de pathologie des émotions, des pensées, des différences de culture et de mœurs sociales dans l’appréciation des troubles et de leur convivialité.
« Le lien entre dysfonctionnement du système sérotoninergique 43 et vulnérabilité suicidaire a été établi ». Lien de cause à effet, ou d’effet à cause ?
Par ailleurs il est rappelé que le « diagnostic s’appuie à la fois sur un bilan biologique et neurologique », notamment pour les enfants et les adolescents. Certes, il tient compte « également de l’environnement dans lequel l’enfant évolue et de son développement », mais aucune mention d’une quelconque dimension psychique, éventuellement recélée dans la notion d’environnement.
Du côté de la génétique, il est question de « gênes de vulnérabilité à l’autisme », et à la schizophrénie, qui ont permis à des équipes, disposant – elles, (sous-)entend-on, en guise de mise en condition pour le bouquet final – de « cohortes de patients de taille suffisante pour bénéficier de la puissance statistique nécessaire », de « confirmer le terrain génétique à l’œuvre dans ces pathologies... et la grande hétérogénéité et l’impact de facteurs génétiques communs à plusieurs entités cliniques ». Mais quel terrain ne serait pas génétique chez les organismes vivants ? Ces données scientifiques progressent, « les troubles mentaux sont aujourd’hui principalement vus comme étant dus à l’interaction de facteurs de vulnérabilité génétique et de facteurs de risque environnementaux » ; c’est-à-dire à l’interaction du réel biologique, le corps du sujet, et de celui du milieu dans lequel il baigne, la culture. Les recherches sur les « liens entre des dérèglements du système immunitaire et des troubles psychiatriques » semblent prometteuses ; défenses biologiques, qui répondent à leur sublimation, les défenses psychiques ? Et dans le registre thérapeutique, « la stimulation cérébrale profonde... technique neurochirurgicale appliquée avec succès dans le traitement de formes sévères de maladies du mouvement, telle que la maladie de Parkinson, a démontré son efficacité auprès de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sévères et résistants » ; amusant, voire intéressant, l’efficacité de cette thérapeutique sur des phénomènes somme toute assez semblables du champ somatique et du champ psychique : raideur (posturale/psychologique), démarche à petits pas et tremblement fin (des extrémités/de l’engagement).
Le secteur psychiatrique est présenté comme un fossile d’un glorieux passé. Il lui est même reproché d’avoir participé à la stigmatisation, par son échec, notamment à assumer la folie dans la Cité. Mais cela tient-il au secteur, ou aux particularités de la pathologie, interrogeant humanité et société, que la préoccupation de la soigner dans la Cité a imposé de la côtoyer aux citoyens qui ne pouvaient plus la refouler dans les asiles. Le travail d’implantation et de développement des secteurs, dépendant dans sa forme, ses modalités, et sa temporalité, des hommes qui le mènent (menaient ?, tant ce terme a disparu des textes législatifs et des organisations qu’ils ordonnent), n’a pas eu le temps nécessaire à l’aboutissement de sa mise en place, laquelle est d’ailleurs infinie car tributaire des évolutions sociales et éthiques. Cet « échec » n’est pas inhérent à la « philosophie » ni à la « politique » du secteur psychiatrique, mais à la manière dont elle est menée.
Il lui est même reproché d’avoir « ignoré... les troubles du spectre de l’autisme ». Spectre de l’autisme, concept très récent. L’autisme n’a pas été ignoré, mais appréhendé avec les moyens, conceptuels, humains, et matériels, disponibles. Et s’est là cristallisée la conflictualité, poussée à son acmé par la brutalité et l’insensé de cette pathologie, inhérente au processus de civilisation (cf. la fête de l’ours dans le Vallespir).
Il lui est aussi reproché une inégalité de l’accès aux soins dans le territoire, ce qui ne manque pas de sel venant de libéraux tant la question de l’inégalité de l’accession à nombre de services publics ou privés sur le territoire se pose de plus en plus du fait des coups de boutoir portés au nom de l’idéologie néolibérale, au point que ce principe d’égalité républicaine n’a plus ni cours ni valeur de principe. Au point que le secteur psychiatrique n’entraînerait plus que de la nostalgie ! C’est plutôt, sauf bien entendu pour ceux qui critiquent cette praxis, une insatisfaction de ne plus avoir les moyens, humains organisationnels et politiques, de le faire vivre. Il serait à bout de souffle ! C’est plutôt un outil sacrifié à l’autel du management et de la rentabilité.
La politique de secteur devait coupler une réduction des lits avec une ouverture de soins ambulatoires dans la Cité. Mais malgré une réduction de 88 000 lits entre 1970 et 1990 – soit de 42 %, et plus significatif une baisse du nombre de lits pour 1 000 habitants de 51 % avec simultanément une baisse de 77 % de la durée de séjour –, puis de 65 000 lits entre 1990 et 2011 – soit 54 %, et plus significatif une baisse du nombre de lits pour 1 000 habitants de 57,5 % –, et donc une baisse du nombre de lits de 73 % de 1970 à 2011 – et plus significatif une baisse du nombre de lits pour 1 000 habitants de 79 % – tandis que dans le même temps la population a augmenté d’un peu moins de 28 % (en France métropolitaine), les auteurs regrettent l’absence de fermeture d’établissement, pour se plaindre un peu plus loin du manque de possibilités d’hospitalisation, et du nombre de patients à la rue ou en prison, en regrettant le manque d’alternatives à l’hospitalisation.

Ainsi, « innovante lors de sa mise en place, la politique de secteur n’a pas atteint l’ensemble de ses ambitieux objectifs de départ ». Est-ce surprenant ou inhabituel ? Surtout si les objectifs étaient ambitieux. Pour quelles raisons ? Qui tiennent à la politique elle-même, ou à la conjoncture ? Et si les objectifs ne sont pas atteints, il faut en analyser les raisons et les dépasser. Le manque de moyens attribués par les pouvoirs publics en compensation des fermetures est à peine évoqué, tandis que le travail accompli par les professionnels de santé pour mettre en place le secteur est quasiment qualifié d’incurie. Mais les moyens, peu attribués, ont essentiellement été pensés et sont évoqués là en termes budgétaires, certes nécessaires, mais pas en termes de liberté de création et d’innovation organisationnelles et structurelles, bridées par des normes réglementaires purement comptables et administratives. Et d’autre part, les évaluations, essentiellement comptables elles aussi, n’ont absolument pas donné le temps à de tels changements de fond et de mentalité d’évoluer à leur rythme selon chaque territoire ou équipe, d’autant que les objectifs posés par les décideurs, susceptibles de dynamiser l’orientation, n’étaient pas fondés sur des critères de soin mais de gestion. D’ailleurs, les auteurs le concèdent : « c’est moins la conception clinique que l’évolution administrative du secteur et son adaptation à l’évolution de son environnement qui posent problème », pour poursuivre dans la foulée : « Le défaut de cette politique, pour reprendre les termes d’Édouard Couty, c’est peut-être sa trop grande ambition : confier à une structure sanitaire, dont le savoir-faire est centré sur le soin, la responsabilité globale de réponses qui relèvent de compétences de différentes collectivités, acteurs du milieu social et économique ». Et de sembler espérer qu’avec les projets territoriaux de santé mentale, ça s’améliorerait. Mais pas sûr qu’ils répondront davantage dans le respect de leur mission première, la santé et le soin, ni qu’ils sauront mieux gérer une telle ambition. Les centres de crise, structures parmi les plus innovantes et les plus intéressantes pour renforcer les soins ambulatoires et freiner les hospitalisations, ont quasiment tous été fermés pour des raisons gestionnaires.
De nombreuses approximations, voire erreurs, entachent toutefois la fiabilité des propos des auteurs. « Historiquement, les contradictions du secteur sont logées dans sa définition même : le découpage administratif du secteur se fondait sur le nombre de lits d’hospitalisation » ; non il se fondait sur un découpage géo-démographique fonction du nombre d’habitants, 66 666 étant la jauge. Certes, ce chiffre avait été calculé entre autres sur la base d’un travail de psychiatres proposant un nombre idéal de lits pour un service de psychiatrie, mais le lit n’était pas le but en soi, il s’agissait de déterminer une taille fonctionnelle pour permettre un fonctionnement optimum du secteur, et à l’époque, le lit était la seule référence pour déterminer la taille de l’outil sanitaire public. « Et le budget du secteur était calculé sur le coût d’une journée d’hospitalisation, ce qui, fondamentalement, n’incitait pas à développer la prise en charge hors de l’hôpital. L’hospitalisation restait (et reste toujours) au cœur de ce système de pensée ». Non, ça, c’était pour le budget de l’hôpital de rattachement qui assumait l’hospitalisation, le travail de secteur était financé par les Directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS), jusqu’à ce que le budget du secteur soit totalement confié à l’hôpital, qui en a fait un usage « hospitalier », c’est-à-dire selon les règles comptables et administratives, et les traditions de pensée et de gestion de ces établissements [3]. On pourrait dire, paraphrasant les auteurs (et Édouard Couty), que le défaut de cette politique, c’est peut-être sa trop grande ambition : confier à une structure administrative, dont le savoir-faire est centré sur la gestion de lits, la responsabilité globale de réponses qui relèvent de compétences de différentes collectivités, acteurs du milieu sanitaire et social.
À ces approximations s’ajoutent quelques indications d’une méconnaissance de la pratique de secteur, lorsqu’est évoqué l’allongement des délais pour obtenir un premier rendez-vous qui serait conséquence de l’hétérogénéité de l’offre de soins et de la démographie médicale, avec le renfort de la Haute autorité de santé (HAS) dans son évocation d’un fonctionnement inadapté des Centre médico-psychologique (CMP). Mais ces structures ne sont pas exclusivement destinées au dépistage des maladies mentales, elles sont aussi le « pivot » du secteur, lieu des soins ambulatoires. Leur engorgement ne résulte-t-il pas d’un effet entonnoir, accumulation de multiples parcours de soins de maladies chroniques ? Plus que l’hétérogénéité de l’offre de soins, la dimension chronique des maladies mentales, pourtant soulignée dès le début de leur ouvrage par les auteurs, en est probablement la principale raison : tout patient qui intègre la file active d’un secteur de psychiatrie y émargera plusieurs décennies. Et bien sûr, la démographie médicale, dont l’évolution n’a pas intégré ce fait, y est pour quelque chose, de même que d’autres variables telles que les modalités d’organisation du secteur psychiatrique, l’articulation des unités qui le constituent, la circulation des patients et des soignants entre ces unités, les rôles attribués à chaque personnel, du psychiatre à la secrétaire en passant par les psychologues et infirmières, et les outils de coordination de leur travail accordés à ces personnels...
Écrire comme ils le font : « l’éloignement fréquent entre établissements ou services dit de MCO (médecine chirurgie obstétrique) et les soins psychiatriques » indique que les auteurs de ce livre ne pratiquent pas dans les hôpitaux généraux et les services de soin ordinaire du terrain. D’abord, il y a une vraie proximité géographique et fonctionnelle entre services de psychiatrie et somatiques dans les centres hospitaliers généraux, ensuite les services d’hospitalisation psychiatriques des centres hospitaliers psychiatriques disposent de médecins généralistes sur place qui assurent les soins somatiques, en lien avec les hôpitaux généraux de proximité. Par contre, il y a effectivement une grande distance entre soma et psyché, mais elle est culturelle, et relève davantage des mêmes raisons que la stigmatisation des malades mentaux.
Ils proposent de démultiplier les équipes mobiles, car « le déploiement d’équipes mobiles est une demande récurrente des associations de patients ainsi qu’une recommandation mise en avant par divers rapports ». Mais elles existent. D’abord c’est le travail de la plupart des CMP, qui vont bien au-delà de la seule proposition de consultations psychiatriques pour proposer des soins et même interventions à domicile. Enfin, ça se faisait, dans les secteurs psychiatriques orientée par la psychothérapie institutionnelle (PI), au moins tant que les secteurs de psychiatrie étaient les unités d’organisation de base de la psychiatrie publique, et jusqu’à ce que la PI ne devienne diabolique, et que les hôpitaux ne tombent sous la tutelle exclusive du « directeur et un seul directeur ». Ensuite, certains secteurs ont, hélas parce que découplant ainsi ce travail des CMP, créé des équipes mobiles cantonnées aux interventions à domicile, fractionnant, fragmentant, ainsi un peu plus parcours et relation de soin.
Dans le même registre, frôlant l’irresponsabilité et la gabegie, ils proposent de « développer une consultation " familles sans le patient " destinée aux proches au sein de tous les services d’urgence psychiatrique... dispositif (qui) nécessite d’associer aux urgences une équipe mobile d’intervention spécifiquement formée pour gérer ce type de situation au domicile du patient ». Ce n’est pas nécessaire. D’abord les équipes psychiatriques aux urgences font très certainement ce travail, à la demande, si elles sont assez fournies, ensuite on peut associer équipe psychiatrique des urgences et CMP afin de s’articuler également pour et avec ce travail, ou mieux encore que l’équipe psychiatrique aux urgences soit celle du CMP. Les urgences de Cahors ne peuvent fonctionner comme celles de Bordeaux. Au passage, voilà qui invalide les structures intersectorielles telle une unité aux urgences psychiatriques d’un gros hôpital commune à plusieurs secteurs, au regard d’une permanence aux urgences d’une équipe émanation d’un CMP d’un secteur.
Par ailleurs, « l’hétérogénéité des pratiques et des organisations (qui) constitue un frein indéniable à l’accès à une offre de qualité, équitable sur l’ensemble du territoire » répond en tout cas à une hétérogénéité des besoins et des demandes, et en plus permet de multiplier les offres de soin et de les mettre en complémentarité et en concurrence. Il est aussi question de « la très grande hétérogénéité des troubles psychiatriques » ; celle-ci ne justifierait-elle pas une hétérogénéité des modalités de soin, plus que cette surspécialisation dilacérante dont on verra en son temps comment elle s’insère dans le projet des auteurs ?
De plus, « le mode organisationnel de la psychiatrie de secteur est aujourd’hui bien peu efficient pour s’occuper (des SDF), notamment du fait de son découpage géographique ». Mais ce n’est pas tant le mode organisationnel que le manque de disponibilité qui pose problème, là où l’essentiel du travail consiste à traîner dans la rue, disparaître de l’agitation sociale pour prendre place dans le paysage marginal. Quant à l’argument géographique du découpage en secteurs, il ne tient pas : peut-on imaginer des équipes qui suivent les patients nomades dans la continuité de leurs périples dans le pays entier ? Et qui pourrait mieux prendre place dans la durée dans les interstices de la vie sociale qu’une équipe tellement implantée dans le paysage local qu’elle y est affectée ? Quant à l’autre reproche qui est fait au secteur psychiatrique face à cette population, à savoir d’« attendre la demande », c’est méconnaître les divers investissements et les divers outils mis en place par les équipes de secteur et même les pouvoirs publics à cet effet, mais aussi les particularités d’une population qui se méfie du bien que la société lui veut malgré elle. Après, mais comme toujours, dans le passé, le présent et à n’en pas douter l’avenir, l’efficience du travail dépend de la motivation à effectuer tel ou tel pan du travail.
Autre méconnaissance de la pratique de secteur : « les détenus sont généralement remis en liberté sans qu’aucun suivi particulier soit prévu ». Deux problèmes d’organisation sont là en cause : d’abord les personnes sont souvent détenues dans des prisons en dehors de leur secteur psychiatrique, ce qui impose un relais des soins difficile à mettre en place, ex-détenus et équipes de secteurs ne se connaissant pas ont beaucoup de réticence à se rencontrer dès lors qu’il n’y a plus le poids de la contrainte ou de la privation de liberté, guère compensées pas de l’enthousiasme à faire connaissance dès l’élargissement. Ensuite, la sortie de prison est souvent mise en œuvre rapidement par l’administration, sans prévenir ou laisser le temps aux soignants de préparer la sortie.
« Officiellement, depuis 2003, les secteurs n’existent plus comme unités géographiques ». Que sont alors devenus les secteurs psychiatriques, par définition géo-démographiques ? Eh bien, ils n’existent plus mais fonctionnent encore. Contradiction administrative du même genre que celle, logique, des auteurs qui ajoutent que « les différents schémas régionaux ont cherché à l’intégrer dans la planification générale des soins, sans toujours tenir compte de sa spécificité » : ainsi la psychiatrie serait une branche spécifique de la médecine, et, « en même temps », la maladie mentale une maladie comme une autre.
Autre aspect du secteur psychiatrique abordé par les auteurs, l’existence de « fortes inégalités territoriales, à la fois en termes de dotation et de pratiques ». C’est effectivement un problème, surtout en matière de moyens – bien qu’il soit inévitable que les moyens ne soient pas comptablement identiques pour tous les secteurs, qui ne sont pas égaux numériquement pour tous les items significatifs pour leur activité –, mais c’est aussi inévitable sui generis – la pratique en la matière est autant nouée au savoir-faire qu’au savoir-être, donc à la personne du soignant, qu’il est impossible de la reproduire à l’identique, quantitativement et qualitativement, dans chaque secteur. Et puis, cette « inégalité territoriale » ne tend-elle pas à devenir la règle dans ce pays où la « gouvernance » de la République met à mal le principe de l’égalité des territoires.
Les auteurs reprochent aussi au secteur psychiatrique de ne pas être assez spécialisé, c’est-à-dire de ne pas être surspécialisé : « imaginerions-nous un cancérologue spécialiste du cancer du sein recevoir en consultation des patients pour une leucémie ». Mais un gastro-entérologue traite aussi bien un ulcère de l’estomac qu’un cancer du côlon ! Serait-ce utile ? Et même est-ce souhaitable ? Enfin, en quoi le secteur de psychiatrie générale l’empêcherait-il ? On pourrait tout aussi bien dire que la fragmentation qu’induirait une telle surspécialisation nuirait à une appréhension globale de l’objet de la spécialité, et créerait des trous dans celle-ci où tomberaient nombre de patients (cf. l’expérience de la surspécialisation pédopsychiatrie et le sort des adolescents, qui a amené à boucher les trous en créant une psychiatrie et des structures pour l’adolescent ; pédopsychiatrie dont est par ailleurs souligné le « risque de rupture de soins à 16 ans entre pédopsychiatrie et psychiatrie adulte » – sic –). Faudra-t-il aussi, pour prendre en compte des spécificités de la femme vis-à-vis de l’homme, doubler systématiquement chaque surspécialité...
Un autre aspect de ce manque de surspécialisation mis en avant est celui des « effets particulièrement négatifs (de la)... coexistence de malades aux profils très différents... dans certaines unités psychiatriques ». Négatifs, ou pénibles... en tout cas une telle cohabitation est le reflet de la vie sociale, et même de la vie. N’est-ce pas un effort d’intégration, d’insertion, que de développer les facultés d’adaptation afin de viser la cohabitation S’agissant de pathologies « du comportement », on n’a pas fini de saucissonner les enfants, adultes, vieux, hommes, femmes, ruraux, citadins, banlieusards, catholiques, protestants, musulmans, jusque dans les bus et les trains ? Il est même reproché que « de tels regroupements facilitent les agressions ». En pratique, c’est l’inverse, l’homogénéité suscitant la rivalité et l’affrontement tandis que l’hétérogénéité favorise la complémentarité et la solidarité. Et on frise le ridicule quand, pour favoriser cette homogénéité, est formulé le vœu que l’hospitalisation en chambre individuelle soit la règle. Va pour le vœu, mais en quoi la chambre individuelle – essentielle pour permettre cette respiration indispensable vie privée/ vie publique – est-elle garantie ou synonyme d’homogénéité ? Ou encore dans la même vue, de se « confronter à la sur occupation des lits ». S’il s’agit qu’il n’y ait qu’un patient par lit, soit, mais sinon quel rapport entre chambre individuelle ou homogénéité, et suroccupation ? Pour éviter la suroccupation, il faut autant de lits qu’il en est besoin.
Il est aussi reproché au modèle du secteur psychiatrique, qui met en avant le psychiatre pour les patients présentant des troubles mentaux, de « freiner le développement d’un modèle collaboratif et tendre à exclure le médecin généraliste ». On pourrait dire le contraire, c’est-à-dire qu’il rapproche généraliste et psychiatre, dans la proximité du patient, si bien qu’une coopération est tellement plus envisageable, facilitée et étroite, qu’elle est même parfois évitée pour pouvoir être supportable, tant les deux discours sont difficiles à tenir ensemble. D’ailleurs « les attentes des médecins généralistes à l’égard des psychiatres sont disparates et imprécises », ils ne sauraient pas ce qu’ils en attendent, et seraient insatisfaits de l’information reçue. Eh bien oui, c’est évidemment là que réside le problème : les généralistes travaillent pour maintenir un état vital convenu et raisonnable, les psychiatres pour interroger et ligaturer, maintenir en équilibre, deux mondes étrangers, le sensé et l’insensé (que souvent les généralistes refoulent ou dénient pour pouvoir faire leur travail). Il y a là un réel hiatus que la conception neuroscientifique de la maladie mentale ne pourra que croire combler en rabattant les maladies mentales sur les maladies comme les autres. Le psychiatre de secteur est dans ce hiatus, tenant d’une main le patient, de l’autre la cité et lorsque c’est possible le médecin généraliste, son allié le plus familier mais parfois le plus étranger dans ce contexte.
Les auteurs reprennent une critique de la présidente d’une association de patients sur les soins « prodigués par des unités différentes qui ne communiquent jamais entre elles dans les différentes séquences de la maladie ». Et pourtant, c’est le résultat de la tendance lourde actuelle de l’organisation et du management des secteurs psychiatriques par les directions des soins et les chefs de pôle, que de spécialiser les unités et segmenter les équipes selon les séquences de soin, et parfois même d’interdire les réunions cliniques entre équipes, voire dans une même équipe, quand le temps ne manque pas.
Ainsi, on peut parler d’échec de la mise en place du secteur psychiatrique, qui revient autant si ce n’est plus aux décideurs politiques et gestionnaires qu’aux soignants, plus que de la philosophie du secteur.
Des organisations étrangères sont proposées en alternatives. En Angleterre, le Community Réhabilitation Teams ressemble un peu aux centres de crise créés en France dans les années quatre-vingt-quatre-vingt-dix, et qui ont tous été fermés. Au Danemark, où le processus de désinstitutionanlisation a eu pour conséquence la réduction de 36 lits pour 100 000 habitants de 1990 à 2005, tandis qu’en France il baissait de 115 pour 1000 habitants de 1990 à 2011, mais elle s’accompagnait « d’une réelle augmentation des modalités de prise en charge hors hospitalisation », dans des « structures de 20 000 habitants », soit à taille humaine ; et son modèle d’organisation de la santé entre gestion régionale des hôpitaux, municipales pour les soins ambulatoires et l’aide sociale, n’est pas très compliqué à adapter en France, en l’améliorant : l’ARS pour la région, le conseil départemental et la commune pour les autorités locales, pourraient coopérer avec le secteur psychiatrique pour l’articulation des champs sanitaire et social. Enfin au Canada, où « la compagnie Bell s’est emparée du sujet de la santé mentale avec le programme Let’s Talk qui œuvre pour un meilleur accès aux soins et une augmentation des ressources allouées à la recherche... ce standard est précurseur au niveau mondial. Mis en place en 2013, il a été adopté par plus de 340 entreprises dans le monde ». Il aurait fallu en informer la gouvernance d’Orange. Mais ça, c’est le mécénat du privé, ce n’est pas l’organisation régalienne des soins psychiatriques.
Dans la communauté médicale, la psychiatrie serait une discipline mal aimée. Les étudiants placent la psychiatrie parmi les cinq disciplines les moins bien classées lors de leur choix de spécialité après les épreuves classantes nationales (ECN). « De là à penser que certains font le choix de la psychiatrie par défaut, il n’y a qu’un pas que l’on peut être tenté de franchir ». Que penser alors du fait qu’« en France, la psychiatrie est la spécialité médicale, hors médecine générale, qui regroupe le plus de médecins », comme ils l’écrivent un peu avant ? Et d’enfoncer le clou en citant une enquête de l’association française fédérative des étudiants en psychiatrie auprès des internes de toutes disciplines : « près de 60 % des personnes interrogées pensent que l’interne de psychiatrie a probablement des antécédents personnels psychiatriques » ? Voilà donc l’explication, les psychiatres sont fous. Mais on peut se rassurer (ou s’inquiéter, c’est selon), « un peu plus de 30 % pensent qu’un interne de psychiatrie a raté les ECN et devrait " mal finir ", car la psychiatrie est " contagieuse" » ; en voilà 30 % qui devraient recommencer leurs études de médecine ! Mais qui forme les étudiants en médecine ; pas les psychiatres de secteur, les professeurs des universités, comme les auteurs de ce livre ! La psychiatrie, une médecine comme les autres ! Déstigmatiser, disent-ils ! La faute à l’échec du secteur !
À propos des traitements, en l’occurrence psychotropes, toujours « les chiffres », qui « témoignent d’un probable manque de formation des médecines généralistes dans le domaine de la psychiatrie, mais, plus encore, démontrent les dangers d’un défaut de coopération entre acteurs du soin ». Peut-être, mais la seule prescription de psychotrope, qui souvent ne « guérit » pas, ne réalise-t-elle pas une situation de piège dans lequel se coince le patient, qui veut aller bien, et généraliste qui ne sait quoi faire d’autre ? Où se situe le manque de formation ? Sur l’objet, pharmacologie ou psychopathologie, ou les deux ? Ou sur l’acteur de la coopération, généraliste ou psychiatre, ou les deux ?
Ils évoquent les limites de la psychiatrie, en reprenant les propos d’un tiers : « Et puis, comment voulez-vous qu’un jeune de 30 ans adhère à son traitement quand il prend 30 kg, devient impuissant et qu’il n’a eu aucune information sur la maladie et sur l’importance de l’observance ? ». Mais ce n’est pas la schizophrénie qui fait grossir, ce sont les médicaments, et une telle prise de poids ne fait pas douter de l’observance. Alors allons-y, posons la question des médicaments. D’autant qu’une révélation incidente nous y pousse : « les maladies psychiatriques telles que définies par la CNAM concernent 2,1 millions de bénéficiaires, alors que la catégorie " consommateurs de psychotropes " concerne 5,1 millions de bénéficiaires » : tiens, il y a plus de 2 fois plus de consommateurs de psychotropes que de malades psychiatriques. Il serait intéressant, voire nécessaire, de comprendre cette différence, peu logique, et... lourde de kilos et d’euros...
Toujours sur la coopération généraliste-psychiatre, « le suivi des soins somatiques des patients est défectueux, quand il n’est pas inexistant, et le cloisonnement entre les soins somatiques et les soins psychiatriques alimente autant qu’il aggrave cet état de fait ». Mais les psychiatres ne sont pas les généralistes des patients. Et prendre en considération corps et psychisme n’est pas la même chose que soigner les pathologies somatiques des patients. Ne pourrait-on pas retourner le compliment et regretter que les médecins soignant les corps ne considèrent que les maladies somatiques ?
Et quelques approximations au sujet de l’exercice de la profession de psychiatre des hôpitaux.
Si « selon le Code de santé publique, le consentement aux soins est une condition sine qua non de toute prise en charge thérapeutique », c’est avant tout par éthique, logique et souci d’efficacité. De même que si « la contrainte aux soins... se justifie juridiquement au motif que les troubles mentaux peuvent altérer, chez le sujet, la conscience du besoin de soin », c’est aussi parce qu’il y a une demande d’un tiers, civil ou représentant de l’État. Et « prendre la décision de restreindre les droits fondamentaux d’une personne en l’hospitalisant sous contrainte » ne peut, contrairement à ce qui est indiqué, relever d’un psychiatre ; il peut le conseiller, et s’associer à cette demande en rédigeant le certificat, mais pas en être le décideur.
Les programmes de soin permettant aux patients hospitalisés sous contrainte de poursuivre les soins contraints à domicile iraient « dans le sens de la désinstitutionnalisation » ; c’est vite dit, voire faux : c’est un verrouillage dans une institutionnalisation élargie (dans les deux sens, courant et juridique, du terme), socialisée, une solution de facilité qui allège l’hospitalisation en termes de durée de séjour, mais alourdit la contrainte et l’aliénation sociale – à venir, un bracelet électronique diffuseur automatique de psychotropes. Une institutionnalisation à domicile.
Si le juge des libertés et de la détention « a désormais pour rôle de contrôler automatiquement la régularité de la procédure d’admission », il n’a pas celui de contrôler « le bien-fondé du maintien de l’hospitalisation complète » : comment un juge pourrait-il évaluer un diagnostic, un pronostic, une indication d’hospitaliser, même sous contrainte, relevant de l’expertise médicale ?
Enfin, ils rappellent, de façon très nette mais surprenante à se souvenir de leur propension à soumettre l’exercice de la profession de psychiatre à l’État, ce passage du serment d’Hippocrate : « Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité ». Serait-ce à dire qu’on ne peut, éthiquement, soigner sous la contrainte !
La psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle (PI) auraient perdu de leur influence à la fin du XXe siècle, « sous le coup d’une relative désaffection des professionnels » et « du fait de l’évolution des structures de soins vers des modalités de prise en charge ambulatoire dans le cadre du secteur ». Ne serait-ce pas plutôt sous le coup d’une désaffection, pas relative, d’une approche « politique » par ces mêmes professionnels qui ont laissé tomber cette « jambe » nécessaire à la bonne marche de la PI, dans le même temps que les décideurs et administrateurs des affaires politiques mettaient à l’index ces orientations de lecture des pathologies de l’être au monde ? Et plutôt de la difficulté de déployer le soin psychique dans la Cité, pour ne pas dire de l’absence de nécessité de l’envisager dès lors que la dimension politique a été abandonnée dans le soin psychiatrique.
Si les psychothérapies « sont reconnues comme indispensables et partie intégrante de la triade, aux côtés de la médication et du respect d’une bonne hygiène de vie, sur laquelle doit reposer toute stratégie thérapeutique, et notamment dans le cas de troubles sévères », et si les auteurs regrettent une carence de la formation et de l’offre de soin en la matière, ne sont citées que les « thérapies cognitivo-comportementales, la psycho-éducation, la remédiation cognitive, l’entraînement aux habiletés sociales, les thérapies interpersonnelles et des rythmes sociaux », où, même en faisant des efforts, on ne voit pas de place pour la psychanalyse ni pour la PI. Et ce quasiment dans tous les passages du texte où il est question de ces thérapies en principes psychiques.
Et de se désoler que, selon les propos qu’ils citent, « encore aujourd’hui de nombreux médecins ne croient pas à l’efficacité des psychothérapies ». Médecins, psychiatres ou généralistes ? Ou les deux ? Et que dire de la HAS et des autorités administratives du monde de la santé !
Dans un encadré, sans doute pour mettre de la distance entre le propos et leur plume, ils rapportent : « Dans son ouvrage consacré à l’autisme, Florent Chapel rappelle que les traitements psychanalytiques n’ont pas fait leurs preuves et ne font donc pas partie des approches recommandées » ? Tiens, je croyais que les psychothérapies étaient « reconnues comme indispensables et partie intégrante de la triade, » ! Mais n’est-ce pas là l’occasion de faire parler un tiers pour dire la position, consensuelle, des auteurs sans y paraître ? « Pourtant, les familles sont encore aujourd’hui confrontées à la résistance de certains thérapeutes, voire à leur remise en cause des avancées scientifiques récentes » continuent-ils. Et ironie, on apprend qu’« aujourd’hui, des familles se voient arracher leurs enfants au motif que les mères seraient à l’origine des troubles, voire les inventeraient », par des professionnels de l’enfance. Ainsi ce ne sont plus les psychanalystes qui accusent les mères de l’autisme de leur enfant, mais des services sociaux ! Et de conclure à ce sujet en vantant les mérites des centres Experts FondaMental dont la « prise en charge conforme aux recommandations internationales s’accompagne d’un pronostic meilleur pour les enfants ».
L’installation, sous le titre d’un chapitre, d’une citation de D. Castelnau donne quelques indications sur la position des auteurs dans le registre de la pensée : « Laissons, nous médecins, les discussions philosophiques aux philosophes ». On peut aussi penser que soigner les pathologies de l’âme peut gagner à s’intéresser à tout ce qui fait la vie de l’âme, où la philosophie peut apporter matière et manière à penser.
Les auteurs définissent les thérapies cognitivo-comportementalistes, qu’ils situent dans les psychothérapies, comme des « thérapies brèves visant à améliorer la prise en charge des symptômes invalidants en agissant spécifiquement sur les schémas de pensée ». Et pourtant, ne seraient-ce pas des thérapies de conditionnement plus que de pensée, pavloviennes plus que psychothérapiques ?
Ils regrettent leur absence de remboursement lorsqu’elles sont pratiquées par des non médecins – ce qui est cas des psychothérapies et de la psychanalyse –, et demandent de « poursuivre le déploiement sur tout le territoire du remboursement des séances de psychothérapie » – y compris les psychothérapies analytiques ? Elles ne sont pas citées parmi les psychothérapies « adaptées » (seraient-elles inadaptées) par les auteurs du texte, qui semblent bien s’en garder pour éviter sans doute les polémiques. Et du coup, qualifient de psychothérapies ces autres méthodes qui s’apparentent plus à de l’éducation et même du conditionnement, permet d’éluder la question. Mais le silence de leur absence est assourdissant. Enfin « ... dans le cadre d’un protocole de soins, leur nombre restant à définir selon la gravité de la pathologie », planification et chiffrage de la folie ; c’est antinomique.
Un certain nombre de convictions sont assénées sans plus d’argumentation.
Des idées ou même des phrases sont empruntées sans les citer à des conceptions ou des auteurs que ces tenants d’une psychiatrie neuroscientifique et d’une politique néolibérale combattent par ailleurs. Ce qui leur permet d’éviter de s’engager dans une disputation et même de se présenter comme consensuels, et de ratisser large, faussement naïfs. Ainsi cette phrase dans l’avant-propos de Nicolas Baverez : « La manière dont une société traite les personnes atteintes de maladies mentales dit tout sur l’importance qu’elle accorde à la dignité et à la liberté des hommes », qui doit mener à l’exorciser : Sors de ce corps, Lucien Bonnafé ! (toi qui as été, au fond, l’inventeur du secteur psychiatrique).
De même, l’antipsychiatrie est présentée comme « une approche holistique, où la maladie mentale (ayant ou non une cause organique) ne peut s’analyser qu’au sein d’une construction sociale ». Mais c’est « naturel », non, puisque l’homme est un animal social ! Cause et/ou effet, la maladie mentale, et même somatique, ne peut s’envisager sans ou hors de ses contingences et conséquences sociales. Là n’est pas l’opposition entre psychiatrie et antipsychiatrie, elle se trouve dans la négation par les tenants de l’antipsychiatrie, que les troubles considérés par la psychiatrie relèvent de pathologies. On voit là la difficulté, mais aussi l’importance, de situer la psychiatrie entre maladies et troubles, qui ne serait ni médicale ni psychosociale, mais maladies et troubles, médicale et psychique et sociale. Et de façon surprenante, il n’y a aucune critique de l’antipsychiatrie, qui est même mieux traitée que ne le sont la psychanalyse et la PI ; mais n’a droit qu’à quelques lignes, se contentant d’évoquer quelques noms célèbres de ces opposants ou de leurs apports. Pas d’analyse, politique ni même scientifique, dans un effort de consensus, sans doute.
« La stigmatisation prend racine dans le besoin d’unité du corps social » est-il écrit. Peut-être, mais ça mériterait d’être argumenté. En quoi mettre à l’écart par stigmatisation serait un facteur d’unité du corps social ?
Pour « leurs pratiques en matière de prescriptions, seuls 17 % des psychiatres s’appuient sur les directives des autorités gouvernementales ». Ah bon, ce sont les autorités gouvernementales qui dictent les bonnes prescriptions ? Ce regret ne trahit-il pas une subordination inconsciente dans un déplacement de champ ?
Dans le même registre, les psychiatres seraient « tiraillés entre les besoins de soins de leurs patients et les exigences de sécurité de la société » ; ça ne devrait pas être de la responsabilité des psychiatres, même s’ils ne peuvent ignorer cet aspect des situations.
Les auteurs regrettent que les « 30 000 personnes... endeuillées chaque année par suite d’un suicide et les 3,7 millions de Français touchés par la tentative de suicide d’un proche » ne soient pas autant l’objet d’attention et de mesure de prévention que les 3 645 personnes mortes dans un accident de la route en 2012. Mais ces morts ne sont pas de même nature, peut-être parce que les accidentés de la route ne souhaitaient probablement pas tous mourir, tandis que les suicidés, a priori, le souhaitaient.
Les auteurs relaient le propos d’un directeur d’Agence régionale de Santé (ARS) : « une " impérieuse nécessité " doit conduire " la totalité de la psychiatrie [à rejoindre] les préoccupations d’une médecine fondée sur les preuves " ». Mais comment « prouver » qu’un suicide est un symptôme de maladie mentale, comment « prouver » qu’un acte, qu’une pensée, est pathologique, comment « prouver » une maladie mentale ? Le désarroi des auteurs à manquer de « preuves » rend probablement compte de leur impatience à disposer de « marqueurs ».
Et de façon plus générale, « près de 60 % des psychiatres considèrent que les recommandations de bonnes pratiques ne sont pas adaptées à la réalité française ». Comment comprendre ça : les recommandations de bonnes pratiques sont à côté de la plaque, ou ce sont 60 %, la majorité donc, des psychiatres français qui sont à côté de la plaque ? La pratique psychiatrique est faite par quelques experts qui y réfléchissent de temps en temps dans le for intérieur de leurs réunions, ou par les praticiens qui la mettent en œuvre au quotidien pendant toute leur carrière ?
Parmi les recommandations de bonnes pratiques, il en est une qui est assénée, d’autant qu’elle justifie le reproche récurrent de retard à la mise en route des soins, c’est celle de la nécessité de traiter précocement les troubles psychotiques. Mais par ailleurs il est aussi signalé que « les troubles mentaux des adolescents et des jeunes adultes se manifestent à l’adolescence, même si rétrospectivement on peut constater l’existence de certains troubles dans l’enfance. Tous les adolescents ayant présenté ces symptômes ne développeront pas de troubles, tous les jeunes présentant, à un moment donné, des troubles mentaux avérés ne deviendront pas malades mentaux, a fortiori psychotiques » (citation de F. Schultze-Lutter). il ne faut donc peut-être pas aller trop vite. Consultation sans tarder, certes, mais sans sauter sur la mise en route en urgence d’une « triade de soins » à partir d’un diagnostic hâtif.
Comme le font souvent les économistes que leurs orientations politiques mènent vers l’élargissement de la gestion des biens communs au privé, lorsqu’il est question de faire le bilan économique de la politique de santé, les auteurs n’envisagent que les seuls coûts : « Les coûts indirects permettent d’appréhender la valeur de la production perdue du fait du chômage, de l’absence au travail, de la perte de productivité au travail et de la mortalité prématurée liés aux troubles mentaux ». S’il y a des coûts, notamment indirects, les plus importants d’après l’estimation citée par les auteurs, il y a aussi des gains, notamment indirects : l’argent investi dans la santé, outre son utilité pour les malades et la santé, circule dans l’économie, produit de l’emploi, du travail, des gains de productivité des malades, une augmentation de leur consommation, des taxes, des impôts, des dividendes, Peut-on ainsi isoler un coût du contexte, de la machinerie économique, qui le produit et dont il n’est qu’une incidence ?
Leurs propositions sur le financement dessinent une usine à gaz.
Malgré « une certaine marge de manœuvre », le mode de financement actuel n’inciterait pas à l’innovation. C’est faire un procès d’intention aux établissements : s’ils ont une certaine marge de manœuvre, ils peuvent la consacrer à innover ! Mais pas de procès d’intention aux auteurs de ce texte, les directions, soumis à tant d’impératifs de sécurité, d’économie, de conformité à des normes et règles comptables et administratives, et même politiques, ne sont pas très portées à innover.
Le budget global ne permettrait pas « d’intégrer les soins de ville (rémunérés à l’acte), ceux assurés par les cliniques privées (rémunérées à la journée) et ceux des établissements de médecine de chirurgie et d’obstétrique (payés au séjour) ». On ne voit pas pourquoi : les consultations libérales, hospitalisations en soins somatiques, transports peuvent être facturées aux hôpitaux psychiatriques qui peuvent les payer avec la dotation globale. Et pas besoin des cliniques privées, sauf éventuellement pour des soins somatiques selon l’offre publique locale, qui est pilotée par l’ARS.
« De nouveaux modes de tarification dits " à l’épisode de soin " » satisferaient plusieurs objectifs. « S’adapter aux besoins des patients enregroupant dans une même enveloppe tous les types de prise en charge médicale et médico-sociale » ; mais à part la gratuité, les patients n’ont pas beaucoup de besoins en matière de financement de leurs soins. Leur demandera-t-on également leur niveau de satisfaction en la matière ? « Améliorer la qualité des soins » ; mais en quoi tout mettre dans une même enveloppe améliorerait la qualité des soins ? « limiter les actes inutiles » ; pas besoin d’un mode de financement particulier pour ça. « Renforcer la coordination entre professionnels » ; là aussi, en quoi tout mettre dans une même enveloppe renforcerait la coordination ? Quel rapport entre mode de financement et soins, sinon permettre leur réalisation ? Ils répondent « l’intérêt de l’ensemble des acteurs » – ne serait-ce pas plutôt une politique humiliante de la carotte et du bâton ? Mais ce sont les intérêts des comptabilités des structures, pas des acteurs des soins ; les soignants ne sont ni informés ni concernés par les modes de financement. Ces structures seraient des Sociétés coopératives d’intérêt public, alors il n’y aurait pas ce hiatus entre administration et soins, ou entre financement et soins.
Le premier étage de cette usine à gaz est d’« améliorer la collecte des données médico-économiques » pour « définir des épisodes de soins ou des forfaits homogènes avec des situations pathologiques comparables ». Voilà qui va encore plus éloigner les soins de l’administration et du financement et soumettre encore plus les premiers aux choix des seconds.
Il s’agit en effet de « définir, pour chaque épisode de soin (premier épisode psychotique, épisode récurrent, crise, etc.) ou pour chaque type de patient pour la capitation (patient schizophrène, patient dépressif résistant, etc.), quelle doit être la pratique clinique à suivre et le forfait correspondant ». C’est-à-dire définir des produits dont les composants et le prix sont fixés par avance, inscrits sur l’emballage selon l’intitulé du produit ? Quid des dates de péremption ? Y aura-t-il des promotions, des soldes... ? Autrement dit, c’est faire de la médecine une entreprise commerciale comme une autre.
Puis d’« identifier le gestionnaire approprié pour centraliser le forfait et le redistribuer à l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins », ce qui « implique de s’appuyer prioritairement sur les établissements hospitaliers, à rebours de la tendance à la prise en charge ambulatoire. Un regroupement de CMP pourrait constituer une alternative intéressante ». Décidément, la marchandisation de la santé se confirme, et s’accompagne d’un retour à l’hospitalo-centrisme. Et le secteur psychiatrique, c’en est décidément fini ! Un niveau de regroupement de plus c’est un niveau de fragmentation de plus. À quand la fission nucléaire de la société !
Le résultat attendu est d’améliorer le « parcours de soins », ce qui serait obtenu au vu de la « diminution du nombre et de la durée des hospitalisations, du nombre de recours aux urgences psychiatriques, et... du nombre de suicides et de tentatives de suicide ». Réussite comptable !

En plusieurs endroits sont avancées des pièces jamais assemblées, mais il n’est pas très difficile d’en apercevoir la construction projetée, une « réforme en profondeur de la psychiatrie française que nous appelons de nos vœux » écrivent-ils. « Source d’inspiration et d’espoir pour la psychiatrie : la cancérologie ». Une agence nationale, suggèrent-ils – et pourtant, « l’époque n’est plus à la création d’agences, les pouvoirs publics n’y sont plus favorables arguant que la spécialisation de leurs missions, leurs statuts juridiques très différents et leur autonomie de gestion vis-à-vis des tutelles ne sont ni forcément gages d’efficacité et d’économie, ni de cohérence d’ensemble de l’action de l’État » – et donc plutôt un « opérateur », selon un trucage du vocabulaire [4] qu’ils avouent d’ailleurs tranquillement. Cet opérateur, donc, placé sous la tutelle des ministères de la Solidarité et de la Santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sera – ils utilisent le futur, sûrs de leur (mé)fait – piloté par un comité rassemblant « des représentants des soignants, des associations de patients et de proches, de l’Assurance maladie, des organismes de recherche, des fédérations hospitalières, ainsi que des acteurs des secteurs social et médico-social ». « Inspiré par l’INCa [5] (dont le budget annuel est d’environ 87 millions d’euros), il sera le guichet unique de la politique nationale de la psychiatrie et fer de lance de la vision globale de la discipline ». À ce titre, « il articulera les structures existantes et garantira la mise en œuvre et l’évaluation de grands axes stratégiques, à savoir, la prévention et la détection précoce des troubles psychiatriques, les soins, la recherche, la formation et les actions de déstigmatisation de ces maladies ». En collaboration avec la HAS et les ARS, il assumera toutes leurs missions (« orchestrer une stratégie nationale de prévention et de déstigmatisation ; produire et diffuser des référentiels communs de pratiques cliniques ; créer des indicateurs d’évaluation et des labels ; favoriser l’appropriation des connaissances et des bonnes pratiques par les professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social ; fluidifier la transition entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte ; créer des outils répertoriant par territoire les acteurs et ressources disponibles ; favoriser une psychiatrie bâtie sur l’empowerment des patients et de leurs aidants ; suivre et d’évaluer les performances de l’ensemble des mesures prises »). En collaboration avec les organismes de recherche, il « lancera des appels d’offres dédiés sur des grands enjeux prioritaires de la recherche qu’il définira chaque année » ; c’est-à-dire qu’il organisera la recherche en psychiatrie dans le pays. Enfin, il définira « en collaboration avec les ARS, le cahier des charges, la labellisation et l’évaluation des centres d’excellence spécialisés, (qui articuleront les) réseaux de diagnostic, de formation et de recherche, centraliseront les données économiques et médico-économiques, (en appui) des projets de recherche innovants, dans l’objectif de comprendre les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent les troubles psychiatriques majeurs, afin d’améliorer les outils diagnostics et de découvrir de nouvelles voies thérapeutiques ». Quant au soin, il sera assuré par « une psychiatrie spécialisée dite " de niveau 3" », comme « dans d’autres disciplines (notamment la cancérologie) », par des « équipes multidisciplinaires et spécialisées partageant les mêmes outils d’évaluation afin d’assurer l’homogénéité des diagnostics sur le plan psychiatrique, somatique, cognitif et social, en vue d’établir des recommandations thérapeutiques personnalisées », qui mettront « également en commun les données anonymisées pour assurer un suivi de cohorte et veille(ro)nt à s’intégrer dans les filières de soins territoriales ».
« Nous proposons de développer des réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) en psychiatrie, pour les cas les plus sévères à l’instar des RCP " protocolisées " dans le traitement du cancer. Ces échanges visent à organiser la confirmation diagnostique dans des situations complexes, à proposer des stratégies de soins adaptées, à uniformiser les pratiques sur l’ensemble du territoire, à favoriser les liens et la communication entre les différents acteurs de terrain, à participer à la formation des internes et étudiants en médecine, et au final à améliorer la prise en charge des malades ». Ainsi, cet opérateur tiendra en main le travail des services de soin de proximité, du diagnostic au traitement en passant par les relations avec son environnement social, la formation et l’embauche du personnel. Il tiendra la main, et la tête des soignants de terrain de la psychiatrie.
Le problème avec ce livre, c’est qu’il est, concluent les auteurs, « un état des lieux (sans concession) de la psychiatrie telle qu’elle est vécue par nombre de ses usagers et de ses acteurs » aujourd’hui, en quelque sorte un bilan, marqué par le regard subjectif des auteurs, mais aussi un plaidoyer pour un opérateur, et « en même temps » un cahier des charges pour une mutation de la psychiatrie, les auteurs se proposant d’être ainsi eux-mêmes, via leur fondation, les maîtres d’œuvre de cette mutation du dispositif de la psychiatrie (pas seulement publique, si on pourra encore la qualifier ainsi, ou probablement psychiatrie publique-privée – PPP –) dans le pays. Sans dire grand-chose, en fait, de l’organisation et du fonctionnement de ce nouveau dispositif.
Cet opérateur serait donc l’alpha et l’oméga de la psychiatrie dans le pays, certes en collaboration avec toutes les institutions de gouvernement, d’enseignement, de recherche et de soin et le pilotage de partenaires, nombreux mais sans doute (bien) choisis, et tenus à distance des informations et décisions, bref, une position hégémonique et dominante. Au nom de la vérité, de l’efficacité, de la rentabilité et du bonheur du peuple, seule la neuroscience pourra être financée et s’exprimer dans un monde neuro-augmenté ; un neuro-monde, libertarien.
Les suites
« Simultanément à la publication le 12 septembre 2018 du livre Psychiatrie : l’état d’urgence, écrit par Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca, psychiatres tous deux, l’institut Montaigne proposait 25 propositions pour sortir la psychiatrie de l’état d’urgence. Dans ce livre, ces auteurs reprennent entre autres les doléances des personnels des hôpitaux psychiatriques qui manifestent ces deniers mois – récupération, dans la mesure où c’est dans une perspective néolibérale, à laquelle s’opposent justement ces mouvements –, et envisagent des remèdes dont celui-ci que l’institut Montaigne propose ainsi en « proposition 1 » : « Mettre en place un opérateur pour définir et piloter une vision stratégique de la psychiatrie et de la santé mentale »... qui « inspiré de l’Institut national du cancer, sera le guichet unique de la politique nationale de la psychiatrie et le fer de lance de la vision globale de la discipline ». Lors de leur interview à la matinale de France Inter du 7 septembre 2018, ils confirmaient qu’ils verraient bien que, à l’instar de l’INCa, la fondation FondaMental assume ce rôle. Le 18 septembre 2018, le chantier « Ma santé 2022 » pour « une transformation en profondeur de notre système de santé » était ouvert par la ministre de la Santé. La ministre de la Santé – dont la mère est « une analyste de renom, proche de Françoise Dolto » –, n’a pour le moment pas semblé s’orienter dans cette direction. », écrivais-je. [6]
Mais elle a créé un poste de délégué ministériel à la Santé mentale et à la psychiatrie, en charge du « déploiement de la feuille de route de la santé mentale et de la psychiatrie en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé » définie le 28 juin 2018, et a choisi début avril 2019 pour occuper cette fonction le professeur Frank Bellivier, qui signe ainsi ses courriels professionnels :
« Frank Bellivier, MD, PhD,
Professor of Psychiatry
Head and Chair, Department of Psychiatry and Addiction Medicine - Expert Centres
Paris Diderot University
INSERM UMR-S1144 - Team 1 leader : Therapeutic response and relapse biomarkers in neuropsychiatric disorders
Fondation Fondamental
… »
Au fond, cette fondation ne serait-elle pas un fond d’intelligence, artificielle, privé d’esprit ? Et ce livre un « rapport » non commandé par les pouvoirs publics, destiné à argumenter une action de lobbying dans le contexte de la stratégie « Ma Santé 2020 », mettant en œuvre la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé promulguée par le président de la République le 24 juillet 2019 ? Et dont un affidé de la fondation FondaMental est chargé d’en déployer la feuille de route.
* Psychiatrie, l’état d’urgence de Marion Leboyer et Pierre-Michel Llorca, avec la collaboration médico-économique d’Isabelle Durand-Zameski, éditions Fayard, 2018.