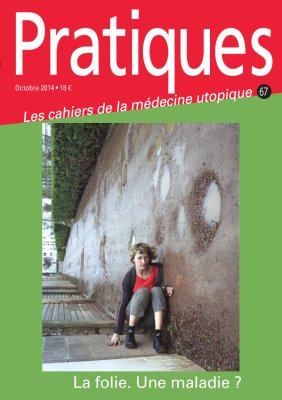Entretien avec Louis Velluet
Propos recueillis par Sylvie Cognard
Louis Velluet a œuvré sur le terrain et au niveau institutionnel pour que la médecine générale, qui intègre la connaissance du patient et de son milieu de vie, devienne un rempart contre la déshumanisation des pratiques.
Pratiques : Louis Velluet, vous êtes médecin généraliste, psychanalyste et enseignant à la faculté Necker à Paris. Vous êtes membre de la société médicale Balint. Pouvez-vous nous raconter votre parcours professionnel ?
Louis Velluet : Je suis l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Ma jeune sœur a été considérée par mes parents comme la merveille du monde et j’ai pour ainsi dire été complètement ignoré. J’ai grandi avec le sentiment d’une extrême solitude. Une façon d’échapper à la solitude, c’est de lire, j’ai donc lu beaucoup. Adolescent, j’étais intéressé par le domaine de la psychologie et j’ai commencé à lire les ouvrages de Freud à seize ans. J’étais en terminale en philo. J’ai commencé mes études de médecine en 1947. Je me suis formidablement ennuyé. Et puis Thèse, service militaire de 1955 à 1957, première installation à Aubervilliers dans le 9-3 comme généraliste. Toujours passionné par ce qui était de l’ordre de la psychologie, je lisais beaucoup, Freud et d’autres auteurs. Un parcours social très banal en quelque sorte.
Et puis, après 68, une chance inouïe, ça bouge à l’UFR (Unité de Formation et de Recherche) de Bobigny, ce n’était pas encore une « vraie » faculté.
Le doyen, Pierre Cornillot, trouvait trop conformiste l’enseignement de la médecine. Il a eu envie de faire place à la médecine générale et aux médecines alternatives comme l’acupuncture, l’ostéopathie, l’homéopathie etc. J’étais un peu gêné qu’il place la médecine générale au même rang que les médecines alternatives, cependant j’ai beaucoup de respect pour certains médecins que je connais bien qui font des trucs complètement farfelus, mais qui ont une sensibilité et une perception complètement géniale. Le doyen s’est précipité au ministère et il a pu rencontrer Edgar Faure, un personnage assez près de De Gaulle, pas très militant. Il a obtenu de créer une faculté expérimentale. Il a écrit à tous les généralistes du département pour leur demander s’ils voulaient participer à l’aventure. Il y a eu quelques réunions, nous étions une vingtaine au départ, une dizaine à l’arrivée avec deux personnages principaux : Jean de Butler et Anne-Marie Reynolds, ces deux-là avaient une consultation de médecine générale à l’hôpital Avicenne. Au fil des rencontres, ça a pris forme, et le doyen a confié la direction du Département expérimental de Médecine Générale à Jean de Butler. Comme ils exerçaient tous les deux à Palaiseau, Jean de Butler a proposé à Anne-Marie Reynolds le côté « psy »… Elle a accepté et m’a téléphoné pour me proposer de participer à l’élaboration de l’enseignement. Parce que lors des réunions, nous avions beaucoup échangé et elle savait que je m’intéressais et participais de très près au travail balintien.
Nous faisions chacun partie d’un des deux grands groupes Balint de l’époque en France. Anne-Marie était dans le groupe de Michel Sapir et moi dans celui de Léon Chertok. Chertok était un personnage remarquable dans la lignée des intellectuels hongrois, chercheur psychosomaticien. Il était élève de Sàndor Ferenczi et pour la petite histoire faisait partie de l’orchestre Rouge durant la guerre. Le doyen m’a alors confié la charge du Département de Formation et de Recherche sur les Comportements Thérapeutiques. Le terme de « comportement » ferait hérisser les cheveux de certains à notre époque, mais c’est comme ça qu’on l’a appelé. En fait on a fait du Balint à l’intérieur.
Pour savoir comment je suis entré dans le groupe de Chertok, il faut retourner un petit peu en arrière. L’été 1967 a été abominable, complètement pluvieux, je m’ennuyais beaucoup. Je suis allé à la librairie médicale Maloine et là, j’ai découvert un livre, Techniques psychothérapeutiques en médecine de Michael Balint. J’ai passé le mois de juillet à le lire. À la rentrée, j’ai trouvé dans les petites annonces de la Revue du Praticien : « création d’un groupe Balint » indiquant un numéro de téléphone. Ni une, ni deux, j’ai téléphoné et c’est comme ça que je suis entré dans le groupe Chertok.
Les premières rencontres suscitées par Pierre Cornillot ont commencé dans les années soixante-dix-71, historiquement ça a un intérêt car c’est le moment où le groupe de Leewenhorst, des généralistes, se réunit pour élaborer une définition de la médecine générale. La définition sera diffusée en 1977 par la Commission européenne à tous les pays de la Communauté. C’est un groupe de chercheurs brillants, Anne-Marie Reynolds représentait la France, le groupe communiquait en anglais. Quasiment tous les pays européens étaient représentés, même ceux de l’autre côté du rideau de fer. Il y avait entre autres un Allemand et un Hongrois. Celui qui animait essentiellement le groupe Leewenhorst, était un anglais, John Horder, qui a été président du Royal Collège des généralistes. John Horder faisait partie du premier groupe de Balint. Ainsi la définition de la médecine générale, complètement ignorée par nos amis hospitaliers ou spécialistes aujourd’hui, vient directement de Balint, c’est-à-dire la relation proche, personnelle et continue à travers le temps, sans distinction de pathologies, de sexe ou d’âge. Le médecin généraliste selon Balint, est donc une personne qui est immergée dans le milieu de vie des gens, qui prend une responsabilité personnelle, qui assume une responsabilité thérapeutique personnelle.
On a démarré les premiers enseignements à la fac de Bobigny en 73-74. En 74-75 étaient donc créés les premiers groupes Balint dans une faculté en France. La participation était obligatoire et systématique. Il y avait dix séances sur l’année, le doyen m’avait confié les étudiants de quatrième année.
Et pendant ce temps-là vous exerciez toujours la médecine générale ?
Oui, oui, j’ai exercé comme médecin généraliste jusqu’à ma retraite en 1996 et en ce qui concerne l’enseignement à Bobigny, j’ai passé la main à mes élèves et j’ai installé à Necker le groupe Balint obligatoire au DES de médecine générale à la demande de Philippe Jaury. J’y anime des groupes encore à ce jour.
Parallèlement, j’ai commencé mon long trajet analytique en 76, parce qu’avec cette responsabilité du département de formation, je ne me sentais pas très à l’aise et je ne voulais pas faire n’importe quoi. J’étais jusque-là un petit mec effacé qui n’avait rien fait de particulier, mis à part mon service militaire en Algérie, en Oranie. Ce service militaire, ce sont les trois premières années où je me suis assumé. J’étais le médecin d’un régiment de sept cents gars. J’avais la charge de tout ce qui était médical, traumatique ou autre, plus les engagements. Je suis devenu adulte lors de ces années-là, je pense qu’avant je n’y étais pas. J’ai été confronté à des choses terribles, les choses de la guerre. À mon retour, je n’étais plus le même.
Le parcours analytique m’a donné une sécurité pour mon travail en groupe Balint. Dans ce travail, il faut obligatoirement un généraliste qui ait un regard analytique. C’est ainsi que je suis devenu analyste tout en étant généraliste. Je me partageais entre les deux, c’est-à-dire que j’avais trois ou quatre jours de médecine générale et un ou deux jours de « psychothérapie – psychanalyse », ça ne transpirait pas. Les gens ne savaient pas, j’avais plein de dames qui venaient avec leur nourrisson, de papis ou de mamies, ils ne savaient pas que j’étais psychanalyste. Ils venaient pour que je leur prenne la tension, faire les examens de nourrisson et puis les deux jours suivants, j’avais des gens qui venaient en psychothérapie. Ce qui est rigolo, c’est que parfois j’avais des gens qui venaient voir le médecin généraliste. La personne s’asseyait, je lui demandais pourquoi elle venait, elle commençait à parler et finalement se retrouvait dans « la cour des analysés »… Je n’ai jamais été du genre de psychanalyste qui prend en charge quarante personnes un quart d’heure par séance dans la semaine, j’ai toujours travaillé sur un minimum d’une demi-heure, parfois trois quarts d’heure. J’avais environ une dizaine de patients de façon à prendre le temps, à laisser mûrir la réflexion. Cela m’a beaucoup apporté pour l’enseignement, c’est un plus pour ce qui est de gérer les groupes.
En 1977, il y a eu la création de la SFMG (Société Française de Médecine Générale). Anne-Marie Reynolds et moi avons participé à sa fondation. Nous faisions partie du conseil d’administration. Ça a explosé très rapidement, en 1979 nous nous sommes fait éliminer de la SFMG. Nous avions voulu installer un séminaire de formation à la psychothérapie et bien sûr la SFMG était très allergique à ce genre de choses, ils étaient et ils sont restés d’ailleurs très organicistes. On était au bureau et puis un jour, on a appris qu’on n’était plus au bureau, c’était assez dictatorial ! Mais on représentait quelque chose qui semblait inconvenant…
Pour revenir à la Société Balint, dans quelle mesure étiez-vous impliqué ?
Étrangement les Anglais n’avaient pas de société Balint, ce sont les Français qui ont créé la première Société Balint en 1967. Balint était amer parce qu’il n’arrivait pas à diffuser vraiment sa pensée comme il le voulait en Angleterre. La NHS (National Health Service) qui s’installait à l’époque était extrêmement rigide. Cependant, il y avait des groupes Balint en Grande-Bretagne. Anne-Marie et moi faisions partie du conseil d’administration de la Société Balint, mais là aussi nous avons été écartés, plus élégamment qu’à la SFMG, puisque nous n’avons tout simplement pas été réélus. Celui qui dirigeait la Société Balint à l’époque était aussi un des créateurs de la SFMG. Il a estimé que nous n’étions pas intéressants et a organisé notre éviction. C’est ainsi qu’avec Anne-Marie, nous avons créé l’Atelier Français de Médecine Générale.
Vous parliez de la NHS en Angleterre, dans le livre Ça va Docteur ? [1] Les médecins ont des consultations très courtes… Ils parviennent cependant à repérer ce qui se passe en eux, et éventuellement chez le patient en très peu de temps. Ils pointent leurs émotions, leurs sentiments et ils en parlent au patient.
Oui c’était ce qu’on apprenait avec Balint. Il y a une explication scientifique que personne ne connaît, bien explicitée par les neurosciences, que j’ai eu l’occasion de détailler dans un article, mais c’est très peu diffusé. L’intuition géniale de Freud, c’est de dire que si on se « débranche » complètement, si on acquiert la capacité de mettre de côté toutes les croyances rigidifiées, médicales ou autres, on a accès à tout ce qui est dans nos profondeurs, et en même temps l’empathie opère. Patient et médecin sont en quelque sorte « branchés ». C’est ce que Balint a installé : le médecin apprend à laisser de côté toutes ses convictions et puis il laisse aller. Cela lui permet d’entrer en empathie avec le patient après avoir échangé seulement quelques mots. Le travail de recherche et de réflexion mené dans ce groupe Balint auquel appartiennent les auteurs est assez fin. Il est mené avec toutes les précautions et les règles que l’on utilise en Balint. Le groupe est un espace qui suscite en nous la possibilité justement, d’être beaucoup plus en lien avec ce qu’on ressent profondément.
L’atelier français de médecine générale représente pour moi une ouverture, un pont entre l’organique et le psychique tout à fait génial.
Oui c’est vrai, mais c’est la réalité scientifique, sauf que dans les facultés ou à l’hôpital, la réalité scientifique elle n’est pas très présente. L’atelier, c’est de la clinique, de la recherche. Actuellement, la clinique est délaissée. Elle existe encore un peu, mais aujourd’hui, on passe tout de suite à l’IRM. La clinique, c’est l’observation et l’observation, c’est scientifique. C’est à partir des observations qu’on construit des théories et qu’on fait des découvertes en menant des recherches. S’il n’y a pas au départ l’observation, il n’y a rien. Pour moi, l’atelier, c’est un endroit où on fait de la psychosomatique, en réalité on fait de la médecine globale, de la « vraie médecine », enfin on essaye, mais en se servant bien sûr de toute l’interrogation de Balint. L’atelier c’est le retour à la clinique, de temps en temps on déborde un peu sur des choses un peu plus personnelles, pas autant qu’en Balint. En Balint, on déborde trop souvent sur le personnel, c’est l’erreur de beaucoup de psychanalystes.
En principe quand celle ou celui qui prend la parole dans le groupe a pigé ce qui se passe, on s’arrête là.
Oui c’est exactement la façon de faire de Balint. Dans ces cas-là, je m’adresse à la personne, et je dis une petite chose pour lui signifier que j’ai compris, du style : « Bon alors… » ou autre chose. J’ai une histoire comme ça : c’était un séminaire de la SFTG intitulé « Comment dire non au patient ». Marie-Anne Puel m’avait invité pour faire le Balint avec elle. Une généraliste présente un cas, c’était une dame qu’elle ne supportait pas etc., etc. Il n’y a eu que ce cas de présenté et tout le travail s’est fait sur cette histoire. Le groupe essayait de travailler ou de généraliser de temps en temps sur les patients difficiles, renvoyant des trucs. À la fin, j’ai dit : « Bon, on va s’arrêter là » et je dis à la personne qui avait présenté le cas : « Ça va oui ? » et tout le monde se lève, et juste au moment de partir elle dit : « Ouais, bon, elle est comme ma mère quoi… » J’espère que ça a travaillé dans sa tête après, c’était vraiment du Balint. On avait tourné autour de plein de choses, on avait abordé d’autres sujets et c’est seulement au moment de partir qu’elle a dit : « Bon, elle est comme ma mère… » L’effet du temps, l’effet d’être en petit groupe, permet d’acquérir une liberté de parole. Le groupe Balint, c’est un endroit de sécurité, il ne faut pas qu’il y ait de mouvements qui puissent être vécus comme agressifs, sinon ça ne marche pas.
Pouvez-vous rappeler les règles du Balint ?
La confidentialité bien sûr, rien ne doit ressortir du groupe. Le respect, on ne juge pas ce qui est dit, on essaye de comprendre, il n’y a pas de malveillance, il faut un respect de l’autre, un respect de sa parole, et une façon d’être au maximum objectif, c’est-à-dire de ne pas émettre de jugement. Ce sont les deux grandes règles. Ça me renvoie à quelque chose dont on a déjà parlé, le débranchage. Il faut que ce soit un espace clos et sécurisant, où l’extérieur n’intervient pas (l’extérieur peut intervenir de quelqu’un qui a envie de prendre des notes, ou qui pense à autre chose) et c’est ce climat de détente qu’on essaye de créer qui permet d’avoir accès à des choses beaucoup plus profondes.
Le groupe Balint, c’est aussi un lieu où l’on peut lâcher certaines choses trop lourdes qui nous ont été confiées…
Oui c’est important. Si le groupe Balint fonctionne bien, on doit pouvoir accepter les choses les plus dures. J’ai participé pendant douze ans au groupe « du trait du cas » qui étaient des gens de chez Lacan. Ce groupe, c’était un groupe Balint de psychanalystes, mais ils ne le savaient pas ! On racontait un cas, la seule différence c’est qu’à la fin de chaque groupe, on faisait le tour, et on disait : « Qui parle la prochaine fois ? » C’était obligatoire. En Balint il faut bien que tout le monde parle, mais c’est plus spontané. C’était formidable parce qu’effectivement, on n’imagine pas la fragilité des psychanalystes, pour la majorité c’était des non-médecins. C’était le seul endroit où il pouvait parler de leurs vécus. Ça m’a énormément enrichi, j’y ai appris beaucoup. Actuellement ne fonctionnent à ma connaissance que deux ou trois groupes de ce type en France. C’est vrai que le Balint, tout le monde n’a pas envie d’en faire. Il faut du courage, pas au sens négatif du terme, mais il faut s’impliquer. Il faut faire tomber toute l’armature, les défenses qu’on a mis en place et pour ça, il faut que le groupe soit très accueillant, et le leader compréhensif. Ça m’est arrivé quelques fois avec des groupes d’étudiants où je voyais que ça n’allait pas trop pour l’une ou l’un d’entre eux. Je la ou le voyais après, on parlait un petit peu pour apaiser les remous provoqués par la séance. Simplement bavarder dix minutes parce qu’on peut toucher à des choses très dures. Ce qui est important, c’est qu’il y ait une personne qui soit là. Je n’aime pas trop Cyrulnik, mais son génie c’est d’avoir parlé du tuteur. C’est-à-dire que pour se refaire, pour repousser comme une plante brisée, il faut un tuteur, il faut quelqu’un qui soit là, quelque chose qui soutienne.
Dans votre ouvrage Le médecin, un psy qui s’ignore [2], vous montrez comment le symptôme fait sens pour le médecin devant un patient qui n’a rien d’organique, celui que l’on nomme « patient fonctionnel », mais qui n’en souffre pas moins. Vous montrez aussi combien les frontières sont ténues entre le fonctionnel, le psychosomatique, le psychique et l’organique. En vous lisant, on réalise l’importance des traumatismes dans l’apparition des maladies.
Le trauma, ça dépend comment ça résonne en soi. Mais vous savez, j’ai mis du temps, j’ai lu beaucoup de choses et pas seulement du psy pour élaborer cela. Toute la théorisation de Balint qui était un scientifique de base au départ, il travaillait sur la biologie cellulaire, s’appuie en réalité sur ce que vous venez d’évoquer à propos des traumas. C’est l’influence des chocs successifs, des chocs de la vie et l’influence du premier choc vécu très tôt quand un nourrisson a un environnement défavorable au départ. Je le dis souvent aux étudiants, les traumatismes petit à petit agissent sur les lymphocytes et, parmi les lymphocytes, il y en a un qui s’appelle « natural killer » qui se promène pour chasser les cellules cancéreuses, et quand les lymphocytes ont diminué et que les « natural killer » ont disparu, la maladie est en risque de survenir. C’est ça la psychosomatique, ce n’est pas une invention, on n’invente pas quand nous disons cela. L’être humain n’est pas scindé avec d’un côté la psyché et de l’autre le soma, psychosomatique ça s’écrit en un seul mot, il n’y a pas de trait d’union. Quand je dis ça, je vois les yeux des étudiants qui s’écarquillent. Ils réalisent pour la première fois qu’il y a des traces biologiques de tout ce qu’on vit. Cela dépend aussi de notre chance, de notre matériel génétique, et là il y a aussi parfois des failles, des choses qui sont transmises et ça, on n’y peut rien, mais tout de même l’être humain est extrêmement adaptable et perfectible. Il faut effectivement le savoir…
Certains psys ne croient pas à la psychosomatique. Ils disent qu’il y a des maladies psys et des maladies organiques qui ne sont qu’organiques et rien d’autre.
Il y a des gens très brillants qui ont du mal à rentrer là-dedans, il faut tout un temps de maturation pour métaboliser ça. Il faut oser.