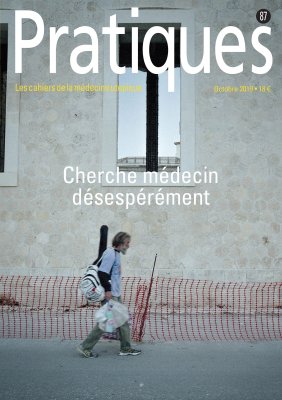Isabelle Canil
Orthophoniste
Nous avons été trois de Pratiques à nous rendre aux 34e Rencontres de Saint-Alban, les 14 et 15 juin derniers..
Saint-Alban sur Limagnole. En Lozère. C’est loin. D’où qu’on vienne, il me semble que c’est loin. La route est belle qui monte et qui descend, de l’herbe verte, des genêts fleuris, des rochers qui affleurent, des vaches tranquilles, un air vif… Les bâtiments de l’hôpital, ancien château, surplombent le village, il faut grimper pour y arriver. Pour être tranquille là-haut ?
Malheureusement, il paraît que l’hôpital actuel n’a plus rien de ce qui a fait sa réputation, acquise du temps où François Tosquelles y officiait. Il en est parti en 1962 et y était arrivé en 1940, après avoir fui l’Espagne franquiste et être interné au camp de Septfonds, près de Montauban.
Lucien Bonnafé était aussi à Saint-Alban et, avec Tosquelles, ils ont pris un virage révolutionnaire en posant les bases de la psychothérapie institutionnelle, qu’ils n’ont cessé par la suite de creuser et d’approfondir, avec d’autres aussi, comme Jean Oury qui travaillera à la clinique de La Borde.
Dans les livres, ce qu’on raconte sur l’enfermement des fous dans les asiles à cette époque fait froid dans le dos. Tosquelles et ses amis ont repensé l’hôpital non plus comme un lieu d’enfermement où on finissait par mourir, mais comme un lieu habitable. Présidait à cette transformation radicale une dimension existentielle qui avait comme corollaires et principes de privilégier la liberté de circuler, de donner aux malades la possibilité d’investir des tâches, des activités (culturelles, manuelles, intellectuelles, artistiques, de loisir etc.) et ainsi de développer toute une vie sociale faites de relations et d’échanges entre les uns et les autres, et même à l’extérieur des murs.
Ce devait être une sacrée époque…
Freud venait de mourir, Lacan (et d’autres) travaillaient d’arrache-pied, écrivaient et fignolaient la psychanalyse…
Outre tout le travail de la psychiatrie réinventée, nourri des découvertes de la psychanalyse, Saint-Alban était aussi un refuge pour les exilés, les résistants, les maquisards, et ceci n’est certainement pas sans liens avec les soins de psychiatrie qui se redessinaient là, tant il est vrai que pour traiter les fous avec humanité et dignité, il est besoin d’avoir quelque idée politique de l’humanité et de la dignité.
La psychothérapie institutionnelle, c’est l’idée que, non seulement pour soigner des malades – qui plus est des malades psychotiques –, mais d’abord pour éviter de leur nuire, l’institution (c’est-à-dire toutes les personnes qui la composent) doit elle-même être en relative bonne santé psychique.
Comment imaginer qu’un malade puisse voir son état s’améliorer s’il est retenu par la force, s’il ne trouve rien d’exprès pour lui, rien d’autre qu’une autorité médicale dure, arbitraire et systématique ?
Comment faire, sinon lui permettre de rencontrer, comme si c’était par hasard, dans un éventail d’ambiances, celle où il pourra puiser de quoi se tenir et y ressentir une continuité d’existence ?
Et du côté du personnel, comment imaginer qu’un soignant aigri, qui se sent – à juste titre ou pas – tyrannisé, négligé ou méprisé aille au boulot avec allant ?
Comment soigne-t-on l’aigreur ? Par la parole et l’écoute.
Il est primordial que tous les acteurs de l’institution puissent y parler, dans des moments spécialement consacrés. Et non, ce n’est pas une perte de temps ni d’argent, et oui ça concerne tout le monde : les malades et le personnel soignant, infirmiers, médecins, aides-soignants… mais aussi les travailleurs qui font tourner la machine, comme les responsables des jardins qu’il faut entretenir, de la cuisine qui nourrit les troupes, du linge qu’il faut laver et repasser, etc.
Que les équipes aient des temps de parole, de réflexion et d’élaboration, c’est ce qui peut garantir que les travailleurs gardent confiance en leur tâche, y dénichent et y renouvellent sens et intérêt, et que conflits et difficultés de tout ordre s’orientent vers une voie de sortie.
Cette année, les Rencontres de Saint-Alban avaient pour thème « L’institution efficace ».
Lors de ces journées, dans quatre salles et ateliers différents, des équipes prenaient la parole et nous présentaient leur travail. Leurs exposés avaient été élaborés collectivement et tous disaient combien cela avait été difficile de réfléchir ensemble pour écrire un texte qui puisse rendre compte de ce qu’ils souhaitaient nous communiquer, mais aussi combien cela les avait ressourcés.
Presque tous disaient aussi qu’ils venaient aux Rencontres pour tenir le coup une année de plus ! Et presque tous témoignaient de leur souffrance au travail, c’en était poignant.
Voici quelques phrases limpides tirées de la présentation du thème sur la plaquette : « L’institution efficace s’appuie sur la désubjectivation, ce n’est plus le sujet qui est pris en compte dans sa souffrance, mais le ratio entre ce qui est dépensé pour ses soins et ce qu’il va rapporter à l’établissement. »
Plus loin : « L’institution efficace est une institution sans idéal autre que d’assurer son propre fonctionnement. »
Et encore : « [elle]est donc celle qui a chassé de son fonctionnement le rêve et toute capacité de rêverie, toute forme d’aléatoire, […] de fiction. L’institution efficace est sans histoire(s). »
Et pour finir, la note d’espoir : « Il est une autre efficacité qui tient au métier de soignant. Elle se décline sous des formes multiples, se moque des hiérarchies, invente une socialité propre au lieu, toujours fragile, souvent inattendue, souvent logée dans les interstices… »
Je suis allée à l’atelier dont le titre était « Cela va sans dire ». Je me souviens d’une équipe travaillant dans un foyer de vie pour adultes handicapés, qui parlait de l’accueil, du temps de l’accueil, de ce qu’ils pensaient qu’ils devaient faire pour que l’accueil (et le soin) soit « pour de vrai ».
Chloé, une jeune adulte arrive un matin, mal à l’aise, inquiète, perdue. Au bout d’un moment, elle parvient à dire à Sylvie, l’intervenante qui « l’accueille » : « Maman ne voudra pas que je reste ce week-end. »
- « Tu crois ? Veux-tu qu’on lui passe un coup de fil ? »
La mère répond au téléphone qu’elle est tout à fait d’accord. Grand sourire de Chloé, grand soulagement. Elle peut entrer dans sa journée au foyer.
Peut-on trouver plus simple ? Moins coûteux ?
L’inquiétude de Chloé a trouvé une place dans le psychisme de Sylvie, l’accueillante, commente pour nous l’animateur qui insuffle la discussion dans le public. C’est un travail au ras des pâquerettes, c’est le travail du quotidien, dit-il.
Dans ce même foyer, Mathieu sourd et autiste s’occupe du jardin avec Anthony, l’homme de l’entretien. Mathieu a besoin de deux brouettes, une pour jardiner, et une autre pour aller d’un point à un autre. Anthony propose une explication à ce comportement. Il y voit un parallèle avec ses propres déplacements : le matin, il arrive au travail avec sa voiture personnelle, mais ensuite il circule avec une voiture de fonction. Si Anthony utilise deux véhicules, Mathieu peut bien avoir deux brouettes.
J’aime savoir ce genre de choses. On peut considérer que ça ne sert à rien d’élucubrer sur les deux brouettes de Mathieu, pourtant, le fait qu’Anthony, l’homme de l’entretien, en parle en groupe d’analyse des pratiques, n’est certainement pas sans effet pour Mathieu. Lui aussi a trouvé une place dans le psychisme d’Anthony.
Il y a encore Martin, qui ne parlait pas, qui ne choisissait ni ne décidait jamais rien. Un jour, il est planté, passif comme à son habitude, devant le potager de l’institution. Il y a des roses qui poussent. Et le jardinier entend Martin prononcer : « Elles sont belles, ces roses, les couleurs…
- Martin, ça te plairait de t’occuper des roses ? »
Et il paraît que le Martin en question s’est mis à tenir un cahier avec toute une documentation sur les couleurs des roses.
Encore un petit rien du quotidien, choper cette phrase au vol elles sont belles les roses… c’est tellement simple que ça peut passer incognito.
L’équipe a découvert beaucoup de ces petits riens dans l’après-coup. Marion se chargeait de prendre note le plus fidèlement possible de tous leurs échanges en réunion, et c’est ainsi qu’ils les ont vus émerger, les petits riens. « On s’occupe de ce qui les préoccupe », voilà ce que les intervenants de cette équipe s’appliquent à faire. C’est difficile de traduire ça. Les gens des bonnes pratiques, les évaluateurs, ceux de la qualité, ils ont des mots, eux !
Mais quels sont les mots pour parler des petits riens, de l’air de rien ? Il faut raconter, faire histoire, on ne peut pas les mettre en fiche, en cases à cocher et ils n’ont rien à voir avec la fameuse traçabilité. Ça prend du temps de raconter une clinique du détail, qui se loge dans les interstices. Et c’est cela que le management, les technocrates, veulent éradiquer.
Dans le public, une jeune psychiatre, pleine de bonne volonté et dont on sent l’enthousiasme pour tout ce qu’elle découvre ici, pose beaucoup de questions : « Comment faites-vous face à la violence ? Comment faites-vous quand un malade déambule la nuit ? »
Les réponses sont souvent cafouilleuses… puis soudain une intervenante s’enflamme :
« Mais il n’y a pas de réponse à ces questions ! C’est comme quand on demande comment faites-vous pour parler à un autiste ! Il n’y a pas UNE manière de parler à un autiste ! C’est à voir au cas par cas ! Comment voulez-vous que je vous dise quoi faire avec quelqu’un qui déambule la nuit ! J’en sais rien ! Y a pas un secret ! Je passerai d’abord une nuit avec, et ensuite je vous dirai ce que j’ai inventé avec lui ! »
Le public frétille d’aise…
Je me souviens d’une autre équipe, qui avait affaire à une direction bien plus retorse. Ils semblaient au bord du découragement, prêts à lâcher, parce que chaque journée devenait une lutte de résistance. Ils travaillaient avec un public en très très grande difficulté, qui ailleurs croupirait, nous ont-ils expliqué. Puis se reprenant : non, il n’y a même plus de lieux où croupir, ils retourneraient chez leur mère, qui serait obligée de s’y consacrer…
Dans leur institution, ils avaient des dispositifs, avec des réunions, des temps de parole, mais ces dispositifs étaient comme vidés, dans les réunions il ne s’y disait rien qui compte.
Un exemple : tous les soirs, ils avaient l’habitude de cuisiner avec les malades. Un beau jour, en réunion, on leur propose : vous ne voudriez pas qu’on demande aux cuisines centrales de vous porter les repas ? Vous n’en avez pas marre de faire les courses et la cuisine tous les jours ? Allez, on va faire appel aux cuisines centrales, vous perdrez bien moins de temps !
Et voilà. Exit tout ce temps de partage qui était plein de ces fameux interstices, où les petits riens advenaient.
Nous, dans le public, on a envie de leur dire : « Mais pourquoi vous êtes-vous laissé faire ? Il fallait refuser les plateaux ! Il n’y a pas de loi pour qu’un directeur vous impose des plateaux-repas ! »
Oui mais… visiblement, ils sont parfois à bout et ne parviennent plus à lutter sur tous les fronts. Leur force, c’est qu’ils sont nombreux à résister ensemble. Mais au fil du temps, avec les départs en retraite, les mutations, leur groupe s’amenuise. Leur institution a mis trente ans à se construire nous disent-ils, ils y ont cultivé la subtilité, et de prétendus experts arrivant d’on ne sait où fragilisent leur édifice en un rien de temps… C’est triste. On les sent malheureux.
J’ai écouté encore des propos indignés : « Si tu es schizophrène et si tu ne veux pas rentrer dans un protocole, et ben, il ne te reste que la rue… ». Se peut-il que des dirigeants bien-pensants puissent dire que si le schizo erre dans la ville, c’est qu’il l’a bien cherché ? Hélas, pour les équipes concernées, il n’y avait pas de doute.
Une psycho ajoute : Pourtant, on le sait que les méthodes managériales font du mal… Même à eux, ceux qui les imposent, elles font du mal. On le sait, on les reçoit tous dans nos cabinets ! Et leurs conjoints, et leurs enfants ! ça les déglingue tous ! »
Le public médite…
L’animateur de l’atelier essaie de regonfler les cœurs usés et fatigués. On reparle de résistance. Ainsi, quand l’administration nous oblige à écrire dans le style rédactionnel qu’elle chérit de plus en plus, sous forme de projets, d’objectifs, d’évaluation etc. eh bien il faut le faire ! Il faut écrire ! MAIS d’une autre manière. D’une manière à nous, qu’il faut cultiver, mitonner et faire croître. Par exemple, pourquoi ne pas écrire des fiches d’événements désirables ? On se prend à rêver. Si chaque soignant se mettait à rédiger tous les écrits imposés en puisant dans sa poésie et liberté personnelles, dans ses rêves et désirs d’un travail qui garde sens et dont on peut être fier ? Si quand un directeur, ou une Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) déchire votre copie, et vous ordonne de la refaire de la façon conforme, la seule recevable, si vous en refaites une du même acabit ? Et comme ça encore et encore, et tous vos collègues feraient pareil, et des pages et des pages d’événements désirables s’écriraient et se répandraient à tous les échelons de tous les établissements, publics ou privés, et on se les passerait sous le manteau d’abord, puis sans vergogne on les afficherait sur les murs des salles de repas, des couloirs, et on sourirait, puis on rirait ouvertement en se poussant du coude : « Tu te rappelles comme on était couillons quand on remplissait des tableaux et qu’on cochait des cases ! »
Les Rencontres de Saint-Alban font bouillonner de telles idées…
Pour revenir à tous ces « moments de riens » rapportés par les équipes, il faut bien comprendre que, même s’ils peuvent évoquer une colonie de vacances, ils ont une autre fonction et raison d’être que celle d’être agréables et distrayants. Il s’agit de petits riens qui contiennent les désarrois, qui apaisent les angoisses, qui soignent peut-être, qui sait ? S’ils soignent un peu ou beaucoup, c’est parce qu’ils sont l’indice, la marque, la preuve qu’il y en a au moins un pour qui l’on compte, au moins un qui vous porte attention. Les corps sont tissés de langage, même si la personne ne parle pas. Trouver la bonne manière d’entrer en contact avec un malade, c’est une affaire subtile, tout en délicatesse, de gestes et de mots, au bon dosage, et jamais une fois pour toutes, et jamais transposable à un autre malade. Mais, à rencontrer un autre et lui parler, il arrive que quelque chose se passe, et alors ce quelque chose s’inscrit dans le corps et y reste, on n’est plus tout à fait pareil avant et après, cela peut changer une vie.
La psychothérapie institutionnelle cherche à créer les conditions pour que de tels effets, minuscules en apparence, puissent se produire.
À la clinique de La Borde, où l’on perpétue le travail de Jean Oury, le prix de journée est de 115 euros. Et cela permet de dégager un bénéfice. Les hôpitaux publics ont un prix de journée cinq fois plus élevé, et sont en déficit.
Alors ?