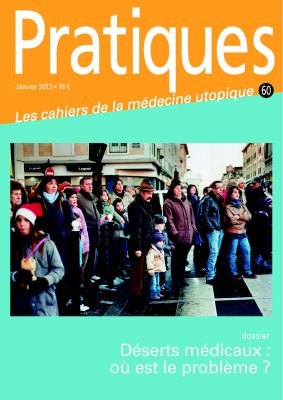Laurent Brutus,
Médecin généraliste
Après plus de treize années passées à bourlinguer en Afrique et en Amérique du Sud, pour y conduire des recherches en santé publique pour le compte d’un institut français de recherche, je suis rentré définitivement en France fin 2006. Jusqu’alors mon approche était surtout centrée sur la maladie et les systèmes de soins. J’étais fonctionnaire, nommé dans une faculté parisienne et je partageais mon temps entre Paris et la Vendée où je résidais. C’est en nouant des contacts avec des collègues pédiatres pour la mise en place d’un système de dépistage néonatal d’une affection parasitaire et en fréquentant assidûment les urgences pédiatriques d’un hôpital parisien que j’ai redécouvert l’intérêt de la démarche clinique et d’une approche centrée sur le patient. J’avais bien effectué des remplacements à la fin de mes études, mais cela faisait des années que je n’avais pas exercé la médecine générale.
Comment pouvais-je me remettre à niveau et quelles étaient les obligations légales pour revenir à la médecine de soins ?
Telles ont été les questions que j’ai alors posées au conseil départemental de l’Ordre des médecins. La réponse fut claire : mon diplôme me permettait de m’installer et je n’avais qu’à entrer en contact avec des groupes de formation professionnelle continue. Insatisfait par cette réponse, j’ai alors contacté le département de médecine générale de la faculté de médecine de Nantes qui m’a proposé de suivre un diplôme d’université de réorientation vers la pratique de la médecine générale. Cette formation tutorée, en alternance, a été financée par mon employeur dans le cadre d’un projet de réorientation professionnelle. Durant deux années, un peu comme un interne de médecine générale, j’ai suivi des enseignements (cours et séminaires de formation professionnelle continue) et effectué des stages chez le praticien ainsi que des remplacements et rédigé plusieurs récits de situations complexes et authentiques (RSCA). J’ai obtenu le diplôme fin 2011, j’avais alors 50 ans.
Durant tout ce temps, l’idée de m’installer dans ma commune de résidence s’est progressivement imposée. Je connaissais le cabinet médical où exercent trois femmes médecins en partage de patientèle et accueillant des internes en médecine. Je les avais remplacées toutes les trois. Le collègue masculin, fondateur du cabinet, venait de prendre sa retraite. Il s’agit d’une zone rurale du nord-ouest vendéen, située à proximité d’un centre hospitalier et à moins d’une heure de Nantes. Je m’y suis donc installé en collaboration libérale à mi-temps en début d’année 2012. L’autre moitié du temps, je demeure fonctionnaire, travaillant au département de médecine générale de Nantes pour y développer des programmes de recherche.
Si mon installation n’a pas posé de problème, l’évolution de la démographie médicale constitue cependant un sujet de préoccupation.
Le nord-ouest vendéen (littoral, marais et bocage) n’est pas à proprement parler une zone de désert médical. Pourtant, nombreux les médecins généralistes qui partent à la retraite et ne sont pas remplacés.
Certaines zones alentour sont devenues tellement déficitaires qu’il a fallu regrouper trois secteurs de garde afin de maintenir à flot la permanence des soins. Depuis 2011, dans ce « grand » secteur (une cinquantaine de médecins généralistes pour 59 000 habitants l’hiver et 111 000 l’été), huit médecins sont partis et seulement trois sont arrivés. Cette « mise en commun » des moyens humains ne s’est pas faite facilement, car il a fallu dépasser les individualismes encore très forts, notamment chez les collègues plus âgés (une dizaine d’entre eux devrait d’ailleurs partir dans les deux prochaines années). C’est ainsi que le projet de créer une maison médicale de garde est resté au point mort, chacun préférant assurer les gardes depuis son propre cabinet au détriment de l’intérêt des patients de consulter en un lieu unique.
Ces difficultés, les médecins ne sont pas les seuls à les percevoir. Les nouveaux patients se plaignent de ne pas trouver de médecin traitant. Certains vont même aux urgences de l’hôpital pour faire renouveler leurs ordonnances. Lors d’une réunion houleuse convoquée à l’initiative du Conseil de l’Ordre pour parler de ce problème, il a même été reproché aux collègues pratiquant une médecine « lente » ou exerçant à temps partiel de ne pas travailler assez ! Comme si, en réponse à la volonté acharnée des politiques pendant des années de réduire les dépenses de santé en réduisant le nombre de médecins, il revenait aujourd’hui à ceux qui restent de multiplier les actes pour faire face aux besoins.
Or l’offre locale de soins n’est pas seulement limitée en médecins généralistes. Les spécialistes libéraux du secteur (trois cardiologues, deux dermatologues, deux rhumatologues, un ORL, un angiologue, un pneumologue et un stomatologue) sont âgés pour la plupart et aucun n’envisage sereinement sa succession. Si bien que les délais et les distances pour accéder aux spécialistes s’allongent. En conséquence, les coûts indirects (transport, journée de travail perdue...) pour se soigner augmentent et les inégalités d’accès aux soins se creusent.
Il y a bien sûr le centre hospitalier, dynamique, qui a notamment salarié les médecins de l’Île d’Yeu voisine afin de faire face à une démographie médicale vacillante. Mais ce salariat demeure très dépendant du paiement à l’acte qui représente la seule recette pour la maison de santé et les médecins sont davantage enclins à consulter qu’à mener d’autres activités, notamment préventives. Le centre hospitalier dispose d’une offre de soins conséquente (médecine, chirurgie, obstétrique), mais le service des urgences y est régulièrement saturé et s’il existe un scanner, il n’y a pas d’IRM.
Le nord-ouest vendéen est ainsi une zone de marge située à égale distance entre deux pôles sanitaires (Nantes et La Roche sur Yon) et finalement assez peu desservie. Il faut faire soixante kilomètres pour trouver un service de pédiatrie ou de soins intensifs neuro ou cardiovasculaires. Selon les dernières statistiques de l’Agence Régionale de Santé (2011), la mortalité prématurée des moins de 65 ans (souvent de causes évitables liées aux conséquences des inégalités sociales, aux carences du système de soins et à l’absence de politique de prévention) y est parmi les plus élevées de la région Pays de la Loire.
Malgré tout, le nord-ouest vendéen demeure une zone de forte attractivité pour de nouveaux habitants. Le solde migratoire y est largement positif, avec un taux de croissance annuelle moyen de 2 %, alors qu’il est inférieur de moitié dans le reste de la région. Les communes rivalisent pour accueillir cet afflux de population composée à la fois de jeunes travailleurs et de seniors et les programmes municipaux ou privés de lotissements se multiplient. La population augmente et continuera d’augmenter, mais le nombre de médecins (notamment généralistes) ne suit pas. Et personne n’a pensé prévenir ces populations qu’elles ne trouveraient peut-être pas de médecin en arrivant. Les communes concernées et le Conseil Général ont bien tenté de pallier ces carences en faisant appel à des médecins à diplômes étrangers, mais ces offres d’installation sont demeurées prisonnières du vieux schéma qui veut que chaque commune ait son médecin libéral. Près d’une quinzaine de confrères roumains ont répondu à ces offres d’exercice solitaire dans des petites communes vendéennes. Mais faute d’intégration à la fois humaine et professionnelle ou de patientèle suffisantes, ces expériences se terminent souvent prématurément. Pourtant, les actuels internes en médecine générale ne refusent pas de venir travailler en zone rurale, mais ils plébiscitent un exercice à temps choisi, en groupes pluri-professionnels avec un lien universitaire fort (généralistes-enseignants et Maîtres de stage pour l’accueil d’étudiants en médecine). En rejoignant un groupe de collègues ayant opté pour une médecine qui prend son temps, engagés dans la formation initiale des jeunes générations et dans un groupe d’échange de pratiques, j’ai fait un choix similaire et je ne regrette pas du tout ce retour vers la médecine générale.
Toutefois, l’avenir peut apparaître bien sombre. Parmi la cinquantaine de médecins généralistes du secteur, seule une vingtaine exerce en cabinets de groupe d’au moins quatre médecins. Les autres travaillent seuls ou à deux. Ce mode de fonctionnement n’attirera pas les jeunes générations. Dans les communes en difficulté, il conviendrait sans doute de favoriser l’émergence de regroupements de professionnels du soin d’horizons divers autour de projets de santé garantissant un meilleur accès aux soins et une participation active à la formation initiale et continue.