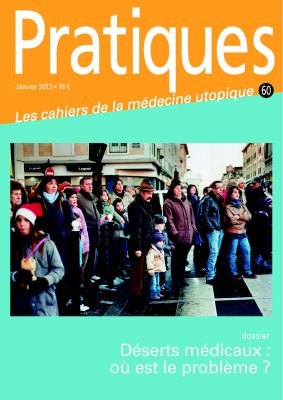Christiane Vollaire,
philosophe
En 1976, Yves Lacoste publiait un ouvrage au titre intentionnellement provocateur La Géographie, ça sert d’abord à faire la guerre. Et il lançait la revue Hérodote, du nom du premier véritable historien de la Grèce antique, dont le travail sur les guerres menées à son époque reposait sur un profond rapport à la géographie. Le terme de « géopolitique » devenait alors significatif de ce rapport polémique au territoire, et des intérêts stratégiques qui s’y nouaient.
Or cette problématique guerrière s’applique on ne peut mieux à la question du médical. Georges Canguilhem, philosophe de la médecine, montrait déjà à quel point le rapport médical à la maladie se traduit toujours en termes de lutte, d’affrontement et de conquête, et relève fréquemment du vocabulaire militaire. Ce qu’il nous faut plus que jamais affirmer actuellement, c’est que viser la santé n’est plus seulement lutter contre la maladie, mais lutter contre les puissances économiques et politiques pour lesquelles elle est devenue un simple enjeu de profit.
C’est dans cette perspective, où l’ennemi prend trop souvent la forme d’institutions soumises au régime entrepreneurial, qu’une géopolitique médicale doit bel et bien servir d’abord à faire la guerre.
Un espace stratégique
Un territoire n’est pas seulement un terrain, c’est un espace stratégique où se nouent des relations de pouvoir. Et si le pouvoir de l’institution médicale a bien été l’enjeu d’une conquête, les contre-pouvoirs qui s’y font jour doivent pouvoir le devenir aussi. Dans le quadrillage territorial actuel, miné par les priorités libérales, c’est une reconquête qu’il faut viser pour faire place à la réalité d’un espace public.
L’enjeu en est complexe, et l’essor exponentiel du libéralisme à partir des années quatre-vingt-dix l’a rendu plus aigu, engageant à des reconfigurations de la pensée du territoire telle qu’elle pouvait se présenter dans les années 1970 ou 1980. Dans la pensée de Michel Foucault en particulier, la manière dont s’engage le rapport entre espace public et liberté est déterminant. Pour Foucault, il s’agit toujours d’un rapport conflictuel. Il l’écrit clairement dans un entretien de 1982, intitulé « Espace, savoir et pouvoir » : La liberté des hommes n’est jamais assurée par les institutions et les lois qui ont pour fonction de la garantir [1].
Cette phrase est explicitement dirigée contre Le Contrat social de Rousseau qui avait posé, en 1762, le fondement du concept de liberté civile : celle-là même qui n’est garantie que par les lois. Et Foucault désigne, d’un point de vue historique, le quadrillage du territoire français en particulier qui va se mettre en place à partir du XVIIIe siècle, sous l’effet de la centralisation post-révolutionnaire issue de la pensée de Rousseau : « À partir du XVIIIe siècle, tout traité qui envisage la politique comme l’art de gouverner les hommes comporte nécessairement un ou plusieurs chapitres sur l’urbanisme, les équipements collectifs, l’hygiène et l’architecture privée » [2].
Il montre comment l’État centralisateur du XVIIIe siècle est conduit à considérer l’intégralité du territoire, y compris rural, sur le modèle de l’espace urbain. Ce modèle est celui du quadrillage, dans lequel l’habitat occupe une fonction intégralement déterminée par l’espace commun, et où toute architecture est pensée dans une problématique strictement urbanistique. Les règles de l’urbanisme régulent le rapport à l’intégralité de l’espace national, incluant dans le public ce qui jusque-là relevait de l’espace privé.
Et bien sûr, un tel modèle, dans sa rationalité organisatrice, est aussi à bien des égards liberticide : Foucault met en évidence une forme de gouvernementalité qu’il identifie au panoptique créé au XVIIIe siècle par Bentham pour rendre tout espace visible au sein des prisons. Le modèle urbanistique apparaît ainsi comme analogique du modèle carcéral : les sociétés de contrôle ôtent tout moyen d’échapper au regard de l’État.
Peuple et population
La géographie est ici manifestement l’instrument d’une guerre de l’État contre la liberté des citoyens, le moyen de leur assujettissement. Contrôler un territoire, c’est assurer, par l’emprise géographique de sa mise en carte, la soumission de ses habitants : la transformation d’un peuple en population, qui doit devenir objet d’une gestion. C’est ce mode de gestion que Foucault a présenté lors de son cours au Collège de France « Sécurité, territoire et population », en 1978 : Gérer la population ne veut pas dire gérer simplement la masse collective des phénomènes ou les gérer simplement au niveau de leurs résultats globaux ; gérer la population, ça veut dire la gérer également en profondeur, en finesse et dans le détail [3].
D’où la définition que donne Foucault du territoire dans un entretien qu’il accorde précisément en 1976 à la revue Hérodote : « Territoire, c’est sans doute une notion géographique, mais c’est d’abord une notion juridico-politique : ce qui est contrôlé par un certain type de pouvoir » [4].
Et plus loin : « Dès lors qu’on peut analyser le savoir en termes de région, de domaine, d’implantation, de déplacement, de transfert, on peut saisir le processus par lequel le savoir fonctionne comme un pouvoir et en reconduit les effets » [5].
Associer à la notion de territoire celle de déplacement ou de transfert, c’est inscrire la question des mouvements de population dans celle de l’espace territorial : le territoire, précisément parce qu’il est une notion juridico-politique, n’existe que par les implantations de population et les dynamiques démographiques qu’il génère. Il n’est pas un espace objectivable et définitif, mais un espace en mutation, incessamment reconfiguré par les flux de population dont il est le lieu, et qui en font précisément ce qu’il est : un enjeu de gouvernementalité.
Mais de cet enjeu, la revue Hérodote, interrogeant Foucault, met immédiatement en œuvre l’ambivalence : « Les métaphores spatiales, loin d’être réactionnaires, technocratiques, abusives ou illégitimes, sont plutôt le symptôme d’une pensée “stratégique”, « combattante », qui pose l’espace du discours comme terrain et enjeu de pratiques politiques » [6].
L’enjeu territorial n’est pas seulement un enjeu de pouvoir, mais tout autant de contre-pouvoir. Il permet de revendiquer, à l’encontre d’une politique définie comme forme de gouvernementalité, une politique définie comme possibilité de réappropriation de l’espace public. On passe alors d’une stratégie de domination à une stratégie de combat. Et Foucault dit à son interlocuteur à la fin de l’entretien : « J’ai bien aimé cet entretien avec vous, parce que j’ai changé d’avis entre le début et la fin. [...] La géographie doit bien être au cœur de ce dont je m’occupe » [7].
Que signifie ce retournement ? Très précisément ceci : il est possible qu’une population puisse redevenir un peuple, mais c’est à la condition qu’elle revendique comme sujet d’un intérêt commun les espaces territoriaux à travers lesquels elle n’a été traitée que comme objet de pouvoir. Et cela suppose un véritable regard stratégique sur la question du territoire.
Les ambivalences de la notion d’État
Une telle ambition est bien une ambition polémique : il s’agit de reconquête. Et cette reconquête passe par celle de l’espace du soin.
Mais les modalités en sont plus complexes dans les années deux mille dix qu’elles ne l’étaient à la fin des années soixante-dix.
Quand Foucault mettait en évidence la filiation entre le contrôle politique qui se mettait en place au XVIIIe siècle autour de la période révolutionnaire, et celui qui organisait la biopolitique de la deuxième moitié du XXe siècle, il considérait à juste titre la maîtrise de l’espace territorial comme une simple modalité du pouvoir sur les populations, dont il attribuait la puissance à l’État.
À la période contemporaine, ce qui est en question est l’autonomie même de l’État, et les nouveaux rapports de domination induits par l’ultralibéralisme comme système de pouvoir. L’État, ayant perdu même la souveraineté qu’on pouvait lui imputer, n’y est plus que le relais de formes de pouvoir économique plus insidieuses, dont le contrôle est devenu radicalement antagoniste de toute forme d’intérêt collectif.
Quand l’organe « de régulation » qu’est le Fonds Monétaire International fait entrer dans ses préconisations le sabordage des politiques publiques, la santé de la population, même à titre de moyen de contrôle, cesse d’être un objectif qui peut orienter la politique d’un ministère : elle devient un facteur de déséquilibre économique en tant qu’objet de dépense publique. Et ce changement de paradigme est en soi une guerre contre l’intérêt collectif. Le néolibéralisme, non pas comme option locale ou nationale, mais comme mode contraignant de gestion politique internationale, transforme la planète entière en territoire désocialisé, et la multiplicité des peuples en un flux indifférencié de populations gérées dans une économie véritablement bétaillère : envoyées à une sorte d’abattoir sanitaire.
En ce sens, la réappropriation d’une carte sanitaire est un enjeu autant matériel que symbolique : celui d’une lutte stratégique, qui nécessite la désignation claire de l’ennemi. Dans les années deux mille dix, ce n’est plus l’État en tant que tel qui domine ; mais l’assignation de l’État à sa responsabilité est devenue au contraire une nécessité de la lutte contre les dominations supra-étatiques.
Il faut donc repenser à nouveaux frais la formule de Foucault : « La liberté des hommes n’est jamais assurée par les institutions et les lois qui ont pour fonction de la garantir » [8].
Et ce de deux façons : d’une part notre liberté ne peut se défendre qu’à l’encontre des préconisations ultra-libérales, si l’on considère que ce sont désormais ces « lois »-là qui prétendent au niveau international la garantir.
D’autre part, notre liberté ne peut se défendre qu’en renvoyant l’État à sa véritable fonction, la seule qui puisse le légitimer : celle, justement, de garantir cette condition fondamentale de la liberté que représente la santé publique. À l’encontre des préconisations ultra-libérales qui visent essentiellement à la détruire.
Une offensive contre les féodalités économiques
Dresser une carte est toujours le premier acte d’une offensive. C’est donc à reprendre l’offensive qu’appelle nécessairement la dénonciation des déserts médicaux. Car ceux-ci ne sont évidemment nullement l’effet du hasard ou de la fatalité, mais au contraire l’effet d’une intention délibérée : celle de l’abandon. C’est une stratégie que de viser à la concentration des lieux de soin : celle qui vise un objectif strictement économique de rentabilité, à l’encontre d’un objectif de service public. Et de ce point de vue, ce type de stratégie sanitaire est exactement équivalent de celui de l’élevage intensif : le regroupement en vue de l’augmentation des profits. On est donc bien dans cette logique où l’Organisation Mondiale du Commerce prend le pas sur l’Organisation Mondiale de la Santé, faisant de la santé un « bien » séparé de tout rapport à la subjectivité. Et transformant donc potentiellement les êtres humains en bétail, dans l’aboutissement de la logique objectivante qui dégrade les peuples en populations.
La représentation de la santé comme « bien » est ici corrélative de la représentation du corps comme objet commercial. Et la marge entre la marchandisation de la santé et le trafic d’êtres humains est bien mince : est-il étonnant que les trafics d’organes se développent de manière exponentielle, dans le temps même où une certaine conception de la médecine n’accorde pas le même statut à tous les corps, précisément parce qu’elle n’accorde aux hommes que le statut de leur valeur marchande ?
Face à ces stratégies destructrices, la volonté de pérenniser ou de recréer des lieux de proximité ne doit en aucun cas passer pour une sorte d’effet réactif ou de visée nostalgique. Elle est exactement tout le contraire : les déserts médicaux n’ont cessé d’être la réalité misérable des périodes où le territoire était dominé par les féodalités. Des périodes précisément antérieures à l’exigence posée au XVIIIe siècle par la pensée des Lumières, de fonder un espace public, et d’en cartographier l’organisation. Ce que préconise la marchandisation de la santé, c’est précisément ce retour au féodal, aux clivages sociaux et à l’omniprésence des rapports de domination, dans un monde où les classes moyennes, comme facteur d’équilibre social, n’avaient pas encore émergé.
Et l’amélioration des conditions d’existence collective et d’hygiène commune est effectivement le premier signe d’un accès à l’équilibre social, même s’il n’en est évidemment pas la seule condition. Appeler à organiser une carte sanitaire qui tienne compte des besoins réels des personnes et des groupes, ce n’est justement pas réduire les sujets au biologique, mais au contraire leur permettre de s’en émanciper, en se reposant sur les institutions de cette angoisse permanente du devenir du corps qui mobilise ceux à qui ne sont pas donnés les moyens de se soigner. L’exigence d’une santé publique est en ce sens une véritable stratégie d’émancipation.
Sur les territoires qui ont été soumis aux féodalités coloniales et continuent de l’être aux prédations de leurs dirigeants, on voit les chefs d’État malades obligés de se faire soigner dans les pays de leurs anciens colons : l’absence de santé publique se retourne contre ceux-là mêmes qui en sont l’origine. La revendication géopolitique d’un équilibre sanitaire n’est donc pas seulement le refus d’un retour aux féodalités, elle est aussi une stratégie de lutte contre cette nouvelle forme de guerre de conquête coloniale que constitue la globalisation. En ce sens, l’accessibilité des soins, comme l’exigence d’un aménagement équitable du territoire, vont autant de pair avec le refus des féodalités financières qu’avec celui des féodalités médicales. Elles ne supposent donc pas seulement des décisions géopolitiques, mais un véritable impact sur les mentalités générées par l’institution médicale : défendre une médecine de santé publique, c’est défendre une attitude de médecins citoyens. C’est donc entrer en guerre contre les féodalités médicales qui ne peuvent que s’inscrire dans la logique d’une marchandisation des corps.