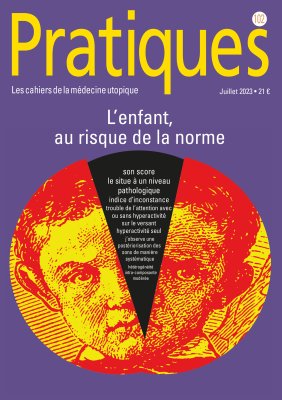Pascale Rosenberg, psychiatre
Les professionnels de la santé, et particulièrement ceux qui travaillent en psychiatrie, dénoncent autant qu’ils le peuvent sur tous les tons la disparition progressive de leur métier. Tant sur le plan qualitatif, spécifique, que quantitatif. Celle-ci est déterminée par les pouvoirs publics depuis au moins une trentaine d’années et s’organise grâce essentiellement à une dégénérescence du concept psychique.
PSYCHEE… Psych… Psychut… psy-chose… Pchitt ! chute de la psy !
Si bien qu’il ne reste aujourd’hui qu’un développement réducteur à propos de « santé mentale ». Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les raisonnements professionnels s’expriment à la manière et à la mesure des autres concepts sur lesquels reposent les « soins » médicaux dans leur ensemble. C’est-à-dire que les seules réponses qui semblent pouvoir être apportées sont dictées par un corpus fonctionnant sur un système de promotion et d’ambition universitaires. À savoir que de nos jours, la médecine s’appuie d’abord et avant tout sur des arguments visuels et « objectivables ». L’imagerie en étant le paradigme (nous serions dans une société de l’image nous dit-on), avec même relégation au second rang des données biologiques qui, sans doute, nécessitent encore trop d’interprétations que les normes ne suffisent pas à encadrer. Je ne parle pas de la génétique qui connaît son heure de gloire économique en attendant que les microbiotes ne la lui fauchent. La médecine ne paraît obéir, pour l’heure, qu’à Saint-Thomas, ne prenant en compte que ce qui se « voit » pour y CROIRE. Et c’est bien sur ces deux principes que notre société mondiale semble vouloir catégoriquement s’organiser. Nous assistons à l’émergence d’un nouveau dogme auquel nous sommes non seulement priés de croire sans discussion, mais auquel nous devons nous soumettre sans conditions sous peine de graves rétorsions. Oui, que se passe-t-il si nous ne voulons pas croire, mais tout simplement poser des hypothèses et chercher si elles se vérifient avec le patient ? Et bien la réponse est simple : plus de sous ! plus de subventions ! dissolution des services ! atomisation des soins ! expulsion des thérapeutes etc. Les considérations éthiques qui ont structuré les démarches scientifiques jusqu’à présent sont désormais classées aux oubliettes dans le fatras des ringardises.
En médecine, il y a belle lurette qu’on a supprimé les hospitalisations pour « observation » devant des symptômes inexpliqués. Du reste, elles font horreur au système de soins privé qui ne sait comment les chiffrer dans son panier pour la facturation au patient. Donc exit.
Par ailleurs, il n’est pas question de laisser la parole au patient pour qu’il exprime de quoi il souffre, ce qu’il RESSENT. D’ailleurs, ce dernier est mis en demeure de savoir dissocier ses troubles de manière à ce qu’ils soient traités séparément, dans des temporalités différentes et éventuellement dans des lieux différents. C’est le PARCOURS de SOINS ! Grâce à cette fameuse organisation, on peut créer des spécialités dans lesquelles exercent des spécialistes qui ne connaissent rien d’autre et ne veulent rien connaître d’autre, car ainsi ils sont promus au grade d’expert.
On voit qu’il n’est plus nécessaire de laisser le patient (sujet pour les familiers de la psychanalyse) s’exprimer. C’est ainsi que lors des dernières négociations, loupées du reste, sur les nouveaux tarifs des consultations, il a été proposé avec insistance aux médecins et paramédicaux d’augmenter leur file active, c’est-à-dire la cadence du défilé des patients dans leur bureau. Ainsi, ils pourront augmenter substantiellement leurs gains. Personne ne songe plus dans cet admirable programme à évaluer les résultats thérapeutiques. On est persuadé, dans les hautes instances politiques qui nous gouvernent, que l’on va remédier au manque de structures de soins, d’accueil, de personnels, de médecins, d’assistantes sociales, de sages-femmes, d’orthophonistes, de psychomotriciens, d’infirmiers etc. TOUT n’étant qu’une question d’ORGANISATION !
Les enfants dans tout cela ?
Bon, déjà il faudrait pouvoir s’entendre à propos de qui est-ce qu’on prétend s’occuper. Les tout-petits ? les jeunes ? les ados ? les jeunes enfants ? les TDAH ? les autistes ? (ah non ! pas les autistes puisqu’ils ne relèvent plus de la psychiatrie d’après je ne sais plus quel secrétaire d’État à je ne sais plus quoi). Les anorexiques ? les déprimés ? les suicidaires ? les bipolaires ? les névrosés ? les psychosés ? les psychopathes ? les retards scolaires ? les hauts potentiels ? les stressés ? De qui doit on s’occuper réellement ? Les définir est absolument IN-DIS-PEN-SABLE car, pour l’organisation, la gestion des soins et des LISTES D’ATTENTE, il faut savoir à quel spécialiste de la spécialité on doit s’adresser, sinon… passez votre tour. Se profile en filigrane l’instauration des priorités. « Comment cela vous vous sentez angoissé ? Pire peut-être, en état de panique et vous voudriez que l’on vous aide à comprendre ce qui se passe ! » Alors, à ce stade la question s’obscurcit davantage car il faut au préalable se soumettre à un incontournable impératif, je veux parler du… DIAGNOSTIC, bien sûr.
Molière a beaucoup parlé du poumon dans sa pièce du Malade Imaginaire. « Le poumon vous dis-je ! ignorantus, ignoranta, ignorantum ! Le poumon !
De nos jours, c’est le DIAGNOSTIC qui répond à TOUT ! Non pas pour proposer un traitement ou un quelconque étayage thérapeutique, une aide etc. Non, non, ne nous y trompons pas, le diagnostic est IN-DIS-PEN-SABLE… pour vous renvoyer chez vous et vous éliminer des listes d’attente des circuits potentiellement soignants ! Mais oui ! Il fallait y penser !
Le diagnostic s’établit dans des centres spécialisés avec des spécialistes du diagnostic selon une liste d’attente très bien organisée et en fonction de normes plus ou moins statistiques sur une imagerie et des tests référés d’abord aux comportements des enfants. Un enfant, de nos jours, ne parle pas, c’est bien connu. Il y a cent ans, on disait d’un enfant qu’il n’était pas sensible à la douleur, ni à la souffrance, ni physique et encore bien moins psychique. L’enfant de 2023 ne sait pas ce qu’il a à dire, donc pourquoi prendre le temps de s’adresser à lui et de chercher à nouer un dialogue avec lui. Puisqu’il n’a pas conscience de ses troubles !
« IL est AGITÉ ». C’est un état. Rien ne sert de le questionner sur CE qui l’agite ! C’est un état et donc LE RESULTAT d’un TROUBLE DU DEVELOPPEMENT. L’affaire est entendue… entre les pouvoirs publics et les capitaux privés.
On voit dans ces conditions combien il est inutile de chercher à « rencontrer » cet enfant.
Les jeunes adolescents que je rencontre dans ma pratique, pour des motifs suicidaires ou des replis mélancoliques, reclus dans leur chambre devant un écran d’ordinateur ou de smartphone, sont tous des jeunes qui n’ont jamais fait l’expérience de la rencontre, du dialogue et de l’écoute. L’écoute consistant, je le rappelle, à laisser l’autre parler et vérifier avec lui si l’on a bien compris ce qu’il voulait nous dire.
C’est ainsi que l’injonction au diagnostic égrène sa petite musique au son de laquelle l’enfant qui n’a rien dit est classé, numéroté et déterminé sur son avenir… d’handicapé. Il est, dès lors, reconnaissable dans les méandres administratifs grâce à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). On peut lui attribuer un traitement médicamenteux éventuellement. Son diagnostic sera son identité, sa personnalité. Il ne saura pas comment on va à la rencontre de l’autre, partager ses questions existentielles et les souffrances qui les accompagnent ; peu importe.
Il faut bien reconnaître que ce merveilleux dispositif de soins, scientifiquement organisé, sans paroles ni rencontres, est parfaitement adapté non pas au patient, mais à la COMMUNICATION ! Elle n’appelle aucune critique ni aucun commentaire. Ainsi soit-il.
A., 18 ans, vient me rencontrer au cabinet car il EST autiste depuis tout petit. De haut niveau. Il parle très bien, s’exprime parfaitement sur ses états d’âme, perspicace, passionné de philosophie et de sciences humaines qu’il nourrit par des lectures assidues sur le Net ou dans les livres. Il est doué d’une grande imagination, créatif, inventif. Il a de bonnes relations avec les adultes, est reconnu par ses enseignants. Il a un bac professionnel dans la chaudronnerie. Avant de venir me voir, il avait été mis sous neuroleptiques pour des manifestations physiques étranges d’un seul bras ou d’une seule jambe qui survenaient de façon tout aussi étrange : des raideurs brusques à mi-chemin entre la crampe et le mouvement involontaire. Au fur et à mesure de nos entretiens hebdomadaires, il laisse entendre que sa parole n’a jamais été vraiment prise en compte. Je me surprends à chercher ce qu’il y a d’autiste chez ce jeune homme. Je finis par le lui dire. Je lui dis également que ses symptômes physiques me font penser à des manifestations anxieuses. Ce qu’il accepte. Mais il est adhérent à son diagnostic d’autiste, car il s’est construit avec dit-il. Il rêve de parcourir le monde dans un camping-car et d’être ainsi INDEPENDANT. Après huit mois d’entretiens, il me dit que cette identité d’autiste lui permet de se protéger et d’échapper à ce qu’il nomme les aberrations familiales.
Tout ce qui vient d’être décrit de la merveilleuse organisation de la réponse aux difficultés psychiques des personnes a-t-il une finalité ? Bien sûr ! Il s’agit de maintenir un ordre social séculaire qui comporte une élite économique recherchant sans cesse à asseoir sa légitimité pour se maintenir. Pour défendre ses prérogatives, il lui faut une non-élite n’ayant accès à aucun moyen de penser, c’est-à-dire de faire entendre sa contestation et son désir de jouir de l’existence à égalité. Ainsi, la suprématie de la classe intelligente et non handicapée est stabilisée. La contestation a ceci de particulier qu’elle concerne surtout la jeunesse.
Ce système de soins prétendument destiné à la jeunesse, en réalité ne fait qu’organiser l’interdiction de l’accès à la pensée et à la culture.
Assigner un enfant à un diagnostic comportemental ne fait que le réduire à ce que l’on voit de lui, en imaginer quelque chose venant faire office d’interprétation sans qu’il soit possible de l’entendre lui-même sur ce qu’il ressent, ni de savoir comment cette gestuelle vient « parler » d’un affect ou d’une douleur de l’existence. Ce qui revient à le condamner à devenir tout à fait un handicapé sans aucune autonomie, ni de penser ni de trouver les moyens de sa subsistance : c’est la définition de l’aliénation.
Paradoxalement, on constate dans nos consultations que ce phénomène concerne actuellement également les classes dites favorisées de la société. Les enfants sont tout autant sidérés dans leur possibilité de penser, sans ouverture culturelle ; ils s’étouffent dans le fonctionnement social, assujettis au « modèle » social imposé, enlisés dans l’obligation de le « répéter », faute de quoi ils s’exposeraient à être accusés de traîtrise à leur milieu. Ils sont donc comme les autres, condamnés à la survie psychique.
Le diagnostic, hormis de structure psychique qui oriente sur les modalités possibles de rencontre avec le patient, n’apporte aucun soulagement ni au jeune ni à sa famille.
C’est le cas de B. ,9 ans qui après quelques semaines d’entretiens au cours desquels il semble vouloir montrer qu’il est dépourvu d’intelligence, d’imagination, d’élaboration intellectuelle, m’explique qu’on lui a fait passer des tests (diagnostiques) afin de savoir ce qu’il avait, pourquoi il ne réussissait pas à être assez intelligent pour réussir à l’école. Il a ainsi compris que l’on souhaitait le ranger parmi les déficients intellectuels. Pourtant ce jeune peut, à présent qu’il a réalisé à quelle injonction il répondait, mettre au travail ses observations du monde dans lequel il vit et inventer sa trajectoire.
Mes préoccupations diagnostiques, lors de mes rencontres avec mes patients, concernent les modalités qui vont permettre de faire connaissance et reconnaissance grâce à une confiance mutuelle.
Alors, il faut du temps, le temps de la rêverie, le temps de pouvoir parler des peurs les plus profondes, le temps d’apprendre à jouer avec les mots et les idées, le temps de trouver la libre circulation dans son esprit. Ce temps-là ne peut pas se compter ni se décompter ni se mesurer ; il n’est pas à comptabiliser au patient, car il est l’expression de la vie et du désir.
Le diagnostic, tel qu’il est imposé par les pouvoirs financiers, remplit un rôle de prédication même pas de prédiction. C’est une injonction à être et non pas à devenir. Un oracle est rendu.
Le sujet doit s’adapter à son diagnostic et en subir les conséquences. Son diagnostic parle pour lui. Comme dans la justice de certains pays où le prévenu doit faire la preuve de son innocence, le sujet patient doit faire la preuve de ce qui l’émancipera de son diagnostic.
La jeune C., 15 ans, vient aux urgences pour tentative de suicide par absorption de médicaments. Elle entend des voix qui lui ordonnent de se faire du mal. Elle est hospitalisée et mise sous neuroleptiques. Pendant son hospitalisation, elle fait part d’attouchements dans son enfance par un étranger à la famille. Les voix persistent et s’intensifient lorsqu’elle dit avoir peur de rester seule avec son demi-frère plus âgé qu’elle. Il a été expliqué à C. et à sa famille qu’elle est probablement schizophrène très malade. Pourtant, lorsque je prends le relai des entretiens, C. parle de sa crainte de trahir sa famille en dénonçant ce qu’elle a subi, ce d’autant que sa famille « préfère » un diagnostic de folie plutôt que les conséquences d’une information préoccupante pour agression sexuelle sur mineure. Ce que nous avons fait malgré tout. Nous n’avons plus revu C., mais les voix avaient disparu.
D. est une fillette de 9 ans. Elle m’est confiée par ses parents parce qu’elle est insupportable de pleurs et de cris le matin avant d’aller à l’école. Elle dit à sa mère qu’elle veut se tuer et que c’est une méchante. Ni elle ni ses parents ne peuvent expliquer ces « crises » du matin. Pendant les rendez-vous, D. se montre joyeuse espiègle, créative, douée d’une fine imagination. Elle parle peu : elle craint les effets de ses paroles quand elle s’adresse à sa mère. Celle-ci est convaincue que sa fille est malade et s’achemine vers la folie. Comme sa propre mère bipolaire. « Il lui faut une hospitalisation pour connaître le diagnostic et les médicaments » dit-elle.
Dans ces deux dernières situations, on voit à quoi sert le diagnostic quand il doit ignorer la parole subjective du patient.
Le diagnostic permet d’assigner la personne à une certaine place et le message sous-jacent signifie qu’il ne faut pas en sortir.
Actuellement, le diagnostic est réduit à des commentaires de l’un sur un autre, à partir de ce qui fait signe pour l’observateur. Il en découle un morcellement et des énumérations dans lesquelles le sujet se perd et qui conduisent à éliminer la question cruciale pour un jeune : QUI SUIS-JE ?