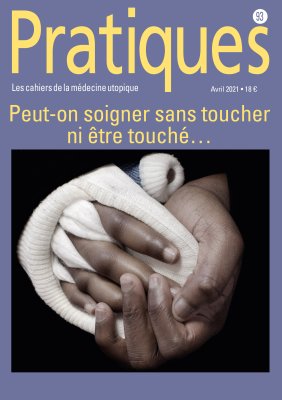Entretien avec Franck Lepage,
animateur au sein de l’association l’Ardeur
Propos recueillis par Françoise Acker, Anne Perraut Soliveres et Jean Vignes
Initiée par Franck Lepage, et développée par des associations d’éducation populaire, la conférence gesticulée, analyse politique nourrie de témoignage autobiographique, est devenue un concept à portée de main des « sans voix » pour relayer une parole politique incarnée et l’encourager chez les autres.
Pratiques : Franck Lepage, tu milites aujourd’hui au sein d’une association d’éducation populaire, l’Ardeur, après être passé par l’animation socioculturelle. Comment en es-tu venu à l’animation ?
Franck Lepage : Je suis suffisamment vieux pour avoir connu les débuts de l’animation. Les jeunes qui y entrent aujourd’hui ignorent que ça a commencé par une contestation des méthodes pédagogiques traditionnelles et donc une contestation de l’école. Ce qui m’a amené là, c’est une espèce d’attitude anti-autoritaire concernant l’école, comme beaucoup de gens de ma génération ou de ma classe sociale. L’autre chose, qui a été analysée par les sociologues, c’est que beaucoup des gens qui entrent dans l’animation ces années-là sont des jeunes en échec scolaire. Quand ils réussissent brillamment à l’école, ils continuent dans les filières classiques de l’élite.
Dans les années soixante-dix, il y a un énorme mouvement de contestation qui va s’éteindre complètement dans les années quatre-vingt. Toutes les remises en cause de l’institution scolaire par les intellectuels vont se ratatiner sous l’argument de l’emploi, déployé et dominant à partir de 1983. L’école ne va plus servir qu’à une chose dans l’esprit des gens : trouver du boulot.
En 1974, j’ai 19 ans, je me retrouve à animer une classe Freinet dans une école libre à Saint-Gervais (avec le bac, on pouvait faire l’école dans le privé), à faire de la pédagogie anti-traditionnelle pendant un an. Assez naturellement, je me trouve aiguillé vers l’animation.
Le deuxième élément, qui va être déterminant, c’est que j’atterris à la faculté de Vincennes en 1978 où la dimension radicale et anti-capitaliste est clairement nommée. J’ai toujours en tête la brochure d’inscription : « Les études d’animation socioculturelle à l’université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 Vincennes sont orientées vers la remise en question de toutes les institutions du capitalisme ». On passe d’un mouvement de rénovation pédagogique, les pédagogies nouvelles (depuis 1920…), à un mouvement politique : comment l’animation peut servir à bousculer l’école, la famille, l’entreprise, la médecine…
Après, je vais mettre un certain nombre d’années à comprendre que l’animation arrive aussi comme mise à mort de l’éducation populaire. L’énergie des années soixante-dix va se trouver embringuée, dans les années quatre-vingt, dans quelque chose qui n’est plus du tout de l’émancipation collective, mais qui devient de l’épanouissement individuel. Grosso modo, les maisons des jeunes et de la culture dans lesquelles je me suis retrouvé à travailler qui, dans les années cinquante étaient des lieux de contre-pouvoir local et animaient des débats sur l’avortement, la guerre d’Algérie, etc., une fois les socialistes au pouvoir, vont se retrouver embringuées dans la théorie du développement local et se mettent au service des municipalités. Assez rapidement, fin des années quatre-vingt, elles ne sont plus que des lieux d’épanouissement personnel, de yoga et surtout pas de contestation qui pourrait déplaire à la mairie.
La décentralisation rend toutes ces associations, qui étaient des contre-pouvoirs, totalement dépendantes des subventions municipales. Ça éteint toute forme de contestation et de radicalité et l’animation dans les années quatre-vingt-dix devient un truc pas dangereux. Je vais contester avec quelques-uns cette forme d’animation et demander le retour à une forme plus radicale qui était celle de l’éducation populaire du mouvement ouvrier.
On est passé du débat au yoga ?
Oui, c’est ça, on est passé de la lutte des classes au développement personnel. C’est pour ça qu’on a une dent contre le développement personnel comme idéologie, pas en tant que pratique personnelle. Toute personne a le droit d’aller chercher de l’apaisement dans ce qu’elle veut, là où ça devient très problématique, c’est que ça tend à devenir une idéologie globale conforme au néolibéralisme : arrêtons le conflit, arrêtons la bagarre, il faut être positif… Sois le changement que tu veux voir devenir… C’est le livre d’Eva Illouz, Happycratie, qui montre comment cette idéologie globale est une idéologie anti-conflictuelle.
As-tu croisé Le théâtre de l’opprimé ?
Oui, à la fin de mes études d’animation. Vincennes a été rasée en 1980 par Chirac et ses bulldozers et déménagée à Saint-Denis dans des conditions qui n’étaient plus du tout ce qu’était Vincennes. Je vais passer du département d’animation au département théâtre en me disant que l’animation prétend aider les autres à s’exprimer, alors que le théâtre c’est comment s’exprimer soi-même. Faire du théâtre à Vincennes, c’est forcément croiser Le théâtre de l’opprimé, je vais même avoir la chance de croiser Augusto Boal. La question que pose le théâtre à Vincennes, contrairement aux études de théâtre dans des facs où on fait de la littérature, c’est : comment faire du théâtre politique, comment se servir du théâtre comme arme politique. Donc Le théâtre de l’opprimé fait partie de ça. D’une certaine façon, je le retrouve aujourd’hui avec le mouvement qu’on a lancé autour des conférences gesticulées, c’est une forme scénique de prise de parole politique, la boucle est bouclée.
La substitution de l’épanouissement personnel à la lutte des classes, tu peux développer ça ?
Ceux qui ont connu cette époque savent que cette période était éminemment politique, d’ailleurs le slogan était « tout est politique ». Ce qu’il faut avoir présent à l’esprit, c’est que les années quatre-vingt sont les années d’une véritable offensive idéologique, coordonnée, très puissante. Ce n’est pas seulement la réhabilitation de l’entreprise, de l’argent qui sont très connues aujourd’hui, mais c’est autre chose, comme la relecture de la révolution française. C’est une offensive qui va passer par du langage, par le ministère de la Culture, qui va nous faire passer le conflit pour le repoussoir de la démocratie, alors que le conflit est une condition de la démocratie. À la fin des années quatre-vingt, avec les premières émeutes urbaines en France, le pouvoir socialiste invente un « ministère de la Ville », qui transforme une lecture en termes de lutte des classes dans les quartiers populaires en problématique urbaniste et qui va théoriser autour de la notion de développement local. Le problème est que si vous réunissez les acteurs et les agents d’un quartier populaire autour d’une table pour faire du développement local, ce n’est plus pour discuter de ce qui ne va pas, c’est plus dans une optique positive et toute critique devient suspecte et condamne le conflit. C’est pour ça qu’on a vraiment des réticences avec la communication non violente, qui est très ambiguë, qui est utile sur certains plans et très néfaste sur d’autres parce que ça élimine l’idée de la conflictualité. S’il n’y a plus de conflictualité, il n’y a plus de démocratie, c’est aussi simple que ça.
Ce qui est en train de se passer en ce moment, avec le discrédit de toute forme de critique de la politique sanitaire actuelle au nom du « complotisme », est, du point de vue de la démocratie, un phénomène extrêmement inquiétant. Les gens, et j’en fais partie, deviennent de plus en plus prudents à énoncer des formulations critiques sur ce qui est mis en place autour de la Covid-19. Parce qu’on se fait immédiatement dégommer par une gauche qui ne trouve rien de mieux à faire que de s’allier au gouvernement pour stigmatiser la critique… et ça c’est vraiment inquiétant. Si toute forme de critique devient complotiste, il n’y a plus de critique possible.
Cela fait partie de l’offensive idéologique. 1973, c’est l’arrivée du paradigme de la crise. La logique de crise est géniale pour faire taire toute forme de contestation. Et comme on y est toujours, une crise qui dure cinquante ans ce n’est plus une crise, c’est le système normal…
Mais ça marche très fort, la télévision ne parle plus que de la crise, on peut faire passer toutes les régressions sociales, tous les reculs des politiques de l’emploi, de la retraite, tout ce qui repart dans l’autre sens à partir des années 1981, c’est au nom de la crise.
Une crise économique, c’est un manque de richesse. La France ne manque pas de richesse, c’est le sixième pays le plus riche du monde, elle a doublé sa richesse en dix-sept ans, elle dégueule de richesse littéralement. Il y a un « pognon de dingue », c’est le premier pays du monde pour le nombre de résidences secondaires. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas des personnes qui en bavent, ça veut dire que la richesse n’est pas distribuée comme elle le devrait.
Faire passer ces inégalités comme une crise, ça va marcher formidablement et ils vont exploiter ce paradigme de la crise tout le temps. Je me souviens de la dernière élection présidentielle, avec le débat entre les sept crétins, ils parlaient tous de la crise.
Il y a aussi l’instrumentalisation de faits divers, les politiques de la peur qui se mettent en place.
Oui, plus un pays est riche, plus il serait dangereux d’y vivre, c’est extraordinaire ! Je ne sais pas si vous vous rappelez les « terrains pour l’aventure », années soixante-dix, c’était dans certaines villes des espaces qu’on laissait aux gosses pour qu’ils fassent ce qu’ils voulaient, n’importe quoi. Vous imaginez ça aujourd’hui ? Maintenant, vous avez des sols en caoutchouc dans les aires de jeu pour pas que les mômes se fassent mal. C’est fabuleux, des exemples comme ça, on peut en citer mille. Je me rappelle une randonnée dans les Hautes-Alpes, on se retrouve dans un gîte le matin et au petit-déjeuner, il y a des petites confitures dans des trucs en plastique et je vois sur l’étagère des confitures qui manifestement ont l’air d’avoir été faites par les gens du gîte. Je demande si on ne peut pas les manger ? Non, ils vont fermer mon gîte si je vous en donne, je dois vous donner des confitures industrielles en plastoc. Ben oui, parce qu’il y a un risque qu’on attrape des microbes quand même, c’est pas rien !
Et là, avec la Covid, c’est du délire. On ne va pas s’énerver sur la Covid parce qu’on va y passer la journée
Si on se laisse aller à rêver, à mettre en évidence toute cette absurdité, c’est tellement énorme qu’on ne peut pas continuer comme ça.
Oui, c’est très puissant, c’est ce que vous faites. La revue Pratiques, ce n’est pas rien. Parce que lancer une contre-offensive idéologique, ça ne peut marcher qu’à force d’agréger des gens qui ne sont pas d’accord. Ça, c’est un peu le travail que vise le mouvement des conférences gesticulées. Tout le langage a été transformé dans les années quatre-vingt en un langage positif, qui est le langage du management également, et pour faire marche arrière là-dessus, c’est difficile. Dans mon petit spectacle de rien du tout, quand j’ai attaqué la notion de projet, de méthodologie de projet, j’ai des gens qui sont venus me remercier : « Ah vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait, je croyais que j’étais folle. En fait s’il y a des intellectuels comme Luc Boltanski, entre autres, qui attaquent la notion de projet, ça veut dire que je ne suis pas folle. » Mais vous comprenez bien que cette personne toute seule face à son obligation de tout faire par projet, elle souffre, elle est dans une injonction paradoxale dont elle ne peut pas sortir, parce que c’est comme attaquer la « démarche qualité ». Comment attaquer la « qualité » ? Personne ne peut être contre la qualité. Or la démarche qualité, c’est probablement un des trucs les plus violents qu’on subisse actuellement en termes de contrôle social, les gens se suicident mais ça s’appelle démarche qualité.
Pour répondre à la question, qu’est-ce qu’on peut faire ? Eh bien faire de l’éducation populaire, faire de l’éducation politique, c’est ce que vous faites, c’est ce qu’on fait, c’est un peu lent, un peu long.
J’utilise peu Facebook parce que je m’en méfie énormément, mais ça m’est arrivé de mettre un post ou deux sur la Covid. Les réactions sont immédiates. Il y a ceux qui m’insultent, qui disent : « Ça y est, Franck Lepage est passé à l’extrême droite, il est tombé dans le complotisme ». Mais il y a tout le bon sens populaire des gens qui comprennent que quelque chose ne va pas du tout, mais qui n’ont plus d’expression à gauche pour le dire. Donc ils sont tout seuls dans leur coin et quand des gugusses comme nous, comme vous, comme moi, envoient un post sur Facebook pour dire : « Non, attendez, le confinement et les hélicoptères qui surveillent les plages, alors qu’on en est à quelques cas de Covid dans les Côtes d’Armor, il y a un truc qui va pas, vous ne confinez pas un pays pour un nombre de cas aussi ridicule ». Il y a tout un tas de gens qui ont dit : « Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait de savoir que je ne suis pas folle ».
La conférence gesticulée, c’est une façon d’exprimer son propre parcours qui fait lien avec les gens ?
C’est cette articulation entre expérience personnelle et analyse politique qui est extrêmement puissante. Si tu ne balances que de l’analyse politique, en gros c’est un tract : on attend que la personne ait tourné le dos, puis on le froisse et on le jette par terre. Si tu n’envoies que du récit personnel, c’est autobiographique, et on va dire : « Ne raconte pas ta vie ». C’est cette articulation entre mon expérience et ce que des intellectuels ont écrit sur la question qui est puissante, parce qu’elle permet au spectateur de dire : « Mais, en fait, moi aussi je vis ça ». Une conférence gesticulée, ce n’est pas un exposé théorique, c’est la façon dont une personne vit cette théorie. C’est une théorie incarnée en quelque sorte. On a été les premiers surpris devant le succès.
Moi j’ai commencé ça en arrivant en fin de droits. J’étais complètement paumé, je n’avais pas envie de retourner sur le marché de l’emploi après avoir passé trente mois aux Assedic à cultiver des poireaux. Et donc, un concours de circonstances fait que je tente une espèce de défoulement un peu bizarre. Je monte sur scène et je raconte deux-trois trucs que j’ai compris dans les quinze années que je viens de passer à essuyer mes pieds sur les paillassons des ministères, et ça marche très, très fort.
Quand on crée une coopérative d’éducation populaire en 2007 qui s’appelle Le Pavé, mes collègues et amis me disent : « On n’est pas là pour faire du théâtre, on est là pour faire de l’éducation politique ». En même temps, la conférence gesticulée amène des gens à s’intéresser à nos formations et à ce qu’on fait. Fidèles à notre désir autogestionnaire de non-spécialisation des tâches, nous allons tous développer cette forme. Alexia Morvan et Anaïg Mesnil vont faire la conférence sur le management, Anthony Brault la conférence sur la fin du pétrole, Gaël Tanguy sur le droit du travail, Emmanuel Monfreux sur la famille, etc. On commence à développer cette espèce de forme, cette espèce d’ovni : je monte sur scène et j’articule de l’analyse politique et du témoignage autobiographique.
Un jour, on va proposer au public, qui a envie de faire la même chose, de laisser ses coordonnées et on récupère une cinquantaine d’adresses. À ce moment-là, on comprend qu’on a mis, sans trop le faire exprès, le doigt sur une forme que les gens se sentent capables d’investir très facilement, alors qu’ils n’ont pas fait de théâtre. Là où on aurait pu s’attendre à ce que les gens disent : « Ah, moi je suis incapable de monter sur scène ». Pas du tout, ils voient une conférence gesticulée, ils voient un homme ou une femme pendant une heure, une heure et demie raconter ses interrogations et ses combats et presque tous se disent : « Ah oui, moi aussi j’ai des trucs à dire, ça, je peux le faire. » Donc on a une forme qui théâtralement est très simple, très pauvre, mais qui a une efficacité politique, militante redoutable. Et ça va aller très vite, ça va devenir une espèce de vague, puisqu’aujourd’hui on est plus de cinq cents, et c’est devenu un concept.
C’est amusant parce qu’au début, j’ai dit ça comme une bêtise, « conférence gesticulée », c’est une idiotie, un gag et maintenant, ça devient un concept, il va y avoir des thèses de doctorat sur la gesticulation. En tout cas, ça devient une forme politique de reprise de parole par des gens qui ne sont a priori pas légitimes pour la prendre. Ceux qui sont légitimes, ce sont les experts titulaires d’une thèse de doctorat à l’École des hautes études en sciences sociales, ceux-là, ils ont le droit de s’exprimer, mais Madame X, qui est assistante sociale, il ne manquerait plus qu’elle ait des idées ! Sauf qu’une assistante sociale a un savoir politique considérable, qu’elle n’a peut-être jamais envisagé comme savoir politique, mais qui est explosif. C’est ce que l’on appelle le mélange entre du savoir chaud (l’expérience) et du savoir froid (la théorie universitaire). Quand on confronte une masse d’air chaud et une masse d’air froid, ça ne fait pas de l’air tiède, ça fait un orage.
Donc voilà, en gros ce qui s’est passé avec les conférences gesticulées
C’est une forme de vulgarisation politique.
C’est drôle parce que dans le vocabulaire, une gesticulation, c’est péjoratif.
Eh oui, c’est pour ça que la droite aura du mal à s’en emparer. C’est malin, mais sans le faire exprès. Mais vous savez, on a cherché un autre mot, mais tout ce qu’on a trouvé ne marchait pas : « conférence politique », tout le monde se sauve, « conférence citoyenne », c’est langue de bois, « autobiographie raisonnée », tu vois la purge, et donc au bout d’un moment on a dit non, ça marche très bien conférence gesticulée parce qu’il y a un paradoxe, ça fait un peu insolent, ça ne fait pas légitime en fin de compte, c’est ça l’astuce.
C’est le bouffon…
Oui, oui et c’est pour ça que c’est malin, ce n’est pas très attaquable, tu peux dire : « Moi je suis un bouffon », sauf que ce qu’on énonce dans une conférence gesticulée, je peux vous assurer que ça parle.
Là je sors d’une semaine de formation avec neuf nouvelles personnes. Nos formations durent seize jours, quatre fois quatre jours, je peux vous assurer qu’au niveau réflexion politique, c’est puissant, on va loin, les gens vont chercher de la matière, de la réflexion. Mais il y a une forme sympathique.
Justement, quelle est la place de l’humour ?
C’est un mystère. À chaque fois, on se pose la question, est-ce qu’il faut que ce soit drôle ? On dit non, ce n’est pas une école de l’humour. Si on fait une conférence gesticulée sur le viol, sur la pédo-criminalité, sur la violence du management ou sur le fait d’accompagner une personne handicapée, ce ne sont pas des sujets marrants. En revanche, je pense que ce n’est pas d’humour dont il est question, mais plutôt d’autodérision. Et ça, ça permet de casser la figure de l’expert.
Tu dis que les gens se reconnaissent ?
Oui, c’est ça qui permet de créer un espace politique pour le spectateur. Ce qui est intéressant, c’est le travail du doute. L’éducation populaire, c’est le travail du doute. Par exemple quand Fehti Brétel fait sa conférence sur la psychiatrie. Il est psychiatre. Ce qui crée un espace pour le spectateur qui l’écoute, c’est de voir partout où il galère, là où il en bave avec l’institution psychiatrique qui est en train de virer à la neuroscience et lui qui essaie de faire ce qu’il peut, et puis, il y arrive ou il n’y arrive pas, ça c’est très puissant parce que ça n’exclut pas le spectateur, au contraire, ça l’invite à rentrer dans un espace où il y a de la place pour lui.
Le récit d’expérience, c’est vraiment bien, comme ce que fait Pratiques, et ça contredit toute une idéologie de la gauche, de l’extrême gauche pendant des années, qui était : « Ne raconte pas ta vie, elle n’intéresse personne ». Il faut qu’il y ait de la chair dans la pensée, c’est ça l’éducation populaire.
On nous dit souvent : « Ça change quoi, les conférences gesticulées ? ». Je n’en sais rien, ça participe de l’élaboration d’un rapport de force, de notre place, là où on est, pour faire basculer le système, l’histoire ne s’arrête jamais, des changements il y en aura, des révolutions aussi.
Le mouvement social, ce que l’on fait, ce que vous faites, c’est contribuer à monter le rapport de force pour le moment où on aura besoin de tout le monde, voilà. On ne peut pas le prédire, on n’est pas des astrologues, ce que je sais, c’est que ça va arriver, c’est sûr je n’ai pas de doute là-dessus. C’est pour cela que l’on a à être là, résister, c’est fatigant mais ce n’est pas déshonorant.