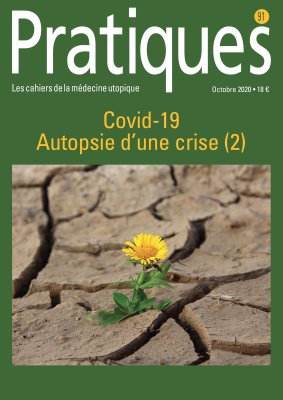Éric Bogaert
Psychiatre
Cette femme petite, menue, qui fait plus jeune que son âge, est discrète, solitaire car désertée, courageuse, tenace même, indépendante et tenant fièrement à le rester, mais fragile, peu sûre d’elle, ne s’aimant pas.
Elle est reconnue travailleuse handicapée par maladie mentale. Après des années entre soins sous contrainte et rejet que, comme elle organisait sa perception du monde, c’était une maladie, et donc de se soigner, elle a progressivement accepté de le reconnaître. Et cette reconnaissance par les institutions. Et de percevoir l’allocation qui l’accompagne. Elle a toujours cherché à travailler, a eu une multitude d’emplois prolétaires et dégradants, en intérim ou à durée déterminée, et courte, évolution faisant. Elle a aidé un temps un compagnon invalide, qui respirait le bonheur, un bonheur simple, à vivre jusqu’à la mort, de sa maladie. Puis elle a trouvé un certain équilibre dans un emploi d’auxiliaire de vie auprès de personnes, âgées ou moins, dépendantes ; emploi à mi-temps qu’elle cumule avec son allocation, comme la loi le permet, même si elle doit souvent se battre contre les institutions sociales pour faire valoir ses droits. Elle a acheté son logement avec ses économies et un don familial.
Elle se sentait suivie par des « psys ». Il faut dire que son père, sa mère, son beau-père, nombre de leurs amis, travaillaient dans ce monde-là. Ils la surveillaient, guettaient ses pensées, ses actes, parlaient d’elle dans son dos, mal, et en mal, vivait-elle. Elle a passé de nombreuses années à les faire parler, à les fuir, à en perdre des boulots, des logements, une voiture, des amis, du temps, et presque la vie. Et bien sûr, le cannabis n’arrangeait pas les choses. Délabrement psychique.
C’est écrit au passé, parce que c’est du passé, depuis qu’elle a accepté d’être suivie par un psy. Enfin par une théorie de psys, au gré des secteurs psychiatriques des lieux où sa vie l’a menée ; par la psychiatrie, quoi !, qu’elle utilise a minima. Et qui le lui rend bien, pour ne pas faire grand-chose, sinon entretenir un rituel scellant un armistice tacite.
Depuis quelques années, ça se présente autrement. C’est l’envahissement insidieux par un effroi torpide, une angoisse qui fige la pensée, ou plutôt la voue exclusivement à l’envahisseur et produit une agitation sociale inappropriée, car irréfléchie, lors-qu’apparaissent, par exemple, dans son logement des cafards. Une cicatrice ! Et le sombre abîme d’une vie sans fond.
Alors, pensez, un virus ! Elle en est envahie. Pas du virus lui-même, mais de l’idée qu’il est peut-être, probablement, sûrement, là, qu’elle pourrait en être infestée, malade – qu’il ait pénétré en elle et y prolifère, ou d’y penser –, et même le transmettre à ces personnes diminuées et démunies dont elle a la charge. Elle est aux aguets, des informations qui ne parlent que de ça, des gens qui ne se protègent pas assez, de ce qu’elle touche, de se laver les mains, de mettre le masque, des moyens d’éviter le virus, ou de se soigner si elle devait être contaminée,… Elle est percluse de ces pensées obsédantes, proliférantes, qui parasitent son existence, et cherche à fuir cette agitation qui l’occupe, la ronge à l’intérieur. Alors elle se garde de tout, s’enferme chez elle, se reproche d’avoir mal fait ceci et cela dans son travail, de mettre en danger les personnes qu’on lui confie, maudit son employeur qui ne lui donnait pas, puis pas assez, de masques, dort mal, téléphone sans cesse à sa mère pour lui parler de tout ça – avoir été psy, il faut bien que ça serve, malgré tout ; et elle est plus proche et surtout disponible que ceux du CMP, qui ne consultaient que par téléphone au plus fort de la crise, et de toutes façons ne reçoivent qu’un quart d’heure tous les trois mois –, déprime…
Au fond, ce n’est plus la même chose, mais c’est encore un peu ça. Ces histoires d’envahissement diffus par des entités invisibles, qui rodent subrepticement, déploient leurs maléfices, ça met en tension des zones psychiques sensibles. Heureusement là, c’est pas imaginaire, mais très partagé socialement ; du coup, s’il y a recrudescence d’angoisse, elle trouve à s’accrocher à du réel et fait lien social – oh, bancal, douloureux, ténu, mais ça tient. Un peu comme le virus avec ses spicules… ça se propage, mais avec une distanciation « sociale », en gardant une saine distance, on se préserve de l’assujettissement. Restent les émois de supporter, à supporter. Algodystrophie.