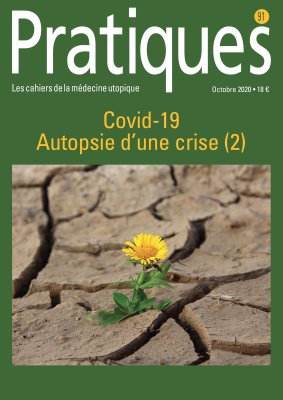Frédéric Keck
Anthropologue, directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale, CNRS
Alors qu’il n’y a pas eu de deuxième vague de SRAS en 2003, le modèle de la grippe est appliqué pour anticiper une deuxième vague de SRAS-CoV-2. La préparation aux pandémies mêle temporalités biologiques et sociales. Une diversité de professions doit intégrer localement des mesures globales.
Au terme de cet été 2020, le débat en France porte sur la nécessité de se préparer à une « deuxième vague » de la pandémie de Covid-19. Le SRAS-CoV-2, arrivé en France dans les premiers mois de 2020, après être apparu en Chine en 2019, a causé une flambée épidémique en mars, contenue par des mesures radicales de confinement de la population, puis a continué à circuler à bas bruit dans la population, en se transmettant notamment dans des « clusters » à l’occasion des vacances d’été. Le Conseil scientifique écrit ainsi dans son avis du 27 juillet intitulé « Se préparer maintenant pour anticiper un retour du virus à l’automne » : « Il est hautement probable qu’une seconde vague épidémique soit observée à l’automne ou à l’hiver prochain. L’anticipation des autorités sanitaires à mettre en place opérationnellement les plans de prévention, de prise en charge, de suivi et de précaution est un élément majeur. »
Pourtant, le concept de « deuxième vague » est contesté par les épidémiologistes, qui observent que le coronavirus est beaucoup plus stable et beaucoup moins saisonnier que la grippe. Qu’est-ce que ce concept de « deuxième vague » révèle sur les techniques de préparation aux pandémies forgées contre la grippe ? En quoi l’anticipation d’une « deuxième vague » transforme-t-elle la temporalité de notre société confrontée à l’épidémie de SRAS-CoV-2 ? Comment distinguer la prévention, la précaution et la préparation comme des formes différentes d’anticipation des menaces sanitaires ?
La préparation aux pandémies de grippe
Lorsqu’on parle de préparation aux pandémies, la « grippe espagnole » revient toujours comme une catastrophe sanitaire exemplaire, avec ses cinquante millions de morts entre mars 1918 et juillet 1921. Pourtant, celle-ci ne fut pas anticipée comme une pandémie, et les données épidémiologiques ne furent reconstituées qu’a posteriori, car les États en guerre étaient réticents à publier les cas de peur de démobiliser les armées. L’épidémie commence officiellement le 27 mai 1918 lorsque l’agence Reuters annonça que le roi d’Espagne était malade de la grippe, car l’Espagne était alors un pays neutre, mais les premiers cas de cette grippe foudroyante furent identifiés en mars 1918 à Haskell dans le Kansas, ce qui permet de supposer une transmission des États-Unis vers l’Europe, puis l’Afrique et l’Asie. On distingue aujourd’hui trois vagues dans la propagation de l’épidémie : au printemps, à l’automne et à l’hiver 1918. Le nombre de cas diminua en juillet-août pour repartir en septembre et atteindre un pic en novembre. La deuxième vague donna donc lieu à des mesures de prévention qui étaient impossibles pour la première vague. Aux États-Unis, la grippe se diffusa de l’est vers l’ouest, si bien que lorsqu’elle arriva à San Francisco en septembre, les autorités de santé publique imposèrent des formes de contrôle qui frappèrent l’imagination dans le reste du pays. Le premier patient déclaré, un certain Edward Wagner arrivé de Chicago le 24 septembre 1918, fut immédiatement placé à l’hôpital, et la maison où il résidait fut mise en quarantaine. La Croix Rouge organisa un comité contre la grippe qui envoyait des infirmières visiter les quartiers pauvres de la ville pour détecter de nouveaux cas, notamment dans les quartiers italiens.
L’usage des masques laissa une empreinte durable dans la mémoire des habitants de San Francisco. Ils furent d’abord portés par les médecins et les infirmières, puis une affiche montra le maire et la plupart des directeurs des organisations en charge de la santé portant des masques. La Croix-Rouge distribuait pour dix cents environ cent mille masques qu’elle avait faits elle-même ou qu’elle avait commandés à la compagnie de jeans Levi Strauss. La baisse du nombre de cas de grippe en novembre étant attribuée au port de masques, le directeur du département de la santé publique de San Francisco, William Hassler, demanda à la population de maintenir cette mesure pendant deux mois. Le 17 janvier 1919, une ordonnance rendait obligatoire le port du masque dans l’espace public. La police arrêtait ceux qui se montraient sans masque, mais de multiples formes de transgression se multiplièrent, comme le fait de porter un masque accroché à l’oreille pour le mettre devant la bouche lorsqu’un policier est visible. Une vaste campagne fut lancée dans les journaux pour critiquer l’inefficacité et l’inconfort des masques, notamment dans le contexte de la célébration de l’armistice et des fêtes de fin d’année. Les statistiques fournissaient des arguments aux deux camps : à la fin de la deuxième vague épidémique de décembre-janvier à San Francisco, seize mille cas furent déclarés et mille cinq cents morts, soit moins de cas mais plus de morts que lors de la première vague [1].
L’idée selon laquelle on pouvait se préparer à la prochaine pandémie de grippe prit une cinquantaine d’années à se réaliser. Il fallait d’abord découvrir le virus qui cause les épidémies de grippe, ce qui fut fait en 1933 dans un laboratoire anglais qui transmit le virus de l’homme au furet. Il fallait ensuite analyser les mutations des virus pour expliquer la distinction entre des virus saisonniers, qui tuent surtout des personnes âgées, et des virus pandémiques, qui tuent surtout les personnes bien portantes. Dans les années 1940, alors que les États-Unis allaient entrer dans la Seconde guerre mondiale, des chercheurs américains purent identifier des virus de grippe chez les cochons, et comparèrent leurs réactions dans des embryons de poulet, ce qui conduit à les classer par leurs formes d’hémaglutination – d’où les protéines H et N qui distinguent les virus de grippe, à commencer par le H1N1 qui causa la pandémie de 1918 [2]. Dans les années 1970, des chercheurs australiens identifièrent des anticorps contre la grippe chez les oiseaux sauvages,et en conclurent qu’ils constituaient le réservoir animal des pandémies. Cela leur permit d’expliquer que les pandémies de grippe de 1957 – H2N2 – et 1968 – H3N2 – ont commencé dans le sud de la Chine, où les contacts entre les oiseaux, les cochons et les porcs sont traditionnellement fréquents, et s’amplifient avec l’élevage industriel lancé par la modernisation chinoise [3]. Dans les années 1990, enfin, la fin de la guerre froide conduisit le gouvernement américain à redouter l’émergence de nouvelles armes biologiques issues des laboratoires soviétiques et à transférer vers les questions sanitaires les techniques de préparation aux catastrophes mises en place pour les attaques nucléaires [4]. En Europe, les crises sanitaires ont d’abord été gérées comme des problèmes de sécurité alimentaire en appliquant le principe de précaution à la chaîne alimentaire, mais l’arrivée de la grippe aviaire en 2005 fut gérée comme un problème de biosécurité selon un agenda militaire. Les pandémies de H1N1 en 2009 et de SRAS-CoV-2 en 2020 furent ensuite gérées comme des guerres aux virus mobilisant la population par la vaccination, le port du masque et le confinement.
On peut ainsi distinguer la prévention et la préparation dans la gestion des pandémies de grippe au vingtième siècle. La prévention consiste à gérer une épidémie sur un territoire donné en fonction des données sur la transmission de l’épidémie en ciblant davantage les populations à risque. Elle engage donc la capacité de l’État à prévenir sa population en fonction d’une certaine représentation scientifique des microbes et de connaissances statistiques sur leur transmission, et en s’appuyant sur des personnalités qui peuvent mettre en pratique ces savoirs – souvent des femmes, qui sont plus en contact avec les patients (les infirmières) et les enfants (les mères de famille) [5]. La préparation (preparedness) repose davantage sur une imagination de la catastrophe par des experts – souvent des hommes – au moyen de scénarios permettant d’enrôler les populations pour limiter les dégâts d’un événement peu probable aux conséquences désastreuses. Elle s’appuie sur des systèmes de surveillance qui lancent l’alerte de façon précoce (early-warning systems) et sur des stocks de biens prioritaires (masques, vaccins, antiviraux…) distribués en urgence à des acteurs ciblés. La précaution constitue une rationalité intermédiaire entre ces deux formes d’anticipation des menaces : elle consiste à maximiser un risque lorsque circule dans une population un agent toxique ou pathogène encore inconnu pour prendre une décision souveraine, comme un abattage massif d’animaux ou le confinement d’une population [6]. Prévention, précaution et préparation sont ainsi trois rationalités d’anticipation utilisées par les experts pour mobiliser les populations contre les menaces sanitaires qui se mêlent dans la temporalité des crises, mais la prévention est plus proche du calcul des risques (donc acceptable par l’éducation), alors que la préparation est plus proche de l’imagination des catastrophes (donc suscite des résistances à une culture de la peur). La prévention implique davantage des professions au contact avec la population (infirmiers, enseignants) alors que la préparation implique davantage des militaires et des artistes qui peuvent construire cet imaginaire des catastrophes.
Être préparés ou se préparer contre le SRAS-CoV-2
En 1997, un nouveau virus de grippe fut identifié à Hong Kong, qui se transmettait directement des oiseaux aux humains. Appelé H5N1, il tuait deux-tiers des personnes qu’il infectait, ce qui conduisit les autorités sanitaires de Hong Kong à redouter qu’il se transmette entre humains, et à abattre les volailles par mesure de précaution. Dans les fermes, des volailles non-vaccinées étaient considérées comme des sentinelles lançant l’alerte sur la présence du virus, et dans les hôpitaux et les marchés, des exercices de simulation permettaient aux acteurs de se préparer à la transmission catastrophique d’un virus pandémique. Cet état permanent de vigilance et de préparation, qui tenait à la relation inquiète que le territoire de Hong Kong avait établie avec le continent chinois depuis la rétrocession de la colonie britannique, lui permit de gérer la crise du SRAS – Syndrome respiratoire aigu sévère – en 2003. Lorsqu’une nouvelle maladie respiratoire apparut à Canton, les microbiologistes de Hong Kong furent les premiers à en identifier l’agent causal – un coronavirus, ordinairement bénin chez les humains – et le réservoir animal – les chauves-souris, avec transmission par les civettes sur les marchés de la médecine chinoise traditionnelle. Grâce aux mesures de contrôle sévère prises en Asie, le SRAS disparut en juin 2003 et ne réapparut que par des échappées de laboratoire. On ne connaît donc pas de « seconde vague » pour le virus du SRAS. Cela peut s’expliquer par sa stabilité génétique, du fait qu’il s’agit d’un virus ADN encapsulé dans une couronne, et non, comme la grippe, d’un virus ARN qui produit beaucoup plus de mutations. En outre, sa capacité à infecter les voies respiratoires par sa protéine « Spike » semble moins dépendante de la température – on a découvert avec la pandémie de SRAS Cov-2 que la nicotine pouvait avoir un effet inhibiteur sur ces récepteurs.
Que signifie alors se préparer à une pandémie de SRAS ? Et pourquoi parler d’une seconde vague de SRAS-CoV-2 ? La discussion vient du Règlement sanitaire international adopté en 2005 par l’Organisation mondiale de la santé après la crise du SRAS. Celui-ci conduisait les États membres de l’OMS à mettre en place des niveaux d’alerte pandémique et à définir des normes internationales de préparation aux pandémies de façon à ce qu’un nouveau virus émergeant dans n’importe quel point de la planète soit rapidement contrôlé dans un objectif de « santé globale ». On pouvait alors comparer les États par leur conformité à ces normes de préparation, notamment dans leur capacité de stockage des masques, des vaccins et des antiviraux. « Être prêts » signifiait avoir un plan, constituer des stocks et faire confiance à l’OMS pour la détection des signaux d’alerte précoce. Lorsque le SRAS-CoV-2 apparut en décembre 2019, il n’y avait cependant aucun vaccin ni aucun antiviral disponible, et l’État français, en suivant une logique d’austérité budgétaire et en remettant sa responsabilité aux échelons locaux de décision, avait considérablement réduit ses stocks de masques constitués lors de la pandémie de H1N1 en 2009.
La discussion sur la « seconde vague » permet alors de changer le sens de la préparation : celle-ci n’est plus une compétence que l’État se donne dans la coordination internationale des politiques de santé, mais une disposition partagée par toute la population face à une menace sanitaire clairement identifiée. Le confinement de l’ensemble de la population entre le 12 mars et le 11 mai 2020 peut en effet être conçu comme une mesure de précaution qui vise à maximiser la menace pour la rendre réelle : c’est le sens des déclarations du président de la République affirmant « nous sommes en guerre » pour obliger les Français à rester chez eux et soulager le personnel hospitalier affrontant la montée des cas. À partir du moment où les masques sont disponibles dans la population et où la circulation dans l’espace public est à nouveau autorisée à condition de les porter, une nouvelle forme de préparation est possible : on porte le masque pour se préparer à la seconde vague. Le discours étatique sur le port du masque obligatoire, en répondant au besoin d’action de la population contre un virus pandémique, fait coïncider provisoirement le global, le national et le local. Alors que la population a été sidérée par les mesures de confinement, qui visaient à appliquer en France ce qui avait marché en Chine au détriment des libertés individuelles, elle est appelée à participer à l’anticipation de la « deuxième vague ».
Temporalités biologique et sociale de l’épidémie
Pour comprendre les formes de responsabilité qui sont en jeu dans l’anticipation des épidémies, il faut distinguer la temporalité biologique et la temporalité sociale. La première est celle des mutations et transmissions des agents pathogènes : elle relève de la compétence des virologues et des épidémiologistes. La seconde est ce qu’Émile Durkheim appelle « les intermittences de la vie sociale » [7] : ce sont les transformations observées par les sociologues et les anthropologues. Le concept de « seconde vague » appliqué au SRAS-CoV-2 n’est pas seulement un modèle épidémiologique appliqué d’une maladie – la grippe – à une autre – la Covid-19. C’est une temporalité sociale projetée sur une temporalité biologique.
Pour se préparer à un événement catastrophique, il faut en effet qu’une société puise dans sa mémoire afin d’imaginer ce qui est improbable. Le vocabulaire de la guerre a permis au gouvernement de faire saisir l’ampleur de la menace pandémique, en reprenant le registre de l’union sacrée et du sacrifice. Mais la radicalité des mesures prises – un arrêt de l’économie pendant deux mois – répondait à l’âpreté des discussions sur la grève depuis un an, en réponse à la réforme du système de financement des retraites et du système d’hôpitaux publics. Le spectre d’un arrêt de l’économie brandi par la société contre l’État pour arrêter des réformes injustes était repris par l’État lui-même pour protéger la population d’une menace sanitaire. On pourrait dire alors que l’État a dérobé l’imaginaire catastrophiste qui circulait dans la société, mais cet imaginaire est lui-même diffusé par des films ou des romans venus du reste du monde. Les menaces environnementales se réalisant à une échelle globale, l’alerte pandémique est une façon pour l’État de rendre réels les effets du réchauffement climatique, de la déforestation ou du trafic international d’animaux sauvages, contre lesquels les experts lancent l’alerte depuis des années. La « première vague » de SRAS-CoV-2 réalisait ainsi l’imaginaire catastrophique sur le mode de suspension de l’activité pour arrêter la circulation du virus.
Le concept de « seconde vague » est alors en accord avec une autre temporalité sociale : non plus celle de la grève comme suspension de l’activité, mais celle des vacances comme relâchement de l’effort. Le discours étatique sur le « relâchement » qui explique la multiplication des clusters n’est pas seulement l’effet d’un paternalisme autoritaire : c’est aussi une tentative de comprendre les comportements de la population après les sacrifices consentis pendant le confinement – sacrifices de ceux qui ont soigné « en première ligne » et de ceux qui sont restés chez eux « à l’arrière du front ». Il était nécessaire, pour respecter « les intermittences de la vie sociale », de laisser ce temps de la fête après le temps du sacrifice. On demande à présent aux plus jeunes de se préparer à la seconde vague comme ils se préparent à la rentrée des classes, et on sait que ce terme rythme la vie sociale en France, avec un calendrier très différent de celui qu’il suit dans d’autres États. Alors que l’on redoute une rentrée des classes en ligne et que l’État souhaite éviter un nouveau confinement généralisé, demander aux plus jeunes de porter le masque est un effort nécessaire pour pallier les effets du « relâchement ».
Se préparer aux pandémies n’est donc pas seulement une rationalité experte dans la gestion des biens de santé publique. C’est un ensemble de techniques qui sont disponibles dans toute la société pour imaginer la catastrophe sanitaire et en pallier les effets. On se demande comment les modélisateurs construisent des simulations des épidémies qui permettent aux gouvernants d’imposer des mesures sanitaires coûteuses. Mais la gestion d’une épidémie implique de combiner des temporalités biologiques et sociales dans l’ensemble de la population. La pandémie de SRAS-CoV-2 accélère des dynamiques globales que l’on pressentait jusque-là confusément, comme les effets de la circulation des humains et des animaux sur la santé de la planète. Elle oblige ainsi à un ralentissement de la vie sociale par les mesures de distanciation, dont le port du masque est la forme la plus visible. Le port du masque cristallise cette tension entre accélération et ralentissement qui est au cœur de la préparation aux pandémies. Si une mesure qui semblait réservée jusque-là au personnel hospitalier est généralisée à l’ensemble de la population, cela ne signifie pas que le monde est devenu un grand hôpital, mais que les temporalités qui sont particulièrement vives à l’hôpital – entre grève, sacrifice et soin quotidien – se jouent maintenant dans l’espace public. Si l’hôpital doit en effet gérer à la fois les temporalités de la routine et de l’urgence en fonction des maladies qui s’y présentent, l’imaginaire des maladies infectieuses émergentes qui se diffuse dans la société à l’occasion des crises sanitaires peut être considéré comme une extension des logiques hospitalières. Porter un masque, c’est arborer les signes visibles d’une mémoire collective, celle des précédentes crises qui nous permettent de nous préparer à la « seconde vague ».