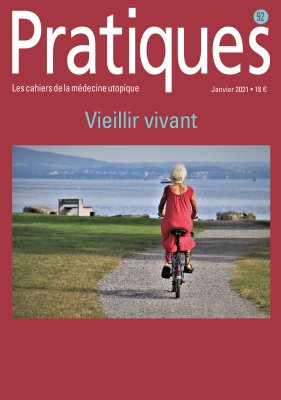Entretien avec Pierre Delion
Pédopsychiatre en retraite
Propos recueillis par Françoise Acker, Anne Perraut Soliveres et Jean Vignes
Si on s’en occupe à plusieurs, le patient peut aller mieux grâce à l’ensemble de la constellation qui fonctionne de façon collective avec lui.
Pratiques : Peux-tu nous raconter ton parcours de militant ?
Pierre Delion : J’étais à la fondation de la revue Pratiques et du Syndicat de la médecine générale en 1974 à Besançon alors que j’étais interne en psychiatrie dans l’objectif de devenir médecin généraliste… Puis, je suis resté en psychiatrie. C’est l’époque où on pouvait croire que ces choses allaient devenir réalité, évidemment on a pris un grand coup dans la gueule ces derniers temps…
Mes parents étaient d’un milieu très modeste, j’ai fait mes études chez les jésuites, de la sixième jusqu’au bac. Ce fut pour moi une vraie chance. Dans mon village de la Sarthe, il y avait un médecin généraliste très sympa, c’était mon idole lorsque j’étais gamin, et je voulais faire ça… J’ai eu mon bac en 1968, c’est-à-dire l’année où tout le monde l’a eu… J’ai donc pu aller faire médecine. Au fur et à mesure de mes stages, je me demandais où était passé mon médecin généraliste de référence… Les médecins que j’avais comme profs, même s’ils étaient très savants, professaient un tel mépris du « peuple » lorsqu’ils venaient palper le ventre ou écouter le cœur de ce peuple, que je me demandais comment avait fait le médecin de mon village pour devenir ce qu’il était.
Quand j’ai fait mes stages de réanimation médicale, j’ai trouvé un patron, Philippe Alquier, qui montrait un respect absolu de la personne qui était là. Un des médecins les plus forts que j’ai rencontré, c’est d’abord la personne qui l’intéressait, y compris lorsqu’elle était dans le coma. Je me souviens d’une scène marquante : un interne examinait une personne dans le coma et retirait le drap, comme s’il découvrait un sac de blé. Le patron lui dit : « Attends, remets le drap sur Monsieur X, ce n’est pas parce qu’il est dans le coma que ce n’est pas une personne, donc avant de retirer son drap tu lui dis : "Monsieur, je vais retirer votre drap pour vous examiner". On ne sait pas s’il nous entend ou pas, mais c’est la moindre des choses que respecter les gens que l’on examine… » Alors là, quelle leçon de médecine ! J’étais en cinquième année et me suis dit « cinq ans pour en arriver là… » Quand je suis devenu psychiatre, j’ai continué à faire des vacations pendant des années avec ce patron.
Je suis resté en contact avec mes copains du SMG, Jean-François Huez et Bernard Châtaignier, installés comme médecins généralistes dans le secteur où j’étais psychiatre en formation, à Trélazé. Cela a été un temps d’apprentissage très intéressant. Dans cette ville, il y a des mines d’ardoise et les patients que je voyais au dispensaire, très déprimés, picolaient beaucoup. Quelques-uns étaient très délirants, mais c’était surtout des malades alcooliques. Au bout d’un certain temps, je leur ai demandé qu’ils me racontent leur métier, car je ne comprenais pas pourquoi ils étaient beaucoup plus alcooliques que la moyenne. Ils m’ont dit : « Vous devriez descendre au fond de la mine, vous comprendriez mieux qu’avec les discours ». J’ai pris contact avec le directeur qui a accepté qu’on descende au fond, à mille mètres sous terre, pour aller voir les conditions de travail des ardoisiers. À partir de ce moment-là, j’ai eu une certaine cote auprès des ouvriers, on avait franchi quelque chose.
Après, j’ai rencontré les gens de la municipalité de gauche pour leur demander comment on pouvait développer la psychiatrie dans la cité au moment où on était en train de mettre en place la psychiatrie de secteur. Ils étaient sollicités pour gérer les crises liées à l’alcoolisme aigu et demandaient un placement d’office… Je leur suggérai qu’on puisse aller voir les gens, essayer de faire autrement, une espèce de prévention du placement d’office. Cela a marché, mais je me suis retrouvé parfois dans des situations très délicates… Le maire m’avait appelé pour intervenir chez M. L qui était en train de braquer sa femme et ses enfants avec son fusil, complètement beurré. Je suis arrivé assez vite et le type m’a braqué… J’avais l’idée que plus je parlais avec lui et plus l’alcool se dissipait dans le sang… il a fini par se calmer et venir avec moi, dans ma voiture, à l’hôpital.
Puis je suggérai à la maire adjointe d’étendre ces principes à des réunions dans une crèche autour des dépressions des mamans afin de développer la prévention autour de la périnatalité. Ensuite, le maire m’a demandé de mettre quelque chose en place pour les chômeurs. J’ai proposé qu’on installe un café dans la salle d’attente où ils viennent pointer et que je sois là avec mes amis infirmiers pour discuter avec eux.
Il ne suffit pas d’installer des dispensaires pour faire de la psychiatrie de secteur, mais dans la cité, cela veut dire être présent avec les citoyens, donc aussi leurs représentants, leurs associations.
À l’occasion de l’accompagnement de patients à l’hôpital, le maire voyait le service dans un état de délabrement comme beaucoup d’autres dans les années soixante-dix. C’était l’asile pur et dur comme il redevient aujourd’hui, sauf qu’à l’époque, on avait le sentiment qu’on pouvait le changer et on l’a fait…
Mais il y a eu des lieux de résistance.
On s’est dit qu’il ne suffisait pas de changer la pratique dans la cité, il fallait aussi changer l’hôpital. Dans le service où je travaillais, il y avait des gens qui étaient en contact avec le courant de psychothérapie institutionnelle, Oury à La Borde, Tosquelles à Saint-Alban, avec lesquels on est entrés en relation, et je suis devenu très ami avec eux jusqu’à leur mort. J’ai beaucoup appris d’eux, j’ai appris une psychiatrie qui n’est pas seulement médicale mais aussi fraternelle. « Je peux parler avec l’autre parce que je suis sur un pied d’égalité avec lui, je sais quelques trucs dans mon domaine, mais je ne pourrai pas les appliquer si je ne sais pas quelques trucs dans le domaine de celui avec qui je parle ». C’est un échange de paysages nécessaire et c’est le fond de la psychothérapie bien comprise. On a beaucoup changé le service hospitalier grâce à la psychothérapie institutionnelle. Avec les infirmiers qui étaient vraiment nos alliés de base, on a révolutionné la psychiatrie dans le service où on travaillait et à la demande d’autres services.
Quelques années plus tard, des universitaires m’ont encouragé à passer l’agrégation pour pouvoir enseigner, ce que j’ai fait après vingt-cinq ans de pratique hospitalière.
Quand je suis devenu prof, j’avais l’expérience de la psychiatrie d’adultes avec des schizophrènes pour lesquels j’avais beaucoup d’affection, parce que ce sont des gens qui sont à côté de leurs godasses, qui délirent à plein tuyaux et, en même temps, on peut vraiment élaborer avec eux des stratégies qui tiennent la route. C’est pas toujours le Pérou, mais il y a quelque chose que l’on peut faire et ça les sort vraiment d’affaire. L’équipe avec laquelle on a travaillé à Angers a continué de faire ça pendant ces trois dernières décennies. Et là, ça vient de s’arrêter parce que la nouvelle médecin chef, prof de psychiatrie, vient de décider que toutes ces « conneries » de psychothérapie institutionnelle, les clubs thérapeutiques pour les malades, l’extra-hospitalier, ça ne servait à rien, que le seul truc qu’on avait à faire c’était des diagnostics et prescrire des thérapies cognitivo-comportementales et des neuroleptiques. Tout le reste n’était pas scientifique. C’est incroyable ! Elle a foutu en l’air un système qui permettait depuis quarante ans de soigner les schizophrènes de façon humaine. Aujourd’hui, les gens sont attachés dans leur plumard, ils servent aux expériences de la prof et basta. C’est ça qui me pose problème, que notre démocratie, qui n’en est plus une à mes yeux, permette de déconstruire des pratiques humaines qui fonctionnent bien et de les remplacer par des trucs inhumains.
Après dix ans de psychiatrie d’adultes, au contact de la schizophrénie et de l’autisme chez les adultes, je me suis demandé comment ça venait chez les enfants. Je me suis spécialisé en psychiatrie de l’enfant à partir des années quatre-vingt, jusqu’à ce que je sois prof. Et là, je n’ai pas fait de la psychiatrie tout seul. À chaque fois, il fallait déclencher, quel que soit le statut, une sorte de désir collectif de changer l’asile. Il a fallu le transformer et je voyais que les soignants étaient là avec leur désir de faire quelque chose, que tout seuls ils n’y arrivaient pas et qu’à chaque fois, on faisait prendre la sauce ensemble. Ça, je l’ai appris de la psychothérapie institutionnelle, de Oury, de l’Association méditerranéenne de psychothérapie institutionnelle (AMPI), de Tosquelles, de La Criée (Chemla à Reims)… Tous ces gens m’ont appris mon métier. Tu ne peux rien tout seul, mais tu peux des choses formidables quand tu arrives à fonder un groupe et que, dans ce groupe, il y a une solidarité, une fraternité qui fonctionnent vraiment. Il ne s’agit pas de faire du scoutisme à deux balles, il y a dans ces groupes des rivalités comme partout, mais le fait que l’on soit d’accord sur ce minimum, ça permet de déplacer les montagnes.
Dans les services où je suis passé, j’ai pensé de façon intuitive que si le responsable du service, en l’occurrence j’étais médecin-chef, s’occupait des gens les plus graves, les autres ne pouvaient pas faire moins que s’occuper de ceux qui sont moins graves. Ceux qui font le contraire m’ont toujours paru nuls sur le plan éthique et déplorables sur le plan épistémologique. Ça me rappelle une anecdote. Les parents d’un gamin de quatre cinq ans viennent me voir, me disant qu’il est trop violent. Mes collègues me disent pareil. Je me dis : je vais le prendre en charge et ça va passer. Au bout de quelques séances, il me fout un coup de pompe dans les roubignolles, je tombe, la secrétaire entend, elle ouvre la porte et me trouve par terre sans connaissance. Là, le gamin est calmé, il se demande : « Qu’est-ce que j’ai fait au docteur ? ». Les parents, qui étaient dans la salle d’attente, récupèrent leur gamin, les collègues présents viennent. Ils s’assoient autour de moi. « Enfin Pierre qu’est-ce qu’il se passe ? - Eh bien je me suis fait avoir. Je croyais que j’allais pouvoir le soigner tout seul, que les autres qui avaient essayé avant, c’était des nuls et voilà, je me suis pris un sacré coup de pompe ». Ils me disent : « On va t’aider alors ». Ça a déclenché un soin extraordinaire. On a entamé une série de packings, trois séances par semaine pendant dix ans. Et ce gamin, on l’a guéri de sa psychose. Par la suite, on a utilisé les packings pour les soins aux enfants violents.
Mais ça a déclenché une espèce de cabale dingue. Des associations de parents ont considéré que c’était un soin barbare et nazi… j’ai eu un tas d’emmerdes avec des parents paranos, ce qui n’a pas empêché que les équipes continuent ce boulot formidable. Ça a abouti à des trucs incroyables, jusqu’aux menaces. Ils savaient dans quelles écoles allaient nos enfants, un vrai scénario de science- fiction, au point que les parents continuaient de nous soutenir, mais ne pouvaient pas le faire publiquement.
Il y a une espèce de force de frappe qui se développe pour influencer le politique. Les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) au sujet de l’autisme n’ont pas été émises en fonction de la science, mais en cédant à un rapport de force puissant, pervers, à l’image de la société contemporaine. J’appelle ça la république des « faux selfs ». L’homme politique, trop souvent, fait un discours formidable, mais dès qu’on lui demande : « Est-ce que ce discours est en accord avec ce que vous faites ? », il y a un arrêt sur image et on voit bien que ce qu’il décrit ne correspond pas à ce qu’il est vraiment. Ils ne sont pas capables de tenir les trucs, comme : est-ce que l’on s’occupe des malades mentaux si ça coûte du fric ? Est-ce qu’on s’occupe des prisonniers si ça coûte du fric ?… Eh bien non, la majorité va dire « ces populations minoritaires, on ne va pas s’en occuper ».
Quand on était soutenu par l’État, des hauts fonctionnaires qui avaient un quant à soi formidable, une éthique, ça marchait. Dès l’instant où certains ont été influencés par des lobbies, ils n’avaient plus aucune raison de nous défendre. On s’est retrouvés en grande difficulté dès lors que les hauts fonctionnaires n’ont plus défendu une politique digne de ce nom.
Actuellement, les collègues universitaires, puisqu’au niveau de l’État la fraternité, l’humanité, l’éthique ne marchent pas, se sont repliés sur les neurosciences. Seulement, si la psychiatrie scientifique est intéressante en ce qui concerne les découvertes des neurosciences, elle ne participe en rien à l’humanisation de la pratique psychiatrique. Ce qui permet une pratique psychiatrique humaine, c’est la psychothérapie institutionnelle. Les neurosciences apporteront une psychiatrie vétérinaire. Les gens que l’on soigne ont alors un statut d’objet de soin, de recherche, de commisération, de pitié, mais en aucun cas ils ne sont considérés comme des acteurs participant activement à leurs soins. J’insiste sur l’aspect collectif que j’ai appris avec Tosquelles et Oury. Il faut des pédagogues, il faut des soignants et tous ces gens-là constituent ce qu’on appelle la constellation transférentielle. Et si on s’en occupe à plusieurs, le patient peut aller mieux, et ce n’est pas grâce à un membre de la constellation, c’est grâce à l’ensemble de la constellation qui fonctionne de façon collective avec lui. Si on travaille dans le service public, la psychiatrie de secteur, c’est parce que l’on a besoin de travailler en équipe pour accueillir les gens qui ont les pathologies les plus graves. Cela n’empêche pas qu’un patient schizophrène puisse aller voir un psychothérapeute en ville, en plus, c’est vraiment intéressant pour lui, mais à condition que la fonction de contenance et de portage, que j’appelle la fonction phorique, soit assurée par une équipe qui comporte plusieurs personnes. On voit bien que pour les parents, c’est absolument fondamental. Quand ils ne sont pas seuls à s’occuper de leur enfant, qu’ils ont d’autres coresponsables avec eux, leur état psychique change fondamentalement.
Avant de faire de la pédopsy je l’ai appris avec mes copains généralistes à Trélazé, dans le cadre de notre groupe de travail sur le mode Balint. On se posait des questions sur les patients qui nous créaient des difficultés, eux en tant que généralistes et moi en tant que psy. C’est de ces échanges horizontaux qu’est né un savoir tout à fait essentiel à nos yeux.
L’idée que l’on avait au départ du Syndicat de la médecine générale était vraiment remarquable. On demandait le paiement à la fonction pour avoir le temps d’accueillir les gens en fonction des problèmes qu’ils présentaient. Si on est payé à l’acte, c’est quelque chose de différent qui se produit.
Évidemment, quand je me suis retrouvé psychiatre d’enfants, j’ai continué de travailler comme ça souvent. En ville, j’étais avec le pédiatre, le médecin généraliste de l’enfant. J’ai fait beaucoup de groupes de travail pour les sensibiliser aux signes précoces de souffrance des bébés. On a fait beaucoup de formations communes sur ces sujets-là, y compris des recherches-actions avec des pédiatres et des généralistes. Je me souviens d’une recherche que l’on a faite à Lille qui a beaucoup intéressé les pédiatres : pendant les dix-huit premiers mois, on observait que si le bébé n’était pas bien dans l’interaction avec ses parents (il ne souriait pas, il ne regardait pas, il avait des troubles du sommeil ou du nourrissage importants), le pédiatre, plutôt que de l’envoyer chez le psy, incitait la maman un petit peu inquiète à raconter. Il prévoyait de prendre une heure avec le parent et le bébé en question. On a constaté au bout de deux ans que 90 % des dépressions du post-partum disparaissaient. Ce genre de recherche-action avec les praticiens permettait de rapprocher les psychistes et les somaticiens. Elle a mis en évidence une réponse que l’on appelle l’articulation psychosomatique. Il ne s’agit pas de séparer ce qui est psycho de ce qui est somatique, mais d’être sensible, avec nos deux métiers, à cette articulation-là. C’est un trésor pour les patients que l’on accueille.
On réunissait les gens qui s’occupaient d’un gamin autiste, ceux qui étaient en contact avec lui à l’hôpital et ceux qui s’en occupaient à l’extérieur, l’école, les parents etc. C’était pour mieux comprendre chaque gamin. Et puis il y avait le champ organisationnel du service dans lequel les gens se réunissaient pour organiser le travail, de façon autogérée. Je trouvais que ça disait quelque chose sur le fonctionnement démocratique. C’est-à-dire qu’on confie des choses qui sont de leur champ à ceux qui peuvent s’en occuper et on confie d’autres choses à d’autres, de temps en temps ça se recoupe, ou pas, mais on respecte absolument ça, et c’est parce qu’on le respecte que ça fonctionne. C’est pareil dans notre société, il faut que chacun puisse organiser son travail sans avoir un type qui va lui dire comment faire.
Il y a une sorte de confiscation de ce qui fait des gens des professionnels.
Et alors, le comble actuel, c’est ce fameux New Management. J’ai lu le petit bouquin de Chapoutot qui est vachement bien, où il met en évidence que ça vient du nazisme… Et ça nous pourrit la vie aujourd’hui ! C’est quand même étonnant, non ?
Donc les mecs qui sont directeurs d’hôpitaux viennent nous dire comment il faut soigner. C’est dingue, c’est-à-dire que les caricatures, dont on rigolait dans les années soixante-dix, sont devenues réalité et maintenant, on n’en rit plus du tout.
Le problème c’est que cette manière de penser la psychopathologie, dans le développement notamment, n’est plus du tout enseignée en faculté de médecine. La psychanalyse a été complètement éradiquée dans beaucoup d’endroits, du fait d’offensives politiques absolument incroyables. J’insiste là-dessus parce que dans l’enseignement des étudiants en médecine, mais aussi des internes dans des cabinets de pédiatres, de généralistes, à l’hôpital où on a cette philosophie de travail, cela donne une cohérence tout à fait intéressante. Il me semble qu’on est en train de connaître une espèce de nouvel âge de la médecine, de la psychiatrie, très marqué par une prétention scientifique qui, dans beaucoup de disciplines, n’est pas au rendez-vous. Pour moi, il faudrait cultiver une sorte d’articulation entre les neurosciences, qui sont nécessaires et qu’il faut absolument approfondir, et la psychopathologie transférentielle (c’est comme ça que j’appelle la psychiatrie dynamique freudienne). On voit bien qu’actuellement, il y a quantité de patients qui présentent des souffrances psychiques et qui ne sont pas pris en charge de façon cohérente.
Tu parles des neurosciences, mais il y a le poids de la chimie aussi derrière ? L’illusion de la pilule miracle.
Alors c’est ça le problème. Une personne psychotique, c’est évident qu’elle a besoin de neuroleptiques, mais pas seulement. Il faut que celui qui les prescrit soit en attitude psychothérapique avec son patient, qu’il se soucie de comment il vit, de ce qu’il bouffe, comment il dort, s’il est emmerdé par les voisins, s’il va dans une association, s’il a des activités. S’il s’intéresse uniquement à ses neuroleptiques et à ses dosages hépatiques, c’est un vétérinaire, ce n’est pas un psychiatre humain. C’est ça que j’essaie de défendre, avec vivacité parfois.
Bien que j’aie pris ma retraite il y a un an, je continue à faire de la supervision avec des équipes en charge de patients très graves, principalement autistes, et qui sont au bout du rouleau.
Comment vois-tu la suite ?
J’ai confiance dans les jeunes, j’ai l’impression qu’ils sont en train de fomenter un truc pour des raisons que je trouve encore plus géniales que les nôtres, c’est-à-dire pour l’écologie de la planète. J’ai l’impression qu’il va y avoir un certain nombre d’endroits où ça va faire des contre-pouvoirs très puissants, alors qu’on nous prend pour des nostalgiques. C’est pour ça que j’ai une dépression relative, il y a une part de moi qui se demande ce qu’on a raté et une autre qui me dit que les jeunes vont arriver là où nous, on n’est pas arrivés. Et sans doute qu’ils reprendront dans les bibliothèques ce qu’on a quand même réussi à pousser un peu loin, notamment les décloisonnements. Je crois qu’on n’a pas assez travaillé sur l’histoire des décloisonnements, mais je pense que sur le plan philosophique, c’est absolument fondamental que les disciplines se mettent à bosser ensemble, que des trucs géniaux et féconds en sortent. À chaque fois ça s’est vérifié, j’y crois beaucoup.