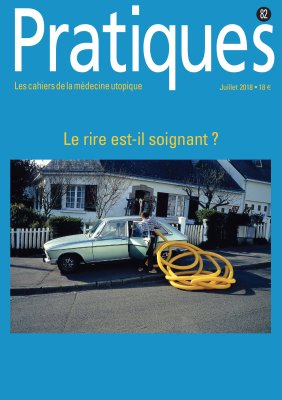Marc Jamoulle
Médecin de famille
Auteur de Éthique d’un médecin de famille, 2017 (à commander sur le site Le livre en papier)
-
-
-
- Marc Jamoulle est installé depuis plus de quarante ans en maison médicale dans une banlieue postindustrielle déshéritée de Charleroi en Belgique, c’est aussi un enseignant et un chercheur en médecine générale à la curiosité insatiable.
-
-
- Pratiques : Comment es-tu arrivé à la médecine ?
Marc Jamoulle : Je viens d’une famille que Bourdieu appelait : ceux qui fabriquent la normalité. Du côté de mon père, ils étaient tous avocats ou notaires, et de celui de ma mère, ingénieurs. J’ai donc un très bel héritage culturel, je suis le neuvième d’une série de dix, à l’époque il n’y avait pas de contraception, heureusement ! On m’a mis chez les Jésuites, dans une pension pour enfants de riches, mais j’étais un enfant infernal et on m’a renvoyé de partout et puis c’était l’époque où « les curés allaient dans les culottes des enfants ». Cela m’a fait une adolescence assez compliquée.
Les études universitaires, c’était en 1966 à Louvain, là où la bourgeoisie catholique belge envoie ses enfants. J’y ai découvert à la fois la réflexion, la pauvreté, l’amour et mai 1968.
On a été peu impactés par 68 parce que l’université mettait ses ouailles à l’abri et qu’à Louvain, on était pollués par la question linguistique flamande. Mais il n’empêche que le mode de vie a profondément changé. J’ai quitté ma famille, j’ai commencé à travailler, j’ai attrapé les longs cheveux et la barbe, mais cela ne m’a pas empêché de continuer mes études et de les réussir alors que cela ne m’intéressait pas trop.
J’ai été très influencé par les conséquences sociopolitiques de mai 1968 ; chez les jeunes, c’était un mouvement très politisé, mais je ne suis jamais rentré dans un groupe.
J’avais aussi rencontré une féministe. J’étais bousculé dans ma tête et dans mes connaissances. C’était aussi le début de ce qu’on a appelé les « maisons communautaires » : un habitat groupé, pour survivre à plusieurs. Et… j’ai fait un enfant et je me suis même marié ! Mais la vie est longue. En tout, j’ai eu six enfants avec trois mamans. Ils sont super.
- Tu t’es ensuite installé à Charleroi.
J’ai déménagé à Charleroi parce que c’était le seul endroit où les stages des jeunes médecins étaient financés, cela payait mon loyer. Et puis, à Charleroi, c’était la classe ouvrière et on allait sauver le monde, nous autres ! C’était le début des grèves : le bassin de Charleroi avait souffert terriblement du passage du charbon au pétrole, puis en 1974, il y a eu des transformations dans la fabrication du verre qui était la deuxième industrie et donc des grèves.
C’est à ce moment-là que j’ai ouvert mon cabinet de médecine. J’étais un médecin avec des bottes, une parka, des cheveux longs et la barbe, je faisais les certificats d’arrêt de travail pour les épuisés du boulot et je recevais dans ma consultation les jeunes qui appartenaient aux différents mouvements marxistes léninistes et qui m’engueulaient par ce que je soignais les trotskystes ! J’ai cru que j’allais pouvoir faire mon chemin de généraliste, mais les médecins locaux ont fait des pieds et des mains pour que je ne travaille pas, ils m’ont interdit de faire des gardes, la seule façon à l’époque de se faire connaître… Faut dire qu’on avait fondé le « Front national pour une médecine au service du peuple ».
J’étais donc à Gilly, une petite banlieue de Charleroi, je roulais en Vespa et j’allais voir mes malades, mais je n’en avais pas. C’est mon premier mort qui a fait démarrer ma clientèle. On sonne à ma porte : « Docteur venez vite ». Quelqu’un était en train de mourir dans la rue d’à côté. Faut que vous imaginiez un grand escogriffe de 28-29 ans avec sa parka et ses bottes pleines de terre. « Attendez, je me change », « Non, non, venez comme ça. » Il y avait une tripotée de Siciliens autour du futur mort. C’était un mineur ; à l’époque, on faisait des conneries mais on ne le savait pas, je lui ai fait une injection de théophylline et puis il a commencé à clapoter et je lui ai fait du bouche-à-bouche, il est mort dans mes mains ; mais tout le monde a trouvé que j’avais tellement bien travaillé qu’après j’ai eu plein de patients et c’étaient mes premiers moments d’anthropologie culturelle. La mort chez les Siciliens, c’est inoubliable.
Quand j’ai eu gagné un peu de sous, j’ai dit : « Je m’en vais ». Je vivais en maison communautaire, mon fils était en de bonnes mains, je pouvais partir.
- Et il y a eu l’expérience du Pérou.
C’était en 1976, tout le monde partait pour aider le tiers-monde, moi j’ai dit : « Je pars pour voir comment c’est ». Je suis arrivé là où Hergé a dessiné Tintin et le temple du soleil, à 4 000 mètres d’altitude. Je remplaçais un médecin suisse et je suis devenu médecin-chef avec une voiture dans un centre de santé. Je ne parlais pas espagnol et j’étais obligé d’apprendre avec des Indiens qui parlaient quechua et un peu d’espagnol.
C’était mon premier contact avec la réalité des humains, autres, différents.
Il y a une scène qui m’a marqué pour toute ma vie professionnelle. On me demande d’aller voir une dame qui ne veut plus sortir de sa maison. Je suis autorisé à entrer, mais je ne peux voir que son visage, elle est entièrement couverte et les fenêtres sont occultées par des tapis. Je me fais expliquer : lors d’un accouchement, il ne faut pas que la lumière entre dans la pièce où est la parturiente et qu’un rayon de soleil la touche, elle ou le bébé. Lors de l’accouchement de cette femme, un rideau s’était décroché et elle avait été frappée par un rayon de soleil. J’ai appris là quelque chose qui m’est resté toute la vie : l’interprétation différente des symptômes par les humains. Elle était atteinte mentalement et j’ai conseillé de voir le sorcier, car ce n’était pas un Occidental qui pouvait répondre à cela.
Quand je suis revenu au pays, j’ai commencé à travailler différemment.
Plus tard, dans les années quatre-vingt, j’ai accompagné une amie anthropologue plusieurs mois au Mali et cela a été une découverte fantastique de pouvoir saisir grâce à l’anthropologie que les autres, les patients, ont bien souvent un vécu du corps, de la mort, de l’amour, de la sexualité totalement différents de celui du médecin. C’est la même chose ici en Europe occidentale où les expériences sont très différentes à l’intérieur des différents groupes sociaux, classes sociales et niveaux de connaissance, mais ça se voit moins. Cela a beaucoup modelé ma réflexion sur la relation médecin-patient et a été très important pour que je puisse chaque fois saisir la question qui anime le patient et qu’il déguise dans le langage qu’il pense compréhensible par le médecin. Le patient a un message à faire passer et il essaie de s’adapter au médecin. C’est comme cela que je me suis intéressé à la notion de « raison de rencontre ».
- À ton retour du Pérou en 1977, tu t’es à nouveau installé.
J’ai d’abord travaillé seul puis j’ai lancé une maison médicale.
En 1979, le syndicat médical traditionnel a lancé une grève, je ne sais plus trop pourquoi, mais pour de l’argent en tout cas. Nous, on était contre et on n’a pas fait grève, cela a pris une dimension nationale. Les patients n’étaient pas d’accord avec cette grève et ont très rapidement identifié les médecins qui ne la faisaient pas. Toute la population s’est mise à notre service. Les associations de cibistes, de jeunes, le mouvement ouvrier chrétien, les partis, les syndicats se sont donné la main pour nous aider et on a tenu le coup pendant un mois, on a fait des consultations non-stop jour et nuit, et ils ont perdu la grève. En Belgique, comme en France, c’était et c’est encore vraiment de la médecine libérale : l’État n’intervient en rien dans l’organisation, la planification, la construction du système de soins primaires.
L’image médiatique des maisons médicales est née en 1979 lors de la grève (N.D.L.R. : C’est dans les suites de cette grève, qu’elles n’avaient pas faite, que les maisons médicales belges ont obtenu, après plusieurs années de tractations, d’avoir un paiement forfaitaire au nombre de patients suivis, ce qui a changé les modes d’exercice). On était trois puis quatre et cinq médecins et puis une infirmière est venue, cela a grossi, on a déménagé, on s’est transformé en association. J’ai tenu le coup dans cette maison jusqu’en 2001. Un jour, le facteur m’a apporté une lettre recommandée disant que l’ensemble de mes collègues avait décidé que je ne devais plus travailler là-bas. Cela a été dur, aujourd’hui je peux comprendre : j’étais un type fort exigeant pour moi et pour les autres, toujours à faire de la recherche, à être parti, à faire des études à vouloir inventer plus et je crois qu’ils en ont eu marre.
J‘ai recommencé sur le trottoir d’en face avec mon épouse à développer une nouvelle maison médicale dans laquelle je suis toujours. C’est la troisième. Étudiant, j’avais contribué à lancer la première à Bruxelles elle s’appelait Norman Béthune en référence à un médecin canadien parti en Chine rejoindre Mao. La deuxième s’appelait Collectif de santé, c’était la grande époque des philosophes, des sémiologues, de Foucault, Derrida, Barthes, Althusser… En 2001, la maison s’est appelée Espace temps. Les noms sont porteurs de sens. Mais maintenant, je suis vieux et les jeunes me poussent dehors. Ils n’ont peut-être pas tort.
Toute ma carrière s’est déroulée dans la même rue. Ma patientèle, ce sont les enfants, les petits enfants et maintenant les arrières petits-enfants des patients que j’ai soignés depuis 1974 ; il n’y a pas grand-chose qui ait changé dans le quartier, c’est toujours aussi pauvre et abandonné. On est dans l’acculturation normalisée des Belges ; les Marocains, les Turcs savent qu’ils ont une culture, eux au moins. Je soigne aussi des Belges « d’en bas », mais je les aime beaucoup, ils sont sympas.
Ma vie a été rythmée par une relation assez lointaine avec mes patients, je n’ai pas accepté qu’ils deviennent mes amis, car je ne veux pas me faire « avaler ». La relation médecin-patient est une relation tout à fait difficile à gérer où on veut montrer de l’empathie et en même temps avoir son quant à soi, c’est assez lourd, et on en prend « plein la gueule » toute la journée. Surtout après l’histoire de l’assassin violeur d’enfant en 1995. Il avait enterré les petites à 500 m de chez moi. Les femmes ont commencé à parler de leur vraie vie. Un moment dur pour tous les intervenants sociaux.
- Tu as aussi accompagné beaucoup de personnes dépendantes.
La ligne de force de mon histoire est la relation médecin malade.
Je me suis mis à soigner les personnes dépendantes, les toxicomanes, quand les enfants de mes patients sont venus me trouver, parce que leurs parents avaient monté avec moi une relation sympathique et franche. Le premier avait 12 ans et avait déjà pris de l’héroïne. Je n’y connaissais rien. On était en 1988-89, tous « mes gosses » sont tombés malades, ils étaient drogués, mais j’ai appris à les voir comme des malades. C’était une épidémie. Beaucoup sont morts. Personne ne le sait parce qu’on ne fait pas de stat avec ces morts-là. Pas vu, pas pris, pas de problème. À l’époque, la Commission médicale provinciale – l’administration qui nous donne l’autorisation de travailler – avait édicté un règlement disant qu’on ne pouvait pas prescrire de la méthadone (produit de substitution de l’héroïne). Ils ont mis en prison un de mes amis, le psychiatre Baudour, ils lui ont fait perdre tous ses titres. Il faut dire qu’il avait prescrit de la méthadone en injectable à des toxicos ! Je l’ai alors appelé pour qu’il vienne nous enseigner ce qu’était la méthadone.
Entre-temps, j’avais suivi un cours de l’OMS en Santé publique et j’avais appris à faire de la bibliographie. J’ai fait une revue de bibliographie commentée à partir d’environ cent cinquante publications qui traitaient de la méthadone. Et en octobre 1992, j’ai fait ma première prescription de méthadone. On risquait gros, on pouvait nous mettre en prison ; mais cela n’a pas été comme en France où le lobby pharmaceutique a fait en sorte qu’on interdise la méthadone aux généralistes pour pouvoir vendre la buprénorphine (autre produit de substitution de la morphine). En Belgique, une association, nommée Initiative Déontologique, a attaqué devant le Conseil d’État la circulaire qui disait qu’on ne pouvait pas prescrire de la méthadone, et nous avons gagné. Ma vie professionnelle a changé. J’étais parmi les premiers à prescrire à Charleroi et ma salle d’attente s’est remplie d’abandonnés en quête de traitement. Ces gens qui prenaient des substances, je trouvais ça fascinant et j’ai appris beaucoup de choses avec eux. Quand tu commences à donner de la méthadone, évidemment tu resocialises les patients, mais tu te retrouves avec un paquet de fous ; on ne s’attend pas à voir un psychotique derrière un héroïnomane et puis on apprend, et on comprend pourquoi la personne a besoin de la substance, parce que quand même l’héroïne, c’est meilleur que la méthadone pour la psychose. J’ai des patients qui prennent la méthadone depuis maintenant plus de 25 ans, mais certains prennent toujours un peu d’héro parce que la méta, c’est pour soigner l’héro et l’héro, pour soigner la psychose. Toute l’idéologie de l’abstinence, toutes ces bêtises, j’ai dû apprendre sur le tas que ce n’était pas cela qu’il fallait faire. Beaucoup de morts, mais beaucoup de vivants aussi et beaucoup d’enfants de mère toxico qui sont beaux maintenant et sont toujours mes patients.
Je me suis retrouvé face à un lot de patients complètement déjantés qui bousculaient un peu mes vieux patients dans la salle d’attente, mais jamais personne ne m’en a voulu. J’avais l’impression qu’ils sortaient d’un camp de concentration. C’était de la vraie médecine. J’ai eu jusqu’à soixante-dix patients atteints d’hépatite C, mais heureusement très peu de Sida.
À l’époque, le Rohypnol® (flunitrazépam, anxiolytique et somnifère de demi-vie très courte très addictif et qui entraîne des amnésies) a beaucoup tué. Cela m’a intrigué que mes patients m’en demandent tout le temps. Je leur ai demandé ce que cela leur faisait, j’ai commencé à les enregistrer et j’ai sorti un rapport en 1992 qui a fait le tour de la francophonie, et un peu du monde aussi. Les responsables sanitaires belges n’ont pas eu les couilles de l’interdire, mais les collègues ont arrêté de le prescrire. Pour finir, le flunitrazépam a disparu de la culture tox, mais il est toujours en vente (en Belgique) Cette histoire m’a donné des contacts un peu partout dans le monde. Grâce à eux, j’avais fait une étude du prix de rue et en prison de ce produit dans de nombreux pays.
Cela recommence maintenant avec l’Oxynorm® (oxycodone, morphinique). J’en ai encore vu une prescription hier et j’ai envoyé une lettre au chef de service des urgences en disant que c’était scandaleux que leurs jeunes médecins prescrivent n’importe quoi, à n’importe qui, n’importe comment et qu’on allait avoir une épidémie de prescription et de dépendance comme aux États-Unis.
- Il y a eu aussi le concept de prévention quaternaire.
En 1985, j’étais en cours de statistiques et comme je rêvais – j’ai toujours rêvé à l’école –, je me suis mis à crayonner des schémas à double entrée sur la relation entre le médecin et le patient et c’est comme cela qu’est née l’idée de la prévention quaternaire : c’est-à-dire l’identification des patients en risque de surmédicalisation et la prévention de celle-ci. On avait lu Illich et Foucault et j’avais été fort influencé par MacWinney, un médecin canadien qui avait lancé « le soin centré sur le patient » et aussi Engel, un médecin américain, qui avait écrit des choses merveilleuses sur la relation médecin malade et sur l’approche bio-psycho-sociale. C’est probablement tout cela qui a fait soupe et de la soupe est sortie une petite fleur, qui s’est appelée « prévention quaternaire », dont j’ai pu parler dans une publication au cours d’un congrès dès 1986.
Ensuite, avec les encouragements de mes collègues, Michel Roland en particulier, nous avons travaillé sur la définition de la prévention quaternaire et l’avons introduite dans le dictionnaire de médecine générale de la WONCA (Organisation internationale de la médecine de famille) paru en 2003.
En 2008, un jeune médecin brésilien, Gustavo Gusso, a été fasciné par ce concept. Il avait travaillé quinze ans dans les favelas de Rio de Janeiro. Gustavo m’a invité lors du 25e anniversaire du Système unifié de santé au Brésil en 2008, soit les soins de santé primaires à l’échelle de toute la population brésilienne. J’ai eu la chance d’être co-orateur avec Cecil Helman, un médecin anthropologue très célèbre. J’ai dû faire ma première conférence en anglais, je parlais très mal, devant 4 000 personnes. De ce jour-là, la prévention quaternaire s’est répandue dans toute l’Amérique latine. Aujourd’hui, il existe un groupe de prévention quaternaire au sein de la WONCA. Des gens dans plein de pays en parlent et écrivent des articles. L’idée m’a totalement échappé et fait sa vie. Avec seize autres auteurs de douze pays, on va sortir un article qui envisage les aspects éthiques, pédagogiques, sociopolitiques et anthropologiques de la prévention quaternaire. La communication commence par la question de la triangulation médecin-relation-patient, et montre l’impact des collègues d’Amérique latine. Grâce à eux, le concept de prévention quaternaire a pris de l’extension. Ils considèrent l’impact de la prévention quaternaire aux niveaux micro, méso et macro : « micro » c’est la relation médecin/patient, c’est tous les jours, « méso » c’est l’organisation locale et « macro » c’est la politique.
- Et ton travail sur les « raisons de rencontre » ?
C’est en 1987 que j’ai commencé à m’intéresser aux « raisons de rencontre ». Tout ça se passe en même temps : on travaille, on retourne faire des études, on voit les patients…
En Belgique, les universités ne faisaient pas cas des médecins généralistes, j’ai fait alors un peu de littérature et j’ai trouvé un médecin hollandais, je lui ai écrit, il m’a répondu, c’était le Docteur Lamberts. Il n’avait plus de traducteur français, je lui ai alors renvoyé son article traduit et du coup, il m’a fait venir dans son groupe ; j’en fais partie depuis trente ans maintenant. C’est ce groupe qui a développé la Classification internationale des soins primaires (CISP). Les « raisons de rencontre » sont intégrées à cette classification.
J’ai toujours été intrigué par le contenu de la médecine de famille, qui n’est décrit nulle part et par le fait que tous les référentiels de médecine de famille dans le monde sont différents. La médecine de famille, on a l’impression que c’est ce qui reste quand on a enlevé toutes les spécialités. Je viens de terminer une thèse de doctorat en sciences : « Un système de concepts pour la médecine de famille ». C’est un travail à l’interface entre sémantique, médecine et informatique.
J’ai commencé par essayer d’analyser les abstracts des communications présentées aux différents congrès de médecine générale avec la CISP, mais ça ne marchait pas parce que cette classification n’identifie que la clinique et les généralistes parlent de plein d’autres choses.
J’ai donc identifié une série de concepts non-cliniques qui me paraissaient fondateurs du métier et qui étaient abordés pendant les congrès : la relation médecin/malade, les migrants, la violence faite aux femmes, la continuité des soins, l’éthique professionnelle, la pollution intérieure, et qu’on ne savait pas où classer avec la CISP.
En me servant d’une part de la CISP avec ses 784 entrées et d’autre part de cet outil que j’ai développé et qui contient 187 entrées sous forme taxinomique, j’ai établi une liste de concepts et de domaines : la recherche, l’enseignement, le point de vue des patients, le point de vue des docteurs, l’éthique professionnelle, l’environnement, les structures etc. Tout ce dont parlent les généralistes quand ils se rencontrent. Ensuite, grâce à l’aide de Stefan Darmoni et de son équipe à Rouen, chaque entrée a maintenant une fiche terminologique précise avec une définition que j’ai choisie dans la littérature, un ensemble de définitions connexes, une bibliographie sélectionnée pour chaque item, et des entrées sur des sites Internet de terminologie.
Cela a tellement intéressé mes copains partout dans le monde que maintenant c’est traduit en dix langues. Cela peut servir pour donner un cours de médecine générale : si un jour tu décides de parler de l’accessibilité aux soins, tout est prêt, il n’y a qu’à suivre… La bibliographie est faite, il y a un système de recherche automatique. À partir du moment où tu as mis un système au point, tu peux l’utiliser pour gérer l’information. On pourrait voir si c’est faisable, à partir de là partiellement de gérer l’information d’un journal comme le vôtre, je ne sais pas, mais l’idée est là.
- Peux-tu nous parler de ton cheminement avec la problématique de la fin de vie ?
Je n’ai pas de problème avec ça. Même quand c’était encore interdit en Belgique, ça ne m’a jamais empêché de faire des choses. Simplement, on ne le disait pas. Quand Marcel dit : « Écoutez Docteur, vous ferez ce qu’il faut… » Je réponds « Bien sûr, Marcel ». On arrange ça longtemps à l’avance, quand on suit les patients dans la durée.
Maintenant, c’est relativement rare parce que les hôpitaux ont mangé la mort des gens. Mais dans les années quatre-vingt-quatre-vingt-dix, on mourait encore à la maison. On donnait un coup de main aux gens discrètement. Toujours en colloque singulier, c’était entre moi et le patient, On ne faisait qu’abréger ce qui était inéluctable. On faisait ça en confiance et dans une relation de longue durée. On faisait ça très confidentiellement parce que simplement, on était respectueux de la dignité humaine.
Je trouve incroyable de faire mourir à n’en plus finir dans certains services de réanimation, de réaliser des opérations de dernière minute, de poser des pacemakers vingt minutes avant la mort. Toute cette horreur de la médecine sans nom et sans dignité.
Ce n’était pas une situation fréquente, une fois ou deux par an, parce qu’il fallait vraiment que les conditions soient réunies.
Puis les choses ont changé en Belgique. L’euthanasie, c’est devenu plus simple même si on ne remplit pas toujours les formulaires… Il y a quelque chose qui est un peu terrifiant dans cette histoire d’euthanasie programmée. C’est de faire vivre l’euthanasie à la famille avant que la personne ne soit morte. C’est une espèce de deuil programmé, moi ça ne me plaît pas. Je préfère le dialogue singulier avec mon patient et laisser la famille faire son deuil tranquille avec la mort telle qu’on l’a toujours connue.
J’ai aussi cette histoire d’un patient et ami artiste belge habitant en France qui m’avait demandé de lui procurer de quoi mettre fin à ses jours parce que son état de santé n’était plus supportable pour lui. Chez nous c’est facile, on va chez le pharmacien, on prescrit un kit, et puis voilà, on a tout ce qu’il faut. J’ai eu l’occasion de lui apporter le kit pour un autosuicide. Cet ami n’est pas mort. En fait, il a mis le produit au-dessus de son armoire et a pu recevoir un traitement. Il s’en est sorti, il vit toujours et fait des dessins merveilleux. Une belle expérience aussi. Ce sont des choses importantes à faire quand on est médecin, il s’agit vraiment de respecter les humains.
Entretien réalisé par Sylvie Cognard et Marie Kayser
Principales recherches :
- « Information et informatisation en médecine générale », Les informa-G-iciens. Les professionnels de l’informatique dans leurs rapports avec les utilisateurs, Actes des IIIe Journées de Réflexion sur l’Informatique (3e JRI), Namur, 28 et 29 novembre 1986. (1986) : 193-209. .
- Le patient héroïnomane, une approche complexe en médecine de famille, Exercer, (32) (1995), 9–13.
- « Le Rohypnol, une drogue dure amnésiante : résultats d’une recherche en médecine de famille », Psychotropes : Revue Internationale des Toxicomanies et des Addictions 2.2 (1996) : 53-66.
- Traitement de l’information médicale par la Classification Internationale des Soins Primaires 2e version (CISP-2), assorti d’un glossaire de médecine générale, préparé par le Comité International de Classification de la WONCA. Bruxelles : Care Editions asbl, Bruxelles. (2000).
- "Quaternary prevention, an answer of family doctors to overmedicalization." International journal of health policy and management 4.2 (2015) : 61.
- "Towards Knowledge management in General Practice & Family Medicine ; Guide to the indexing of master thesis." Thèse de sciences. Université de Liège. Care Edition (2017).
- [Éthique d’un médecin de famille], Care Edition (2017).