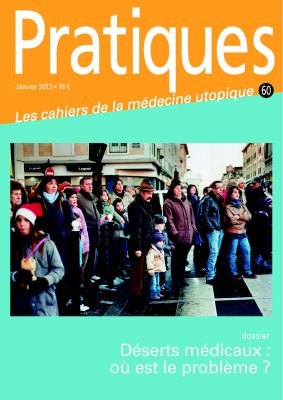Entretien avec Pierre Volovitch, [1]
Économiste.
Propos recueillis par Martine Lalande et Anne Perraut Soliveres
Pratiques : Comment êtes-vous devenu économiste de la santé ?
Pierre Volovitch : Me suis-je posé la question ? Il n’y a pas eu de moment où j’ai décidé que c’était ce que j’avais envie de faire, mais en me retournant, je me dis que ce n’est pas totalement un hasard. Quand je passe mon bac, je ne suis pas suffisamment bon en sciences pour continuer vers les Sciences et pas assez littéraire pour me lancer vers les Lettres. L’économie commence juste à être enseignée à la fac : en 1965, à Paris, si on faisait de l’économie, on était obligé de faire du droit, car il n’y avait pas assez de professeurs d’économie pour en faire un cursus complet. Là-dessus, je deviens professeur de sciences économiques et sociales en lycée parce que cela m’évite d’aller me confronter avec l’économie en entreprise, c’est plus commode. Comme enseignant, je fais des cours sur l’ensemble de l’économie, et pas du tout spécialement sur la protection sociale, encore moins la santé. Quinze ans plus tard, le ministère des Affaires sociales recrute un professeur détaché et je me retrouve au ministère. Ce passage-là, de l’enseignement au ministère, est sans doute un effet de hasard. Mais pour des raisons personnelles, j’avais eu beaucoup de rapports avec le système de soins et quelque part, j’avais « des comptes à régler ». Donc je me retrouve en position de faire de l’économie sur des questions de santé. J’ai alors toujours tenu à dire que je faisais de l’économie de l’Assurance maladie et pas de l’économie de la santé. Qu’on fasse de l’économie, c’est-à-dire réfléchir sur « combien ça coûte », « comment cela se finance »... en assurance maladie, cela me semble justifié. « L’économie de la santé » cela me paraît beaucoup plus ambigu parce que cela veut dire que l’on accepte, quelque part, de considérer qu’il est légitime de faire du calcul économique sur la santé, la vie... ce qui me paraît, en termes d’impérialisme de l’économie, beaucoup plus discutable. En particulier, c’est un peu moins à la mode maintenant, mais il y a eu une époque où un certain nombre d’économistes se sont mis à évaluer le « prix de la vie humaine » pour pouvoir calculer combien on « gagnait » à sauver une vie humaine. Quand j’étais prof, j’avais travaillé avec mes élèves sur une étude portant sur le dépistage du cancer du sein qui était très rigolote, car il y avait d’un côté : « combien cela coûte ? » et si on veut faire de l’économie on dit, en face : « combien cela rapporte ? », ce qui oblige à calculer combien vaut la vie d’une femme. Dans l’étude en question, la valeur de la vie d’une femme était calculée sur le salaire féminin moyen, ce qui était une façon de dire que la valeur de la vie d’une femme, c’était 20 % de moins que la valeur de la vie d’un homme (!). Il y avait même dans l’étude un moment de discussion pour savoir si, après la ménopause, une femme valait encore quelque chose ou si elle ne valait plus rien (!!). Si on veut faire de l’économie sur la vie humaine, on se met à faire des calculs un peu bizarres. Donc, si on me demandait de définir ce que je faisais, j’ai toujours eu plus tendance à dire que j’étais économiste de l’Assurance maladie qu’économiste de la santé.
C’était un choix ?
Cela m’a paru un sujet tout à fait intéressant à pleins de points de vue. Un des points de vue intéressant est que, quand on fait des études d’économie, et encore maintenant, la protection sociale est totalement ignorée. Un bon élève ayant sa maîtrise de sciences économiques peut n’avoir jamais entendu parler de la protection sociale. En termes d’anecdote, quand j’étais au ministère, nous sommes allés intervenir, avec un collègue, à l’École Normale Supérieure, auprès d’élèves qui préparaient l’agrégation de sciences économiques et sociales. On leur a fait un topo et comme ce sont plutôt de bons élèves, ils savent poser des questions : il y en a un qui a levé la main et qui a dit : « Mais expliquez-moi, le ticket modérateur, c’est quoi ? ». Il avait fait cinq ans d’économie, il savait plein de choses sur les taux de change, mais le ticket modérateur, il n’en n’avait strictement jamais entendu parler. La deuxième chose qui me paraît intéressante, c’est que je suis persuadé qu’on ne peut pas aller très loin en économie si l’on n’a pas conscience des liens très forts entre les phénomènes économiques et les phénomènes sociaux. Et la protection sociale, sauf à être totalement aveugle, oblige à faire ce lien. Si tu fais juste du monétaire, tu peux te dire que tu ne fais que de l’économie et que le social est absent... il y a des domaines de l’économie où on peut croire qu’on va faire de l’économie pure. Mais dans le domaine de la protection sociale, on ne peut pas avoir ce type d’illusion. Assez vite, je me suis trouvé confronté au fait que les gens de gauche étaient totalement silencieux, ne voulaient rien dire sur le boulot des professionnels de santé en général et celui des médecins en particulier. Je me trouvais face à des collègues qui travaillaient en économie de la santé, du côté des syndicats, du côté des partis de gauche, et les médecins n’étaient jamais un sujet d’interrogation de réflexion, de critique. Et un jour, je ne sais plus comment, j’ai rencontré le Syndicat de la Médecine Générale (SMG) et le monde a repris une certaine assise : on pouvait être de gauche, parler de santé et avoir un discours critique, organisé, sur les problèmes de pratique professionnelle des soignants en général et des médecins en particulier. Et cela a été un bol d’air bienvenu, le monde prenait une cohérence. J’ai essayé de me souvenir comment je suis entré en contact avec le SMG et je n’arrive pas à me rappeler comment cela s’est passé. Ce dont je suis sûr, c’est que le premier du SMG que j’ai rencontré était Patrice Muller. Tant qu’à faire, rencontrer le SMG par le biais de Patrice était une cerise sur le gâteau. Je suis issu d’une famille de militants, je suis moi-même militant, et le deuxième bol d’air du SMG ce fut de me retrouver, pour la première fois dans un groupe d’extrême gauche où j’étais strictement incapable de voir qui avait envie de piquer la place de qui. En termes de confort intellectuel, de respiration, c’était un cadeau extrêmement agréable. Et je pense que la personnalité de Patrice, sa façon de mener les choses n’y était pas pour rien. Malheureusement, Patrice est mort il y a quatre ans. Heureusement, le SMG reste un endroit où on ne voit pas qui aurait envie de piquer la place de qui. Ce n’était donc peut-être pas seulement Patrice...
Justement, comment avez-vous rencontré le SMG ?
C’est une chance que j’ai eue, j’ai essayé de reconstituer comment cela s’était passé. Comme j’ai dit tout à l’heure, je n’arrive pas à me souvenir des circonstances et ça me désole.
Je travaillais sur la comparaison des systèmes de santé en Europe. Au niveau anecdotique, une conseillère d’État (Yannick Moreau) avait été chargée de faire un rapport sur les différents systèmes de santé européens. Elle a fait son rapport et à la fin, elle a fait des préconisations. Elle a dit : « Il est quand même regrettable que le service statistique du ministère ne travaille pas sur la comparaison des systèmes de santé. » J’étais arrivé comme prof détaché au ministère la semaine d’avant. Le service ne sachant pas quoi faire de cet ordre m’a chargé de faire les comparaisons statistiques des systèmes de santé européens. Cela a été pour moi très intéressant, mais cela en dit long sur le fonctionnement de l’administration. L’intérêt de la comparaison, c’est que cela ouvre la tête. On s’aperçoit que tout un tas de choses qui relèvent, dans un pays, de l’évidence absolue, non discutable, qu’on ne peut même pas imaginer que ce soit autrement... sont différentes dans le pays d’à côté. Les habitudes sociales, le poids historique jouent un rôle non négligeable dans les conduites des politiques. Si on veut comprendre pourquoi les Anglais raisonnent comme ça, pourquoi nous on raisonne autrement, il faut remonter un peu dans le temps et dans l’histoire. On découvre alors que les champs des possibles sont relativement vastes. Mais en même temps, on comprend assez rapidement que cela n’a aucun sens d’aller chercher un élément d’un système étranger et de vouloir l’importer dans notre système, parce qu’évidemment chaque élément n’a de sens que dans son articulation avec les autres éléments du système. Par exemple, en Allemagne où il y a une vraie organisation des professionnels de santé qui discutent avec des pouvoirs publics qui ont des objectifs, il y a eu pendant un temps, et je crois que ça existe encore, des objectifs de dépenses de l’assurance maladie. Si les objectifs de dépense étaient dépassés, la valeur des actes était diminuée pour rentrer dans l’enveloppe prévue. En 1995, Juppé met en place la même idée de faire varier la valeur de la consultation en fonction du fait que l’on a respecté ou pas l’évolution des dépenses. Le problème est qu’il s’agit d’une décision gouvernementale, qu’il ne négocie avec personne, dans un pays où les professionnels ne sont pas organisés. Évidemment, sa mesure a tout de suite une odeur, un goût, une signification qui n’a rien à voir avec ce qu’il croit avoir copié. Et d’ailleurs, dès ce moment-là, le discours des politiques est que cette mesure, si elle devait avoir lieu, serait une sanction. Essayer de mettre en place un truc que l’on présente dès le départ comme une sanction... On est un peu mal barré pour l’appliquer. À mon avis, Juppé lui-même n’avait aucune idée sur le système de modulation des lettres-clé flottantes allemandes. Il y avait des technocrates à la direction de la Sécurité sociale qui devaient savoir que ça existait, qui ont dû faire des notes, et c’est arrivé sur son bureau.
C’est ce qu’il s’est passé à l’hôpital avec la T2A.
Tout à fait. On a mis en place ici un système de tarification qui avait été pensé dans un système qui, globalement, fonctionnait tout à fait différemment du nôtre. La comparaison internationale montre à la fois que beaucoup d’autres choses pourraient se faire, mais en même temps, ce n’est pas une espèce de boîte à outils où on peut chercher un « bout » de système pour aller l’implanter dans un autre système. Ce que je trouve très triste, c’est que nous sommes politiquement dans une situation où il n’y a plus, il n’y a pas, et dans le domaine de la santé, il n’y a peut-être même jamais eu, de réflexion à moyen et long terme. C’est-à-dire que les gens qui prennent les décisions les prennent avec des objectifs d’avoir des réponses dont l’horizon n’excède pas l’année. Et, si on revient sur l’idée que les systèmes ont une cohérence globale, et qu’ils sont très différents, cela veut dire que pour transformer un système, cela suppose à la fois d’avoir des objectifs à moyen et long terme suffisamment précis, que les politiques sachent où ils veulent aller. Une fois définis les objectifs on peut, parce que l’on sait où l’on veut aller, se donner une grande souplesse dans les modalités d’application. On est exactement à l’inverse, dans une situation où il n’y pas d’objectif à long terme, mais où il y a des mesures dont on veut qu’elles deviennent effectives extrêmement rapidement. Et donc, on va leur donner une forme contraignante qui va provoquer des réactions...
Si on veut rester dans l’actualité, on a un ensemble de responsables : ministère, Assurance maladie, caisses d’assurance complémentaires, qui n’ont jamais réfléchi ni n’ont aucune idée sur le niveau de rémunération souhaitable des professionnels de santé, sur les écarts à atteindre entre spécialistes et généralistes, entre infirmières et médecins, entre hospitaliers et libéraux... Or, ils ont un problème qui est l’évolution délirante des dépassements d’honoraires. Ils ne vont pas prendre le sujet du niveau de rémunération de façon globale, mais ils vont y entrer par cette petite excroissance maligne. Dès lors, ils vont essayer de le résoudre vite fait sans rien remettre en cause, mais en refilant le bébé aux assurances complémentaires avec pour objectif d’arriver à un résultat le plus vite possible. Cela donne un protocole débile, même de leur point de vue, et ils ne l’appliqueront pas. Et tout d’un coup, dans ce désert de réflexion, pour la première fois à ma connaissance et sur un sujet très spécifique qui est celui des déserts médicaux, Madame le ministre de la Santé annonce un niveau de salaire souhaitable pour les généralistes. Cela arrive tout d’un coup, elle dit 5 000 euros par mois et on se demande d’où ça vient... quand ils ont discuté des dépassements, ils avaient déjà cette idée en tête ? Qui en a débattu, pourquoi comment ? Et donc, quand on essaie de réfléchir aux questions de l’Assurance maladie, aux solutions intelligentes que l’on pourrait progressivement mettre en place, on s’aperçoit que nous sommes face à des politiques qui mènent des réformes peu renseignées sur la réalité, avec objectifs extrêmement courts et correspondant à des rapports de force au moins conjoncturels, pour ne pas dire pire... c’est un peu déprimant. Est-ce que l’action publique, c’est en permanence des petits coups en fonction du gré du vent ? Est-ce que la tentative d’essayer de transformer ça en sujet de débat démocratique public, où les acteurs réfléchissent au bien commun, est une idée sympathique mais illusoire ? En ce moment, je suis d’un optimisme limité.
Ce sont des problématiques politiques qui dépassent les questions de santé. Ce n’est pas que les politiques ne savent pas, mais quand ils sont en position de prendre des décisions, on ne sait pas ce qui fait qu’ils prennent telle ou telle position... En 2003, les politiques se sont tout à coup aperçus qu’ils n’avaient aucun outil de connaissance de l’évolution de la démographie des professionnels de santé, en particulier de la féminisation. À l’époque, ils avaient enfin réalisé que les horaires de travail d’un médecin femme n’étaient pas les mêmes que ceux d’un médecin homme. Donc ils ont mis en place un observatoire national de la démographie médicale et de santé. Cet organisme a fait une étude comparative avec les pays étrangers. La conclusion de l’étude montrait qu’une politique visant à réduire les déserts médicaux, qui ne s’adresserait qu’aux plus jeunes et qui n’aurait que des incitations financières, n’aurait aucune chance de réussir... Le gouvernement Sarkozy a pourtant essayé de le faire, cela n’a pas marché, et qu’est-ce que l’actuelle ministre veut faire ? La même chose... Bien sûr la politique va vite, mais si les politiques paient des gens qui prennent, eux, le temps de réfléchir... puis qu’ils ne lisent même pas les rapports qu’ils ont commandés... On va où avec ce type de pratiques ? J’en ai découvert une autre. En 2004, je ne sais quel fonctionnaire avait réussi à proposer à Douste-Blazy l’idée d’une loi de santé publique.
C’était la première fois depuis 1911 qu’il y avait en France une loi de santé publique... Une histoire courait au ministère : on avait enfermé dans un cabinet un stagiaire de l’ENA et on lui avait demandé de sélectionner cent objectifs pour cette loi de santé publique. Des objectifs à suivre sur cinq ans, c’est une loi quinquennale, avec un bilan. Avez-vous entendu parler du bilan de la loi de santé publique en 2010 ? Non, mais l’administration française est bien faite : tous les ans, dans une indifférence générale, la DREES publie un document sur l’état de santé de la population française, en particulier autour des cent objectifs de santé publique. Qui parle de ce document ? Qui s’y intéresse ? C’est une interrogation parce que je n’ai pas de réponse définitive. Si j’étais sûr qu’ils avaient des objectifs à moyen terme, cela me rassurerait.
Dans d’autres pays, y a-t-il des politiques avec des objectifs à moyen terme ?
Les Anglais, les Néerlandais, par exemple, ont décidé à un moment de passer 25 % de l’activité des médecins aux infirmières, sur quatre à cinq ans, ce qui supposait une modification de leur formation. Cela ne veut pas dire que c’est une bonne politique, mais ils se sont dit qu’il y avait des choses que font les médecins que des infirmières pourraient faire. Ils ont mené cette transformation, avec un débat avec les organisations de médecins et d’infirmières. Les Anglais ont une gestion de leur système de santé à beaucoup moins court terme que nous. Le drame de la France, c’est que les pouvoirs publics n’ont aucun interlocuteur vraiment représentatif avec lequel négocier. Avec les médecins, on sait que l’organisation avec laquelle les pouvoirs publics signent n’a absolument pas les moyens de rendre effectif ce qui a été signé. Je n’aimerais pas être aujourd’hui décisionnaire dans le champ de la santé !
Il faut voir la réalité en face. Quand les pouvoirs publics disent : « J’aimerais bien limiter les dépassements à 40 % » et qu’ils finissent par signer un accord où c’est 120 % en sachant qu’ils ne pourront rien imposer...
Le problème, c’est que celui qui signe un accord sait que si l’accord n’est pas respecté, il ne se passera rien et tout sera comme avant. Reconnaissons aux fonctionnaires qui sont au ministère de la Santé qu’ils ne peuvent pas appliquer des décisions car : 1) ils n’ont pas d’objectif à long terme et 2) n’ayant pas d’objectif à long terme, ils n’ont pas non plus de moyens de les faire appliquer. Ils prennent des mesures à court terme avec des acteurs sociaux qui sont dispersés et peu représentatifs. On échange le fait que l’étudiant en médecine va être complètement sous-payé, avec des horaires déments pendant le temps de ses études (il est interne), avec la promesse qu’il va pouvoir s’en mettre plein les poches quand il sera en libéral... c’est vrai que le jour où on lui annonce que la deuxième partie du contrat ne fonctionne plus, il n’aime pas...
Dans toutes les entreprises, on a toujours considéré qu’employer un stagiaire surdiplômé en le payant des clopinettes n’était pas vraiment légal. On pourrait se dire la même chose pour les études médicales ? Mais dans un raisonnement à court terme, ce que l’on se dit, c’est que si on devait les payer, cela coûterait cher à l’hôpital.
Il faudrait se pencher sur le système de l’internat et se poser deux à trois questions : qu’est-ce qu’ils font, quels sont leurs horaires, quelle charge de travail, combien ils sont payés ? Et négocier avec eux. Est-ce qu’on dit à un médecin et ce serait légitime : vous êtes payé comme un cadre de l’industrie ? Après tout, il n’y a aucune loi naturelle qui oblige à ce qu’un médecin soit payé comme un cadre de l’industrie. Il pourrait être payé plus ou être payé moins. Mais il faut, au moins, se poser la question. Ce qui me choque, c’est qu’il n’y ait pas de réflexion là-dessus. Après qu’on décide, par exemple, qu’un médecin soit payé plus que celui qui boursicote cela, ne me gêne pas...
Les médecins disent qu’ils gagnent beaucoup parce qu’ils travaillent beaucoup.
Dans le système britannique, le cabinet moyen comprend six médecins, quatre infirmières, deux secrétaires médicales et le résultat, c’est que le médecin généraliste britannique passe 80 % de son temps en activité médicale, tandis que le médecin français y passe 60 % de son temps, à cause des tâches administratives. Ils gagnent plus parce qu’ils ont une organisation, alors que chez nous, il y a des tas de choses qui ne relèvent pas de la médecine, mais qui relèvent de l’organisation du cabinet. Pour discuter de rémunération, il faut aussi discuter de l’organisation du travail des médecins. La conclusion qui me semble un peu originale est d’insister sur le fait que le problème que nous avons dans ce pays, aujourd’hui, c’est que nous sommes dans un champ, la santé, où les acteurs sociaux sont faibles, dispersés et sans objectif à long terme. Les pouvoirs publics ne peuvent pas inventer seuls des formes d’organisation cohérentes et représentatives d’un milieu, mais ils pourraient avoir des politiques moins désorganisatrices. Comment réformer, faire bouger, transformer un système quand lorsque l’on signe la mise en place du médecin référent avec l’organisation dite majoritaire cinq ans après, moins de 10 % des médecins ont choisi l’option médecin référent ? Il faut que les pouvoirs publics aient, et débattent, d’objectifs et il faut alors les négocier avec des interlocuteurs qui soient de réels acteurs.