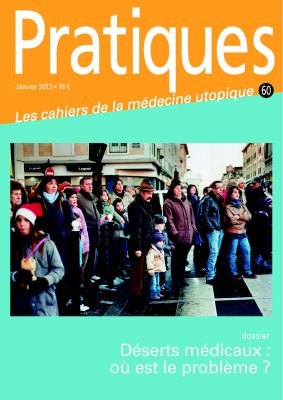Géraldine Bloy,
sociologue à l’Université de Bourgogne (LEG UMR CNRS 5118)
La dynamique spontanée des installations de professionnels de santé libéraux n’a jamais permis dans notre pays une répartition homogène des médecins ou des infirmières sur le territoire [1]. Les déséquilibres de leur densité ne sont pas justifiés par des besoins de soins objectivables, aussi fragile que soit cette notion : les territoires qui attirent le moins les soignants sont souvent ceux où les indicateurs de morbidité et de mortalité sont durablement les plus mauvais. Si la vulgate concernant le déficit supposé de médecins doit être fortement relativisée, leur répartition et leur âge annoncent des difficultés d’accès aux soins primaires qu’on ne peut ignorer, même si elles ne devaient toucher qu’une frange limitée de la population. La problématique des « déserts médicaux » concerne ou devrait concerner à moyen terme deux types de territoires : des zones rurales reculées et des banlieues cumulant déjà des problèmes socio-économiques.
Le propos que je développe, en tant que sociologue, revendique un double ancrage, dans mes enquêtes de terrain et dans un corpus de connaissances. Je me fonderai ici sur l’enquête longitudinale que j’ai consacrée entre 2002 et 2010 au suivi d’une cohorte d’une cinquantaine de jeunes diplômés de médecine générale. La recherche visait à rendre compte des choix de vie, opportunités et contraintes diverses présidant à leurs parcours personnels et professionnels, de manière compréhensive et non normative. Le travail de terrain par entretiens répétés amène à reconsidérer certaines idées reçues sur ce que veulent ces jeunes qui déçoivent les attentes de leurs aînés, investis dans la promotion de la médecine générale comme des pouvoirs publics. Quels enseignements en tirer en ce qui concerne l’évolution du rapport des jeunes généralistes à un choix de pratique (et de vie) et à l’installation sur un territoire ? En quoi cela peut-il contribuer à renouveler les pistes de réflexion sur les dispositifs susceptibles d’attirer davantage de jeunes pour pratiquer la médecine générale sur les territoires déficitaires ?
Raisonnons pour commencer dans le cadre actuel de l’exercice libéral, nettement dominant pour la pratique de la médecine générale en France, mais dont on nous dit que les jeunes ne veulent plus. Une minorité de nos enquêtés se retrouve dans cet exercice cinq à sept ans après avoir fini son cursus, mais la réalité est plus complexe que ne le laisse penser la thèse d’un déclassement global du cadre libéral aux yeux des jeunes. Si la plupart de ceux qui l’ont finalement choisi ne l’ont pas fait par affinité idéologique (ils le redoutaient plutôt), tous ceux qui ont franchi le pas de l’installation en médecine générale au terme d’un cheminement pragmatique s’y épanouissent lorsque nous repassons les voir. Ils ne s’y trouvent ni « harcelés » ni « étranglés » par les charges ou la « paperasse » comme on l’entend ailleurs. Si l’exercice en groupe a un attrait certain à leurs yeux, l’idéal du métier partagé reste souvent difficile à concrétiser dans le respect des préférences individuelles et est mis en balance avec les avantages de l’indépendance. Il n’y a nullement convergence vers un type d’exercice qui serait un nouvel idéal consensuel, mais pluralité des préférences comme des réalisations.
Nous rejoignons toutefois le constat commun selon lequel, pour attirer les jeunes diplômés sur des territoires dont ils se détournent aujourd’hui, la solution ne peut venir de la seule installation libérale, quels que soient les avantages financiers venant la soutenir. Des primes peuvent bien conforter des choix d’exercice (qui sont déjà parmi les plus lucratifs pour un généraliste), mais elles ratent leur cible car peu de ces jeunes sont actuellement disposés à fonder leur choix de carrière sur une maximisation de la rentabilité de leur pratique. L’installation suppose en revanche un ancrage fort et exclusif dans un lieu de vie que l’on se dispose à investir durablement. Des données sociologiques profondes déterminent la côte générale des territoires et l’attrait qu’ils peuvent avoir pour de jeunes cadres : un aménagement du territoire qui a conduit à des inégalités territoriales croissantes en France ; un recrutement social des diplômés en médecine dans les classes urbaines favorisées ; leur inscription enfin dans des couples de doubles actifs à haut niveau de qualification. Qu’il s’agisse aujourd’hui majoritairement de femmes dont le conjoint est cadre ne fait que renforcer ce dernier point : l’évolution des rapports de genre ne va pas jusqu’à rendre normal que leur époux ou compagnon s’estime valorisé par un statut de conjoint de médecin ou un exercice professionnel d’appoint, comme cela fut longtemps le cas pour les femmes de médecins. Ces différents facteurs s’imbriquent pour rendre de plus en plus improbable l’installation dans une zone rurale n’offrant pas de perspective de carrière pour le conjoint. En l’état des choses, ce choix ne peut être qu’exceptionnel. Il est éventuellement le fait de célibataires, de couples de médecins (qui y trouvent mieux que d’autres à s’employer à deux), ou de couples peu égalitaires au sein desquels priorité est donnée à la carrière d’un seul. Quant au choix de l’installation dans une banlieue déshéritée désertée des cadres, avec la perspective d’avoir à scolariser ses enfants dans un contexte où la ségrégation scolaire bat son plein, il doit être le fruit d’un engagement militant sans faille. Encore faut-il, en amont ou en marge du cursus médical, avoir été préparé à investir l’un ou l’autre de ces types de territoire par une socialisation non limitée aux grands centres urbains. De ce point de vue, une moindre homogénéité sociale du recrutement des étudiants en médecine pourrait éventuellement conduire à des dispositions et habitus un peu plus variés parmi eux.
La faiblesse des installations spontanées dans les « déserts médicaux » est donc surdéterminée par des évolutions sociales dépassant le champ de la médecine, bien qu’elles aillent avec une transformation du rôle social du médecin : déclin et moindre attrait de la notabilité traditionnelle, séparation des sphères privée et professionnelle, transformation d’un éthos de la disponibilité, plus grande horizontalité de la relation médecin-patient. Pourtant, ceux des jeunes diplômés qui vivent positivement leur orientation en médecine générale et s’essaient à la pratique dans le cadre des remplacements, font état quasi-unanimement d’un intérêt pour ces contextes de pratique ruraux ou urbains défavorisés. La médecine générale y est créditée d’un surcroît de sens et d’utilité, la relation au patient redevenant une relation d’aide plus que de prestation de services au fur et à mesure que les ressources des personnes diminuent et que l’accès aux spécialistes se raréfie. Cela ne va certes pas sans difficultés et exigences supplémentaires pour une pratique consciencieuse, mais, à les écouter, le généraliste semble se rétablir symboliquement dans ce contexte de pratique. S’il n’y a pas nostalgie du rôle social du médecin notable de province, il y a chez les jeunes qui se projettent en médecine générale à un moment de leur trajectoire nostalgie de cette forme de confiance (et peut-être de pouvoir...) qui se développe mieux en marge des centres urbains, avec des gens moins dotés culturellement et économiquement. À la campagne, pour plagier A. Allais, la relation médecin-patient et la médecine générale semblent plus pures... Faute de pouvoir mettre les patients de la campagne à la ville pour des soins de premier recours, comment amener les médecins de la ville à la campagne ?
Toute solution pérenne passera par une dose d’inventivité organisationnelle. On songe immanquablement aux maisons médicales et autres pôles pluri-professionnels, présentés depuis quelques années comme la solution à tous les maux affectant les soins ambulatoires. Ils devraient être le moyen non seulement d’un enrichissement et d’un partage de la pratique, d’une optimisation de l’utilisation du temps médical, mais aussi du repeuplement de territoires démédicalisés. Comme toute panacée, celle-ci est suspecte par l’abondance des problèmes qu’elle prétend résoudre simultanément. Si elle répond bien aux aspirations à un exercice moins isolé, à un partage du métier autour de prises en charge coordonnées, cette adéquation a priori avec les vœux de beaucoup de jeunes en matière de travail médical ne règle pas tout. Outre le cadre juridique et financier à consolider, les clés du savoir travailler ensemble et de l’articulation des cultures professionnelles ne sont pas données. Les projets émergents sont le plus souvent construits autour du leadership d’un médecin homme, militant en fin de carrière, engagé dans le profilage d’un outil de travail remarquable qu’il ne pratiquera que peu de temps... La capacité de ces maisons ou pôles à constituer en routine des lieux d’exercice effectivement intégrés qui retiendraient durablement les jeunes reste inconnue : dans quelle proportion le grand nombre de ceux qui font aujourd’hui des choix alternatifs (salariat, hospitalier ou non ; orientation vers un exercice plus ou moins spécialisé) serait-il intéressé par la pratique de la médecine générale dans un cadre alternatif au cabinet traditionnel ? Combien pourraient en devenir pleinement acteurs ? À quelles conditions ? Rien n’indique que les jeunes diplômés soient aujourd’hui massivement prêts à investir l’innovation organisationnelle. L’envie de participer au montage de nouveaux dispositifs ne transparaissait pas en entretien, et aucun ne se posait en bâtisseur d’une offre de soins alternative, faute de compétence et sans doute d’appétence. Sauf exception liée à une orientation militante personnelle, on peut se demander s’ils sont équipés pour mener cette réflexion et conduire le travail organisationnel requis par une refonte, même partielle, de l’offre de soins primaires. Leur formation ne les y prépare pas plus aujourd’hui qu’hier et le compagnonnage durant les études, par ailleurs apprécié, freine plutôt leur capacité d’élaboration d’une vision autonome et informée du système de soins ou de leur place dans la société. Ils relaient à leur insu nombre d’idées reçues ou d’affirmations rapides qui, pour être celles de leur milieu professionnel, résistent mal à l’analyse. Construire leurs compétences médicales puis trouver la voie qui fait sens pour eux dans l’espace des possibles prend de plus en plus de temps, du fait de l’allongement des cursus, de la montée des exigences, de la multiplicité des expériences professionnelles offertes au sortir des études et de l’évolution des conditions de stabilisation dans la vie adulte ou la carrière. Ils s’étonnent au moment où ils relèvent la tête de voir leurs préférences mises en cause par les seniors, les élus ou l’opinion. Leurs syndicats peinent à articuler une prise de parole publique autre que défensive sur ces enjeux territoriaux, ce qui accroît le malaise en donnant l’impression qu’ils ne prennent pas collectivement la mesure des inquiétudes en matière d’accès aux soins. Alors qu’ils sortent exténués des concours et de l’internat, avec le sentiment d’avoir payé leur écot à la société et de pouvoir légitimement profiter d’un espace de liberté dans lequel trouver leur façon de faire de la médecine, on leur rappelle qu’ils sont formés sur les deniers publics pour rendre un service essentiel à la population. Sortir de ce dialogue de sourds s’annonce difficile sans une réelle réflexion sur le sens et le vécu des études de médecine, qui constituent aujourd’hui une expérience dominée par la surcharge de travail et les contraintes, faisant la part congrue à l’expression des choix individuels. Au vu des enquêtes, une seule certitude, sur laquelle toute réforme a selon moi à prendre appui : l’attrait du salariat et le regret très partagé de ne pas pouvoir combiner de façon souple différents types d’exercice sans s’encombrer de considérations de statut et de charges, notamment en situation d’exercice libéral limité. Des contrats multi-sites et multifonctions permettant de passer simplement du travail en institution au cabinet, de la médecine générale de premier recours à une pratique médicale plus orientée, seraient appréciés. Dans notre cohorte, plusieurs personnes qui ont remplacé un temps en médecine générale en gardant un pied en institution délaissent finalement le cabinet traditionnel non pas en raison de la nature du travail médical, mais du fait des contraintes associées à un exercice libéral partiel. Alors que les conditions du métier plaisent, celles de l’emploi peuvent décourager. La bascule se fait souvent vers le salariat en institution parce que pratiquer exclusivement en libéral est jugé insuffisamment protecteur en cas de coup dur, et parce que ne faire que cela est vu comme un risque de limitation ou de routinisation de la pratique. Il y a certes des limites à la dispersion à poser si l’on veut que les médecins puissent se sentir réellement partie prenante d’un cadre d’exercice, mais moins de compartimentation, d’ignorance voire de mépris du contexte de pratique des confrères ne pourrait qu’aider à une meilleure intégration des soins primaires. Les jeunes généralistes ont justement cette force de ne pas s’être construits contre l’hôpital ou les institutions.
Pour finir, il ne faudrait pas que les habitants des territoires enclavés ou délaissés soient les grands absents du nouvel équilibre à trouver entre besoins sanitaires à couvrir et aspirations légitimes à un équilibre de vie des professionnels (qui est aussi une condition de leur attachement à la clinique et aux patients). Confrontés au départ sans successeur de leur médecin, ces personnes risquent de se trouver parmi les plus attachées, à tort ou à raison, à une relation de soins personnalisée traditionnelle, donnant une place symbolique forte au généraliste. S’il est certain que d’autres formules sont viables et peuvent s’avérer au moins aussi performantes que celle de l’interlocuteur médical unique travaillant seul, il faut aussi considérer la déstabilisation des habitudes que ce nouveau mode de professionnalisme peut représenter pour des personnes fragiles. S’adapter à une pluralité d’interlocuteurs de santé leur impose de reconsidérer les bases de la confiance dans le médecin généraliste qui les connaissait pour la transférer à une équipe de soins correctement articulée. La figure de généraliste, qui se réclame de la capacité à réaliser une intégration singulière de multiples aspects de la vie du patient, n’en sortira pas inchangée.