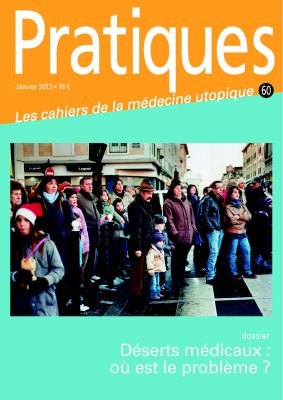Anne Véga,
docteur en anthropologie, chercheur attaché au Sophiapol (LASCO), université Paris-Ouest
Communication en partie proposée lors du 52e congrès des centres de santé, 2 octobre 2012 (Paris) : Caractéristiques et risques de la prescription médicamenteuse chez les médecins généralistes : une prévention est-elle possible ?
La culture du médicament en France : la panacée ? Dans cette étude qualitative le choix des enquêtés, médecins généralistes, s’est fait en complément de nos précédents corpus déjà importants [1]. En effet, il s’agissait à la fois d’avoir une diversité des situations (en termes d’âge, de genre, de lieu, de mode et de secteur d’exercice), mais aussi d’homogénéiser les données en vue de comparaisons. Grâce à notre connaissance préalable du terrain et de réseaux d’interconnaissance, trente nouveaux entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de praticiens exerçant en milieux semi-rural, urbain, semi-urbain et en banlieue. Tous travaillent en secteur [2] et ont des patientèles appartenant plutôt à des classes sociales moyennes et défavorisées. Parmi eux, la trajectoire de dix-huit praticiens — incluant des salariés travaillant en centres de santé — a été particulièrement étudiée, et dix ont été observés (soit cinq-cent cinquante consultations et cinquante visites à domicile analysées comprenant les relevés d’activité des médecins libéraux observés). J’ai cherché ainsi à mieux comprendre comment on devient ou on reste un « petit prescripteur » [3] en France « malgré tout », grâce également à un « Focus group » réalisé en formation initiale, au suivi de colloques et congrès professionnels et à une analyse de la littérature internationale.
Toutes les études sur l’hexagone font en effet état de recours à l’ordonnance avec des niveaux importants de produits dont l’efficacité n’a pas été démontrée. À la clé, il y a le besoin de se conformer à des normes d’action : « on doit montrer qu’on a fait quelque chose ». J’ai également retrouvé chez des enquêtés des traditions positivistes et des représentations positives du médicament « toujours plus bénéfique que toxique » : « ça ne peut faire que du bien ». Plus précisément, des fonctions spécifiques sont attribuées au médicament. Il permet de réduire rapidement tous les symptômes (logique culturelle dite de « réparation instantanée »), présents ou susceptibles d’apparaître. De plus, il existe en France des sensibilités importantes à l’égard de risques redoutés, en particulier en termes de complications respiratoires ou de « passage à l’acte » des patients « dépressifs ». En conséquence, j’ai observé dans les consultations des tendances à prescrire un produit par symptôme, y compris en cas d’épidémies saisonnières bénignes (type rhumes), des sur-prescriptions « préventives » en pathologie respiratoire, en cardiologie ainsi que des associations d’anxiolytiques aux antidépresseurs pour « prévenir » les passages à l’acte suicidaire (soulignées également dans l’étude Polychrome, 2009). Autre problème, en lien : chaque médecin a tendance à prescrire dans sa propre spécialité. Des médicaments dont les causes initiales de prescription ont été oubliées sont laissés dans des ordonnances, d’où des cumuls particulièrement visibles dans celles des personnes âgées. Ces tendances font suite à la valorisation de l’autonomie dans le travail : l’habitude est de ne pas intervenir dans les décisions d’autres médecins. Elle est doublée d’une importante hiérarchisation des soins : les enquêtés font plutôt confiance à l’expertise des médecins spécialistes, y compris en cas de doute sur des prescriptions. La survalorisation des savoirs « experts », aux dépens des savoirs plus généralistes, semble persister. Du moins, de jeunes médecins enquêtés font le même constat que leurs aînés : ils estiment ne « rien savoir » en sortant de la faculté, ceci les conduisant « à s’en remettre » à ceux « qui savent ». Or, les spécialistes sont nombreux à travailler avec les laboratoires pharmaceutiques, dont la présence est jugée généralement sans effet sur les prescriptions et positive par des enquêtés. En effet, les étudiants sont peu informés de leurs influences, par ailleurs peu contrôlées à tous les niveaux du système de santé [4].
Enfin, les médecins français travaillent beaucoup : des prescriptions permettent de pallier leur fatigue, c’est-à-dire de faire face à des plaintes répétitives, à des retours de patients non guéris (des caractéristiques de la médecine générale). Ces plaintes et ces retours sont amplifiés en France par des consommations et des prescriptions élevées de médicaments qui peuvent présenter des effets secondaires, et qui seraient loin de pouvoir répondre à tous les problèmes de patients de « ville ». Des prescriptions dues à la fatigue semblent également plus importantes, car cette dernière, et plus généralement les situations d’épuisement professionnel, restent peu reconnues et amènent des médecins à consommer des médicaments « pour tenir »... ce qui les conduits à banaliser des produits [5].
Pour toutes ces raisons, la plupart des praticiens enquêtés restent convaincus du bien-fondé et de l’indépendance de leur prescription, ce qui facilite grandement le travail commercial des firmes pharmaceutiques. En effet, ils informent d’autant moins leurs patients d’effets négatifs de médicaments prescrits qu’ils s’avèrent être eux-mêmes le plus souvent sous-informés par les firmes (prescription par exemple sans le savoir de « me too » : molécules nouvelles, mais proches d’une ancienne), et qu’ils croient en l’efficacité et aux effets bénéfiques des produits en général. Faute de recul sur le « réflexe » ordonnance-médicaments, ils continuent à penser que les patients viennent systématiquement... pour des médicaments.
Les petits prescripteurs, des contre-modèles
Ces enquêtés échappent à ces tendances générales. Mais à y regarder de plus près, tous ont eu des parcours « hors normes » auprès de patients également « hors normes ». Des motivations soignantes en entrant en faculté (« vocation », médecine humanitaire, médecine « de famille », soins « de santé primaires », etc.) les ont poussés à multiplier les expériences avant de s’installer : en planning familial, prisons, PMI, en médecine scolaire, de la marine, soins palliatifs, aux urgences, à la Croix Rouge, etc. En se confrontant précocement à des profils de patients variés, ils ont alors pris conscience de l’importance des conditions de vie dans les soins. Ils se sont également familiarisés avec les situations d’urgences sociales et vitales qu’ils prennent en charge sans crainte (problèmes psychiatriques, addictions diverses, tentatives d’autolyse).
La qualité des soins était et reste leur principale motivation au travail. Afin de faciliter les parcours de soins de leurs patients, ces praticiens ont gardé des liens directs avec des médecins hospitaliers. Mais la plupart travaillent également avec des paramédicaux et des professionnels du social (ce qui modère leurs ordonnances), et certains travaillent avec des pharmacologues, des spécialistes de la psyché, parfois au sein de réseaux formalisés. De même, la plupart ont repassé des diplômes (par exemple en pharmaco-chimie, en psychiatrie, en gynécologie, gérontologie, urgences, homéopathie) ou ont suivi des formations spécifiques (toxicomanie, groupes Balint). Ceci les a aidés à comprendre les limites du « réflexe » médicament-ordonnance. Ils sont progressivement devenus plus critiques à l’égard du médicament (a fortiori associé) et par rapport aux stratégies des laboratoires. Car tout est dans tout : ils se sont abonnés à la revue Prescrire, suivent régulièrement des Formations Médicales Continues et/ou recherchent des informations indépendantes (sur des sites anglo-saxons ou sur des sites comme le Formindep). Ils font donc preuve d’attentisme avant de prescrire de « nouveaux » traitements susceptibles d’être des « me too », privilégiant plutôt d’anciens produits dont ils ont appris à connaître les effets et qui sont souvent moins coûteux. Certains très petits prescripteurs font l’effort de « dé-prescrire » des produits, y compris de confrères spécialistes, qu’ils jugent « inutiles » « très peu efficaces », voire « dangereux » et « toxiques ».
Ces praticiens médicalisent peu les problèmes liés aux difficultés sociales, à la petite enfance, au vieillissement et aux états dépressifs, également parce qu’ils se sont créés progressivement des repères et compétences généralistes et/ou ont développé des alternatives aux médicaments (y compris des médecines complémentaires pour certains). Quelles que soient leurs orientations, tous interviennent sur des domaines habituellement pris en charge par les « spécialistes » (ex. urgences, petite chirurgie, « écoute empathique », prescription de neuroleptiques, de produits dermatologiques, etc.). Ils valorisent autant le fait d’éviter à leurs patients des recours aux urgences que de leur apprendre à s’automédiquer et à attendre la guérison de maux « bénins ».
Les pratiques observées concordent avec la plupart des recommandations de Jean Brami et René Amalberti (dialogues avec les patients informés visant à adapter des décisions médicales, suivis des patients et auto-surveillance du médecin) [6]. Cependant, ce qui distingue ces enquêtés de leurs confrères et consœurs plus prescripteurs, c’est un rapport positif au patient dont ils cherchent à comprendre le(s) motif(s) de venue et le point de vue. Car ce dernier est considéré comme intéressant et responsable : ayant des capacités de jugement, des expériences et des arguments à entendre.
Pour toutes ces raisons, leur travail est source d’épanouissement. Reste que ces médecins, tous libéraux dans cette étude, sont pénalisés par le système de rémunération à l’acte (puisqu’ils veillent également à ne pas trop travailler et pratiquent une médecine « lente »). Certains souffrent de formes de solitude car « le modèle de parcimonie de la prescription n’est pas favorisé par le système actuel ».
Une approche médico-centrée encore dominante ?
Par comparaison, les autres enquêtés plus prescripteurs oscillent entre recherche de réassurance et de confort personnel.
Ils sont venus à la médecine pour d’autres motivations que la santé des populations et sont davantage issus de familles de médecins : ils avaient des motivations de reproduction familiale, et moins le désir de devenir généraliste au départ. En conséquence, ils ont développé des compétences plus limitées : suite à des besoins de conformité, à des désirs de spécialisation, à la recherche de confort psychologique et/ou financier. Ils délèguent davantage de soins aux médecins spécialistes, avec lesquelles ils ont des rapports plus déséquilibrés, et à qui ils adressent des patients redoutés (comme les « psychiatriques »). Mais surtout, ils accordent moins leur confiance au patient dont ils ont des représentations plus négatives (profane non sachant, « demandeur » de médicaments, peu responsable voire peu considéré). Dans tous les cas, ils ont plutôt tendance à penser que seuls les médecins sont légitimes pour juger ce qui est « bien » pour leurs patients (expliquant qu’ils consacrent peu de temps à les écouter). Ces généralistes ont des pratiques fondées sur l’observance, d’autant plus qu’ils ont des visions positives à très positives des médicaments et qu’ils sont en contact avec les firmes pharmaceutiques. Enfin, ils travaillent davantage hebdomadairement et/ou plus rapidement, et d’après des modèles dominants qui ont des limites en médecine générale : poser un diagnostic (malgré l’incertitude), trouver un traitement médicamenteux et/ou multiplier des examens (alors que la plupart des patients de médecine générale sont atteints d’affections chroniques, bénignes ou débutantes d’une extrême diversité, fréquemment liées à leurs conditions de vie et sans supports lésionnels). Cependant, comme le médicament reste souvent leur seul moyen d’action, ils passent souvent leur temps en consultation à « jongler » avec leurs effets, avec plus ou moins de bonheur. Ainsi, les moyens prescripteurs expriment de nombreuses difficultés d’exercice, bien qu’ils soient dans les moyennes nationales. Parce qu’ils ont tendance à se cantonner à de « petits » soins, ils ont tendance à se sous-estimer et craignent de déranger les spécialistes, d’où des difficultés ensuite à « gérer de gros dossiers ». De gros prescripteurs le sont malgré eux. Ils n’ont pas d’autres alternatives que de recourir à des médicaments pour ne pas revoir de suite des patients dérangeants ou devenus « insupportables » (utilisation de produits pour ne pas les revoir de suite, pour ne pas s’investir par manque d’appétence, pour en « finir au plus vite »). Inversement, ils prescrivent par compassion ou désir de « régler tous les problèmes » de personnes jugées vulnérables, d’autant plus qu’ils jugent leurs proches « irresponsables ». Ces médecins se chargent alors d’eux-mêmes de « lourdes responsabilités » et se placent dans des situations d’impuissance. Car ils restent conscients de leurs propres limites relationnelles, de celles de leurs savoirs et de celles de la médecine spécialisée. Ils sont alors conduits à faire semblant d’avoir de l’intérêt pour les problèmes de patients, de maîtriser les effets des produits, et plus globalement d’avoir réponse à tout.
Leurs confrères encore plus prescripteurs ont généralement réglé ces problèmes en excluant les personnes leur faisant courir trop de risques et peu rémunératrices : ils ne sélectionnent que des patients « rapides » et « malléables » (absence de négociation). Une partie des prescriptions de ces médecins techniciens [7] « stakhanovistes » et quasi spécialistes visent à fidéliser des patients « captifs ». Ils s’allient souvent avec des médecins spécialistes également motivés pour « faire du chiffre ». Cependant, des épisodes malheureux survenus avec des patients et sources de traumatisme expliquent aussi certaines de leurs sur-prescriptions (ces « accidents » de parcours rapportés chez des correspondants de médecins généralistes enquêtés seraient donc également à l’origine de prescriptions élevées de médicaments en France, compte-tenu du manque d’échanges professionnels ou de leurs déséquilibres). Ceci renvoie plus précisément à l’insuffisance de communication autour de l’erreur médicale. Ces médecins échangent très peu sur leurs pratiques — a fortiori lorsqu’ils se sentent responsables de décès de patients. Leurs « abus » défensifs sont connus des autres médecins travaillant à proximité, mais ces derniers se contentent souvent simplement d’en prendre acte.
Les recrutements des généralistes et les formations médicales en question
Les enquêtés dont les désirs initiaux étaient d’emblée tournés vers les patients ont plutôt des usages modérés des médicaments. Ils sont devenus des « omnipraticiens » (au sens québécois). Après avoir multiplié les expériences auprès de patients et s’être reformés, ils ont acquis une certain « scepticisme » à l’égard des réflexes ordonnance-médicament. Malgré les limites de cette étude, ses résultats font échos à de nombreux travaux, dont ceux de Rosman [8]. Car au-delà de la médecine générale, beaucoup de médecins français en exercice continuent inversement à se sentir « obligés de prescrire » : par activisme, par conviction de bien faire et/ou de faire le bien du patient, pour se réassurer (se prémunir de risques réels ou supposés et « d’accidents de parcours »), et souvent faute d’autres alternatives légitimes acquises en facultés (soins de santé primaire, santé publique, épidémiologie, psychothérapie, etc.).
De notre point de vue extérieur, l’urgence serait de travailler sur les motivations des étudiants, voire de remettre en cause la façon dont ils sont sélectionnés. D’ici là, il semble important de développer des formations à l’incertitude (au doute) et à l’erreur, ainsi que les groupes de pairs (y compris sur la fatigue au travail et sur des peurs non dépassées). Autres pistes ? Travailler avec les étudiants sur le regard posé sur les patients, sur la médecine générale et sur les industries du médicament. Par exemple, en invitant des omnipraticiens à parler de leurs expériences positives auprès des patients et en diversifiant encore les lieux de stages en médecine générale (pour les sensibiliser davantage aux étiologies sociales, aux inégalités sociales de santé et aux besoins multiples des usagers). Des lieux de stage où la « coordination des soins » est effective. Histoire d’inculquer des habitudes de partage des décisions, pour contrecarrer un manque d’échanges directs et de connaissances des pratiques entre médecins et pour apprendre à travailler avec d’autres professionnels. Tout ceci passerait par l’implication de tous dans des enquêtes et publications pluridisciplinaires : associant des (para)médicaux, professionnels du social, pharmacologues, sciences humaines, et représentant d’usagers.
Resterait le nerf de la guerre : parler aux étudiants des pratiques de sous-information des firmes et, inversement, développer les apports en pharmacologie et en toxicologie. Car ce qui nous a le plus marqué dans cette étude, c’est l’absence de connaissance par la plupart des prescripteurs enquêtés des « me too », ou de notions claires des notions de SMR (Service médical rendu) et Amélioration du service Médical rendu (ASMR), voire des interactions médicamenteuses et des contre-indications. Toute une « éducation thérapeutique » à refaire ? Des travaux déjà publiés ou en cours de réalisation permettront de répondre dans la nuance à cette question, en particulier ceux qui interrogent la place de l’esprit critique dans la formation médicale, dans la suite des travaux d’Arthur Kleinman ou d’Alain Froment.
Publications : Une ethnologue à l’hôpital, Editions des Archives Contemporaines, Paris, 2000 ; « Cessation d’activité libérale de médecins généralistes : motivations et stratégies », Dossier Solidarité et Santé, no 6, 2008 (collectif, en ligne) ; « La mort, l’oubli et les plaisirs : les cheminements des patientes dans le cancer du sein », Anthropologie et santé, no 4, 2012 (en ligne).