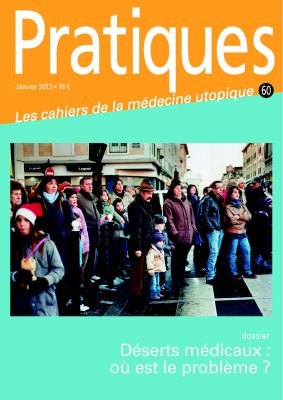Entretien avec Annie Thébaud-Mony,
directeur de recherche honoraire à l’INSERM, docteur ès lettres et sciences humaines en sciences sociales, présidente de l’association Henri Pézerat santé travail environnement, porte parole du réseau international Ban Asbestos (expérience de réseau citoyen, qui a refusé d’avoir une existence officielle d’ONG internationale)
Propos recueillis par Anne Perraut Soliveres et Martine Lalande
Une recherche toujours mise en cause
Récemment, je suis intervenue dans l’expertise CHSCT demandée par des délégués syndicaux de France Télécom. Le cabinet d’expertise agréé a fait appel à l’équipe GISCOP 93 de l’université Paris 13 pour reconstituer les parcours professionnels des agents de France Télécom atteints de cancers et documenter leurs expositions professionnelles. À aucun moment je n’ai dit que je pouvais déterminer ce qui avait provoqué leur cancer, pas un médecin ou un scientifique qui se respecte ne peut affirmer cela, ce serait un abus. Quand un médecin dit à un patient que son cancer est lié au tabac, il n’en sait rien, même si la personne a fumé. Le cancer n’est pas le simple effet d’une cause, c’est une histoire. Il y a tout ce qu’on a pu respirer comme cancérogènes, ainsi que toute l’alchimie des systèmes de réparation en cas d’atteintes cellulaires ; systèmes qui fonctionnent ou non, des systèmes enzymatiques, et une variabilité individuelle rendant impossible la reconstitution a posteriori de ce processus du cancer pour une personne donnée. Les scientifiques un peu sérieux assument ce fait. Les médecins sont plus péremptoires, quand ils disent « Votre cancer est dû au tabac », cela ferme la porte. Du coup, les gens sont dubitatifs lorsqu’on leur dit qu’il pourrait y avoir d’autres cancérogènes en jeu. Ils ne comprennent pas que c’est une histoire, pas seulement une relation simple entre une cause et un effet. Dans l’enquête Giscop, nous essayons, partant des connaissances que l’on a sur l’histoire du cancer, d’établir au moins la liste des substances cancérogènes auxquels les personnes malades ont été professionnellement exposées. Cela permet, non pas de déterminer la « cause » du cancer, mais d’identifier les différents cancérogènes ayant pu contribuer à ce cancer.
J’ai été convoquée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région où se déroulait l’expertise et l’Institut de Veille Sanitaire pour examiner et discuter ma méthodologie. Quand les scientifiques veulent essayer de disqualifier une recherche, ils discutent la pertinence de la méthodologie. L’expert auprès du CHSCT et moi-même, ainsi que les syndicalistes à l’origine de la demande d’expertise, nous avons fait face à des questions mettant en cause notre démarche avec un double procès d’intention : « Vous n’apportez pas la preuve du lien de causalité entre les cancers observés et les expositions recensées » ; « Vous visez la reconnaissance en maladie professionnelle » (avec un sous-entendu : quitte à « exagérer » les expositions).
On m’a attaquée sur la façon dont j’avais « choisi » ma population d’étude, or je ne l’avais pas choisie, puisque j’ai étudié ceux qui étaient malades. On m’a reproché de ne pas avoir pris de cas-témoins, mais je n’en avais pas besoin, puisque je ne voulais pas démontrer une causalité, mais explorer l’exposition professionnelle de patients atteints de cancers à des cancérogènes avérés. Ils disaient qu’alors je ne pouvais pas affirmer que c’étaient ces polluants-là qui avaient donné ces cancers. Je me suis fâchée et leur ai rétorqué qu’on n’avait pas besoin de prouver à nouveau que l’amiante donne des cancers, que les rayonnements ionisants donnent des cancers, que le plomb donne des cancers, etc. La seule chose qu’on ne sait pas, c’est — dans une population exposée à ces différents polluants — sur qui ça va tomber, c’est-à-dire qui sera atteint de cancer. Je ne dis pas ce qui a, à coup sûr, donné le cancer, mais je suis sûre que ces gens-là ont été exposés professionnellement à des produits cancérigènes. Il existe une jurisprudence qui dit que quand le travail a pu provoquer ces cancers-là, ils doivent être reconnus dans le cadre d’une légitime réparation en maladie professionnelle. C’est alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire, à savoir prouver que le cancer dont sont victimes ces travailleurs est lié exclusivement à une autre cause, tel le tabac ! Je ne dis rien d’autre. La causalité, ils s’en chargent.
L’hypocrisie de la recherche de preuve
Je ne suis d’ailleurs pas d’accord avec la façon dont ils traitent la causalité, ce n’est pas l’épidémiologie qui donne la preuve, elle établit seulement des corrélations. Seuls les toxicologues peuvent établir des éléments de preuve. Mais malheureusement, et c’est le fruit des rapports de domination dans l’institution scientifique, les données toxicologiques sont considérées comme insuffisantes pour apporter la preuve. Il faut une expérimentation humaine pour que la preuve soit établie. Et c’est une mauvaise preuve puisqu’elle reste probabiliste. La statistique est capable d’établir des liens, de dire s’il y a un risque relatif augmenté, mais comme on ne peut pas dire à coup sûr s’il s’agit de tel ou tel polluant, on est continuellement dans la fabrique du doute. C’est si vrai qu’un collègue américain, David Michael, aujourd’hui, responsable de la santé au travail dans l’administration Obama, a écrit un livre qui s’intitule : Le doute est leur produit. Il explique comment, de l’industrie du tabac, à l’amiante, en passant par le plomb, les rayonnements ionisants, etc., la stratégie des industriels (et des scientifiques qu’ils ont payés pour cela) a été de prolonger autant que faire se peut le doute sur les effets sanitaires de ces substances toxiques. Cela a contaminé les institutions comme le Centre international de recherche sur le cancer qui dit que pour qu’un cancérogène soit reconnu, il ne suffit pas d’avoir des résultats toxicologiques, il faut qu’il y ait la preuve, une « évidence suffisante ». C’est cocasse : alors qu’on me reproche mes études qualitatives, qu’est-ce qui est plus qualitatif que ces « évidences suffisantes »... ? Il existe un blocage énorme dans le mode de fonctionnement de l’institution scientifique : tant qu’on restera accroché à l’idée que c’est l’épidémiologie qui apporte la preuve, on courra derrière les catastrophes sanitaires les unes après les autres.
Blocage scientifique et cynisme industriel
On vient de le voir avec Séralini et son étude sur les OGM et les cancers. Pour faire de la recherche, vivons cachés... ! C’est ce qui s’était passé dans les années 90 pour Jean-François Viel, qui étudiait les enfants atteints de leucémie autour de la Hague. Il a fait une enquête remarquable et le jour où elle est sortie, tous les épidémiologistes se sont jetés sur lui pour disqualifier son travail. Là encore, c’est sa méthodologie qui a été discutée, comme si la méthodologie de l’épidémiologie pouvait apporter la preuve. Après l’avoir disqualifié, ils ont fait d’autres études qui ne remettent pas en cause ses résultats, au contraire. Alfred Spira, qui ne connaissait absolument pas les rayonnements ionisants, a fait une étude en se fondant sur le type d’hypothèse que l’industrie est capable de générer. Il est parti d’une hypothèse émise par un anglais, suite à un accident nucléaire dans l’usine de retraitement des déchets nucléaires, à Sellafield, autour de laquelle avait été identifié un excès de leucémies chez les enfants. Ils ont émis l’idée que c’était lié à un virus inconnu apporté par les populations venues construire l’usine de Sellafield... Spira a fait la même hypothèse pour expliquer l’excès de leucémies chez les enfants autour de la Hague. Il a même fait lever le blocage sur l’utilisation du numéro de Sécurité sociale pour rechercher des données et essayer de prouver que l’épidémie de leucémie n’avait rien à voir avec les rayonnements ionisants, mais était liée à un virus. Il n’a rien prouvé du tout et, malgré tout, il a été obligé d’admettre que l’incidence de leucémies chez les enfants autour de la Hague était plus élevée qu’ailleurs. Donc le symptôme était validé, mais l’explication n’ayant pas été validée, il a dit qu’on ne savait pas très bien... Et les résultats de Jean-François Viel ont été enterrés [1].
Au niveau industriel, ce n’est pas du blocage, c’est du cynisme... C’est de la criminalité organisée. L’histoire de l’amiante se répète pour la chimie, l’agro-industriel, le nucléaire, la métallurgie, l’aérospatiale... Notre Code pénal dit que la mise en danger d’autrui, l’homicide, sont passibles de prison et de peines lourdes en termes d’indemnisation des dommages. Et l’amiante continue à faire des ravages.
Les dangers de l’amiante, pas seulement au travail
Je reviens d’une réunion à Bruxelles où on a constaté que l’amiante en place est très mal gérée et que la deuxième vague, derrière celle dont on n’a pas encore fini de voir les dégâts, sera celle des dégâts du désamiantage. C’est ce que craignait Henri Pézerat, mon compagnon. Nous sommes très inquiets de ce qui est en train de se passer. On a mis de l’amiante partout : en France, il y a entre 75 et 80 kg d’amiante par habitant. Nous avons écouté un exposé remarquable d’un anglais qui a perdu sa femme d’un mésothéliome. Elle était institutrice. Il a fait émerger le problème de l’amiante dans les écoles et de l’exposition des enfants dans les écoles amiantées. En France, nous n’avons pas de recensement et de registre des écoles et autres bâtiments amiantés. Le cas d’Aulnay-sous-Bois est très emblématique. Une usine a broyé de l’amiante pendant cinquante ans à Aulnay-sous-Bois, juste à côté de deux écoles, une école primaire et une école maternelle [2]. Le premier cas déclaré était Pierre Léonard, le frère d’une amie. Il est décédé de mésothéliome à 45 ans : sa seule exposition était manifestement celle-là, d’avoir fréquenté l’école primaire voisine de l’usine. Depuis, les associations ont recensé plus de cent cas, dont l’exposition était uniquement environnementale pour une majorité. Les travailleurs de cette usine étaient des migrants qui sont retournés mourir chez eux, on n’a pas pu les recenser. Les victimes recensées étaient des enfants qui étaient à l’école et les riverains : on pouvait écrire au doigt sur les tombes du cimetière qui jouxtaient l’usine, tellement il y avait de poussière, et le maraîcher lavait ses salades en laissant de l’amiante dessus, car il ne pouvait pas faire autrement. Nous sommes en lutte avec les autorités depuis quinze ans pour obtenir qu’une information soit diffusée auprès de tous les enfants qui ont fréquenté cette école et qu’ils aient droit à un suivi médical gratuit, comme les travailleurs de l’amiante. Et pour les riverains, dans un périmètre à déterminer. Il existe un travail de l’INVS réalisé à ce sujet par Émilie Counil, aujourd’hui directrice du Giscop. À partir de la localisation des cas et de ce qu’on sait par d’autres travaux sur l’amiante, on peut déterminer un périmètre raisonnable pour dire que tous ceux qui sont à l’intérieur de ce périmètre devraient pouvoir bénéficier d’un suivi postexposition. On voudrait qu’il y ait un travail systématique de registre, à partir des registres de l’école, des listes électorales, des registres des travailleurs, pour identifier les cas existants et ensuite sur cette cohorte, identifier les cas à venir et faire le véritable bilan de cette catastrophe. C’est ce qu’on aurait dû faire autour de tous les sites et de tous les endroits où il y a de l’amiante. Pour tout immeuble amianté, qui a pu contaminer des habitants, il devrait y avoir des lieux de suivi post-exposition. C’est une de nos bagarres, qui concerne aussi les autres cancérogènes. Dans le domaine du travail, il existe un décret donnant droit au suivi post-exposition pour les personnes exposées à des produits cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Nous demandons que ce droit s’étende à toute personne connaissant son exposition. C’est à partir du moment où il y a eu des procès que cela a évolué sur l’amiante en France. Le rapport de forces actuel est tellement en défaveur des travailleurs, des citoyens et des riverains qu’il est très important de considérer l’action judiciaire comme un outil d’action politique. Le procès comme action politique est indispensable pour la prévention.
Il faut aller en justice contre les pollueurs
Il y a des polluants connus depuis des décennies, voire plus, comme les hydrocarbures polycycliques aromatiques, ce qui concerne toute l’industrie chimique pétrochimique, l’industrie de la route, la construction, tout ce qui est en rapport avec les produits pétroliers, les solvants, toute une gamme de produits utilisés dans la construction, dans le travail des métaux, les fluides de coupe, toutes ces substances sont utilisées communément sans aucune protection. Des enquêtes du ministère du Travail comptabilisent et estiment le nombre de salariés exposés quotidiennement dans leur travail à ces polluants. Les industriels, les employeurs responsables de ces expositions sont en infraction pénale caractérisée. Car il existe des décrets. On ne peut pas dire : « On ne sait pas ». Délibérément, ils exposent des personnes, avec cynisme, car ils savent qu’on ne sait pas qui va être atteint de cancer, sur qui ça va tomber. Et cela tombe sur des ouvriers qui sont le plus souvent en situation précaire, des intérimaires, les ouvriers sur la route et bien d’autres encore... Quand on voit les ouvriers en train d’étendre du bitume, c’est une horreur. Les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers du bâtiment sont hallucinantes. Ils travaillent dans des conduites enterrées, au marteau-piqueur, sans masque, alors qu’il y a certainement au minimum de la silice, probablement des déchets d’amiante encore présents dans les revêtements, il y a du plomb, et même si les tuyaux sont en plastique plutôt qu’en fibrociment, le chlorure de vinyle, le PVC, est également un polluant, ils les chauffent, il y a des émanations... La sous-traitance permet à ceux qui sont les véritables responsables de s’abriter complètement derrière la sous-traitance des risques. On l’a dénoncé pour la maintenance dans le nucléaire, mais on le retrouve absolument à tous les niveaux. Les employeurs sont passibles des mêmes peines auxquels des industriels, ex-PDG suisse et belge du groupe Eternit, ont été condamnés à Turin.
Turin : les industriels condamnés
Pour la première fois à Turin en février 2012, des industriels ont été inculpés puis condamnés pour désastre volontaire. C’est historique au plan mondial, une brèche dans le droit pénal. Dans « désastre volontaire », il y a deux notions importantes. La notion de « désastre » qui prend en considération l’ensemble des conséquences au niveau collectif. Il y a des morts, des malades et une contamination qui demeure une menace. Et « volontaire » : ils savaient, et leur stratégie délibérée a été de continuer alors qu’ils savaient. Il existe un texte célèbre qui relate une conférence à Londres en 1971 où étaient réunis tous les industriels de l’amiante, peu de temps après la sortie des résultats de Selikoff. C’est le premier chercheur américain qui avait conduit une étude, indépendante de l’industrie, sur les rapports entre amiante et cancer, réalisée avec la caisse de retraite des travailleurs de l’isolation de New York.
Lors de la conférence de Londres de 1971, ces industriels se réunissaient pour établir les stratégies leur permettant de différer autant que possible l’information sur les effets sanitaires de l’amiante, faire une action de lobbying auprès des pouvoirs publics pour empêcher l’adoption de réglementations et mettre en place des organes comme le Comité permanent amiante français, faisant la cooptation la plus large pour maintenir le contrôle sur les scientifiques, sur les pouvoirs publics et sur les organisations syndicales. Ils ont parfaitement réussi pendant vingt-cinq ans. C’est ce qui a été au centre du procès de Turin [3].
Stephan Schimdheiny (ex-PDG d’Eternit Suisse) et Louis Cartier de Marchienne (ex-PDG d’Eternit Belgique) ont été condamnés à seize ans de prison ferme, une condamnation très lourde, avec de très lourdes indemnisations, et pas seulement pour les victimes. Les parties civiles étaient constituées des victimes, des organisations syndicales et des associations, des collectivités territoriales, la région, la ville de Casale, la région Piémont et d’autres régions, et aussi de la caisse d’assurance maladie italienne. L’indemnisation concerne tout ce monde-là. La région Piémont a obtenu une indemnisation pour régler le problème de la décontamination. À Ban Asbestos, c’est une de nos revendications depuis longtemps : un fonds d’indemnisation financé par les industriels de l’amiante et tous les industriels qui ont utilisé l’amiante en pleine connaissance de cause, les multinationales comme Alsthom, la SNCF, EDF... et Bouygues évidemment — ceux de la construction ne sont pas vierges dans cette histoire. Nous considérons qu’il devrait y avoir un fonds qui serve à la décontamination et à financer le suivi post-exposition post-professionnel. Mais ce fonds doit être public, avec une collecte de fonds qui soit à la mesure des dégâts qui ont été produits. Un peu comme il a été statué dans le cadre du procès de Turin. Malheureusement, on n’est pas près de l’obtenir au niveau européen.
Les limites de la médecine du travail
Individuellement, certains médecins du travail sont des gens formidables. Ils se sont battus pour la défense et l’illustration de la médecine du travail. Quand on a créé l’association pour l’Étude des Risques du Travail (ALERT) en 1986 et 1987, avant la réforme de 1988, la question en débat était la forme qu’il fallait donner à cette institution pour qu’elle se dégage de sa soumission au patronat. Je plaidais pour ce que j’avais vu ailleurs, et notamment en Italie ou au Québec : un service de santé publique. Un champ à part entière de la santé publique pour la santé au travail au sens propre du terme, non pour faire faire des hemoccult aux ouvriers ni leur dire de ne pas fumer, mais s’occuper des risques du travail. Ce service public serait financé par un impôt spécifique aux entreprises au prorata du nombre de salariés. En d’autres termes, un impôt sur lequel les entreprises n’auraient aucun droit de regard. Malheureusement, parmi les médecins du travail et les syndicats de médecins du travail, cette proposition a eu très peu d’échos. Et elle a été enterrée dans les débats et de nouveau récemment. La faillite actuelle de la médecine du travail, avec le texte récemment adopté qui les rend encore plus prisonniers du patronat, est liée à leur défense qui me semble beaucoup trop corporatiste. La réforme, qui avait été adoptée du temps de Sarkozy et que Hollande a décidé d’accepter, institue le fait que le patronat dicte aux médecins du travail ce qu’ils ont le droit de faire, à travers un habillage de pluridisciplinarité. On a changé les mots, on parle de « santé au travail »... Pour ma part, je parle de « santé des travailleurs », c’est beaucoup plus clair.
Cette réforme renforce la dépendance par rapport au patronat, et renvoie la santé au travail dans le champ de la soi-disant négociation salariale, mais les syndicats ne se battent pas sur ce sujet. Les syndicats d’EDF se battent pour la médecine du travail EDF, mais pas pour la médecine du travail des sous-traitants qui est absolument indigente. Un médecin du travail de la sous-traitance qui surveille les salariés intervenant en centrale nucléaire, les plus exposés à tous les risques, la radioactivité et le reste, la légionellose dans les vestiaires qui ne sont pas nettoyés... ce médecin du travail n’a pas que les sous-traitants du nucléaire à surveiller. Il a une panoplie de 300 à 500 entreprises, entre 3 000 et 7 000 salariés à surveiller, et quelques sous-traitants. Le médecin du travail d’EDF surveille 500 salariés de la même entreprise sur le même site, où il va passer toute sa carrière. On a essayé de dire qu’il pourrait surveiller ceux qui viennent chez lui et, avec l’informatique, on peut mutualiser un dossier médical, même si le même salarié se retrouve à 800 km de son entreprise. On sait communiquer entre la France et l’Australie, on pourrait bien s’écrire entre médecins... Cela n’a jamais été possible !
Des syndicalistes portent plainte
Il y a un droit d’exception qui autorise, en pleine connaissance de cause, d’exposer des gens à des risques mortels. C’est aussi le cas du suicide. Un jugement très intéressant a concerné le « risque organisationnel », récemment à Lyon. Un tribunal a condamné pour mise en danger d’autrui la Caisse d’Épargne, en raison de son système d’évaluation des salariés, qui est une manière de mettre en permanence en concurrence les salariés sur leurs performances, un système qui rend fou. La Caisse d’Épargne a été condamnée [4]. Ils feront appel bien sûr. C’est parti d’une plainte avec expertise du syndicat SUD, qui a obtenu gain de cause. C’est un beau jugement. Malheureusement, on assiste dans beaucoup d’endroits à l’affaiblissement syndical lié à la sous-traitance et au fait que les syndicats sont dos au mur avec les questions d’emploi. Sans compter la division et la frilosité des syndicalistes qui n’osent pas venir chercher les experts comme moi et d’autres qui sont prêts à travailler avec eux pour faire évoluer les choses. L’association Henri Pézerat [5] est maintenant constituée non seulement d’un réseau d’associations et de volontaires, mais aussi de syndicats. À travers ce type de réseau, on voit se développer des collaborations qu’on ne connaissait pas il y a dix ou quinze ans. Des syndicalistes ont été à l’origine du réseau qui a construit le mouvement contre l’amiante, dont je suis membre fondateur. L’Andeva ne le reconnaît pas suffisamment, à mon sens : les associations locales ont souvent une base syndicale très solide qui permet que les choses continuent à évoluer, au moins localement.