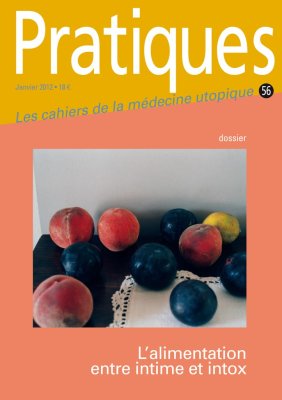Alain Caillé
sociologue et économiste, professeur émérite à l’université de Nanterre, fondateur de la revue du MAUSS (mouvement anti utilitariste dans les sciences sociales) www.revuedumauss.com
Dans les années 70-80, le paysage intellectuel a changé du tout au tout. La répartition des rôles entre les disciplines en sciences humaines, sociales, économiques, philosophiques et politiques a basculé vers une vision économiciste de la société. Jusqu’aux années 70, les économistes limitaient l’usage de la notion d’homo economicus, rationnel, qui ne cherche que son propre intérêt, à leur discipline pour expliquer ce qui se passe dans le monde du marché sans se pencher sur les autres domaines.
Deux grands changements ont eu lieu après : d’une part, les économistes ont commencé à penser que cela peut s’appliquer à tout : à l’amour, aux croyances, etc. D’autre part, la grande surprise, c’est que les autres disciplines leur ont donné très largement raison. Du côté libéral, avec Raymond Boudon, champion de l’individualisme méthodologique, on pense que toute la vie sociale doit être expliquée par les choix rationnels des individus. Mais également du côté néomarxiste avec Pierre Bourdieu, qui s’appuie sur le postulat que l’intérêt de classe explique tout. En philosophie, dans la Théorie de la justice, Rawls essaie de penser ce que sont des institutions justes qui seraient, pour lui, choisies par des hommes rationnels, c’est-à-dire des sujets économiques. La philosophie sociale bascule dans un registre complètement économiciste. Cette révolution intellectuelle a précédé de quinze ans, la légitimant à l’avance, la mondialisation, c’est-à-dire l’universalisation du marché à toutes les sphères de l’existence.
Le pari du MAUSS
Le MAUSS naît en 1981, à partir d’une surprise, face à cette évolution des idées, et se fait le porteur d’une perspective anti-utilitariste, soucieuse de proposer une autre vision. Marcel Mauss, neveu et successeur d’Émile Durkheim, dans son Essai sur le don en 1925, rassemble le savoir ethnologique de son temps et donne à voir le mode d’organisation des sociétés premières. Ces sociétés archaïques ne reposent pas sur le marché, sur le donnant-donnant ou sur le contrat, mais sur la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Autrement dit, sur l’obligation de rivaliser de générosité. Le don est un combat, c’est une forme de guerre. Ce don est agonistique. Mais cette guerre par le don est un moyen de faire la paix, de transformer les ennemis en alliés. Depuis trente ans, le MAUSS approfondit le volet de la critique de l’économisme, mais s’attache aussi à développer le côté positif : qu’est-ce qui subsiste et doit subsister de l’univers du don dans la société moderne ? Comprenons en effet que porter le regard sur les sociétés archaïques ne signifie nullement qu’on s’inscrit dans une vision ou dans des aspirations passéistes. Au contraire. Rappelons que Marcel Mauss était un socialiste convaincu, bras droit de Jaurès.
S’opposer sans se massacrer (Marcel Mauss)
L’organisation de toutes les sociétés archaïques, à partir de la logique du don et de la triple obligation du donner, recevoir et rendre, répond à la question politique première. C’est la réciprocité des dons, dans une mise en scène permanente ritualisée qui permet d’éviter de se massacrer, d’éviter la guerre, la mise à mort de boucs-émissaires, ou l’instauration de hiérarchies plus ou moins rigides qui enferment chacun à sa place. On voit bien que cette logique du don, basée sur la réversibilité et la réciprocité est de même nature que celle qui permet de faire vivre la démocratie, toujours menacée de sombrer dans la guerre générale des intérêts individuels à court terme ou dans la monopolisation du pouvoir et de la richesse par une oligarchie.
La croissance ne fait pas le bonheur
L’adhésion à la démocratie d’aujourd’hui a reposé sur la perspective d’une forte croissance, ininterrompue, comme pendant les trente glorieuses où la progression du PIB atteignait 4 à 5 % par an, participant à l’amélioration des conditions de vie. La croissance a fonctionné comme une sorte de bouc-émissaire à l’envers, non pas une victime désignée que l’on rend responsable de tous les maux, mais comme une « boucle émissaire », un espace de projection non de la haine mais de l’espérance où l’on met tous ses espoirs dans une croissance à venir, corrélée à la recherche du bonheur.
Or aujourd’hui, il y a de moins en moins de croissance et il n’y a plus de corrélation entre croissance et bonheur. La question est donc de savoir si on peut se passer de la croissance ou s’il faut la faire revenir alors qu’elle devient insoutenable écologiquement. Si elle ne revient pas, ne peut-on chercher le bonheur dans autre chose que la croissance ? Il faut trouver un autre fondement à la démocratie que celui de l’économie.
Pour John Stuart Mill, l’état stationnaire est le plus heureux pour l’humanité. Mais il faut ajouter, pour ne pas tomber dans le sacrifice, la mortification, que l’état stationnaire peut être dynamique, au sens que le PIB n’augmente pas, mais où il y a des inventions techniques, un énorme accroissement de l’inventivité culturelle, sociale et politique. A certains égards, cela apparaît plus facile que de passer sa vie à accroître la production économique. Pour penser cette évolution, nous sommes obligés d’accepter une mutation de la philosophie politique héritée des grandes doctrines : socialisme, communisme, anarchisme et néolibéralisme. Ces quatre doctrines, aussi opposées soient elles, ont en commun un soubassement utilitariste, une idéologie économiciste : la certitude que les grands problèmes de l’humanité ne seront résolus que par le toujours plus économique. C’est avec cette certitude que nous devons prendre des distances, car elle ne suffit plus.
Conjurer l’illimitation et la démesure
S’opposer sans se massacrer, c’est la question de fond de l’humanité. Le défi de toutes les morales et de toutes les religions est de limiter le désir de toute puissance des hommes, leur désir insatiable du toujours plus. Selon les Grecs, ceux que les Dieux voulaient perdre, ils les faisaient entrer et s’abîmer dans la démesure. Dans l’ubris. C’est elle qui déclenche des haines inexpiables. En termes laïcs, Durkheim pensait que les besoins ne peuvent être satisfaits que s’ils sont limités, et limités par quelque puissance morale légitime. À défaut, les hommes basculent dans ce qu’il appelait l’anomie, la perte de toutes règles, une variante de l’ubris.
Aujourd’hui, cette démesure est devenue la religion du capitalisme moderne. L’illimitation a été exacerbée à compter des années 80, multipliant les inégalités. Dans les années 70, les cent patrons les mieux payés gagnaient quarante fois plus que leurs employés. Depuis 2010, ils gagnent 1 000 fois plus... Si l’on regarde les principes économiques des États-Unis en 1970, à la lueur de la réalité inégalitaire d’aujourd’hui, on pourrait croire qu’on était dans un pays communiste... Cette dynamique inégalitaire est à la fois cause et effet de la stagnation de la croissance économique en Occident, car les quatre cinquièmes de la croissance sont spéculatifs, et alimentent une véritable sortie de la démocratie par la corruption, la toute puissance de l’hyperfinance, les mafias, le crime généralisé, provoquant des tensions mondiales terrifiantes et la dévastation de la planète.
Commune humanité et commune socialité
Le problème central aujourd’hui est de revenir à une commune humanité et à une commune socialité en s’attaquant immédiatement à la question de la démesure.
Principe de commune humanité : l’affirmation de l’unité du genre humain, que l’égale dignité et valeur en droit des être humains est première par rapport à toutes les différences biologiques, culturelles, économiques, religieuses, etc. aussi inévitables ou légitimes qu’elles puissent être.
Principe de commune socialité : les sujets humains ne sont pas d’abord et pas seulement des individus, mais sont avant tout des êtres sociaux. Ce sont leurs relations avec d’autres être sociaux qui constituent leur véritable richesse. Ce que j’appelle le convivialisme doit donc être le souci de la dignité des hommes et la préservation de ce qui leur permet de faire société.
La traduction politique de cette idée directrice est l’affirmation qu’aucun être humain n’a de titre à posséder une richesse qui dépasse un seuil jugé excessif par le sens de la décence commune. Et que symétriquement, aucun être humain ne doit se voir réduit à l’extrême pauvreté, condamné à l’abjection de la misère.
Convivialisme ou barbarie
Le défi de l’humanité est de trouver une réponse pérenne à la question de savoir comment vivre ensemble en s’opposant sans se massacrer. En surmontant ses haines et ses folies meurtrières. Ce défi qui est celui du « convivialisme » passe par la redéfinition d’un idéal civilisationnel. Nous n’avons plus le choix, il nous faut maintenant le réaliser pleinement ou disparaître. Convivialisme ou barbarie. Civilisation (pour de bon) ou disparition.
Le convivialisme, au contraire des totalitarismes d’hier et du totalitarisme à l’envers d’aujourd’hui, reconnaît et accueille comme tels les dons de la nature comme ceux des cultures passées. La seule alternative est de faire confiance à l’esprit du don et de la démocratie en choisissant de s’engager résolument dans la voie de la construction d’une démocratie universalisable, choisie pour elle-même, et non, en premier lieu, pour favoriser un enrichissement matériel individuel sans limite. Une démocratie qui repose sur la priorité accordée à la question de savoir comment bien vivre ensemble et sauver la Nature. Cette préoccupation écologique est indispensable à la survie du monde.
Construire cette démocratie suppose trois conditions principales :
— lutte délibérée contre la démesure, source de toutes les corruptions, qui mette hors la loi tant l’extrême richesse que l’extrême pauvreté. Ceci suppose que soient instaurés conjointement, selon les conditions locales, un revenu maximum et un revenu minimum et que soit systématiquement découragée la déconnexion entre la finance spéculative et rentière et l’économie réelle.
— La redéfinition des États-nations dans une perspective transnationale et transculturelle qui prenne comme principe régulateur l’objectif de favoriser le maximum de pluralisme culturel qui soit compatible avec leur maintien. Ou encore celui de viser la plus grande compatibilité possible, dans chaque communauté politique, entre droit à l’enracinement et droit au déracinement, entre l’égalité de droit des diverses cultures et leurs inégalités de fait.
— La conquête par la société civile associationniste, locale, régionale, nationale ou transnationale de sa pleine autonomie et de sa souveraineté politique. Libéralisme et socialisme ont été les champions, respectivement, du Marché et de l’État. Le convivialisme parle au nom de la Société elle-même, telle que représentée, mise en forme et en actes par l’efflorescence des associations.
Quel pourrait être le déclencheur ? L’étincelle qui nous permettrait de relier les multiples luttes, les multiples expériences, les multiples théorisations qui se font jour partout au travers de la planète, mais sans réussir jusqu’ici à suffisamment converger pour peser de manière effective sur le cours du monde ? Très probablement la conjonction d’un désastre économique social et écologique et d’un sentiment d’indignation irrépressible. Mais la difficulté, énorme, sera alors d’éviter que la catastrophe ne débouche sur des régressions archaïsantes et fascisantes ou sur des fuites en avant, millénaristes ou révolutionnaristes.
Pour cela, il faudra qu’un grand nombre d’hommes et de femmes se soient dé-convaincus qu’une politique de civilisation (Morin) et de dialectisation démocratique de la haine est possible. La seule possible en réalité. Et qu’elle suppose que soient enfin dépassées, dans l’histoire humaine, les logiques de vengeance et de ressentiment. Tel est le véritable défi qui nous attend.