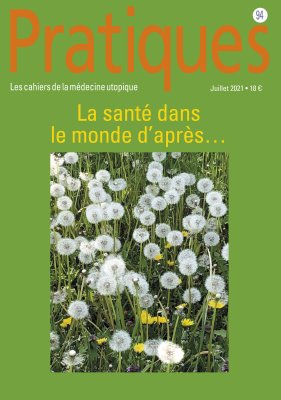Solène Forget
Infirmière sociologue
Devoir de réserve et fiction
Nous, soignantes de l’hôpital public, sommes soumises à la neutralité. Nous obéissons au devoir de réserve.
Cette notion floue place la critique publique de l’hôpital par l’une d’entre nous comme une faute passible de sanction, voire de révocation. Nous nous questionnons donc sur la capacité de l’État à se remettre en question. Pire, nous le soupçonnons de refuser de considérer ses agentes comme des êtres humaines égales aux autres en liberté. Car il s’agit bien là de nous nier une forme de liberté fondamentale, la liberté d’exprimer notre opinion.
Le devoir de réserve est régi par la jurisprudence et par la discrétion qui laisse aux hiérarchies le pouvoir de décider du sort de la fautive. Notre prise de parole est vouée à l’interprétation qui en sera faite, elle devient donc risquée. L’opacité fait de cette règle de droit, plus qu’une loi, un instrument de peur qui dissuade de toute parole. La rhétorique guerrière du président en mars l’année dernière entérinait son usage. En temps de guerre, le devoir de réserve sert à étouffer une mauvaise propagande qui freinerait les volontés et l’assaut des soldates. Il est plus aisé de sacrifier des vies bâillonnées pour en sauver d’autres dans les discours.
Nous ne sommes pas devenues soignantes au nom de la guerre, mais au nom de la vie. Nous ne sommes pas devenues soignantes pour combattre, mais pour aider. Nous sacrifions déjà nos vies de famille, nos nuits, nos soirs et nos matins, nos mains et nos dos, nos salaires, notre tranquillité et souvent, notre dignité. Nous mettons nos ego derrière nous, mais nous ne sommes pas prêtes à mourir comme des soldates. Nous voudrions le hurler fort dans les médias, mais le devoir de réserve se dresse comme une barrière épuisante à franchir pour les déjà épuisées que nous sommes. Alors nous nous taisons. Nous laissons ce risque à quelques-unes d’entre nous, syndiquées ou déjà prêtes à la démission.
Nous sommes des héroïnes sans nom ni voix, réduites au silence mortifère de la neutralité. Mais la neutralité est-elle possible pour des corps et des esprits grignotés ? Que reste-t-il d’humain dans le traitement des soignantes par le pouvoir public pour qu’on ait encore besoin de les faire taire ?
Voici le témoignage de deux infirmières en temps de Covid. Elles n’auraient pas parlé si l’histoire n’avait pas été adaptée en une fiction pourtant criante de vérité. Elles racontent la peur, le mépris et l’impuissance dans une profession laissée à la dérive. Elles racontent la disparition de leur droit à la parole.
Confidences après l’hôpital
Cela fait un an et demi qu’on ne s’est pas réunies toutes les quatre. On avait l’habitude de s’empiffrer dans des bouis-bouis du centre de Vignoles en se racontant nos vies après le boulot. On finissait toujours par trouver une soirée où l’une arrivait tard de l’hôpital et rattrapait le repas des autres, levées depuis 5 heures du matin. On laissait s’effilocher le temps dans les rires et les murmures confidents, malgré le réveil à 5 heures le lendemain ou la sieste écourtée pour vivre, tout de même, après le travail. Inutile de préciser que les week-ends n’existaient plus dans notre perception du temps.
Après le début de la Covid, plus rien. Ce chaleureux sas de détente qu’on s’est inventé a cessé d’être. Ce soir, on prend tacitement le prétexte de mon retour exceptionnel à Vignoles, on utilise nos badges d’infirmière pour traverser le couvre-feu et vivre ce petit miracle.
Quand j’arrive, Gina est en train de coucher son fils. Sa mine est rayonnante malgré les cernes qui pèsent sous ses yeux. Je me rappelle ma première journée avec elle au CH, le centre hospitalier de la ville. Elle se posait des tas de questions sur l’origine du monde comme une petite fleur émerveillée, perdue au milieu d’un champ de bataille. Le contraste m’avait conquise. On est devenues une sorte de bulle d’oxygène l’une pour l’autre en utilisant nos discussions sur la vie pour repeindre la dureté de notre quotidien. C’était un peu avant qu’elle n’abandonne définitivement la profession. Elle a déserté après sa grossesse. Je crois qu’elle aimait trop les gens. Le soin technique, les piqûres à la chaîne, les dizaines de patients à la demi-journée, ça ne l’intéressait plus. Elle entame maintenant sa deuxième année en naturopathie et m’envoie régulièrement des messages pour me raconter ses cours de botanique. J’ai démissionné dans sa foulée non sans faire un bon burn-out – une sensation de lourdeur qui vous rend incapable d’une quelconque empathie, la disparition de l’ego, l’incapacité à retourner au boulot, la révolte sourde qui fait place au vide vertigineux, l’arrêt maladie puis la démission pour survivre. J’ai repris des études et rien ne m’a paru plus serein qu’une salle de classe après l’hôpital. À mon dernier jour au CH, une cadre de santé qui ne m’avait jamais adressé la parole auparavant m’a déclaré : « Tu devrais faire un enfant plutôt que de reprendre des études ». J’ai senti mon utérus se rétracter. C’était violent et très maladroit. Je me suis surtout dit que je faisais le bon choix en quittant cette institution dans laquelle je me sentais disparaître. On m’a encore demandé, scandalisé : « Pourquoi tu veux démissionner de la fonction publique ? » J’ai pensé à ma liberté et je suis partie, légère.
Il est presque 22 heures Sara et Inès nous rejoignent enfin. Sara sort d’une courte sieste. Inès arrive droit de l’hôpital. Toutes deux sont restées fidèles au CH. Ce sont les plus anciennes à l’HDJ, l’hôpital de jour où l’on s’est connues. Les plus dures à cuire aussi. Le genre de femmes inébranlables qui avancent en se frayant des tranchées dans les affres de la vie.
En déployant les assiettes de fromages et de charcuterie sur la table basse du salon, je me sens au chaud après des mois d’hiver. On s’assoit toutes proches comme une famille au terrier et très vite, nous parlons de l’hôpital. Je veux savoir comment se passe la gestion de la Covid à l’HDJ.
Sara - La peur
Sara soupire.
C’est très dur. On travaille dans la peur. Elle engloutit un morceau de gruyère. Au premier confinement, la direction de l’hôpital nous a annoncé qu’elle fermerait notre service et qu’on serait détachées la moitié du temps dans un service de réanimation. On levait la main pour poser des questions et faire part de notre peur. La réanimation, c’est pas l’HDJ ! C’est comme si tu demandais à un plombier de devenir électricien ! Il aurait un gros risque d’électrocution non ? Là, c’était pareil. On nous a répondu, « vous n’avez pas le choix, vous devez obéir ».
- Quelle trouille ! je m’exclame.
Tu l’as dit ! renchérit-elle. Le soir même, les portes du service étaient fermées. Dans le bâtiment d’à côté, une unité spéciale Covid a ouvert et des équipes d’autres services nous on rejoint. On tournait toutes entre la réanimation et cette unité où l’on accueillait six fois plus de patients qu’à l’HDJ. C’était l’époque où tout le monde venait se faire dépister. Il a fallu qu’on s’adapte rapidement. Au départ, malgré la peur qu’on avait de ne pas y arriver, on était euphoriques parce qu’on avait envie d’aider, c’était un mouvement dans notre routine, mais très vite on a perdu nos repères. Nos horaires, nos roulements d’équipes, nos locaux, nos connaissances techniques, l’emplacement du matériel, tout était nouveau.
- Vous aviez peur d’attraper le Covid ? demande Gina
- D’abord, on avait peur pour nos familles, répond Inès. On s’exposait tous les jours. Certaines d’entre nous s’isolaient des leurs pour les protéger et ne vivaient plus que pour l’hôpital.
Sara sourit tristement avant de reprendre. En réanimation, étant donné nos conditions de travail, on avait peur de tuer plutôt que de mourir. On n’y connaissait rien, personne ne nous a formées et après quelques jours, c’était chacun pour soi tellement il y avait de travail. On faisait de l’abattage, je n’ai jamais vu ça ! On avait peur du chef qui nous hurlait d’aller plus vite, alors qu’on courait sans cesse pour installer un patient, donner un médicament, récupérer les ordonnances, remplir les papiers. La peur détruisait les relations avec les collègues. Peu à peu, certaines d’entre nous, conscientes de leur manque de connaissances, ont demandé à ne pas aller en réanimation et à rester sur l’unité Covid. Les cadres ont fait la sourde oreille. Il y a eu des arrêts maladie. La cadre supérieure a reproché aux absentes d’être responsables de l’épuisement de celles qui poursuivaient le travail. Elles se sont même entendues dire : « Si vous ne pouvez pas aller travailler en réanimation, c’est que vous êtes des incapables ». Tu te rends compte de la culpabilité que ça te colle une remarque comme celle-là ? Mais tu sais, la peur a souvent raison des autres sentiments. La culpabilité s’est enfouie au fond d’elles et elles ne sont pas revenues.
- Vous vous êtes plaintes auprès des chefs ? je demande, abasourdie.
On a écrit des lettres cosignées au chef de service pour soutenir nos collègues. On était toutes d’accord sur l’importance de reconnaître à une infirmière sa force de dire : « je ne suis pas capable ». C’est une manière de nous protéger, mais aussi de protéger le patient. Le chef nous est tombé dessus en salle de pause sans prévenir. Il était en pétard ! « Vous n’êtes pas là pour vous entre-aider mais pour travailler ! » a-t-il hurlé avant de claquer la porte. À ce moment-là, je me suis dit qu’ils étaient en train de nous briser toutes l’une après l’autre et que si nous n’étions pas terrassées par la peur, nous le serions par leur mépris.
Sara regarde Inès qui acquiesce et poursuit.
Inès – Le devoir et le mépris
Quand la direction de l’hôpital est venue nous annoncer la fermeture de l’HDJ et notre redéploiement sur d’autres services, j’étais choquée qu’ils ne nous aient pas consultées. On a été prévenues la veille pour le lendemain. J’aurais aimé donner mon avis en tant que première sur la ligne de front, pour reprendre leur champ lexical.
Au lieu de cela, le directeur de l’hôpital, le chef de service et les cadres de santé n’ont pas cessé de nous renvoyer à nos prétendus devoirs : celui de faire passer l’entre-aide avant le travail, le devoir d’obéir sans poser de questions, le devoir d’accepter le travail qu’on nous donne quel que soit le service où l’on est affectée, celui surtout de nous taire. J’aurais aimé pouvoir leur dire qu’on n’avait pas besoin de recevoir d’ordre, ni d’oublier l’entre-aide, ni d’être forcée au travail ou assignée au silence pour être présentes et faire notre devoir. Car il n’en est qu’un seul pour lequel je suis là tous les jours, celui de soigner inconditionnellement et nous sommes toutes animées de cette même passion.
J’ai compris à quel point on étaient méprisées quand ça a été mon tour de partir en réanimation. Les premiers jours, il n’y avait même pas assez de linge pour nous changer. J’ai dû garder la même blouse pendant une semaine. Je la laissais dans un vestiaire improvisé de trois mètres carrés prévu pour quatre personnes. Au départ, on faisait tout pour préserver notre pudeur. On a eu vite fait de la mettre de côté.
- Quelle maltraitance ma chérie ! s’exclame Gina.
Sara hoche énergiquement la tête. Inès élève subrepticement la voix. Oui. Et cette maltraitance nous assigne nous-même à la maltraitance ! Tu te rends compte ? Ça fait trente ans que je suis infirmière, vingt-cinq ans au CH et c’est la première fois que je me dis : « Inès, t’es maltraitante tous les jours ».
- Comment ça, tu es maltraitante ? je demande étonnée.
On a le temps de rien, on travaille à la chaîne, du coup on doit mettre de côté le confort du patient. Hier, le directeur du CH voulait savoir comment ça se passait pour les soignantes détachées de l’HDJ au service de réanimation. Je lui ai parlé de maltraitance. Tu sais ce qu’il m’a répondu ? « Je ne veux pas entendre ça »… et il est parti en me laissant là avec ma détresse. Il n’a même pas feint d’être sourd il m’a dit : « je ne veux pas entendre » ! Tu vois, quand on donne pleinement de nous, quand on a fait ce métier par sens du devoir, pour servir et qu’on n’est pas considérée, pas comprise, pas même entendues, on a juste envie de partir.
Gina et moi acquiesçons. Nous savons que nous ne retournerons à l’hôpital public pour rien au monde.
- Et l’unité Covid ? demande Gina.
Inès réfléchit puis raconte. Quand je suis revenue à l’unité Covid, il y avait cette patiente. Sans que je sache pourquoi, les médecins l’ont fait passer devant les autres patients pour un test de dépistage alors qu’elle n’avait pas rendez-vous. Plus tard dans l’après-midi, j’ai compris que c’était la fille du chef de service. Le soir même, j’ai eu des symptômes, frissons et fièvre. Je l’ai dit au chef, il n’en a rien eu à faire. Il ne m’a même pas proposé de me faire le test, rien. J’ai dû prendre un rendez-vous dans mon propre service. J’ai trouvé ça terriblement injuste.
Sara et Inès – L’épuisement ou la fin de la parole.
- Vous croyez que tout ça est lié uniquement à la crise ? je demande peu convaincue.
Sara secoue la tête. Je crois que le problème est plus profond. Cela fait quelques années qu’on est écrasées par les tâches et les responsabilités qui s’accumulent. On travaille de plus en plus comme sur une chaîne de montage. On ne doit plus seulement gérer les soins, mais aussi faire le ménage qui incombait aux agents sanitaires hospitaliers, faire les commandes de pharmacies à la place des cadres de santé, remplir de plus en plus de papiers pour justifier de notre activité, remplacer les laborantins pour certains actes comme les analyses de sang par exemple… Que reste-t-il de notre métier dans tout ça ? Notre travail maintenant, c’est de dire aux gens : « Désolée, je n’ai pas le temps de parler avec vous. ». La relation avec le patient disparaît peu à peu. On n’a même plus envie, on est tellement épuisées.
Inès ajoute : Personnellement, je me sens prise en otage. D’un côté, j’ai la sincère volonté d’aider et d’accompagner mes patients, c’est pour cela que je fais ce métier, de l’autre côté, avec un chef qui nous hurle constamment d’aller plus vite, un désintérêt total pour notre bien-être physique ou mental, pire, un chantage sur notre capacité à accomplir notre devoir, je n’arrive pas à faire mon métier correctement. C’est terrible ! Je rentre dans la chambre d’un patient et je suis déjà en train de penser à ce que j’ai oublié de faire, aux papiers à remplir, au matériel qu’il va manquer, à la commande en cours. Je n’ai même pas le temps de le regarder, je fais mon soin et je cours ailleurs.
Mais je crois que ça va avec la recherche de rentabilité des soins. Tout est codé. On fonctionne comme des robots au service de l’efficience maximale, au prix du lien social. La clinique, c’est-à-dire le temps qu’on passe au lit du patient perd de plus en plus de valeur. C’est la fin progressive de la parole.
Le rêve de Sara et Inès
- Si le métier tel qu’on l’a aimé disparaît à ce point, qu’y pouvons ? demande Gina.
- On devrait monter notre clinique ! je lance en riant. Gina aurait son jardin de plantes médicinales, moi je ferais des entretiens d’écoute qu’on proposerait à tous les patients quel que soit leur motif de consultation, Sara et Inès vous vous occuperiez de l’organisation des soins ! Un patient, une demi-heure au moins !
Sara sourit puis reprend plus sérieuse : Si déjà on commençait par remplacer le mépris par de la reconnaissance.
Inès acquiesce : Moi, je suis convaincue qu’il faut doubler nos payes. Ce n’est pas tant l’argent, on sait toutes que ce n’est pas la raison pour laquelle on fait ce métier, mais c’est une réalité quand on est mère de famille. C’est aussi du temps de soin. Si on doublait nos payes, chacune pourrait avoir le choix : gagner plus d’argent pour le même travail ou diviser son temps de travail par deux.
Sara poursuit : Cela aurait forcément un impact sur la qualité des soins. Il faudrait aussi doubler les effectifs : une soignante par patient dans les services complexes, deux dans les services de réanimation, jamais plus de cinq patients pour une soignante quel que soit le lieu d’exercice.
- Pour ça, il faudrait que l’on ne prenne plus la santé comme un commerce à rentabiliser. Je lève mon verre. Il faudrait que les politiques publiques reconnaissent que c’est un droit fondamental et qu’il est normal que cela coûte de l’argent !
C’est évident, répond Inès en trinquant. Mais avant qu’on y arrive, je crois qu’il y a des leviers à actionner au sein même des hôpitaux. Si ça ne doit pas venir d’en haut, alors il faut inventer des systèmes là où les gestionnaires ne nous ont pas encore imposés de règles. Je crois que la hiérarchie est une bonne piste de réflexion.
On pourrait imaginer des réunions d’équipe auxquelles tout le monde participerait, directeurs, secrétaires, agents d’accueil et de ménage compris.
- C’est vrai ! s’exclame Gina. Je ne connaissais même pas les noms des personnes de l’accueil, alors qu’elles parlent avec les patients toute la journée ! Leur rôle est essentiel dans le soin ! À l’inverse, je connaissais le nom du directeur qui ne voit pas de patient et qu’on ne voit jamais.
Chacun aurait un temps de parole équitable, poursuit Inès. Pour l’organisation interne du service, il n’y aurait pas un seul décisionnaire, mais des discussions puis des votes. Libre à chacun et chacune de participer selon sa motivation et ses besoins.
Pour ce qui est de notre moral, renchérit Sara, les supervisions c’est bien, mais il faudrait qu’elles soient plus systématiques. On vit des choses tellement fortes, on se blinde tellement ! On finit par se prendre pour des machines de combats, mais on est faites de chair et quand on craque, c’est terrible. Dans notre métier, c’est nécessaire d’évacuer. Nous, ça fait huit ans qu’on n’a plus ni réunion d’équipe ni supervision. L’autre jour, une psy du service m’a demandé comment je me sentais, j’ai couru au vestiaire. J’avais les larmes aux yeux. Je ne m’y attendais pas. Voilà. Il faudrait quelqu’un qui nous demande de temps en temps comment on va. Un vrai service médical et d’accompagnement pour les soignantes !
Nous sommes toutes d’accord et renversons nos verres.
Rendre leurs voix aux soignantes
Nous poursuivons l’échange et les confidences jusque tard dans la nuit. Je remarque que malgré la peur, le mépris et le silence systématique subis par Sara et Inès ou l’épuisement de leur quotidien, elles continuent d’aimer profondément leur métier, de croire en la possibilité de sa transformation. Gina et moi n’avons pas cette force de caractère, ni ce sens infaillible du devoir et nourrissons d’autant plus d’admiration pour nos deux amies. Pourtant, les mots qu’elles emploient ce soir, je ne les ai jamais entendus dans leurs bouches auparavant. Ils décrivent une violence institutionnelle sourde et l’impossibilité de la dire publiquement ou au sein de leur service.
Pour la sauvegarde du soin, il est urgent de laisser s’exprimer librement les infirmières, ses meilleures promotrices. Il serait temps de refuser qu’au nom d’un devoir caduc, on interdise la liberté de parler qui est le début de tout acte de soin. Il serait temps d’écouter celles qui, mieux que personne, connaissent les maux autant que les ressources de l’hôpital public.
Ce soir, il suffit de la présence aux autres, d’oreilles tendues, d’un peu de vin et de cette délicieuse tomme de brebis pour dissoudre miraculeusement l’interdit et l’impossible. Les mots s’étalent comme une marée déferlante. Ils sont un remède car la possibilité de dire c’est le modeste espoir d’être enfin reconnue.