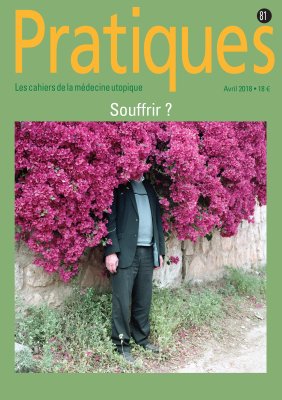Bernard Friot
Professeur émérite de l’université Paris Nanterre
Auteur aux éditions La Dispute de : L’Enjeu des Retraites (2010), L’enjeu du salaire (2012), Puissances du salariat (2012, nouvelle édition augmentée), Émanciper le travail - Entretiens avec Patrick Zech (2014) et Vaincre Macron (2017).
-
-
-
- Apprendre et comprendre l’histoire du régime général pour qu’il soit relancé et revienne aux mains des citoyennes et des citoyens.
-
-
Bernard Friot a travaillé comme économiste du travail à l’université de Lorraine, puis comme sociologue à l’université Paris Nanterre. Passé de l’économie à la sociologie du travail son objet de recherche est resté la Sécurité sociale. Militant au Parti communiste, syndiqué au SNESup-FSU, il s’attache depuis sa retraite à l’éducation populaire en écrivant des livres et en animant des débats et des formations avec les syndicats, les partis politiques et les associations de « la gauche de gauche » en France, en Belgique et en Suisse francophone.
- Pratiques : Vous parlez dans Vaincre Macron d’une production communiste de santé dans les années 1960, que voulez-vous dire par là ?
Bernard Friot : Ce sont les travailleurs eux-mêmes, et non pas les prétendus « partenaires sociaux », ni l’État, qui ont construit en 1946 le régime général de Sécurité sociale et l’ont géré jusque dans les années 1960, avec des directeurs de caisses élus par les administrateurs élus représentant les assurés. Alors que les soins de ville n’étaient jusque-là pas remboursés et que les hôpitaux étaient des mouroirs, le régime général a été alors capable de porter une considérable mutation de la production du soin qui a été jusque dans les années 1980 presque totalement non capitaliste, à l’exception hélas des médicaments, qui elle est restée capitaliste. C’est d’ailleurs un des points urgents à régler : se battre pour que les marchés publics aillent exclusivement à des coopératives, ou à des formes d’entreprises dont la propriété est celle des salariés et que Sanofi, Servier et autres soient éliminés des marchés publics.
La santé c’est 240 milliards, les soins, si on enlève le médicament, c’est 200 milliards, soit 10 % du PIB qui ont été produits avec des personnels payés à la qualification personnelle, parce que fonctionnaires hospitaliers ou conventionnés depuis 1961 pour les soins ambulatoires. Il faut avoir conscience de l’enjeu que représente le salaire à la qualification personnelle. Dans une entreprise privée, ce n’est pas le salarié lui-même qui est payé, mais son poste, car dans la convention collective, c’est le poste qui est le support de la qualification et donc du salaire. Alors que dans la fonction publique, c’est la personne elle-même qui est titulaire de son salaire parce que la qualification (le grade) est attachée à la personne et non au poste. Les personnels de santé sont ainsi libérés du chômage et du chantage à l’emploi, fondateurs du statut du travailleur dans le capitalisme. À cette libération s’en ajoute une autre : les soignants sont libérés du chantage à la dette qui est l’autre institution par laquelle le capital tient les travailleurs. En effet, à partir de la fin des années 1950, les CHU ont été créés, les hôpitaux psychiatriques sont passés de l’aide sociale à l’Assurance maladie, les hospices ont été transformés en hôpitaux locaux, et cet énorme investissement a été conduit sans appel massif au marché des capitaux, mais grâce à une hausse du taux de cotisation maladie qui est passé de 8 % du salaire brut en 1945 à 16 % de celui-ci à la fin des années soixante-dix. Cette progression a permis à l’Assurance maladie de financer l’investissement par subvention et a fait ainsi échapper l’outil de travail à la propriété lucrative. Salaire à la qualification personnelle, propriété patrimoniale non lucrative de l’outil de travail rendant possible sa propriété d’usage par les soignants : nous avons là les caractéristiques concrètes d’une production communiste de la santé, si par « communisme » on entend, comme le disent Marx et Engels dans L’idéologie allemande, le « mouvement réel » par lequel les travailleurs deviennent maîtres de leur travail. On mesure toute la portée d’une telle production communiste quand on la compare à la situation actuelle où, du fait du gel du taux de cotisation depuis près de quarante ans, la pénurie de soignants, l’embauche de contractuels et l’énorme endettement des hôpitaux font que les professionnels ont perdu le pouvoir sur leur travail.
- Pratiques : C’était au sortir de la guerre, les communistes avaient du poids et le patronat était discrédité.
Je conteste cette fiction des circonstances exceptionnelles. Certes le PCF était majoritaire en matière électorale en octobre 1945, puis à nouveau en 1946, mais il n’a eu que quelques strapontins ministériels, et cela pendant à peine plus d’un an. Le patronat déconsidéré pour collaboration, je n’en crois pas un mot. Dès 1942 les dirigeants économiques, très dépendants du capital allemand, ont – tout comme ce dernier – pris langue avec leurs homologues anglo-saxons. Les intérêts du patronat étaient omniprésents dans les gouvernements de la Libération. Quant à la Confédération générale du travail (CGT), elle est extrêmement divisée en 1945 et va se retrouver en 1947 avec la scission de Force Ouvrière (FO) et le départ de la Fédération de l’éducation nationale (FEN). Nous nous consolons de notre impuissance actuelle en disant que les circonstances étaient exceptionnelles en 1945, eh bien non, il y a eu un mouvement ouvrier décidé, c’est tout. Actuellement, il est en difficulté, c’est ça le problème.
Il y a en revanche des choses tout à fait nouvelles. De très nombreux jeunes aujourd’hui ne veulent plus jouer le jeu du capital. Ils sont dans une forme de dissidence du point de vue économique. Ils « bricolent » des tas d’alternatives passionnantes. Dans le domaine de la production de soins, je pense à une maison de santé dans laquelle travaillent une vingtaine de soignants libéraux qui ont pendant cinq ans construit leur projet. Une partie d’entre eux étaient des hospitaliers ou travaillaient dans des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et ils ont quitté tout cela, parce qu’ils en ont eu marre des injonctions gestionnaires. Ils se partagent la rémunération à l’acte qu’ils reçoivent de l’Assurance maladie selon des règles qu’ils ont établies entre eux. Ces libéraux-là ne sont pas propriétaires patrimoniaux de leur outil, c’est la communauté de communes qui est propriétaire, mais ils en sont propriétaires d’usage. Ils se réunissent tous les samedis pour vérifier que leurs pratiques correspondent bien à ce qu’ils ont mis comme projet sur la table. Ils ne produisent pas que des soins, ils ont aussi une activité énorme de prévention et d’éducation à la santé et ne sont pas confinés dans la consultation. Des jeunes professionnels décidés à maîtriser leur travail, il y en a des centaines de milliers qui sont à l’origine de dizaines de milliers d’entreprises alternatives. Il est vrai que, dans le cas que je viens d’évoquer, ils peuvent s’appuyer sur l’institution macroéconomique non capitaliste qu’est l’Assurance maladie. Beaucoup d’autres restent dans la marginalité, ou alors sont récupérés par le capital dès que leur entreprise fait la preuve de sa viabilité. C’est là que l’expérience de la CGT et du PCF est utile, sur la façon de conquérir des institutions macrosociales et de ne pas être simplement dans l’alternative ici et maintenant. Si ces nouveaux militants de l’alternative contribuent à revitaliser des institutions de la gauche de gauche actuellement essoufflées, je suis plutôt optimiste.
- Pratiques : Comment passer de la plainte à l’offensive ?
La santé est un lieu décisif : c’est une branche professionnelle dans laquelle les personnels ont un statut particulièrement construit, certes mis en cause par des embauches de contractuels et par la dictature bureaucratique des Agences Régionales de Santé (ARS), mais c’est sans commune mesure avec la dictature des groupes capitalistes sur les salariés du privé. Il y a dans la fonction publique hospitalière et dans l’exercice libéral de la santé des possibilités d’auto-organisation, de refus collectif, en s’appuyant collectivement sur les droits. Il y a une responsabilité des soignants, des enseignants et d’autres professionnels qui bénéficient d’une moindre pression du capital, de sortir de la plainte, de montrer que – quand on est moins sous la pression du capital – on travaille mieux, on est plus heureux. Le rôle du syndicalisme de santé serait que les travailleurs s’auto-organisent pour produire selon leurs règles déontologiques. Il est possible de sortir la production de soins des griffes du capital. On l’a fait de manière massive autrefois : rappelez-vous le conflit qu’il a fallu pour changer le statut des hospitaliers dans les CHU dans les années soixante, et le conventionnement de 1961 n’a pas été acquis sans luttes. Aujourd’hui, tout ça fait partie du paysage, mais ce qui manque c’est une bagarre pour la hausse massive du taux de cotisation maladie. On ne double pas un taux de cotisation, comme ça a été le cas entre 1945 et la fin des années 1970, sans se battre en permanence pour l’obtenir, et c’est cette bataille qu’il faut reprendre car c’est ce doublement du taux qui a permis la création d’une médecine ambulatoire et hospitalière, avec une forme de bonheur des professionnels.
- Pratiques : On a l’impression que désormais, les soignants travaillent pour rembourser la dette publique.
Mais ce sont tous les travailleurs qui travaillent pour rembourser la dette d’investissement contractée par leur entreprise, et cette situation doit cesser ! Les soignants sont aux premières loges pour voir la différence entre un investissement financé par subvention et un investissement financé par emprunt ou par un partenariat public–privé. EIFFAGE fait des profits en or sur une location à plusieurs dizaines de millions par an pendant trente ans pour l’hôpital de Paris Sud, équipement que la cotisation, dont le taux est gelé depuis près de quarante ans, n’a pas pu subventionner. Et les personnels de l’hôpital trinquent. Soigner pour soigner est tout à fait différent de soigner pour rembourser une dette. Dans le premier cas, on fait de la clinique, dans le deuxième, on fait du protocole. Les gestionnaires imposent cet outil sous la pression de l’endettement d’hôpitaux dont l’Assurance maladie ne peut plus subventionner les investissements comme elle l’a fait dans les années soixante. La subvention, financée par la cotisation, avance de l’argent et fait le pari que cette avance va rendre possible une valeur économique supplémentaire parce que l’outil nouveau va permettre un travail plus productif. Cette valeur nouvelle va pouvoir être utilisée pour subventionner l’investissement à la période suivante. C’est le cycle cotisation-subvention que nous avons expérimenté de façon tout à fait efficace. Il faut contester en permanence son remplacement par un cycle capitaliste crédit-remboursement qui est complètement mortifère et source de profit inouï pour le capital. Du fait que la cotisation n’augmente plus, un déficit s’installe structurellement depuis une quinzaine d’années en matière de Sécurité sociale, alors que jusque-là, elle a toujours été légèrement excédentaire. La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), mise en place par Juppé en 1997, a amorti depuis vingt ans 80 milliards de « dettes » de la protection sociale, moyennant plus de 40 milliards d’intérêts, c’est une incroyable gabegie ! Ces 40 milliards qui les paye ? C’est l’Assurance maladie, l’Assurance vieillesse… Les régimes de Sécurité sociale, par absence de hausse du taux de cotisation, sont devenus une vache à lait pour les prêteurs. Il est important de redire que le bonheur au travail des soignants était infiniment supérieur il y a quarante ans. Parce qu’ils travaillaient pour soigner et non pas pour rembourser une dette et parce que la hausse du taux de cotisation permettait d’assurer un recrutement suffisant de fonctionnaires : aujourd’hui, nombre de recrutés sont des contractuels, tandis que numerus clausus et quotas aboutissent à des territoires sans soignants.
Ce que je dis de la production de soins vaut pour toute la production. Si nous voulons tout produire avec des personnels payés à la qualification personnelle et propriétaires d’usage de leur outil de travail, parce qu’il est financé par subvention, et donc par une cotisation et non pas par du profit, il faut faire une proposition de hausse massive de cotisation qui soit compensée par un non-remboursement, par les entreprises, des dettes qu’elles ont contractées pour leur investissement auprès de parasites. Parasites car, il faut le répéter sans cesse, les prêteurs ne prêtent que ce qu’ils ont pris ou vont prendre sur notre travail.
- Pratiques : Le mouvement social refuse-t-il cette hausse de la cotisation par crainte que cela entraîne une diminution des revenus ?
Votre question appelle deux remarques. S’agissant de la crainte individuelle de voir son salaire net baisser du fait de la hausse du taux de cotisation, je rappelle que dans les tracts de la CGT des années cinquante, la demande était toujours « hausse du salaire brut et hausse du taux de cotisation », de sorte que cette dernière n’ait pas d’incidence sur le salaire net.
Mais le problème de fond relève plutôt de la capacité qu’a eue la classe dirigeante de poser la cotisation comme le financement d’une dépense et non pas d’une production, d’où la représentation très répandue de la cotisation comme une charge. Si la cotisation maladie n’est pas la reconnaissance de la production d’une valeur économique par l’appareil de santé, si elle finance une « dépense de santé », revendiquer le doublement de son taux devient difficile. Il importe donc de mener une bataille idéologique sur le fait que les soignants ne dépensent pas mais produisent de la valeur économique.
C’est quoi produire de la valeur économique ? Pour le capital, ne produit de la valeur économique que celui qui met en valeur du capital : celui qui produit du Médiator® produit de la valeur, parce qu’il met en valeur le capital de Servier, même si son activité a une valeur d’usage extrêmement dangereuse. D’ailleurs, dès qu’une production de soins se fait dans une boîte capitaliste, mettons une clinique à laquelle le groupe Icade, propriétaire des murs, fait payer un loyer énorme, cette activité est considérée comme productive parce qu’elle met en valeur du capital ; un soignant dans un hôpital public dépenserait alors qu’un soignant dans une clinique du groupe Icade produit ? C’est évidemment absurde. La bataille politique pour imposer une autre définition du travail, pour le sortir de son carcan capitaliste, est une bataille centrale.
Pour cela, nous pouvons bien sûr nous appuyer sur l’utilité sociale de l’activité des soignants, dire que ce que fait l’appareil hospitalier ou la médecine ambulatoire est infiniment plus intéressant que ce que font des quantités d’entreprises capitalistes qui sont considérées comme des lieux de production, alors qu’elles produisent de la merde. Pour soutenir une telle argumentation, il y a une réalité nouvelle : les travailleurs n’adhèrent plus comme il y a cinquante ans à la pratique capitaliste de la production, et cela pour des raisons écologiques, anthropologiques et territoriales. Ils sont conscients que d’un point de vue écologique, le capitalisme nous mène dans le mur ; du point de vue anthropologique, il y a une exaspération devant notre impuissance à maîtriser notre travail ; et au niveau territorial, tout le monde voit bien maintenant que la division capitaliste du travail dépouille nos pays de productions et de savoir-faire fondamentaux et qu’autour des métropoles c’est le désert – et pas qu’au niveau des soins.
Mais cela n’est pas suffisant : le caractère productif d’une activité ne s’impose pas par la preuve de son utilité sociale, mais par la mise en place d’institutions de la valeur antagonistes des institutions capitalistes. Ces institutions communistes vont poser comme travail des activités niées comme travail par les institutions capitalistes de la valeur, le marché du travail, le crédit à l’investissement et la propriété patrimoniale lucrative de l’outil de travail. Il s’agit de créer une dynamique qui remplace le marché du travail par le salaire à la qualification personnelle, le crédit par la subvention de l’investissement, la propriété lucrative par une propriété patrimoniale non lucrative, rendant possible la propriété d’usage de l’outil par celles et ceux qui l’utilisent. Bref, la bataille du travail ne se joue pas que sur le terrain de l’utilité sociale, il faut aussi mener la lutte de classes, c’est-à-dire populariser d’autres institutions de la valeur : le changement de la définition du travail s’opère de manière politique. Pour prendre une métaphore, les femmes peuvent encore dire pendant des siècles, « ce que nous faisons dans la 2e journée, c’est utile », cela ne changera rien tant qu’une lutte féministe contre la domination masculine n’imposera pas le caractère productif de la 2e journée.
Si nous savons montrer qu’une hausse massive du taux de cotisation est une alternative rendant possibles la subvention de l’investissement, le salaire à vie des personnels et leur propriété d’usage de leur outil, nous ouvrirons une porte à nos compatriotes convaincus que le capitalisme n’est pas l’avenir, mais qui sont fatalistes parce qu’ils ne voient pas d’alternative, faute que nous organisions la mobilisation sur le terrain des institutions de la valeur.
- Pratiques : Comment redonner de la dignité et du sens au travail ?
Il est décisif de se battre sur le terrain des institutions de la valeur, et donc d’accomplir un formidable travail politique pour convaincre les travailleurs qu’ils sont capables de diriger les entreprises, de décider de la production et donc de l’investissement, de constituer à leur initiative les collectifs de travail nécessaires. Cela passe par l’auto-organisation des travailleurs, un champ immense d’activité pour les organisations syndicales et politiques.
- Pratiques : Dans les centres de santé, les professionnels sont obligés de « courir » après les subventions.
On en revient à la bataille du taux de cotisation. C’est la hausse du taux de cotisation maladie qui permet d’attribuer aux soignants un salaire pérenne à la qualification personnelle, des équipements subventionnés de manière pérenne et, si les prestations sont gratuites, une subvention de fonctionnement pérenne. Grâce à quoi les professionnels doivent être dans une situation autogestionnaire permanente, et sûrement pas comme il en va dans les centres de santé mutualistes où les dentistes se font imposer un quota de prothèses ou autres actes particulièrement lucratifs pour leur employeur. Mais là encore, nous sommes renvoyés à notre responsabilité collective. Pourquoi ces professionnels acceptent-ils que leur autonomie clinique soit niée ? Ils sont vraiment à ce point peu amoureux de la liberté ?
- Pratiques : Maintenant il y a, pour les médecins, la carotte de la rémunération à la performance, la ROSP, avec l’inquiétude sur la mise en place d’indicateurs gestionnaires tels que le nombre de jour d’arrêts de travail.
Une fois que la rémunération à la performance a commencé, elle ne s’arrête jamais : si on est payé pour ce que l’on fait, on n’en fait évidemment jamais assez, ni assez « comme il faut ». Le mouvement ouvrier a construit tout son combat autour du droit au salaire déconnecté de la mesure du travail concret, alors que la ROSP connecte la rémunération à la mesure de ce que fait le professionnel, sans que ce dernier maîtrise les indicateurs puisqu’ils sont déterminés par les gestionnaires. Le paiement à la performance nie la souveraineté de l’individu sur son travail. Le problème est que la perversion de la convention, qui introduit ces modulations en fonction de tel ou tel indicateur performé, est tout à fait cohérente avec l’attachement des libéraux de santé au paiement à l’acte. Si on veut en finir avec la ROSP, et plus généralement avec tout ce qui lie la rémunération, au jour le jour, avec une évaluation de l’activité sur laquelle le professionnel a peu de prise (vous faites allusion, par exemple, à un indicateur qui pénaliserait le soignant pratiquant des arrêts de travail), il faut que les soignants libéraux acceptent d’être payés pour leur qualification personnelle. La bagarre pour la liberté professionnelle dans l’exercice libéral suppose le paiement des libéraux par un salaire à la qualification personnelle et donc l’abandon du paiement à l’acte. Pour faire admettre ce point décisif à des professionnels réticents, il faut tordre le cou à l’idée reçue qui assimile le salaire au contrat de travail avec un employeur. Que les libéraux n’aient aucune envie de passer un contrat de travail avec l’ARS ou avec une mutuelle, je ne peux qu’approuver ! Je prends ma situation d’universitaire : j’ai eu un salaire à la qualification, mais je n’ai jamais passé de contrat de travail avec un employeur. Un retraité perçoit un salaire sans qu’il soit lié à un employeur, tout comme un intermittent du spectacle entre deux cachets : une des clés de la construction du statut communiste du travailleur est la déconnexion du salaire et de l’emploi, en d’autres termes l’attachement de la qualification à la personne et non pas à un poste de travail dépendant d’un employeur.
Comment déterminer la qualification d’un soignant d’exercice libéral ? Partons de ce qui est déjà pratiqué à grande échelle et que j’ai connu dans ma carrière d’enseignant-chercheur. Ma progression en qualification a été décidée par des jurys de pairs élus qui ne me connaissaient pas et n’avaient pas travaillé avec moi (pour éviter les copinages) et qui appréciaient selon des critères élaborés collectivement mon activité des années précédentes – on change de qualification tous les dix/quinze ans – en matière d’enseignement, de recherche et de responsabilités administratives (ce dernier point, par parenthèses, parce que nous ne souhaitons pas connaître à l’université le destin funeste des professionnels à l’hôpital qui ont été dépossédés par des gestionnaires). Une fois l’épreuve de qualification passée avec succès, la progression est acquise définitivement. C’est là un point décisif de l’attachement de la qualification à la personne. Notre travail concret doit être en permanence objet d’évaluation (je renvoie à cette équipe de la maison de santé qui évalue chaque samedi son travail à l’aune du projet qu’ils ont construit ensemble ; moi-même, j’ai été en permanence évalué par les étudiants et par mes collègues), mais cette nécessaire évaluation en continu ne doit avoir aucune incidence sur notre qualification et donc notre salaire, sinon nous allons tricher pour ne pas nous exposer à une mauvaise évaluation.
- Pratiques : Que pensez-vous du fait que la gestion de la Sécu soit de plus en plus sous la dépendance de l’État ?
L’étatisation est une catastrophe, à laquelle nous devons opposer la gestion par les intéressés eux-mêmes telle qu’elle a été pratiquée dans le régime général dans ses vingt premières années. Le communisme, tel qu’il a commencé à se construire en France, est incompatible avec l’étatisation. C’est la classe dirigeante qui a étatisé le régime général pour empêcher sa gestion par les travailleurs. C’est de Gaule, puis Juppé, qui ont été à la manœuvre. De Gaule a supprimé en 1967 les élections aux conseils d’administration et a confié de fait la gestion des caisses au patronat en instituant le paritarisme. Les écoles de Rennes et de Saint-Étienne ont été créées pour former des directions d’hôpitaux et de caisses dans une logique professionnelle exonérée de tout compte à rendre sur un mode démocratique. Puis Juppé a mis en place les Agences régionales de l’hospitalisation transformées depuis en ARS et la passation de conventions d’objectif et de gestion (COG) entre l’État et l’Assurance maladie. ARS et COG sont aux mains d’un exécutif en capacité de réguler comme il l’entend le débat parlementaire annuel sur la loi de financement de la Sécurité sociale, instituée également par Juppé. Tout cela constitue un grand recul démocratique.
- Pratiques : Que pensez-vous du financement par l’impôt qui est progressif ?
En soi, il n’y a pas de bonne cotisation contre du mauvais impôt ou de mauvaise cotisation contre du bon impôt ; et ce n’est pas parce qu’un impôt est redistributif qu’il est bon. Tout dépend à quoi cela sert. Si l’impôt sert à subventionner l’investissement de services publics en dehors de toute logique capitaliste, ou à payer des salaires à la qualification personnelle de fonctionnaires, je trouve l’impôt excellent. À l’inverse, si l’impôt type CSG sert à financer un panier de soins et à confier à la complémentaire le soin de financer au-delà du panier, je trouve cet impôt très mauvais : le régime général rembourse de moins en moins et ce sont les complémentaires qui complètent, en fonction non pas du besoin mais du niveau de cotisation. Du côté de la cotisation, si elle sert à payer les fonctionnaires hospitaliers ou à payer des libéraux dans une convention de secteur 1 à revitaliser, elle est pour moi excellente. Si, à l’inverse, c’est une cotisation à un régime complémentaire de retraite ou de maladie, c’est une très mauvaise cotisation. Quant à penser que l’impôt étatise alors que la cotisation garantit la gestion par les intéressés, c’est tout à fait discutable. Depuis vingt ans, la cotisation maladie finance un dispositif largement étatisé, alors qu’on peut très bien imaginer que l’impôt finance des structures médicales autogérées. De toute façon, par la cotisation ou l’impôt, la valeur socialisée dans le régime général de Sécurité sociale doit doubler pour rattraper le temps perdu en gel des taux depuis quarante ans.
Entretien réalisé par Sylvie Cognard et Marie Kayser