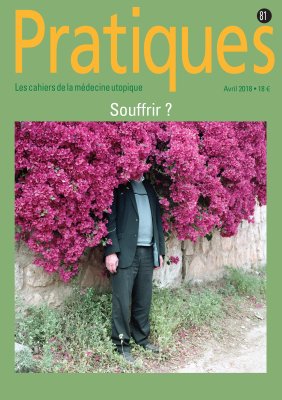Benjamin Becker
Cadre infirmier
- Vous travaillez depuis quelques mois dans un nouvel établissement, pourquoi avez-vous quitté le CHU de Grenoble ?
J’ai travaillé comme infirmier aux urgences du CHU de Grenoble pendant presque 3 ans, jusqu’en novembre 2017, puis au bloc opératoire et au déchoquage chirurgical d’octobre à février dernier.
Depuis février, je travaille au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, bâtiment de la mutualité française ; il regroupe trois cliniques privées à but non lucratif : un institut de médecine, de chirurgie et d’oncologie. J’ai en charge l’encadrement de l’unité de soins de chirurgie. Un service de 52 lits et de 37 professionnels en management direct. On fait surtout de l’orthopédie et de l’urologie, avec un peu de vasculaire et de viscéral de temps en temps.
- Vous parlez de souffrance au travail à propos de votre vécu au CHU de Grenoble.
Je suis particulièrement intéressé par la question de la souffrance au travail pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en parallèle de mon emploi, j’écris une thèse en philosophie morale à l’École Normale Supérieure de Lyon et je travaille beaucoup sur l’empathie et la compassion, ou la sympathie. Je me suis aperçu qu’il y avait plusieurs formes de souffrances au travail : celle qui est liée à la complexité de nos métiers, au fait d’être en lien toute la journée avec des patients atteints de diverses pathologies ; et celle qui est directement induite par l’Institution et par les injonctions que nous recevons : injonctions essentiellement économiques, mais aussi en lien avec le droit du patient. C’est important que ces dernières existent, mais on en demande de plus en plus aux soignants et ceux-ci se retrouvent souvent tiraillés entre des obligations contradictoires (celles de respecter le libre choix du patient et en même temps celles de s’évertuer à tendre vers ce que nous pensons être bon pour ce dernier ; parfois, les deux sont diamétralement opposées) et dans des situations complètement éloignées des valeurs et des images qu’ils pensaient attachées au métier. Les soignants avec une certaine expérience comme moi (j’ai été ASH puis AS avant de devenir infirmier puis Cadre de santé CDS), voient ces valeurs s’effriter. Les autres arrivent dans un milieu qui n’est pas du tout ressemblant à l’image qu’ils s’en faisaient et ils s’enlisent dans des processus un peu aliénants, dont il est très difficile de s’extraire. On en arrive ainsi aux situations qu’on connaît de burn-out au sein de l’hôpital, mais qu’on retrouve un peu partout dans la société.
Le mouvement des professionnels des Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) soulève les mêmes problématiques ; il y a les mêmes tensions : le manque de plus en plus important de matériel et de personnel, des patients de plus en plus exigeants, exigence normale que l’on ne s’y méprenne pas, des familles de plus en plus prenantes qui veulent participer au processus de soin, et c’est tant mieux également. C’est ce que l’on nomme la littératie, et je suis fervent défenseur de cela.
Mais on nous demande de faire de plus en plus avec de moins en moins de temps. Et comme le disait Edgar Morin, « À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on oublie l’urgence de l’essentiel ».
De plus l’institution n’est pas toujours présente et les cadres de terrain s’éloignent de plus en plus des vraies missions auprès du patient.
Je ne veux pas généraliser mais, pour avoir fait pas mal d’intérim, je pense que les soignants sont souvent confrontés à un mur, et qu’ils ont une direction, une hiérarchie qui ne sont pas toujours dans la pleine compréhension, voire considération. Mais je n’envie pas du tout nos supérieurs de pôle et nos directeurs des soins dans les hôpitaux publics, car ils ont des comptes à rendre au niveau national et des chiffres à tenir. Des collègues cadres qui sont à deux doigts du burn-out et du « laisser tomber », je suis convaincu qu’il y en a également énormément.
- Est-ce cela qui vous a amené à quitter l’hôpital public où vous étiez et à rechercher un autre travail ?
Il y a plusieurs raisons, mais celle qui m’a définitivement poussé en dehors du CHU, c’est qu’à plusieurs reprises j’ai voulu interpeller ma hiérarchie sur une situation qui devenait compliquée, voire désastreuse au sein des services dans lesquels je travaillais, ce qui pouvait mettre en difficulté certains patients, en tout cas aux urgences. Je travaillais comme infirmier dans le service des urgences depuis deux ans quand j’ai alerté ma direction des soins en novembre 2016, avec un courrier qui a été très mal perçu. J’ai été convoqué et on m’a gentiment demandé de rester dans les clous et de faire l’école des cadres si je voulais avoir mon mot à dire. Puis, en septembre 2017, on m’a « gentiment » demandé de quitter le service des urgences. Je suis alors allé au bloc opératoire des urgences qui m’intéressait bien.
Il a fallu le suicide d’un neurochirurgien qu’on appréciait tous énormément, pour que la direction se réveille et dise que peut-être, effectivement, il y avait un problème. Ce qui m’a décidé à partir c’est que face à l’ensemble des professionnels, la direction a nié l’existence d’un mal-être ou d’un burn-out un peu généralisé alors que la lettre que j’avais adressée deux ans avant en était la preuve, flagrante qui plus est.
Je n’incrimine pas uniquement la direction du CHU, je pense que c’est un peu le même mal être général qui est partagé au sein du système de santé. On est dans un processus chronique de dégradation constante des conditions de notre offre de soins, dont les raisons sont multiples et dont nous aussi, les soignants, sommes pour partie responsables. Peut-être parce qu’à un moment donné on a laissé faire ou qu’à vouloir toujours « faire le mieux » pour le patient, on a plutôt fait pire encore, en montrant qu’on pouvait continuer certaines déviances, et on a laissé faire cette dégradation. Mais peut-être le patient y a-t-il aussi une part lorsqu’il s’inscrit aujourd’hui dans un processus un peu individualiste qui lui fait considérer son état clinique et son état de santé comme étant pire que celui des autres.
On en arrive à des situations aberrantes avec des patients qui viennent aux urgences le lundi matin pour quelque chose qui leur paraît insurmontable alors que cela pourrait être traité chez le médecin traitant. Cela complexifie énormément nos missions de soins quotidiennes et l’organisation de nos journées de travail, la classification des patients et notre réflexion clinique.
- Le chirurgien dont vous avez parlé, qui s’est suicidé, est un soignant que vous connaissiez bien et avec qui vous travailliez ?
Oui, quand cela s’est passé, en novembre 2017, je travaillais depuis deux mois comme infirmier au bloc opératoire des urgences, qui était par ailleurs le seul bloc ouvert la nuit et les week-ends. De ce fait, toutes les spécialités y intervenaient dans le cadre de l’urgence, et donc cela nous est arrivé de travailler avec ce neurochirurgien, qui était un très bon professionnel.
- Comment voyez-vous la situation maintenant que vous êtes dans une nouvelle institution et avec une autre fonction, celle de cadre ?
Votre question soulève un point très intéressant pour moi, celui de la construction de l’identité professionnelle. Dans ma nouvelle institution, j’ai un N+ 1 qui est le cadre supérieur de l’Institut de chirurgie, et un N+2, le directeur des soins. La direction est déjà, et globalement, plus facilement accessible que dans les grands groupes hospitaliers publics tels que le CHU de Grenoble.
Cette nouvelle situation professionnelle m’a fait relativiser certaines choses : les cadres de terrain ont une injonction supplémentaire : « satisfaire » les demandes de la direction et « satisfaire » celles des agents de terrain.
Cela demande des qualités professionnelles d’adaptation et de diplomatie qui doivent se forger au fil du temps et qui nécessitent de remettre en question une part de soi-même. Mais je pense que la situation ici n’est pas comparable à celle qu’on pouvait vivre au CHU. C’est déjà un plus petit établissement, beaucoup plus familial ; il relève de la mutualité, donc il y a quand même un certain nombre de valeurs auxquelles j’étais très attaché quand j’ai commencé ma carrière, il y a plus de treize ans, et qu’à mon grand regret je ne retrouve plus aujourd’hui dans la fonction publique. Je ne parle pas des valeurs de soins et de service public bien sûr, parce que ce sont des obligations presque juridictionnelles, mais des valeurs de solidarité, d’entraide, d’égalité et de justice. Je suis très attaché à ces quatre principes-là, que je retrouve ici, et cela se joue à tous les niveaux : entre cadres, au niveau de l’écoute que les cadres peuvent avoir et qu’ils peuvent recevoir de leur hiérarchie, sur le terrain aussi, avec des professionnels qui sont beaucoup plus dans l’action collaborative et dans la participation à la construction de l’identité du service dans lequel ils évoluent.
Des anciens collègues des urgences du CHU m’ont dit que c’était peut-être lié aussi à la taille du service, et c’est vrai qu’aux urgences, c’était une très grosse équipe avec un gros turn-over de patients. Mais j’ai été aide-soignant avant dans d’autres services à l’AP-HP à Paris, au CHU de Toulouse…, et globalement, je ressens qu’au fil des années, il y a un certain nombre de choses qui se sont effritées, les professionnels se sont épuisés, certains d’entre eux sont tombés de fatigue ou à bout de souffle, à bout de nerfs, ils ont la sensation de ne pas être écoutés, de ne pas recevoir le soutien de leur hiérarchie quand ils ont des difficultés, de ne même pas être pris en considération. Mais le pire, c’est que le manque de visibilité sociale est plus que palpable. Et comme à chaque fois en France, il faut une médiatisation outrancière des problèmes socio-professionnels pour que les choses avancent. Pourtant, le nouveau Ministère de la santé prône la prévention.
Vous savez, quelques fois, il faut juste savoir écouter les professionnels. C’est ce que j’essaie de faire avec l’équipe que je manage aujourd’hui : mettre de la visibilité, par l’écoute, sur un disfonctionnement ou sur un mal-être particulier permet déjà de tarir beaucoup de choses, d’apaiser des petites souffrances internes et de faire que les choses aillent mieux pour l’agent, ou pour le moins, qu’elles n’empirent pas. Des agents en bonne santé physique et mentale c’est un service qui roule, et donc un cadre en bonne santé c’est une institution qui fonctionne.
- Vous avez évoqué la question de la taille de l’établissement et des équipes, Pensez-vous qu’il y ait d’autres facteurs dans votre nouvel établissement plus favorables à une prise en charge des soins qu’au CHU de Grenoble ?
Au niveau de la population soignée, on a, pour partie, la même qu’à l’hôpital public, mais il y a aussi les chirurgiens libéraux qui ont leur propre activité et utilisent les locaux pour opérer leurs propres patients. Il est clair que les exigences de ceux-ci ne sont pas les mêmes.
Au niveau des moyens matériels, je pense qu’il y a proportionnellement une plus grosse enveloppe qu’au CHU, et même si on est soumis à des obligations d’économies, quand quelque chose manque, cela ne manque pas longtemps. Au CHU de Grenoble, aux urgences, on pouvait manquer de brancards ou de dispositifs médicaux beaucoup plus lourds et indispensables à la bonne marche des processus de soins des patients, pendant des mois et des mois, et on nous rabâchait qu’il n’y avait pas d’argent pour changer telle ou telle chose.
Au niveau du personnel, on a la chance ici d’avoir un pool qui fonctionne très bien, avec des vacataires horaires qui dépannent très facilement et qu’on a les moyens de payer. Au CHU cela arrivait parfois, en tout cas aux urgences, non pas qu’on nous dise qu’on ne pouvait pas les payer, mais qu’il n’y avait pas d’intérimaires ou que personne ne pouvait venir ; on se retrouvait dans un service avec 17 patients en charge au lieu de 11, ce qui est vite compliqué. Toutefois, aucun texte règlementaire ni recommandation de l’HAS existent sur cette question des ratios. Et à bien y penser, vues les difficultés de personnel que connaît l’institution publique aujourd’hui, ce serait probablement scier la branche sur laquelle nos dirigeants et représentants nationaux sont assis ; et sur laquelle, in fine, nous y sommes tous, soignants comme usagers. C’est vrai qu’il y a aussi des arrêts-maladie chez les intérimaires, et les agences ont de plus en plus de difficultés à pouvoir fournir à temps du personnel car il y a de plus en plus de besoins partout.
- Pensez-vous qu’il y ait moins de personnel absent là où vous travaillez maintenant qu’au CHU de Grenoble ?
Je pense que oui, mais bien sûr il faudrait faire un calcul de proportionnalité.
Dans mon service, en tout cas, j’ai actuellement très peu d’arrêts et je pense que sur l’ensemble de la clinique, il y a une moins grosse problématique d’arrêts qu’au niveau du CHU.
Il faut aussi reconnaître qu’on n’accueille pas non plus la même population et qu’on a des prises en soins qui sont moins lourdes ici qu’au CHU : par exemple, on a un service de soins continus, mais on n’a pas de service de réanimation. Si les patients s’aggravent et qu’ils nécessitent d’être intubés, on les rapatrie vers le CHU. Mais si on voit le côté financier, je connais deux cliniques à but lucratif de la région grenobloise qui tiennent à leur réa parce que c’est ce qui leur rapporte du fric, au même titre que des blocs opératoires qui fonctionnent très bien.
Ce qui est vrai c’est que, dans le public, les typologies chirurgicales comportent souvent des facteurs aggravants et sont donc plus compliquées à encadrer au niveau de la prise en soins ; pourtant, selon les préconisations de l’ARS, le ratio infirmières-patients est le même pour tous les établissements qui ont une activité de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), que vous soyez privé ou public.
- Il vous semble donc que ce n’est pas exactement le même public entre l’hôpital public et l’établissement où vous êtes ?
On a ici aussi une population un peu précaire d’un point de vue médical et d’un point de vue social, mais en nombre bien moindre qu’au CHU.
Certains patients chroniques ne viendront jamais ici parce qu’ils savent que pour tout ce qui est imputable à leur maladie il vaut mieux aller au CHU directement. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai été très attaché à la fonction publique pendant des années et que j’ai travaillé dans des grands CHU – j’ai eu cette chance-là –, par ce que c’est aussi ce qui stimule. C’est très intéressant, notamment en début de carrière, d’être dans des services de pointe très aigus, avec une technicité toujours de plus en plus modernisée et des gros pôles de recherche qui permettent quand même des prises en soins extraordinaires.
Mais je pense qu’on a atteint aujourd’hui un seuil où ça ne suffit plus. Les étudiants sortent des écoles infirmières avec des étoiles dans la tête en se disant "oui, il va se passer ça dans la fonction publique ou aux urgences" et en fait, au bout d’un ou deux ans, c’est terminé. Ils s’aperçoivent que, finalement, l’arrêt cardiaque du patient de 40 ans aux urgences, qui met tout le monde en adrénaline, c’est 1 patient sur, je ne sais pas, au hasard, environ 1 500 passages – et heureusement du reste –, et qu’ils sont surtout confrontés à de la misère sociale, à de lourds problèmes sociaux à régler, à des « gros » patients polypathologiques, et finalement à cette population extrêmement précaire dont « personne ne veut ». C’est une expression très péjorative, mais c’est une réalité : Il y a une grande part de cette population qui ne va qu’à l’hôpital parce que c’est la seule porte qu’elle trouve encore ouverte. Je pense que cela joue aussi sur « le moral des troupes ». Mais nos politiques publiques ne sont pas toujours adaptées pour répondre à ces particularités. Par exemple, il y a au niveau de la gérontologie un manque criant de coordination avec toutes les plateformes périphériques à l’hôpital qui existent ; et on se retrouve avec des patients âgés aux urgences, dont on ne sait que faire parce qu’il n’y a aucun réseau mis en place pour assurer une continuité des soins qui soit adaptée et juste, dans ce sens d’adaptée à la pathologie, mais également au mode de vie et à la volonté des patients âgés et vieillissants, socialement isolés.
- Vous dites que les gens polypathologiques ou âgés se retrouvent plus facilement à l’hôpital. Est-ce aussi parce que les médecins traitants les y adressent plus facilement ou que la régulation par le 15 va être plus ou moins sélective ?
Les médecins régulateurs du SAMU sont les urgentistes du CHU. Quand il y a un appel SAMU ou un appel via les pompiers, la très grande majorité du temps les patients vont au CHU. Sauf si vraiment on est certain que cela peut être traité dans des établissements annexes et périphériques, ou dans d’autres cliniques.
S’il y a une petite suspicion de polypathologie ou des signes d’aggravation possible, les gens sont orientés directement au CHU.
- Pour revenir à la souffrance au travail, n’est-elle pas liée au fait que le professionnel ne peut plus faire le travail comme il pense qu’il devrait le faire ?
Il y a beaucoup de cela. Aujourd’hui on est dans une protection à outrance. Il y a eu la loi Kouchner en 2000, après le plan Juppé de 1995 qui mettait déjà en avant une volonté affichée de protéger l’usager de santé, puis celle de Jean Léonetti en 2005…, et l’usager du système de santé qu’est le patient s’est aperçu qu’il disposait d’un certain nombre de droits, dont celui de porter plainte et d’être défendu s’il estimait que les choses n’avaient pas été bien faites pour lui.
On en est arrivé à des situations extrêmes où, pour se protéger, la part de l’administratif dans nos métiers est devenue considérable, parce que ce qui n’est pas écrit n’est pas considéré comme fait pour le législateur, et il faut être certain qu’on sera capable de prouver ce qui pourtant découle de la logique dans nos prises en soin du quotidien.
On s’écarte alors de nos vrais rôles et de nos missions auprès du patient, parce qu’on a moins de temps : faire des transmissions ciblées, c’est extrêmement chronophage. Je ne dis pas qu’il ne faut pas en faire, mais parfois elles sont poussées à l’excès à mon avis. Et c’est du temps qu’on ne passe plus auprès du patient.
Mais il n’y a pas que cela. Il y a aussi de moins en moins de secrétaires dans les établissements publics, comme privés d’ailleurs. Le travail de secrétaire – commander les ambulances, faire les bons de transport, éditer les bons de biologie, gérer les parties administratives des dossiers « patient » etc., ce sont les infirmières qui le font, ce qui augmente leur part administrative.
Chaque nouvelle loi, chaque nouvelle réorganisation de pôle ou inter-hospitalière – parce que maintenant on parle beaucoup des groupements hospitaliers de territoire – demande en interne un boulot extraordinaire.
Quand vous passez un patient d’un établissement à un autre, vous avez tout un dossier médical, paramédical et social et de transmissions à fournir, qu’on n’avait pas forcément à faire avant. Aussi parce que les choses étaient faites plus directement et parce qu’on avait aussi des moyens annexes et humains à qui tout cela incombait.
Tout cela, et il faut également l’entendre, c’est du temps en moins qu’on a auprès des patients.
- Si on revient à votre travail de cadre, vous disiez que vous essayiez d’être bienveillant avec l’ensemble de votre équipe. Qu’entendez-vous par là ?
La bienveillance c’est un terme… un peu complexe, mais en même temps très terre à terre. C’est évidemment l’écoute, mais ce sont aussi les actions de tous les jours.
La grosse complexité, c’est aussi d’être le plus juste possible parce qu’il ne s’agit pas d’être bienveillant avec l’un et malveillant – ou en tout cas non bienveillant – avec les autres. Concrètement, c’est remplacer une aide – soignante qui a besoin à la dernière minute de son samedi. Et c’est là que je parlais de solidarité, parce que dans mon équipe cela fonctionne très bien : elles arrivent beaucoup à se dépanner les unes les autres. Mais la bienveillance, c’est aussi pour qu’elles puissent in fine être elles-mêmes bienveillantes avec les patients.
Peut-être que c’est grâce à mon ancienneté et aux recherches que je fais dans le cadre de ma thèse que je suis très sensibilisé à toutes ces notions. Ce que je ne peux plus faire avec le patient, c’est-à-dire promouvoir cette bienveillance, parce que je m’en suis éloigné par choix, par besoin et par conviction, il faut que je le fasse par l’intermédiaire des agents que j’ai en management. Je pense que la meilleure façon que je puisse avoir de rencontrer des professionnelles qui sont probes et qui s’investissent dans de telles missions, c’est peut-être en m’investissant moi-même d’une mission par rapport à elles et en leur montrant que je peux être aussi là pour elles.
Certes, j’ai des injonctions qui viennent d’en haut, mais ce n’est pas forcément aux professionnelles de les porter, en tout cas pas directement. Par exemple : on me demande de faire tourner mes lits, surtout en chirurgie (plus il y a de patients à passer au bloc, plus cela rapporte d’argent) ; mais il faut arriver à ne pas faire porter ce poids sur les épaules des agents en leur infligeant un stress supplémentaire.
Voilà toute la grosse complexité de cette construction identitaire qui est un chemin de vie. On construit son identité en permanence tout au long de sa vie. On ne peut pas du jour au lendemain renier ce que l’on a été et se dire, c’est bon, à présent je suis un bon manager, ou je suis une bonne infirmière, ou je suis un bon directeur ! Il faut constamment chercher à se renouveler et à se remettre en question.
- Concrètement comment faites-vous, par exemple, quand des infirmières vous disent qu’elles pensent qu’un patient devrait rester un jour de plus que prévu ?
Tout d’abord j’ai la faiblesse de considérer, en pleine conscience, que je ne suis pas spécialiste de la chirurgie ; je travaille avec des infirmières qui sont dans le service depuis plusieurs années et sont beaucoup plus à même que moi de dire si le patient peut être sortant ou pas. Je n’ai aucun complexe à dire à un chirurgien qu’un patient doit rester un jour de plus, même quand cela pousse derrière et qu’on a 10 lits à trouver dans les 4 heures. C’est le bien-être du patient qui doit primer, je l’ai dit dès mon entretien d’embauche et j’ai prévenu que si on commençait à mettre cela à mal ou à me poser des injonctions économiques, je quitterais le poste comme je l’ai fait il y a quelques mois. Je pense que ce qui doit encore nous tenir vivants dans ce métier, c’est qu’on a fait le choix de vouloir prendre soin des autres, et pousser les gens dehors pour pouvoir faire du fric, pour le dire crûment, ce n’est franchement pas en adéquation avec les choix que j’ai arrêtés.
- Que vous a-t-on répondu quand vous avez dit cela ?
Pas grand-chose, on a gentiment souri, un sourire un peu sous-entendu.
Je suis aussi membre du comité d’éthique de l’établissement, et je pense que cela a quand même du poids. Par ailleurs, la direction et les médecins font globalement confiance aux cadres de terrain et quand un cadre décide quelque chose pour son service, il est quand même écouté s’il a de bons arguments ; voire, il est même soutenu. Et l’argument du patient dont il faut prendre soin tient encore ici, mais ce n’est pas forcément le cas dans d’autres endroits, cela, j’en suis convaincu, et la Tarification à l’activité (T2A) a quand même beaucoup modifié les pratiques.
- Vous avez l’impression d’avoir une équipe plus homogène sur les valeurs ou en tout cas votre équipe a des moments où elle peut en parler, cela se discute ?
J’ai mis en place des moments de parole. La cadre que j’ai remplacée avait lancé cette idée que j’ai reprise, car je l’ai trouvée très intéressante : ce sont des moments informels où tout pourra être dit en équipe, aides-soignants et infirmiers confondus, avec la présence du cadre en garde-fou. Tout ce qui s’y dit restera entre nous et à partir de cela, il faudra grandir. Et s’il y a des abcès percés ou des difficultés qui remontent, il faudra qu’on essaie de les traiter ensemble ou en tout cas de leur donner du sens. Il y a quand même ici une parole très libre, adjointe à un puissant syndicat très protecteur des professionnels et du bien-être général des équipes. Egalement une direction qui est très efficace et qui répond très facilement aux demandes des professionnels. Globalement, il y a ici une solidarité qu’on peut ressentir et un bien-être que je n’avais pas trouvé depuis longtemps. J’avais fait quelques remplacements ici en tant qu’infirmier et c’est pour cela que j’ai postulé ensuite. Cette ambiance, on ne la retrouve plus dans la fonction publique ; je pense que c’est ainsi ici parce que l’encadrement est très englobant avec son personnel de terrain et très à l’écoute, et que l’ensemble des cadres a globalement la même vision de ce que doit être le management participatif. Enfin, on est conscients que ce qu’on fera de nos équipes soignantes, c’est ce que les équipes feront du patient.
- Comment se passent ces réunions « temps de paroles » avec le personnel ? Quelle différence avec les staffs ?
Les réunions « temps de parole » sont des réunions auxquelles les professionnels prennent part, sur la base du volontariat, entre eux, dans l’office infirmier pour discuter des problèmes d’organisation entre les deux équipes jour et nuit.
Dans les dernières années de ma carrière aide-soignante et infirmier, je n’ai travaillé que dans des équipes tournantes : on faisait autant de nuits que de jours ; j’avais donc perdu l’habitude d’être confronté au dissensus entre équipe de jour et de nuit, qui est souvent très prégnant dans les établissements médicaux et sociaux. J’ai voulu instaurer ces réunions parce que même si c’est le rôle du cadre d’essayer de temporiser, je pense qu’il faut que les équipes se rencontrent pour savoir comment l’autre fonctionne et ainsi se comprendre.
Les staffs sont des réunions intra-services avec tous les professionnels de l’équipe. Pour moi les équipes de nuit font partie intégrante de l’équipe, et les filles de nuit ont le droit à la même importance que celles de jour. Je me suis donc fait un point d’honneur à faire des staffs aussi avec l’équipe de nuit. Durant les staffs sont abordées les thématiques institutionnelles, les protocoles, les formations en vigueur, les recommandations HAS… Mais ces staffs doivent aussi permettre de construire le projet de vie d’équipe. Je commence toujours mes staffs, par l’expression des desiderata et de ce que l’équipe veut dire, cela permet de libérer la parole. Au début de ces staffs, c’était toujours « oui l’équipe de nuit n’a pas fait ci » ou « oui l’équipe de jour ça »… jusqu’à ce que je mette ces réunions communes « temps de paroles » en place, et maintenant cela va beaucoup mieux ; c’est aussi grâce à deux infirmières du service qui font autant de jours que de nuits et qui ont donc pu avoir des arguments très positifs pour faire avancer notre cohésion d’équipe.
Il y a toujours beaucoup de monde aux réunions « temps de paroles ». Les heures sont payées ou récupérées, ce qui n’est que justice sociale, mais je suis convaincu que, même si ce n’était pas le cas, elles viendraient quand même parce qu’elles se sont aperçues que finalement, cela faisait beaucoup de bien à tout le monde en permettant de mettre à plat certaines tensions qui, parfois, naissent sur des quiproquos. Mais qui, avec le stress et la fatigue, montent en pression, épuisent tout le monde et au final sont ressenties très négativement par les patients.
- Vous dites que c’est assez récemment que ces réunions « temps de paroles » ont été mises en place.
Il y a trois mois et demi que je suis là et cela fait un mois que cela fonctionne, je vais essayer de mettre cela en place deux fois par mois, si besoin on le fera plus souvent.
- La direction vous suit-elle au niveau financier ?
Je n’en ai pas parlé avec la direction des soins mais avec mon N+1 ; en fait c’est comme quand elles reviennent pour des entretiens professionnels, cela fait partie du processus d’unification et de vie du service. Pour le moment on ne m’a jamais mis de bâtons dans les roues.
À ces réunions de libération de la parole s’ajoutent donc les staffs bi-mensuels d’une heure où sont présentes les personnes qui sont en poste, une dizaine en journée ; et il y en a 3 ou 4 qui s’ajoutent en général, alors qu’elles ne sont pas prévues au planning. Et elles reviennent sur ces staffs parce qu’elles sont intéressées par des sujets particuliers. J’ai fait un staff de nuit la semaine dernière et il y en a deux qui sont venues alors qu’elles ne travaillaient pas, et je trouve normal qu’on leur compte leurs heures.
J’aimerais personnellement faire plus de management de terrain, parce que je me suis aperçu à un moment donné que je ne voyais quasiment plus les filles avec toute la part administrative et les réunions qui m’incombent. Je mange avec elle tous les vendredis midi, parce que c’est le seul moment où on est un peu détendus et où on peut se voir de manière informelle. Et finalement, c’est lors de ces repas qu’on me fait remonter le plus de difficultés et que j’en apprends le plus sur l’équipe et son fonctionnement interne. Parce qu’évidemment, elles ont aussi leur fonctionnement et leurs interactions à l’abri du regard des cadres.
- Et en même temps, elles ont aussi besoin du cadre ?
Oui dans une certaine mesure, et elles sont aussi tout à fait contentes de le trouver dans certaines circonstances. Le cadre d’un service de soins, ce serait comme un chef d’orchestre, un Directeur de chantier ou un Capitaine de navire. Aucun des trois ne peut mener à bien ses missions s’il n’existe pas de lien intime, de soutien de son équipe, et en même temps de collaboration et d’une certaine forme de subordination. Les agents doivent malgré tout se plier à une certaine forme d’autorité imposée par le cadre pour que l’équipe puisse avancer de concert (tout bienveillant qu’il puisse être). Si le capitaine est seul à bord, qu’il n’espère jamais quitter la rade d’ancrage. Mais je pense qu’il faut aussi savoir s’effacer pour qu’elles puissent mûrir ensemble, se construire et grandir les unes des autres, et ainsi façonner une organisation de service qui leur ressemble. C’est une gymnastique perpétuelle.
Quand j’ai pris cette fonction, j’avoue que je me suis posé la question de savoir si j’avais les épaules assez solides, si j’avais l’envie de faire certaines choses, car il y a des tâches qui ne sont pas du tout excitantes et qu’il faut faire quand même. Et puis après, on découvre l’équipe et il y a toutes ces belles choses qui se passent et qui font qu’on se dit qu’on a quand même choisi le bon métier. Dans le service où je travaille, les patients sont très satisfaits, à part 2 ou 3 bien sûr de temps en temps, qui montrent leur mécontentement ou qui écrivent un courrier. Je pense que j’ai réussi à mettre le doigt sur des choses qui étaient importantes pour les soignantes et dont elles avaient besoin. On verra comment cela va évoluer. Je n’ai pas le sentiment, peut-être parce que je ne les connais pas assez bien encore, d’avoir dans l’équipe des professionnels en très grande souffrance ; en tout cas, si je sens qu’il y a une petite faiblesse quelque part, je suis capable de tout lâcher pour voir ce professionnel-là et pour mettre les choses à plat tout de suite. Surtout parce que je n’ai pas envie qu’il leur arrive ce qui m’est arrivé il y a quelques années, où j’étais à 2 doigts de complètement tomber d’épuisement parce que je ne retrouvais pas ce que j’avais besoin de retrouver à ce moment-là. Je privilégie la communication, la loyauté et la transparence avec mon équipe. Manager sans ces outils et valeurs, c’est mourir d’épuisement tel un caméléon sur du tissu écossais. Et lorsque je parle de loyauté, ça n’est assurément pas de dire « Amen » à tout ! Mais plutôt de se battre avec les armes avec lesquelles on a dit que l’on se battrait.
- Pensez-vous que votre parcours d’aide-soignant, d’infirmer puis de cadre de santé change votre regard par rapport à d’autres cadres ?
J’ai longtemps cru que l’expérience de terrain pouvait faire le bon manager ou le bon directeur des soins, mais je me suis aperçu qu’il y avait beaucoup d’infirmières qui étaient d’anciennes aides-soignantes et qui n’étaient pas forcément les plus bienveillantes avec leurs collègues. Je pense que l’expérience peut apporter une énorme plus-value et trouver son importance dans la construction de son identité professionnelle, mais Il faut aussi rester humble et se souvenir toujours d’où l’on vient. Je crois sincèrement qu’il y a beaucoup de gens qui perdent cette humilité, car le parcours est plein d’embuches et c’est une vraie bataille à mener du fait des concours, des formations, des mémoires à rendre… et du coup, je pense qu’il y en a parfois qui ont tendance à oublier ce qu’ils ont été.
- Que pensez-vous du changement de la formation survenu en 2009 ? Et des nouvelles modalités de formation des cadres ?
J’ai vécu les changements liés à la nouvelle formation infirmière. En 2009, après des années de bataille, les infirmières réclamaient légitimement la reconnaissance Bac + 3 de leur diplôme. Il a été décidé de leur accorder le grade licence et toute une partie de leur formation a été transférée à l’université. Depuis, ce sont des médecins et des pharmaciens qui font une grande part de l’enseignement et les infirmières ne travaillent plus par grands modules – le fonctionnement d’un ensemble d’organes – mais par grands processus : les processus infectieux, oncologique, obstructif… On se retrouve donc avec des infirmières qui ont beaucoup de mal à faire des liens entre les pathologies, la clinique et les soins qu’il faut accorder au patient.
Avant 2009, il y avait une « clinique infirmière » et on travaillait beaucoup à partir des « besoins perturbés », c’était une approche plus globalisante du patient : celui-ci entrait pour une pathologie, mais on était capable de le voir dans une globalité et de mettre en place des actions soignantes qui n’étaient pas accrochées à la pathologie elle-même. Aujourd’hui, ce n’est plus vraiment faisable, hormis peut-être par les infirmiers qui ont été aides-soignants et qui ont encore cette culture-là, car la formation aide-soignant n’a pas changé et se fait toujours à partir des « besoins perturbés ». Je pense que l’universitarisation des études a permis d’ouvrir la profession à la recherche. Cela a un côté très séduisant et positif, en ce sens que cela permet aux infirmières de s’engager dans des masters de recherche de clinique infirmière, de spécialisation ou de politiques publiques, comme moi (la formation continue permise par l’Université Grenoble Alpes – l’UGA – m’a permis de faire un master 2 de recherche à Sciences Po dans les politiques publiques de santé), mais pour les infirmières qui veulent faire du soin leur métier, cela complexifie vraiment le regard soignant et la clinique infirmière.
Au niveau des cadres, il y a beaucoup d’établissements, et je crois même que c’est obligatoire dans la fonction publique, dans lesquels il faut qu’ils valident un master, soit de sciences sociales, soit de management. Pour ma part, je l’ai fait à Sciences Po. Les masters de management sont ceux qui forment les grands cadres du privé, mais vous ne pouvez pas manager la santé comme on manage une entreprise du Cac 40.
Quand je disais que certains cadres ou infirmières oublient d’où ils viennent, je pense que c’est un peu inhérent à cela : on leur demande aujourd’hui à l’école – c’est pour cela, entre autres d’ailleurs, que je n’ai jamais voulu faire l’école des cadres – de faire du chiffre et de s’éloigner du terrain. En somme, de renier complètement une identité infirmière et soignante. Quand ils arrivent à l’institut de formation des cadres de santé, la première chose qu’on leur dit c’est : « Vous n’êtes plus soignants : le patient, c’est fini ! les soins, c’est fini ! il faut encadrer, contrôler, faire de la qualité… ». Sauf qu’on reste dans des métiers qui sont baignés de l’humain et on ne peut pas en faire abstraction.
- Est-ce qu’il y a d’autres choses qui vous semblent importantes à nous dire, à transmettre ?
Ce dont j’ai pris conscience ces dernières années, c’est qu’il n’y a pas de « petites » phrases, de « petites » craintes ; il faut accorder toute leur importance aux signes qui pourraient faire penser qu’il y a une difficulté quelque part. Je pense que c’est ce dont nos cadres dans la fonction publique ne sont plus capables, peut-être parce qu’ils ont été formatés comme ça ou parce que c’est ce qu’on leur demande à un plus haut niveau. Je sais que j’en ai souffert dans ma vie d’infirmier et je n’ai pas envie de le faire subir aux membres de mon équipe. Il est grand temps de prendre soin de ceux qui prennent soin. Le « prendre soin » passe par l’écoute et par la considération et celle-ci n’a pas qu’un visage, elle a tous ces multiples visages, ces multiples facettes du quotidien et ces millions de façons qu’on peut avoir d’ouvrir les bras et les oreilles. Ces façons de montrer qu’on a de la considération. Je trouve que c’est déjà énorme. Il y a un philosophe, Gabriel Marcel, que j’aime beaucoup et qui disait : « considérer l’autre, c’est lui accorder la possibilité de prononcer deux tout petits mots : ma vie ». Je trouve que c’est exactement cela, qu’on soit patient ou soignant c’est le même combat ; quand on manage une équipe, celle-ci est à l’image de ce que le manager veut en faire et de ce qu’il a dans le coeur et dans la tête.
L’avenir, c’est à notre nouvelle génération de manager de le forger et de s’évertuer à faire bouger les choses. Mohammad Ben Ali disait de l’impossible qu’il n’était qu’un « gros mot prononcé par de petits hommes qui trouvent plus facile de vivre avec le monde qu’ils ont reçu plutôt que d’explorer le pouvoir qu’ils ont de le changer ».
Propos recueillis par Françoise Acker et Marie Kayser