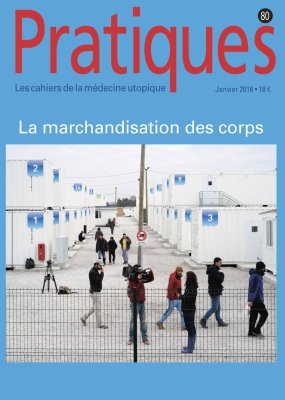Céline Lafontaine
Professeure agrégée de sociologie
à l’université de Montréal, auteure notamment de L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine (Seuil 2004) et de La société post-mortelle (Seuil 2008).
-
-
-
- L’ouvrage de Céline Lafontaine, le Corps-marché, la marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie, révèle comment les éléments du corps humain sont source de plus-value dans une nouvelle économie qui serait sans limite, exploitant et privatisant le vivant, toujours renouvelable.
-
-
Céline Lafontaine : Je suis sociologue des sciences et des techniques. Dans ce livre, j’ai essayé d’analyser comment les éléments du corps humain : les cellules-souches, les gamètes, le sang et ses composés en viennent à être complètement détachés des personnes et de leurs corps. Le gisement, la source de matière, c’est le corps. La bioéconomie fonctionne en effaçant ce lien au corps, en effaçant l’individualité des corps.
- Pratiques : Qu’entendez-vous par « l’ère de la bioéconomie » ?
Le concept de bioéconomie a été forgé au début des années soixante-dix par l’économiste Georgescu Roegen. Pour lui, il s’agissait d’un modèle économique qui devait tenir compte des limites propres au monde vivant, rejetait l’industrialisme productiviste et ouvrait ainsi la voie aux théories de la décroissance.
À la même période, un rapport commandé par le Club de Rome lançait un signal d’alarme sur les conséquences environnementales de la production industrielle à grande échelle et sur la diminution progressive des réserves en pétrole de la planète. Les conclusions de ce rapport et la crise pétrolière ont nourri l’intérêt des autorités gouvernementales, particulièrement aux États-Unis, pour les promesses portées par les avancées dans le domaine de la biologie moléculaire et du génie génétique. Dans son rapport La bioéconomie à l’horizon 2030. Quel programme d’action ?, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a officiellement inauguré, en 2009, un plan d’action visant à favoriser la mise en place d’un modèle de développement au sein duquel l’exploitation et la manipulation technoscientifique du vivant constituaient la source de la productivité économique.
Il y a eu un investissement massif, à la fois dans les biotechnologies et dans les technologies de l’information, basé sur l’idée que le vivant, puisqu’il est une ressource renouvelable, pourra être la source d’une nouvelle économie qui sera sans limite.
Il y a donc eu un détournement complet de la notion de bioéconomie telle qu’elle avait été théorisée par les partisans de la décroissance.
Ce que l’on nomme actuellement bioéconomie a débuté avec le développement massif de l’agriculture et de l’élevage industriel dans les années 50-60.
Par la suite, on a transposé les modèles de l’élevage industriel aux technologies de la reproduction avec la mise en place de la fécondation In vitro (FIV). Ces technologies ont créé une transformation du rapport au corps, à la reproduction, avec la possibilité de maîtriser celle-ci. Ceci a été vécu comme une forme de libération. Cela coïncidait avec l’idéologie de l’époque, et la société a porté cette évolution sans voir les enjeux critiques de l’exploitation de l’être humain qui se trouvaient derrière.
Les cellules-souches des embryons produits de façon industrielle ont ensuite servi de base au développement de la recherche au service de la médecine régénératrice.
Aujourd’hui, les recherches biomédicales se sont diversifiées à d’autres domaines que la reproduction, mais l’industrie mondiale de la procréation in vitro est actuellement une industrie importante. Le développement de ce modèle industriel est directement lié au consumérisme. Le désir d’enfant était à l’origine calqué sur le modèle patriarcal, par la suite, il s’est élargi à toutes les tranches de population, les gays, les lesbiennes et les femmes ménopausées. Le corps est devenu un capital sur lequel on peut investir et que l’on peut exploiter.
- Pratiques : Vous parlez du refus actuel d’admettre la finitude des corps.
Mon livre précédent, La société post-mortelle, était consacré à la quête d’immortalité par la science et aux transformations du rapport à la mort, c’est ce qui m’a amenée à travailler sur la marchandisation du corps. Ce qui m’intéressait, c’était d’analyser les représentations, les enjeux pour une société, pour qui la mort n’est qu’un obstacle pouvant être contourné, et d’étudier les organisations politique et économique que cette idéologie suppose. L’idée de la performance d’un corps qu’on peut « pousser » est en contradiction avec les réalités sociales. Tous les corps n’ont pas la même valeur et, dans cette économie des cellules, certains corps en servent d’autres. Le concept de biocitoyenneté renvoie au fait que de plus en plus l’individualité s’exprime par une volonté de contrôler des mécanismes biologiques. La médecine personnalisée va dans ce sens, avec l’idée qu’en ayant la cartographie de son génome, on pourrait dès la naissance prévoir ou prédire les facteurs de risque pour intervenir dessus. Cela élimine toute idée des dimensions sociales de la santé et donne une vision très néolibérale d’un individu qui a le devoir d’investir dans sa santé et qui en est responsable. Ce n’est plus la société qui est responsable de la santé des individus.
- Pratiques : Qu’en est-il de la notion de don ?
Dans le modèle français, comme au Canada, on est dans des logiques de don de personne à personne et les organes sont prélevés sous consentement. C’est moins vrai à l’échelle internationale puisque le tourisme médical nourrit tout un commerce d’organes.
À l’origine, les transplantations étaient faites dans une logique de survie. Désormais, certaines, telles celles d’utérus, ne sont pas liées à des questions vitales.
On a conservé le modèle du don très idéalisé et encadré par des règles éthiques très claires dont l’origine est le don de sang pendant la guerre. C’est le modèle du sang versé pour la patrie, don anonymisé qui nous ramène à la communauté.
Lors d’un don pour la recherche, c’est comme si le chercheur avait le même crédit que la vie d’un citoyen. On a pris les mêmes termes et puis on a changé le système, mais on a gardé le même imaginaire du « corps national ».
Chacun des éléments du corps pose des questions différentes.
Dans le cas des cellules, on n’est plus dans le don d’un individu à un autre. Les tissus donnés, qui sont des déchets, vont faire l’objet de recherches et, par le biais des transformations, aboutir à des produits qui seront brevetés. Ces brevets pourront être rachetés et s’il y a des retombées en matière de traitement, celles-ci ne seront vraisemblablement pas disponibles, en raison de leur coût, dans le cadre d’un système de santé publique. Ceux qui ont donné anonymement et de bonne foi des parties de leur corps ne vont le plus souvent pas être ceux qui vont pouvoir bénéficier des résultats des recherches.
Dans le cas des ovules, il ne s’agit pas de déchets. La stimulation ovarienne, le prélèvement d’ovules ne sont pas des actes anodins. Il n’y a pas de don – ou très rarement dans des contextes familiaux – parce que les femmes n’ont pas envie de subir cela et que les enjeux sur la santé sont trop grands. Au Canada, on parle de rémunérer les femmes pour compensation. Dès lors, on conserve le modèle du don comme idéologie, alors qu’en réalité c’est une logique économique qui est à l’œuvre. Comme il y a pénurie d’ovules, entre autres pour la recherche, il faut aller les chercher, ce qui entraîne la mise en place d’un commerce international.
Le consentement éclairé que les médecins font signer au donneur concerne a priori une partie précise du corps, mais quand on consent à donner des ovules, des cellules, pour la recherche, on ne peut pas savoir quelles recherches vont être faites ni aujourd’hui, ni demain puisque les données sont conservées et pourront être utilisées dans des années. Le consentement éclairé n’a donc plus de sens dans ce cas.
On est dans une collectivisation du don, mais dans la privatisation des résultats de la recherche et du vivant. C’est ici qu’il y a une mystification que personne, même les soignants, ne réalise. Partout dans le monde se créent d’immenses biobanques qui vont permettre le développement d’un nouveau type de médecine fondée sur la croyance en l’innovation, mais aussi fournir des données incroyables sur les populations. La question n’est pas de rejeter les biobanques, mais de repenser le modèle économique et de réfléchir à quels types de recherches entreprendre pour quels types de sociétés. Sinon, c’est comme si on mettait en place la disparition de la santé publique. C’est un angle mort des recherches actuelles.
- Pratiques : Le corps des femmes est particulièrement exploité.
À l’échelle internationale, le commerce d’ovules est très organisé. Certaines femmes indiennes peuvent accéder à la FIV parce qu’en contrepartie, elles donnent leurs ovules. Ce commerce se développe beaucoup au Mexique. En Europe, ce sont l’Espagne et Chypre qui en sont la plaque tournante.
Ce commerce sert à la recherche, mais il est aussi très bien connu des citoyens français, anglais… On sait qu’en général les gens vont acheter des ovules en Espagne parce qu’ils proviennent de femmes d’Europe de l’Est qui ont des caractéristiques génétiques recherchées : blondes aux yeux bleus, grandes… Et dans le cadre de la grossesse pour autrui (GPA), ils vont aller faire porter les grossesses par des femmes indiennes. Ce sont des enjeux raciaux et d’exploitation graves. Il y a là plusieurs femmes en jeu, ce qui complexifie encore plus ce commerce des corps. Les impacts sur les mères porteuses sont au premier plan, mais pour les pourvoyeuses d’ovules, les conséquences sur leur santé semblent occultées. Ce sont souvent de très jeunes femmes, les stimulations ovariennes à répétition, les prélèvements d’ovules affectent leur propre santé reproductive, d’autant que lorsqu’elles repartent chez elles, elles n’ont pas toujours le suivi nécessaire. Des documentaires, tels que Eggsploitation aux États-Unis, montrent les effets de l’hyperstimulation ovarienne sur ces jeunes filles, dont certaines ont développé des cancers en lien avec l’utilisation massive d’hormones. Ce sont les femmes invisibles de tous ces discours, les gens ont très peu de connaissances sur les procédures médicales utilisées pour amener une femme à produire dix à quinze ovules dans un mois. C’est dans une logique de marché : transformer le corps des femmes pour qu’il soit plus productif.
On trouve nombre de gens pour justifier ces pratiques ! À propos de la GPA, je trouve hallucinant que personne n’évoque la violence inouïe faite à ces mères indiennes qui portent des enfants blonds aux yeux bleus, pour maximiser les potentialités biologiques et dépasser les limites. Ce qui est vu, au contraire, c’est le côté libertaire de plus en plus valorisé dans nos sociétés.
La meilleure façon de poser les questions sur la GPA, c’est de poser celle de l’utérus artificiel. S’il y avait un utérus artificiel, on ne ferait pas appel aux mères porteuses. Quand on parle d’utérus artificiel, les gens réagissent un peu plus violemment, mais c’est de cela qu’il s’agit dans le cas des mères porteuses, c’est de transformer un corps en machine !
- Pratiques : N’y a-t-il pas en même temps une réification des enfants qui sont ainsi produits ?
Même en FIV classique, quand on trie des embryons avant l’implantation, on est dans cette logique de sélection. Cela se fait pour la recherche de maladies particulières, mais cela va s’élargir.
Un autre type de manipulation a été autorisé au Royaume-Uni : en cas d’anomalies mitochondriales chez la mère, la fécondation in vitro peut se faire en utilisant trois génomes : le spermatozoïde paternel, le noyau de l’ovocyte maternel et l’ADN mitochondrial d’une autre femme.
Tout cela se fait sous l’égide du curatif, mais ce n’en est pas, c’est de la sélection génétique. Une fois qu’on permet cette sélection, au nom de quoi va-t-on l’arrêter ?
La question de l’avortement à visée thérapeutique est aussi très complexe : à Montréal, les femmes ont droit à l’avortement thérapeutique pour des motifs psychologiques ; dès qu’il y a anomalie, elles peuvent demander l’avortement thérapeutique, c’est autorisé par exemple quand l’enfant a des pieds bots.
Ce qui m’intéresse là, c’est quelles sont les définitions de l’enfant, de la maternité, dans la logique actuelle de performance.
Une de mes étudiantes travaille à un mémoire de maîtrise où elle a comparé les représentations de l’enfant en GPA et en adoption internationale. On s’aperçoit qu’il y a une dévalorisation des enfants en adoption par rapport à la GPA : les gens ont l’impression qu’avec la GPA, l’enfant sera « mieux », parce qu’en adoption on ne sait pas d’où viennent les enfants. Au final, l’argument, c’est la santé : dans le cadre de la GPA, la mère va être surveillée, va mieux manger… Le modèle est celui d’une santé parfaite. On s’imagine que si on peut connaître le génome des enfants dès leur conception, on va avoir des enfants en meilleure santé avec une longévité plus grande. Comme si l’environnement n’agissait pas sur la santé !
Beaucoup de recherches vont dans ce sens. Un des exemples les plus frappants est celui des banques de sang de cordon. Au Canada, il en existe dix privées et une publique. L’idée est de pouvoir capitaliser sur son corps alors qu’on n’a aucune preuve scientifique que cela va servir. On privatise ainsi ces éléments du corps alors que ce sont des tissus qui sont utilisés dans le cadre de traitements pour la leucémie. Ici toute femme qui accouche peut être sollicitée. Une amie suisse m’a envoyé une brochure publicitaire disant « Si vous voulez être un bon parent, il faut penser à la santé de votre enfant, congeler le sang du cordon, c’est une assurance santé, une assurance vie… ». En France, pour l’instant, c’est interdit, mais ça ne pourra pas le rester longtemps, parce qu’il y a déjà des gens qui se rendent en Grande-Bretagne, en Espagne pour faire congeler leur sang de cordon. Cela nourrit un imaginaire très fort.
- Pratiques : Ces privatisations de parties du corps humain et cette attention portée à la médecine prédictive individuelle relaient des inégalités de santé majeures, l’exploitation du corps des femmes, le déséquilibre Nord-Sud et la discrimination raciale.
Toutes ces questions soulèvent des enjeux éthiques, surtout en ce qui concerne la reproduction. Pour la GPA, viennent s’ajouter les dimensions religieuses les croyances. Ces dimensions masquent les vrais enjeux de santé publique, d’éthique sociale et d’égalité d’accès aux soins. De mon point de vue, la santé est un phénomène social, un bien commun et non pas un privilège individuel. Ce qui m’alarme à l’échelle géopolitique, c’est « le tourisme médical » parce qu’ici ce qui est en jeu, c’est l’exploitation de la souffrance des riches comme des pauvres. Les pauvres vont servir pour faire des expérimentations cliniques, donc participer au développement pharmaceutique et aux innovations biomédicales, mais les riches aussi, ceux qui se rendent en Inde pour avoir des traitements soi-disant révolutionnaires avec les cellules-souches, ne sont rien d’autre que des cobayes humains. Une amie vient de décéder de son cancer du pancréas. Elle s’est rendue plusieurs fois à l’étranger pour un traitement qui n’est pas donné au Canada. Cela lui a coûté très cher. Ce que j’ai constaté, c’est énormément de souffrances. Au lieu de rester chez elle sous sédation ou en contrôlant la douleur et en profitant des derniers instants de sa vie, elle est allée là-bas alors que c’était « brûlé » d’avance. Ce qui est à l’œuvre dans ce tourisme médical auquel les plus riches s’adonnent, c’est que personne ne veut mourir.
- Pratiques : En fait, il y a une sorte de marché global et une exploitation jusqu’au-boutiste de la ressource humaine.
Les individus ne le voient pas ainsi. C’est très complexe du point de vue de la personne qui souffre. Des personnes âgées vont peut-être refuser des traitements parce qu’elles ont décidé de vivre sereinement la fin de leur vie, mais une large part des populations les plus jeunes va intégrer ce principe de mettre son corps à l’épreuve jusqu’à la fin. C’est toute la question du sens de la souffrance. Il existe bien un marché, mais la personne est juste dans la quête et la volonté de vaincre la maladie. Tout le sens qu’on donne à la souffrance et à la maladie est en train d’être détruit. On dit que notre société n’aime pas la souffrance, mais c’est le contraire ! Le biomédical produit de la souffrance et des souffrances parfois intenables.
Le sensationnel se développe avec cette idée d’innovation constante, sans que personne n’y trouve à redire. L’industrie et la clinique ont fusionné, créant l’adhésion à une médecine personnalisée et régénératrice. Ces nouveaux modèles me questionnent sur le plan économique parce que finalement, chaque malade nourrit cette industrie biomédicale. On nous promet des thérapies géniques depuis trente ans. Les retombées sont très rares. Ce sont des milliards qu’on aurait pu investir ailleurs. C’est une économie de la promesse.
- Pratiques : Tout un pôle de recherche se met en place avec de l’argent public sans aucun délibéré sociétal, politique ou citoyen.
Des chercheurs français m’ont dit : « En France, on n’est pas dans une telle bioéconomie ! » Je pense que si, les biobanques sont liées aux multinationales françaises. N’importe quel chercheur privé ou compétiteur international peut avoir accès aux données et les acheter. Et ces biobanques, ce sont les corps des citoyens. C’est vrai que la majorité des soignants ne sont pas au courant de ces enjeux.
Pour les chercheurs, le donneur a consenti, ils ne se posent pas de questions et travaillent, sans saisir les enjeux de ces modèles de recherche d’innovation. Certains croient même sincèrement participer au bien-être de la population.
Dans le fond, ce n’est pas tellement la médecine qui est en jeu, c’est le fait d’un modèle capitaliste qui s’est imposé, le vivant est une mine sans fin.
Les grands développements de l’innovation biomédicale et de l’innovation technoscientifique sont sortis des cadres de l’Occident. On a transposé nos modèles en Chine, en Inde et dans une grande partie de l’Asie où les représentations du corps sont différentes, où les modèles sont différents.
Sur l’expérimentation, les cadres stricts mis en place avec Nuremberg ne tiennent plus, parce qu’on n’a pas réfléchi à ce que cela signifiait de faire de la santé un enjeu du capitalisme international. Le tourisme médical en est toujours le meilleur exemple, parce que même si on essaie de poser des limites aux citoyens, ils vont eux-mêmes prendre des risques pour aller chercher des traitements.
Une canadienne de 50 ans à qui on avait refusé une FIV est allée en Inde. Sa grossesse s’est mal terminée, elle a eu des problèmes de santé majeurs et un enfant lourdement handicapé. Elle est revenue au Canada. Qui a payé ? C’est le système de santé publique. Va-t-on laisser une femme souffrir même si elle a risqué sa vie ?
Ce sont des questions complexes, il n’y a pas assez de réflexion. L’éthique prend toujours ces questions du point de vue individuel et du point de vue du droit abstrait comme celui du droit à l’enfant, on ne pense pas les enjeux en termes de corps social. C’est la défaite de la sociologie en fin de compte.
- Pratiques : Voyez-vous des alternatives ?
Ces tendances dans le domaine de la recherche sont basées sur le fait qu’un être humain est un individu. Or, un être humain n’est pas un individu isolé, c’est un être lié. Celui qui vient au monde dépend de ses semblables et la santé est un bien public. Il n’y a pas de solidarité sociale possible s’il n’y a pas de partage. La santé dépend des conditions d’existence de base. Aujourd’hui, nous sommes dans une société complètement dopée à la croyance dans la science et la technologie.
Là où l’on pourrait créer des alternatives, c’est sur la problématique du changement climatique qui nous donne les limites de notre environnement et nous permet de réfléchir sur la santé : quelle santé est-elle possible si on ne prend pas en compte les enjeux environnementaux ? C’est comme s’il y avait deux visions de la science. Il faudrait revaloriser une solidarité à partir d’un modèle de science qui ne soit pas fondée sur la promesse et le consumérisme qui va avec. La seule chose que l’on peut faire c’est : informer, expliquer les enjeux environnementaux pour y réfléchir. Des pans importants de la population peuvent comprendre que les technologies de reproduction sont basées sur une utilisation abusive d’hormones et que, quand on est dans cette logique-là, on ne peut pas défendre des positions favorables à l’environnement. Faire comprendre que la manière dont on exploite le vivant n’est pas compatible avec le respect de l’environnement. J’ai l’impression que les populations sont plus sensibles aux arguments environnementaux qu’à un discours sur la fatalité de la maladie et de la mort. Nous sommes dans une société qui veut pouvoir combattre la mort, il faudrait décentrer le débat. Je sais que si on parle de commercialisation du corps humain, ça touche les gens, mais si on parle des enjeux environnementaux et qu’on réussit à relier les deux, c’est peut-être là qu’on a le plus de chances. Il faut faire en sorte qu’on ne confisque pas l’avenir d’un monde où il fait bon vivre et où les inégalités en santé ne sont pas incommensurables, au nom d’un futur colonisé par le fantasme d’une santé parfaite façonnée par les nouvelles technologies médicales.
Propos recueillis par Françoise Acker, Sylvie Cognard, Marie Kayser et Anne Perraut Soliveres