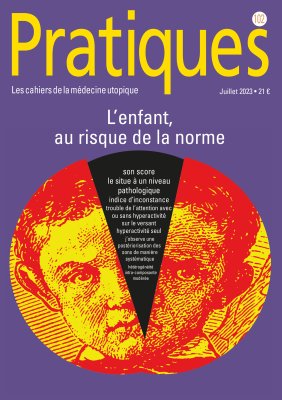Sandrine Deloche, Médecin pédopsychiatre
C’était un livre très épais recouvert de cuir noir dont une partie avait été brûlée de part et d’autre de son épaisseur par on ne sait quel engin, mais qui devait être d’une puissance terrifiante, genre chalumeau ou barre de fer rougie au feu. Les jours suivants de la découverte du livre brûlé, Ernesto était entré dans une phase de silence. Ernesto n’était pas censé savoir lire à ce moment-là de sa vie et, pourtant, il disait qu’il avait lu quelque chose du livre brûlé. Elle, elle pensait qu’Ernesto avait été frappé par la solitude de l’arbre et du livre. Ainsi avait-il compris que la lecture est une espèce de déroulement continu dans son propre corps d’une histoire par soi inventée. Bouleversé de sa découverte essentielle, voici qu’il tente d’expliquer son refus d’apprendre à l’instituteur interloqué : « Avec ce livre… justement… c’est comme si la connaissance changeait de visage, Monsieur, dès lors qu’on est entré dans cette sorte de lumière du livre… On vit dans l’éblouissement… Excusez-moi c’est difficile à dire… ici les mots ne changent pas de forme mais de sens… de fonction… vous voyez, ils n’ont plus de sens à eux. Ils renvoient à d’autres mots qu’on ne connaît pas, qu’on n’a jamais lus ni entendus mais dont on soupçonne la place vide en soi…ou de l’univers. » [1]
Le roman de Marguerite Duras, Une pluie d’été, parle du vertige que l’enfant rencontre, en découvrant le savoir, au titre de l’émerveillement. Mais aussi tout ce qui le précède sur le chemin de la connaissance, le faisant grandir selon une destinée pré-écrite « d’amour ».
La rencontre du livre troué raconte l’importance d’un espace désœuvré mis à disposition de l’enfant, libre de faire histoire singulière d’un savoir non encodé. Et Ernesto d’incarner ce pas de côté jusqu’au refus d’école. Il veut bien tout apprendre, tout, sauf ce qu’il ne sait pas déjà. Ernesto refuse d’abandonner sa pensée à la connaissance encodée.
Dans les années quatre-vingt-dix, l’échec scolaire revient encore à la responsabilité politique de l’époque. Les classes de perfectionnement, les réseaux d’aide scolaire avec maîtres spécialisés et psychologues dans les écoles offrent du temps et d’autres façons d’apprendre.
Dans les années 2000, la bascule s’opère vers une médicalisation de l’affaire. On ne parle plus d’échec, mais de trouble spécifique des apprentissages et de handicap. Et dans le cas précis d’Ernesto, il serait étiqueté phobie scolaire ou précoce haut potentiel ou les deux. En somme, la résistance infantile à l’endroit du savoir encodé est inaudible. Elle est reléguée à un état de dépendance. Plus rien ne doit venir s’opposer à l’encodage des élèves en panne.
Heureusement, Ernesto persévère, cette fois en la personne de Camille De Toledo. Il écrit dans Une histoire du vertige la suite de nos savoirs tronqués.
« Nous autres, Sapiens narrans disposons de deux types d’appui : ceux primordiaux concrets du corps et ceux sémiotiques qui viennent avec le langage et la lecture des signes. Nous tenons au monde par des prises concrètes et par des encodages – des histoires, des fictions, des contes, des équations, des algorithmes, des cartes, des chiffres… qui créent une certaine relation de lisant au reste du vivant, or tu vois, ce que nous appelons modernité est le lieu d’un chiasme de plus en plus aigu entre les appuis concrets – le contact au monde, les pieds qui touchent le sol, les mains qui sentent les choses et les êtres – et les appuis sémiotiques – les codes sur lesquels nous croyons pouvoir prendre appui. » [2]
Le livre troué a perdu de sa superbe. La béance en ces temps tourmentés se devine dans le monde abîmé et heurté que nous fabriquons, rendant incertain l’avenir des petits.
Depuis la crise sanitaire, combien de jeunes sont restés reclus chez eux loin de l’école et du monde des apprentissages ? Combien de jeunes refusent d’apprendre ce qui ne leur servira pas pour vivre les années futures ? Doit-on les entendre en inventant un sens nouveau du savoir et de l’apprentissage ? Un sens qui doit faire lien avec les autres formes de vie. Marguerite Duras nous aide-t-elle à reprendre appui, à nous détourner de l’ensorcellement de l’encodage, à soutenir la poésie de nos imaginaires ?
« Ça rend sauvage l’écriture. On rejoint une sauvagerie d’avant la vie. Et on la reconnaît toujours, c’est celle des forêts, celle ancienne comme le temps. Celle de la peur de tout, distincte et inséparable de la vie même. On est acharné. On ne peut pas écrire sans la force du corps. Il faut être plus fort que soi pour absorber l’écriture. Il faut être plus fort que ce qu’on écrit. » [3]
L’écriture est l’autre histoire fondatrice que l’enfant va rencontrer. Mais voilà qu’Ernesto, en la personne de Roberto, refuse d’écrire. Il sait lire, mais écrire comme on le doit, c’est non. De même, il refuse la présence d’une aide de vie scolaire à ses côtés qui pourrait écrire sous sa dictée. Il voit bien le procédé, mais préfère être laissé à son embarras pour de longues heures de tranquillité en classe. L’institutrice questionne un trouble attentionnel, et se désole : « Comment l’aider à faire son travail ? Il m’est impossible de l’évaluer en l’état ». Roberto préfère ne pas… ne pas céder à son entêtement.
Il vient chaque semaine en séance de psychothérapie. Son imaginaire lui fournit matière et raison pour échapper à l’école. Il profile de s’en extraire en solo ou en duo avec un plus petit. Les défauts de surveillance aux heures de cantine, de récré, ou à la loge, il les connaît. Il dessine des croquis des alentours, concocte des méthodes de diversion. Tout est étudié avec minutie. Fuir l’école lui semble être la solution rêvée : « Je sens bien que c’est pas mon truc. D’autres enfants l’aiment, moi je déteste l’école. » Roberto sait-il à quel point il défie son époque ? Que nous apprennent les enfants qui n’apprennent pas ? L’époque s’organise en réponses fermées et préférentiellement à partir de ce dont elle oublie de s’occuper. Fini le pourquoi des enfants inadaptés à la méthode, récalcitrants à la règle ou indisciplinés de l’intérieur. L’époque efface l’enfant qui trouve refuge dans le livre-troué. Cette suspension-là n’est plus tolérée.
L’époque s’active à formaliser un monde gouverné par la norme. Enfants inaptes ? Affaire classée en trois mots : trouble - handicap - spectre. Ça peut même se réduire en trois lettres : DYS -TSLA-TFC. Une manœuvre de réduction subjective ouvrant la voie à la schématisation binaire des horizons : normal ou pathologique. Tout ce qui sort de la norme doit être enregistré, classé, codifié, orienté et traité. L’assignation au pathologique est dorénavant indissociable du signifiant handicap.
Pour être aidé, l’enfant doit être reconnu handicapé, heu pardon, reconnu en situation de handicap.
Pour tout enfant résistant de près ou de loin à la connaissance, l’époque lui renvoie qu’il est abîmé, amputé. Il devient l’enfant troué. Le livre troué d’Ernesto, allégorie du manque, de l’imaginaire, de l’importance de la place du sujet à l’endroit du savoir n’est plus d’actualité. Ça dérange la solution binaire. Le nombre d’enfants handicapés en France se compte en wagons, en tonnes de dossiers à classer. Personne ne bouge.
Roberto a eu droit à son bilan neuropsychologique pour y voir clair. Le résultat, une liste longue comme le bras de recommandations à la maison comme à l’école, dont l’usage du clavier et de l’ordinateur, sachant Roberto dramatiquement vissé aux écrans, le plongeant sans filtre dans un monde virtuel envahissant, en quelque sorte une contre-indication absolue à amplifier ce penchant. Roberto a eu droit à sa reconnaissance par la maison départementale des personnes en situation de handicap pour pouvoir obtenir la présence d’une AESH en classe alors qu’il s’y oppose ouvertement. Par chance, le dossier s’est enlisé quelque part dans les tuyaux de l’infernale mécanique du handicap. Par chance, Roberto est suivi dans un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) qui accueille encore la parole de l’enfant. Par chance, Roberto participe à un groupe d’écriture qui soutient la position subjective du sujet dans ce qui le constitue de manquant et en devenir. Le livre troué cette fois-ci est symbolisé par des bulles de bande dessinée sur planche pour en tracer une histoire en paroles. L’écrire un jour peut-être.
Par chance aussi, l’école et le CMPP ont pu se parler pour essayer de comprendre ce à quoi Roberto résiste, en supportant de ne rien résoudre artificiellement.
Par chance, le pédopsychiatre qu’il a rencontré ne prescrit pas la pilule très en vogue pour faire cesser, chez petits et grands, toute divagation ou tressaillement anormal. A contrario, il lui assure le temps nécessaire pour déployer ce qui le trouble et l’agite. Ce qui tracasse Roberto est la disparition de Bubulle, son poisson préféré évaporé du bocal. Cette perte l’entête : qui, quoi, comment. Roberto avance par hypothèses, tâtonne, cherche. Par là même, il est en train d’accepter de construire un savoir troué par la finitude, l’inexplicable et surtout l’imaginaire. Roberto n’est-il pas en train d’écrire dans sa tête, là où personne ne peut le voir, une espèce de déroulement continu dans son propre corps d’une histoire par soi inventée ?
Croiser des lieux qui préservent la parole des enfants frappés par la solitude de l’arbre ou du livre, n’est plus une chance donnée à tous. C’est le fait d’un hasard de plus en plus restreint, puisque ces endroits deviennent îlots de résistance à l’époque trouble de la norme… au risque de fabriquer encore plus d’enfants troués.