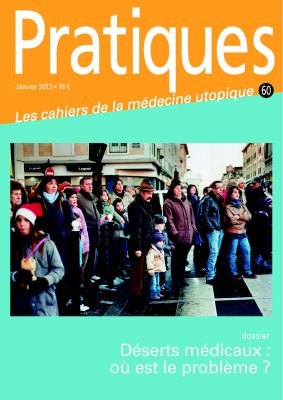Jean-Paul Canévet,
médecin généraliste, maître de conférences Associé en Médecine générale, Université de Nantes
Comme celle des feuilles mortes, la saison des certificats en tous genres revient chaque année chez les médecins généralistes : pendant les semaines de rentrée, une partie de leur temps de travail est consacrée à certifier que le demandeur ne présente aucune contre-indication à la pratique d’une activité sportive. Ce qui paraît une mesure de bon sens pour des sports à risque, comme la plongée ou la boxe, confine souvent au ridicule s’il s’agit de paisibles occupations de loisir, comme la marche à pied ou l’aquagym. Chaque médecin généraliste a son bêtisier des certificats : pour la pêche à la ligne, le billard, la pétanque ou la « gymnastique douce »...
Pour des praticiens surchargés, qui peinent à satisfaire les demandes des malades, ces certificats de rentrée viennent s’ajouter aux innombrables justificatifs que doivent produire des personnes présumées bien portantes pour avoir accès à toutes sortes de démarches de la vie quotidienne : pas de prêt bancaire sans certificat médical ; pas de colonie de vacances sans attester, lors de l’inscription, soit plusieurs semaines à l’avance, de sa bonne santé ; pour certains établissements scolaires, un certificat exigé pour l’éducation physique, pourtant matière obligatoire du programme ! Ces demandes hétéroclites agacent d’autant plus les praticiens qu’elles ne s’appuient souvent sur aucune obligation légale : la loi n’impose pas, par exemple, de certificat annuel pour les pratiques sportives de loisir, sans compétition. Mais l’inflation certificatrice illustre l’ambiguïté de la demande sociale faite à la médecine, à la fois surinvestie comme instance de normalisation et instrumentalisée par l’idéologie du risque zéro : le passage obligatoire du sportif par le cabinet médical témoigne de ce paradoxe qui fait du sport à la fois une hygiène de vie érigée en norme sociale sous contrôle médical, et un risque sanitaire auquel on ne peut s’exposer qu’avec autorisation médicale. Le certificat annuel est parfois une occasion utile de rencontrer un médecin : pour les pratiquants de quelques sports dont les contre-indications sont bien identifiées, telles que l’asthme pour les plongeurs ou la cécité d’un œil pour les boxeurs ; pour les adolescents, peu familiers des cabinets médicaux, c’est le moment pour le médecin de se mettre à l’écoute de leurs préoccupations corporelles exprimées ou implicites ; pour les enfants, c’est l’occasion annuelle de surveiller leur développement et d’échanger, avec eux et leurs parents, sur l’hygiène de vie, leur corps, leurs peurs... pour les adultes, c’est parfois l’occasion d’évoquer un symptôme ou un facteur de risque qui n’aurait pas mérité à lui seul une consultation. Mais cette dernière éventualité peut se révéler un piège redoutable.
Un piège coûteux et iatrogène risque de s’ouvrir si une plainte, évoquée à l’occasion d’un certificat, témoigne d’un trouble fonctionnel passager, en dehors de toute maladie. Cette éventualité est de loin la plus fréquente en médecine générale où la fréquence des maladies graves est faible. La spirale de la médicalisation abusive peut alors se mettre en route, stimulée par une culture médicale dominante orientée vers les techniques sophistiquées, à la recherche immédiate d’un diagnostic grave. Le sportif bien portant devient alors l’objet de la traque presque toujours vaine, mais non sans risque iatrogène, d’une hypothétique maladie. Ce certificat est parfois présenté comme un acte de prévention. Mais en dehors des quelques cas de sports à risque ou de malades candidats à un sport inadapté à leur pathologie, cette conception d’une prévention molle et généralisée, sans objectif ciblé et évaluable, n’a pas d’intérêt. C’est aussi le point de vue de l’Assurance maladie qui ne rembourse pas ces consultations médico-sportives. La balance bénéfices/risques du certificat médico-sportif, appréciée par l’expérience des généralistes, ne penche pas en faveur de cette pratique systématique qui impose aux praticiens des tâches souvent inutiles et parfois absurdes. Les médecins certificateurs sont là confrontés à une inversion de leur rôle : attester l’absence de maladie, au lieu de soigner ou prévenir. La (relative) pénurie tant redoutée de médecins généralistes impose d’ouvrir le débat sur cette pratique qui confisque du temps médical au détriment du soin.