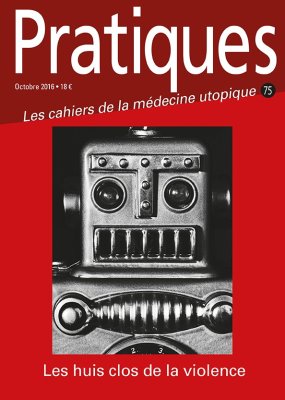Entretien avec Pinar Selek
Sociologue, écrivaine
-
-
-
- Être révolutionnaire, dire non, ce n’est pas seulement revendiquer, c’est d’abord être heureux, apprendre à écouter, à regarder, se nourrir de l’humanité qui nous est offerte.
-
-
- Pratiques : Peux-tu te présenter et nous raconter ton histoire ?
Pinar Selek : Lors de mes interventions on me demande comment il faut me présenter : universitaire, sociologue, politologue, écrivain, militante ? C’est une drôle de question parce que je n’imagine pas une personne qui s’appelle sociologue… ou qui s’appelle militante… Sociologue, ce n’est pas un métier pour moi. J’ai étudié la sociologie parce que j’avais besoin de structurer mes pensées, de poser mes questions et de tenter d’y répondre. Ce n’est pas quelque chose qui me définit. Je peux dire que je suis sociologue et politologue pour des raisons conventionnelles, mais pas pour le public parce que ces deux outils ne font pas une « identité ». Je voyage aussi pour mes écrits littéraires et mes contes pour enfants. Je suis militante dans plusieurs groupes. S’il faut me définir, je dirais que je fais partie des gens qui veulent tout simplement être heureux, comprendre la vie… Moi je me suis questionné vis-à-vis de la société et donc j’ai appris ça. Après, observant les choses, on peut ressentir l’envie d’écrire, de chanter, bref de s’exprimer autrement, pas forcément d’analyser, mais vraiment de s’exprimer. Si on écrit, on dit que c’est de la littérature, si on peint on dit que c’est de l’art puis quand on rencontre une injustice, alors on devient militant. En France et en Europe en général, je constate beaucoup de cloisonnements. Je parlerais même de castes ! Cela a tendance à s’atténuer dans les jeunes générations, j’observe des engagements politiques militants très divers et je pense que les identités se déconstruisent petit à petit.
En septembre 1980, j’avais 9 ans, j’ai été témoin d’un coup d’état. Mon père avocat qui militait pour les Droits de l’Homme a été emprisonné. Des milliers de personnes ont été tuées. L’anticommunisme primait. Toutes les personnes progressistes, la junte les nommait communistes. Des auteurs ont été interdits, pas seulement Marx, Lénine, Engels, mais même des poètes comme Paul Eluard ou Louis Aragon. Lire Aragon était un délit pour lequel on risquait la prison. Si vous parliez d’égalité ou de liberté, vous étiez communiste. Un million de personnes ont été accusées d’être communistes.
Pour l’enfant que j’étais, qui rêvait de devenir écrivain, cette période m’a amenée à me questionner et à réfléchir sur ce que j’observais. Ma tête ressemblait à un tourbillon. Pour moi, le communisme était devenu un terme très positif parce que c’était une insulte dans la bouche des dictateurs. Ma sœur et moi, nous nous questionnions beaucoup sur les femmes, sur l’existence, sur l’homosexualité… Je voulais vraiment comprendre comment il était possible d’être libre, je voulais définir les libertés, le bonheur. Ceux qui étaient en prison étaient devenus des héros « intouchables »… Mais nous sentions que même s’ils étaient des héros, ils n’étaient pas capables de répondre à toutes nos questions dans ce contexte très lourd de la dictature militaire. Je me suis mise à lire beaucoup pour trouver des réponses. Je me nourrissais des réflexions des personnes plus âgées et j’aimais la façon qu’ils avaient de se questionner. C’est comme ça que j’ai eu envie d’étudier la sociologie pour « guérir » notre société malade. J’ai aussi cherché comment je pouvais m’engager.
- Quand as-tu commencé à dire NON ?
J’ai eu la chance de grandir dans un milieu qui disait NON. Ce milieu, ma famille n’étaient pas très « orthodoxes ». Proches des libertaires, athées, ils questionnaient tout, remettaient sans cesse en question les choses, il n’y avait rien d’interdit. A la maison, des gens venaient dormir, manger, débattre. Des livres partout. Une ambiance très joyeuse, chaleureuse malgré les difficultés. Il n’y avait pas que des militants, mais aussi des gens qui venaient simplement apporter leur soutien, leur tendresse, leur affection. On fumait, on buvait, on chantait, on dansait beaucoup, on s’embrassait, on dormait tous ensemble, c’est dans cette effervescence joyeuse que j’ai grandi. Pour moi, être révolutionnaire, dire non, ce n’est pas seulement revendiquer, c’est d’abord être heureuse. Certes, on souffrait de la répression, mais on était heureux. Résister contre les violences d’État, c’était plus facile parce qu’on avait ces ressources, l’amour, la joie, la confiance, l’ouverture.
Mon père était donc en prison, ma mère qui était pharmacienne continuait de militer. Sa pharmacie, c’était comme une association. Elle organisait des actions de solidarité avec les prisonniers et contre la répression. Elle réunissait les gens pour essayer de faire quelque chose. Elle avait ce besoin de lutter, de résister pour rester elle-même et garder cette joie qui l’animait. En tant que femme, ce n’était pas facile…
À l’extérieur, bien sûr, ce n’était pas comme chez moi ! Quand je sortais de la maison, ça devenait difficile de poser mes questions. J’ai vécu des contradictions très dures. On était dans un pays avec des centaines de milliers de personnes en prison, en exil ou assassinées. Tout était interdit, en particulier les livres. Sur le plan politique, la dictature a brutalement ouvert « les portes » au néolibéralisme, au fascisme et la consommation est devenue un mode de vie en un rien de temps. J’ai vu comment tout le monde a été obligé de rentrer dans le rang. Comment le silence, la peur et la nouvelle culture nous ont été imposés.
Avant le coup d’État, la Turquie était proche de l’Union soviétique, les mouvements sociaux étaient très forts. Sur le plan culturel, c’était très imaginatif. Le coup d’État a donné un coup d’arrêt à ces mouvements.
A un moment, j’ai été scolarisée dans une école française, une école de riches. C’est moi qui avais voulu aller dans cette école parce que j’avais lu La Religieuse de Diderot et je voulais voir une religieuse de près. Dans cette école catholique, il y en avait des religieuses… Je me suis retrouvée dans la même classe que la petite-fille du dictateur. J’ai réussi avec mes amis à créer une contestation en fondant un journal du lycée. On y mettait tous les poètes interdits. Plein de gens autour de moi ont commencé à bouger.
J’étais sûre qu’on avait raison, on n’a pas besoin d’être très intelligent pour comprendre que les dictateurs, les fascistes, ils avaient tout faux et n’énonçaient que des mensonges. Cruels, méchants, ils pourchassaient les Arméniens, les Kurdes et étaient opposés de façon systématique à la culture et à tous les plaisirs de la vie.
Avant le coup d’État, il existait un mouvement marxiste-léniniste révolutionnaire armé très violent. Ils combattaient la culture bourgeoise et, entre autres, l’homosexualité qu’ils assimilaient à la culture bourgeoise. Quand la répression s’est abattue sur eux, ces militants se sont posés en victimes, mais ce n’est pas parce que vous êtes victime que vous devenez autre. En fait, ils continuaient à perpétrer les phénomènes de domination, ils ne se questionnaient, ni ne se remettaient en question. Ils se comparaient aux putschistes et aux dictateurs et, bien sûr, ils se disaient beaucoup mieux qu’eux. Ils n’étaient ni libertaires, ni féministes non plus. Après le coup d’État, un nouvel espace de contestation s’est créé, bien différent, avec des personnes qui en avaient assez d’attendre le « grand jour », assez de dire que la révolution était pour demain, après-demain… Le dictateur est resté sept ans et après, ils ont civilisé le système, ils n’ont jamais vraiment fait cesser cette répression.
Quand j’ai terminé mes études secondaires, j’étais très dispersée. J’avais des amis avec qui on faisait de la poésie, je faisais partie d’un groupe de théâtre, d’un autre où il n’y avait que des discussions. Je continuais de chercher des groupes étudiants un peu plus radicaux. Parmi tous ces groupes dans lesquels je militais, rien ne me convenait vraiment. Ce multi-engagement ne me suffisait pas, je sentais que j’avais besoin d’autre chose. C’est comme ça que je me suis retrouvée à fréquenter la rue. Cela a commencé par des rencontres de hasard. Beaucoup d’enfants dormaient dans les rues. J’ai commencé par parler avec eux, je leur demandais des cigarettes. Après, ils venaient devant l’école m’amener des cigarettes. Comme j’écrivais des contes, j’ai commencé à leur lire ce que j’écrivais. Un jour, ils m’ont dit : « Mais pourquoi tu ne dors pas avec nous ? » C’est ainsi que j’ai commencé à dormir avec eux, une fois par semaine, puis plus souvent. J’avais deux vies, celles des espaces militants et ma vie dans la rue. Je ne pouvais pas faire se rencontrer mes deux cercles parce qu’ils ne se comprenaient pas et mes relations avec les gens de la rue se développaient avec lenteur. On dormait place Taksim. J’étais déguisée en garçon, on ne me voyait pas, j’étais entourée par un groupe très solide. Ils ne disaient à personne que j’étais une fille. J’étais très protégée. Quand je regarde en arrière, je me demande comment j’ai pu faire cela parce que les rues d’Istanbul sont très dangereuses. Je dormais avec des gens qui se droguaient, qui buvaient, qui se battaient et je n’ai jamais été agressée. J’ai vécu cette expérience avec eux pendant presque quinze ans.
Dans le même temps, j’avais fait connaissance avec les filles des bordels, avec des transsexuels et aussi avec des gitans. Je n’ai jamais fait de recherches sur ces personnes « à la marge », même si je les côtoyais et vivais avec eux. Une fois, des chercheurs ont voulu faire une enquête sur les enfants des rues et les prostituées. J’ai vu que ça ne leur plaisait pas du tout et je me suis fait la promesse que je ne ferais jamais une enquête sur eux. Les rencontres, c’est très réciproque, tu leur apprends quelque chose et eux, ils t’apprennent quelque chose. Mon expérience dans les rues m’a beaucoup transformée…
Les amis du milieu de la prostitution m’ont également fait changer de regard. J’étais contre la prostitution, mais j’étais solidaire avec les prostituées, j’étais avec elles. Je pense qu’on ne peut pas abolir la prostitution sans les prostituées. Quand on chemine ensemble, alors on commence à mieux comprendre. Ces femmes m’ont beaucoup aidée à réfléchir sur la sexualité et les rapports hommes-femmes parce que j’étais très jeune. Pour les transsexuels, j’ai fait aussi un travail d’observation et de recherche universitaire parce qu’elles me l’avaient demandé. La police avait fait une grande opération de « nettoyage » contre les transsexuels qui représentent une contre-culture depuis l’empire ottoman en Turquie. Les fascistes sont arrivés avec des drapeaux turcs, ont encerclé leurs « maisons » et ont exercé une violence terrible. Je suis restée là-bas des mois et des mois, je ne les ai pas quittés. Comme je n’étais pas transsexuel, je pouvais circuler. La nuit, je leur portais de quoi se nourrir. Elles m’ont demandé de faire quelque chose pour défendre leur cause, faire entendre leurs voix. Comme à cette époque je faisais ma thèse, j’ai effectué cette étude. J’ai pu fréquenter les maisons qui acceptaient leurs clients et faire mes observations. J’ai été critiquée par certains amis intellectuels. J’ai constaté beaucoup d’hypocrisie dans ces rues sombres, ces rues des exclus, j’y ai appris beaucoup. Je dirais que cela a été mon université de l’intime. J’ai gardé beaucoup de secrets sur ce que j’ai vu, vécu. Ce que je voudrais dire c’est que quand on apprend à écouter, à regarder, quand on ouvre ses fenêtres, on se nourrit, on se construit avec cette humanité qui nous est offerte. J’ai eu cette chance de rencontrer ces gens et je m’y suis attachée.
Quand j’ai commencé mes études de sociologie, je me suis mise à voyager en France et en Allemagne. Là-bas, j’ai découvert les squats. De retour à Istanbul, j’ai eu l’idée de créer un squat avec les gens de la rue. Ensemble, on a créé un « Atelier des artistes heureux ». Cela n’a pas été facile de réunir les gens de la rue pour que ce soit une réelle co-création parce qu’ils ne s’aimaient pas entre eux. Les mecs des rues détestaient les transsexuels, les transsexuels détestaient les gitans et tout à l’avenant. Mais comme chacun était l’ami de Pinar, ils ont fini par se mettre d’accord et ils ont commencé à créer ensemble. J’ai mobilisé mes amis de l’université pour enseigner la peinture et plein d’autres choses. Avec mes amis de théâtre, on a créé un théâtre de rue et, au bout de deux trois ans, on est devenu une compagnie très importante. On nous invitait partout, on faisait des expositions… Notre atelier, c’était un lieu où tout le monde pouvait venir. Au bout d’un moment, ça « roulait » tout seul, on n’avait plus besoin de moi… Nous n’avions aucun soutien de l’extérieur, pas de projet écrit… Nous payions le loyer avec nos œuvres. Des gens nous amenaient des objets de récupération, sur lesquels on pouvait travailler.
C’était avant que j’aille en prison. Je fréquentais les mouvements féministes, les LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans), les antimilitaristes, les écologistes sociaux et les mouvements libertaires, mais je les trouvais un peu élitistes. Je me sentais plus à l’aise dans ce milieu de l’Atelier. J’ai essayé de créer une organisation autogérée pour que ça ne dépende pas d’une seule personne. En fait, l’atelier pouvait fonctionner sans moi, mais je restais une « personne morale ». J’intervenais quand il y avait des bagarres entre les groupes.
Quand avec l’université j’ai fait cette recherche sur les violences à l’endroit des transsexuels, j’ai aussi commencé à me questionner sur la question kurde, sur la guerre. J’ai fait une enquête qui a duré deux ans sur la question kurde.
Qu’une Turque blanche d’une famille intellectuelle fasse une recherche sur les Kurdes a été considéré comme une hérésie par les autorités. Comme j’étais mêlée à beaucoup de mouvements contestataires, cela ne leur a pas plu. La junte a voulu que je donne les noms des Kurdes que j’avais interviewés. J’ai refusé et alors j’ai été soumise à la torture. Ils m’ont détruite au point que je ne pouvais plus bouger mon épaule. Puis ils m’ont mise en prison en m’accusant de faits terroristes. Ils ont arrêté un jeune Kurde qui m’a dénoncée en disant que j’avais posé une bombe avec lui.
En prison, on était dans des dortoirs, je n’étais donc pas isolée. C’était très dur parce que les filles kurdes étaient violées, torturées, mais le fait que l’on soit nombreuses a engendré une grande solidarité entre nous. On se soutenait les unes, les autres. Cela a représenté une expérience extraordinaire cette solidarité. Pour ne pas sombrer, on riait beaucoup, on chantait, on dansait, j’ai appris plein de danses kurdes… Notre manière de résister, c’était la joie. Vous ne le croirez pas, mais c’est en prison que j’ai le plus ri dans ma vie. Bien sûr il nous arrivait d’être tristes, mais malgré tout on prenait du recul et on essayait d’être actives. Je suis sortie de prison au bout de deux ans et demi. J’étais devenue un symbole de paix et un monde fou m’attendait devant la prison.
Pendant que j’étais en prison, l’Atelier a été détruit. Lorsqu’ils me torturaient, ils me racontaient que tous mes amis de l’Atelier avaient été arrêtés et qu’on les torturait pour qu’ils dénoncent les personnes dont je refusais de donner les noms. Ils n’ont pas réussi à me faire craquer. Quand je suis sortie, j’ai compris que c’étaient des mensonges mais que l’Atelier était détruit. En fait, comme mes amis de la rue n’ont pas de papiers en règle et ont toujours des problèmes avec la police, dès que j’ai été arrêtée, ils ont quitté l’Atelier. Depuis le premier jour où j’ai été incarcérée, ils étaient toujours devant la prison. C’est grâce à eux que le procès est devenu aussi médiatique. Les accusations qui pesaient sur moi étaient terribles ! C’était comme si j’avais réellement commis des actes terroristes, tué des gens. Personne ne croyait à ces accusations, ils me connaissaient trop bien pour me savoir capable de tels actes. Alors imaginez ces gens-là devant un tribunal, les filles avec leurs porte-jarretelles, les SDF, les femmes voilées, les Roms, tous ces gens très différents que j’avais réunis. Je leur envoyais des messages, « ne venez pas », ils ne m’ont pas écoutée. Ils venaient en prison pour me voir, ils venaient au procès, ils s’inscrivaient comme témoins, ils étaient toujours dans les médias. En fait, c’était le résultat de ce travail de fourmi, cette expérience de l’Atelier qui les faisait se mobiliser pour moi.
A ma sortie de prison, j’ai essayé de tisser des liens entre les différents courants de pensée dans lesquels j’avais milité : les mouvements féministes, anticapitaliste et antimilitariste. En Turquie, on peut parler de convergence des luttes. Tout se passe dans de grands collectifs qui réfléchissent et luttent contre la guerre, contre les violences faites aux Arméniens etc. Le contexte nous portait. Cette année-là, j’ai beaucoup publié et j’ai organisé une grande marche au Kurdistan pour la paix et porté ces combats dans les médias.
Parallèlement ont eu lieu mes procès, tous mes jugements ont été cassés, mais je risquais la condamnation à perpétuité compte tenu des motifs d’accusation. J’ai dû fuir en Allemagne où j’avais obtenu une bourse d’écrivain, c’est là que j’ai écrit La maison du Bosphore qui a été publié en turc et traduit en allemand. En Turquie, ça a très bien marché, mes livres peuvent être vendus en librairie. C’est paradoxal, on veut que je sois en prison à vie, mais mes livres ne sont pas interdits. Je crois qu’ils ne veulent pas que je sois connue par mes livres, ils veulent me criminaliser. Ils savent que s’ils interdisent mes livres, je risque de devenir une héroïne. En m’accusant d’être terroriste, ils imaginent que les gens ne me liront pas.
J’ai décidé de quitter l’Allemagne pour venir en France. C’était une décision difficile à prendre car en Allemagne, j’avais une bourse, un appartement et j’étais accueillie sans limites dans le temps. C’est la langue qui a motivé ma venue en France. Quand on est en exil, la langue c’est très important. J’avais pas mal oublié, mais c’est vite revenu. Je préférais aussi la cuisine française à la cuisine allemande, le vin aussi… Je connaissais les chansons de Barbara, de Brassens, j’avais lu Balzac, Rabelais… Ce n’était pas la Turquie, mais c’était presque mon pays… Je n’ai pas demandé l’asile politique, je me suis inscrite en thèse à Strasbourg. En 2013, les juges qui s’occupaient de mon procès ont été changés et ils m’ont condamnée à perpétuité. La Turquie a demandé tout de suite mon extradition et a demandé à Interpol de me mettre sur la liste rouge des terroristes. J’ai alors demandé l’asile politique et je l’ai eu très vite. C’est grâce à la solidarité qui s’est développée autour de moi. Déjà en Allemagne, mes amies féministes antimilitaristes avaient utilisé tous leurs réseaux internationaux pour me soutenir. Je ne suis pas seulement une réfugiée, je suis aussi une militante. Pour faire barrage à mon extradition, des collectifs de soutien ont vu le jour à Strasbourg, Paris, Rennes, Nantes. Un site Internet était tenu par ces collectifs. C’est génial tous ces gens qui me soutiennent comme si je les avais toujours connus. En France, j’ai pu être plus active parce qu’en Allemagne, il fallait que l’on me traduise les informations en anglais. Ici, je participe aux débats internes, je milite dans plusieurs organisations : un groupe féministe lesbien, un collectif de femmes handicapées, des mouvements d’écologie sociale… L’écologie sociale, c’est un mouvement plus libertaire, non violent, féministe, qui met en question les façons de vivre et les phénomènes de domination en général. Je me sens très proche du journal Silence, un journal alternatif écologiste social. J’écris régulièrement dans le magazine Rebelle Santé.
Maintenant j’enseigne en Sciences politiques à Nice. Là, je me trouve bien même avec la forte répression policière qui m’impose d’être accompagnée pour mes interventions quand je suis seule. Je pense vraiment qu’il y a des raisons d’être optimiste en France. Depuis quatre-cinq ans, il existe de nombreux médias, de nombreux groupes locaux qui ont des convergences, comme ceux qui militent contre les grands projets inutiles. On est en train par exemple d’organiser des manifestations le 15 octobre à Saint-Étienne suite à la mort de Rémi Fraysse. C’est un choix symbolique parce qu’il y a encore à Saint-Étienne une usine d’armement. Je vais animer un débat sur comment on résiste avec des méthodes alternatives, sans violence et malgré les violences. On a invité des Iraniens, des Syriens, des Français, on va mettre ensemble ces gens et on va tout traduire. Les non violents ont besoin de s’entendre aussi. Je suis aussi très heureuse parce que mes contes pour enfant vont être traduits et publiés en France.
Maintenant, mon procès est en attente, c’est la cour suprême qui doit décider entre l’acquittement et la perpétuité. J’ai vraiment fait de belles rencontres en France, j’espère qu’un jour mon procès va finir, mais je ne repartirai pas en Turquie. Ici j’ai trouvé des racines, des amis et même un amoureux ! Voilà disons que maintenant j’ai deux pays.
Propos recueillis par Sylvie Cognard et Anne Perraut Soliveres
Ouvrages de Pinar Selek :
La maison du Bosphore, Éditions Liana Levi, 2013.
Parce qu’ils sont arméniens, Éditions Liana Levi, 2015.
Loin de chez moi mais jusqu’où, Éditions iXe, 2012.
Devenir homme en rampant, L’Harmattan, 2014.
Lina Prosa dramaturge italienne a réalisé un spectacle sur Pinar Selek « Éclats d’ombre » qui va être présenté à Colmar du 3 au 10 novembre, puis à Strasbourg et Nice.