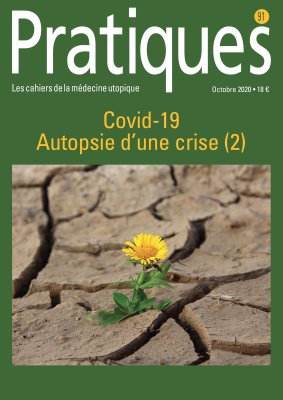Michaël Wizmann
Psychologue, CH Les Murets (94)
Comment décrire ce qui s’est passé depuis mars 2020 dans ce pavillon hospitalier de psychiatrie ? Avant que l’oubli ne fasse son travail, que la parenthèse ne se referme.
À la veille du « déconfinement » du 11 mai 2020, c’est vers l’arrière-plan qu’il faut se tourner pour éclairer l’expérience.
Confinement sanitaire = déconfinement de la pensée
Car ce confinement sanitaire aura été à quelques égards un déconfinement de la pensée, propice à un ressaisissement fragile et temporaire.
Avec l’arrêt du confinement sanitaire, le retour au confinement de la pensée nous guette.
Sur le pavillon, le confinement a interrompu la chaîne de production mécanisée des « prises en charges », la « délivrance » quasi standardisée du kit de soins psychiatriques : chacun à sa place, chacun dans son métier, son statut, son rôle et son geste, peu questionnés. Automatisme faisant pièce à l’agencement symptomatique des patients eux-mêmes. Tant la partition de cette non-rencontre est connue, tant la cartographie de l’impuissance institutionnelle est partagée par tous. C’est en tout cas le sentiment dans lequel j’abordai cette période.
Une importante partie de l’énergie passe dans le fonctionnement de la machine hospitalière elle-même. Si cette dernière n’était pas régulièrement subvertie par ses « agents », consciemment ou inconsciemment, elle ferait du patient une simple donnée (data), certes au « centre » du système d’information d’un processus de production de soin, mais en aucun cas son bénéficiaire. C’est-à-dire qu’il serait un data-patient.
Le formatage relatif de ce que nous faisons et l’empêchement de penser ont été le temps de cette « guerre », comme suspendus. Laissant la place à un retour de l’inventivité.
Les rôles, statuts et fonctions ont été ébranlés, mettant à nu le désir de chacun, le dévoilant qui dans sa vigueur, qui dans son essoufflement, ou se révélant décuplé par le contexte pour certain(e)s d’entre nous.
Sous-jacence
L’honnêteté nous pousse à dire que beaucoup de chemin avait été parcouru dans ce secteur de psychiatrie accueillant des adultes, dans le sens d’une prise en compte de l’expérience de la psychothérapie institutionnelle.
La réunion du pavillon s’était infléchie ces dernières années. De prétexte récurrent au défoulement attendu contre le lieu et l’équipe, elle était devenue un moment de vrais échanges en écart de ce que commandent la fixité de l’expérience hospitalière et des assignations aux places socialement aliénées.
La présence du club thérapeutique Trouble(s)Fêtes avait permis de commencer des pratiques où patients et soignants fabriquent ensemble dans un idéal d’horizontalité des évènements du quotidien, notamment sous la forme de la Buvette Pop-Up chaque mercredi, tenue par des patients et des professionnels.
L’existence d’ateliers d’artistes avait permis de modifier la texture vécue de l’espace et du temps : Merhan, réalisateur, présent une journée complète au pavillon, fait un atelier autour de la vidéo ; Catherine, metteuse en scène présente le mardi, anime avec Isabelle, psychomotricienne, l’atelier « Café Ciné Burlesque ; Sandrine, artiste et psychologue, anime notamment un atelier de création de chansons, textes et musiques.
Le partage des repas avec les patients par plusieurs professionnels et artistes avait transformé ces moments trop automatisés en moments de convivialité.
Évocation brève et non exhaustive de la « sous-jacence » (Oury, 1991) qui nous a fait basculer vers un renforcement de la créativité plutôt que vers une crispation et une angoisse mortifères. Cela permet d’envisager d’étendre à l’avenir ces « vacuoles en écart d’une extrême violence institutionnelle » (Nioche, 2010) au fonctionnement plus global du pavillon.
Car ces pratiques sont en rupture avec les activités thérapeutiques classiques et les « ateliers à médiation » qui étaient la règle voilà quelques années. Cet écart consiste en un changement de l’ordonnancement vertical de la proposition thérapeutique qui assigne habituellement chacun à une place prédéfinie et très souvent réductrice (tant pour le patient que pour le soignant du reste). En rupture aussi, car elles se centrent sur le « co-oeuvrement » (Nader Aghagkhani, 2020) et l’affirmation des singularités.
Mais on ne saurait pour autant négliger « l’humus » sur lequel tout ceci a pu s’enraciner : activités pâtisserie, esthétique, randonnées, sorties, jardinage, chansons, atelier d’écriture etc., animés par différents professionnels depuis très longtemps. Tant il est sans doute vrai qu’on soigne aussi avec des dispositifs incluant de l’aliénation sociale sédimentée, qui permet à certains, de tenir lieu d’identifications et d’inscriptions symboliques défaillantes, donc d’être aussi résolument thérapeutique.
Pas plus, on ne peut ignorer que beaucoup de professionnels, grâce ou malgré leurs métiers et leurs statuts, œuvrent bien souvent à une subversion discrète, une résistance permanente à l’évidement du sens de leur pratique. Contrecarrant heureusement la mascarade et l’imposture fondamentale de certaines logiques administratives et managériales.
Nous n’en sommes plus là
Nous n’en sommes plus, lorsqu’on fait des gâteaux, à se voir opposer un bouclier « normes-hygiène-qualité ».
Ni, lorsqu’on accroche des œuvres au mur, à se voir opposer des précautions « ignifugation-sécurité incendie ».
Ni à assister au décrochage sauvage desdites œuvres dans le réfectoire.
Nous n’en sommes plus non plus à s’entendre répondre, lorsqu’on invite un(e) collègue à participer à un atelier ou une réunion avec les patients : « Moi j’ai du travail ».
Mais avec le confinement, un saut a encore été fait à l’hôpital : la prise en compte du quotidien comme tel, comme ressort thérapeutique principal ! Cela n’est lisible qu’en ayant en tête ce contexte récent et ces éléments de l’histoire du lieu.
La fermeture des portes du pavillon hospitalier : une chance ?
Ça nous a rappelés le temps, il y a six ans, où la décision avait été prise d’ouvrir les portes du pavillon, jusqu’alors fermées. Parmi les arguments s’opposant alors à l’ouverture, il y avait l’inquiétude que la libre circulation des patients ne les rende seulement libres d’errer, et d’échapper encore davantage à la rencontre, aux soins, et peut-être à l’existence.
Cela rendait nécessaire de travailler beaucoup plus sérieusement « l’offre » du pavillon : quelle trame quotidienne, quel cadre et quel « esprit des soins » (Racamier, 2002), quel contenu, quelle thérapeutique ?
Avec le confinement, nous renouons avec ces questions fécondes. Comment rendre l’hospitalisation thérapeutique au lieu de seulement « gérer la crise » ? Car cette crise dévoile la crise permanente antérieure, ou plutôt la déshérence devrait-on dire, de la psychiatrie et plus particulièrement des hospitalisations.
Sans cette privation de liberté imposée aux patients par le confinement sanitaire, nous en serions encore à laisser beaucoup de patients errer, très mal se nourrir, se droguer, s’alcooliser massivement hors du pavillon et venir ensuite prendre leurs médicaments, et cela en quasi bonne conscience.
Dans l’ombre de cette « anti-métaphore » (Abraham et Torok, 1978) nécessaire de l’ouverture du pavillon il y a sept ans, nous poursuivons nos efforts pour fabriquer de l’ouvert là où c’est encore fermé (tout en nous réjouissant quand même que la porte soit ouverte).
Cela peut s’appeler « l’Atelier », pour atelier de création d’ouvert ; atelier de prolifération subjectile ; atelier de subversion du lieu ; atelier de déconfinement permanent de la pensée et des cœurs ; atelier du temps et de l’espace retrouvé au sein de l’arpentage kafkaïen.
Cela implique de faire avec tout ce qu’autrui véhicule d’exclusion, d’exil, d’inhébergeable, et de foncièrement dérangeant.
Avec le coronavirus, et surtout avec le confinement, les états d’âme ont voisiné plus que d’ordinaire : le mécontentement ou le contentement partagé, qui conduit patients et professionnels dans le même bateau à devoir apprendre à ramer ou à nager.
Pour une fois, patients et soignants, nous sommes l’un pour l’autre la plus grande part de notre vie sociale. Enfermés ensemble, d’une certaine façon.
La brèche réelle ouverte dans le fonctionnement ordinaire a libéré un espace formidable où nous avons vu se densifier enfin la présence, l’attention portée à l’autre et son apparition, au croisement des regards. Nous avons dû organiser les moindres détails pratiques de la vie quotidienne, et fabriquer ensemble ce quotidien au lieu de le laisser suivre le cours d’évidences ayant la force de l’habitude.
L’apparent paradoxe de reconnaître une vertu à l’enfermement se dissipe si l’on songe que c’est un des moyens trouvés pour s’obliger nous-même à re-fabriquer un contenu aux hospitalisations. Ce n’est certes pas satisfaisant. Et nous n’en sommes pas à prôner un tel enfermement ! Simplement à remarquer quelle fonction cette restriction de libertés a tenue dans ce contexte particulier.
Et si l’on veut réinventer des alternatives, on ne peut pas non plus faire l’économie de la question de ce que les patients viennent trouver, éprouver, dans ces lieux de privation de liberté. Du moins si on leur suppose une part de liberté et de responsabilité subjective, ce qui est mon cas.
Le rôle « contenant » si souvent évoqué, contient aussi une dimension transférentielle.
À savoir qu’à un moment de son histoire, plutôt que de s’affronter jusqu’au bout à une instance psychique persécutante, une personne en vient à rechercher une limite dans un lieu hospitalier. Cette limite notamment physique dans les premières heures, ne peut lui apparaître autrement que comme un ersatz de persécuteur ! Sous une forme atténuée et moins virulente que celle qu’il porte en lui-même. Une sorte de vaccin à l’aliénation endogène (temporaire).
Se voiler la face sur cette question, c’est s’interdire de trouver de vraies alternatives aux privations de liberté telles qu’elles sont actuellement pratiquées. Et c’est me semble-t-il laisser in fine la question aux tenants d’un tout sécuritaire.
Et j’observe parfois une certaine goguenardise qui me blesse, chez certains de mes collègues qui semblent satisfaits des pratiques actuelles, lorsqu’ils entendent les discours prônant la suppression des « contentions » (physique cette fois-ci) lors même que la psychopathologie de l’aliénation propre à la psychose n’est pas prise en compte.
Entretiens déambulatoires dans le parc arboré
L’interdiction de sortir, même pour des patients qui auraient normalement « bénéficié d’une permission », nous a poussés à proposer des promenades dans le parc de l’hôpital, un soignant pour un patient.
Tout le monde a alors (re)découvert les bienfaits de la marche, et combien la parole est différente hors-les-murs lorsqu’il n’y a plus le bureau, le mobilier, l’agitation autour, lorsqu’on s’accompagne l’un l’autre.
La parole marchée, la marche-parole, la parole-symptôme, la marche-folie… Le peu d’évidence du chemin, de la route, de la verticalité, pour certains, nous rendent sensibles à son aliénation propre, parfois mieux qu’un « entretien », qui peut parfois entretenir une certaine méconnaissance.
La marche est aussi devenue un thème très travaillé à l’atelier Café Ciné Burlesque des mardis confinés. Lectures marchées, dessin lus puis chorégraphiés. Marches tracées sur une feuille, ou traces partageables d’une marche intérieure…
Un effectif minimum et des renforts maximums
Deux infirmiers et un aide-soignant, là où d’habitude c’est trois infirmiers et un aide-soignant. Avec dans le même temps une liste allongée de tâches indispensables autour des précautions sanitaires.
La priorité est toujours donnée aux actes obligatoires, contrainte par la machine hospitalière, entraînant un protocole serré : « entrée » (inventaire, fiches à remplir etc.), « sorties » (rebelote) ; « délivrance » des médicaments ; changement de chambres ; placards, clés, inventaire, linge, nettoyage, désinfections… Avec le confinement cette liste s’allonge encore.
Et cela au détriment de ce qui est considéré comme facultatif : tous les soins corporels thérapeutiques, les accompagnements (balades, caisse, courses, poste, distributeur, Espace Vet’ de l’hôpital… Sans compter la cafétéria qui est fermée, le temps passé aux différents ateliers et activités thérapeutiques, les réunions patients-professionnels, et tous les temps interstitiels passés avec les patients, c’est-à-dire l’essentiel pour faire de la psychiatrie !
Ainsi, un tiers des infirmiers ou aides-soignants en moins, c’est une activité qui s’arrête : jardinage, randonnée, chant, pétanque, esthétique…
Avec le confinement, ce sont presque toutes les activités habituellement soutenues par des infirmiers ou des aides-soignants qui se sont interrompues ou n’ont été proposées qu’en pointillé !
À cela s’ajoute l’arrêt des visites pour les patients. Toute une clinique des infirmiers et aides-soignants se fait d’habitude entre les patients et ses visites de proche ou de familiers. Il en résulte une certaine frustration, et l’impression de faire « du travail bâclé ».
Comme d’habitude, les étudiants aident beaucoup, sont beaucoup auprès des patients, discutent, se soucient, accompagnent, participent aux réunions et ateliers. Ils font parfois ce que les infirmiers et aides-soignants n’ont malheureusement plus le temps de faire (il y a là de belles transmissions et rencontres entre différents métiers, qui compteront dans leur avenir professionnel, et dans les futures ambiances d’équipes…).
Mais parallèlement à la mise en place de l’effectif minimum, l’équipe a été renforcée aussitôt par une psychomotricienne, une art-thérapeute et un psychologue.
Ce renfort exceptionnel a permis d’expérimenter une fabrication du quotidien très différente de ce qui se pratique habituellement. En particulier, l’expérience des « ateliers d’artistes » est soudain sortie de ses lieux de confinement ordinaire (l’ancienne salle d’ergothérapie, depuis rebaptisée l’Atelier), pour essaimer, se démultiplier, proliférer dans les espaces communs, et notamment le réfectoire. Nouvelle géographie, de l’insulaire à l’archipel puis à une certaine continentalité (mais l’eau peut remonter très vite et les marées sont puissantes). Cela a eu des conséquences croisées très diverses.
Conséquence de l’effectif minimum : une explosion du temps passé au chevet du malade par les infirmiers et aides-soignants. Avec parfois près de la moitié des patients confinés en chambre pour « quatorzaine » en plus des patients en isolement. Avec ce que cela représente de plateaux-repas en chambre, de balades dans le parc, car il aurait été inhumain de ne pas leur permettre de sortir de temps en temps, de pauses cigarettes dans le « patio », tout cela dans une surveillance draconienne en raison des risques de contamination !
C’est devenu l’activité principale des infirmiers et aides-soignants, durant toute la période. Et ce d’autant plus que les activités responsables de l’ambiance étaient assurées par ces renforts inhabituels.
Le sanitaire et le psychiatrique se sont mélangés. Les mesures sanitaires et psychiatriques sont devenues indiscernables. Nous avons eu beau expliquer pourquoi nous faisons ceci et cela (ce qui a d’ailleurs été parfaitement compris), rien n’a empêché que nos actes habituels liés à ce lieu de soins psychiques, ne se teintent des autres actes sanitaires. Comme par contamination.
Face à cela, nombreux sont les patients à s’être appropriés cette ambiance sanitaire et l’avoir incorporée, mêlée étroitement à leur symptomatologie.
L’enfermement pour cause sanitaire (quatorzaine) a par exemple fourni des mots et un motif de plainte concernant une évidence partageable, mots qui auraient peut-être été plus difficiles à trouver pour parler de l’aliénation endogène.
Les mots étaient disponibles, en boucle sur toutes les chaînes. Reliaison possible à un événement planétaire, à un sens commun.
Fabrication du quotidien
D’habitude, les professionnels passent leur temps à être gênés dans ce qu’ils ont à faire ou croient avoir à faire par les « demandes incessantes » des patients. Ces derniers courent après les infirmiers et les aides-soignants pour « deux cigarettes », « une permission », une clé de placard, un bon de caisse…
Cela renforce le patient dans une dépendance quasi-infantile au soignant. Cela renforce le soignant comme objet pulsionnel mal délimité, et comme sujet de jouissance potentiellement angoissant (d’où l’affirmation défensive plutôt bien trouvée d’un patient : « C’est vous qui m’avez volé ma cigarette, arrêtez ! »)
Avec la dépendance accrue des patients aux professionnels pendant le confinement, pour l’approvisionnement en cosmétiques, cigarettes et produits de première nécessité, nous avons été contraints d’organiser beaucoup plus méthodiquement ce qui touche à leurs besoins. Et d’en faire en quelque sorte des activités à part entière, établies, programmées, au centre de nos actes professionnels. Et non plus facultatives, parfois au bon vouloir, « si on a le temps », subordonnées au comportement souhaité, comme une récompense, ou au contraire dont la privation relèverait d’une punition.
Du terrain semble repris sur les trafics dans le pavillon (trafic de sucres, de café, de tabac, de drogues, d’alcool, de sexe) qui visent à substituer un ordre mafieux à la loi commune.
Lorsque le professionnel substitue au produit un peu de sa présence incarnée, la dépendance du patient au produit passe par une boucle incluant l’autre, même un tout petit peu. Et c’est là qu’il faut s’appliquer à nous-même une règle, par exemple le jour et l’horaire des courses, le jour et l’horaire de clôture des demandes… Afin que cet autre se relie à un réservoir de sens commun et un lieu d’inscription de ce qui représente alors le sujet dans sa drogue, sa prise, sa dose.
La centration sur les besoins concrets des patients, tels qu’ils sont et non tels qu’on voudrait qu’ils soient, a permis de rendre les activités lessive, cigarettes, cosmétiques, distributeur etc., tout simplement thérapeutiques, pour l’ambiance du pavillon autant que pour les patients eux-mêmes.
Les repas : le confinement et les « mesures barrières » nous ont enfin contraints à faire deux services !
Et à rendre la participation des patients nécessaire et non plus facultative et objet d’une condescendance implicite ou explicite.
Car là encore, tout est d’habitude fait pour aider non pas le patient, mais l’institution et ses professionnels payés.
Le service est pensé, organisé, pour avoir lieu en « optimisant » : le moins de soignants possible pour la tâche requise.
Ce n’est pas forcément le vœu des professionnels, mais c’est celui d’une administration qui n’est pas inquiétée.
Quand le professionnel est minuté pour des actes précis censés s’enchaîner, il ne peut pas faire autrement que de transformer le patient en élément secondaire voire une entrave à son action. Il arrive parfois dans mes échanges avec certains professionnels de l’hôpital que je ressente un vertige, la sensation qu’ils ne sont pas là pour le patient mais pour autre chose.
Et comme la culture institutionnelle veut que les patients soient passifs et passent sagement de la chambre à la chaise puis au patio sans se faire trop entendre ni se faire trop attendre, sans déranger la pauvre « hôtellerie » du lieu, on assiste à ces repas mornes, déprimants, machiniques…
Il a fallu cette contrainte impérieuse (avec enjeu vital) pour que cela change un peu.
Dans chaque service un ou deux patients sont demandés pour aider, faute de professionnels suffisants pour les deux services.
L’effet sur l’ambiance est immédiat. Le temps du repas s’allonge (un bien pour certains, un mal pour ceux dont le but est de terminer au plus vite le service). Les échanges sont plus fluides, il y a de l’humour, du plaisir.
Encore une fois, il faut insister sur le fait que les bonnes volontés en présence ne suffisent pas, mais que c’est l’organisation seule qui permet vraiment de changer l’expérience. C’est donc là que doivent porter nos efforts.
Et nul doute que cela sera balayé par le retour à la normale si personne ne vient organiser les choses différemment en pesant de son pouvoir réel et hiérarchique. Car on ne peut pas demander aux patients hospitalisés, sédatés, préoccupés, malades parfois, d’être à la hauteur de l’organisation des repas comme par exemple aux repas du Club du mardi.
De même qu’on ne peut pas demander aux personnels s’occupant du repas de fabriquer des activités thérapeutiques autour du repas sans leur donner toute la latitude organisationnelle et clinique, et la légitimité qui en découle.
Les lessives. De la même façon, avoir du linge propre est d’ordinaire facultatif à l’hôpital psychiatrique. Sans doute le « pyjama » a longtemps été la réponse hospitalière à ce problème. Nous n’en sommes plus tout à fait là, encore que le « pyjama » subsiste.
Là encore, l’organisation systématique des lessives a été rendue nécessaire par le confinement, là où rien n’était organisé de façon systématique, puisque l’institution ne le considère pas prioritaire.
Il faut parfois des années avant de se rendre compte de l’évidence : « rendre son "vêtement social" au patient » (Danièle Roy) ne se produit pas uniquement par la bienveillance de notre regard. Il faut encore mettre le linge dans la machine avec de la lessive, puis le sécher… En temps normal, sur l’hôpital cela prend une journée complète !
Alors en période de confinement, c’est pire, et ceux d’entre nous, comme Isabelle, qui ont trouvé impossible d’oublier la question du linge, ont dû s’y coller et nous ont fait comprendre que cela aussi doit devenir une activité à part entière à organiser avec les patients.
Tout cela n’a pu être amélioré que par un effort conjoint de tous. L’ambiance de l’équipe s’en est trouvée améliorée : une nouvelle manière de faire équipe ensemble, dans l’indicible, les microchangements dans la façon de se parler, de se « calculer », d’être ensemble, enfin ! L’enjeu sera de ne pas maltraiter cette expérience et ses protagonistes, en étouffant ce début d’initiative et de désir de faire un travail différent.
Feuille de jour
La création artisanale et spontanée par Isabelle d’une feuille de jour permet de rendre enfin lisible la fabrication d’un quotidien centré sur les besoins concrets.
En grand format, à l’encre de chine et aux pastels secs, reprenant l’esthétique de l’Atelier Café Ciné Burlesque, cette feuille de jour a été le blason d’une (re)conquête d’un espace habituellement réglé par un ordre gestionnaire-administratif-sanitaire (plus que médical) et sa segmentation artificielle des tâches (et des glissements de tâches), des fonctions, des gestes, des temps, des sons, des odeurs, des paroles, des territoires…
Autour de cette feuille de jour s’ébauche une réunion matinale avec les patients, où l’on se demande comment ça va ce matin, où l’on recueille les demandes du jour, les requêtes, et où l’on annonce le déroulement possible de la journée.
La date est inscrite, les horaires aussi. Cette contrainte retrouvée à s’inscrire dans le temps et l’espace, au lieu d’en être désarrimés, s’oppose à la tendance néantisante d’un temps hors du monde, sans arrêt, butées, repères, plages.
Les « trois-huit » et les habitudes professionnelles ayant tendance à recomposer comme une prothèse la texture du temps vécu, qui s’impose à tous, disposant ainsi du vécu des patients. Tout cela est rationalisé en avançant les effets thérapeutiques de ce rythme qui ne suit pas tant que ça la vie quotidienne, mais plutôt la vie hospitalière.
Cela produit de la fermeture, au sens topographique et psychique du terme. Ce qui peut s’entendre aussi comme une isolation de la fonction culturelle ou anthropologique du « lieu de vie ».
Car à force de concevoir des lieux avec l’impératif souvent exprimé qu’ils ne doivent pas devenir des lieux de vie, s’énonce implicitement qu’ils sont un peu des lieux de mort, d’une part, et qu’ils sont finalement des non-lieux, d’autre part. Raison pour laquelle tant d’existence psychotique peut y élire non-domicile pour de longues durées.
Avec cette feuille de jour, on peut parler ici de greffe de l’ouvert de l’atelier Café Ciné Burlesque dans la salle commune par l’irruption d’une pratique redonnant de l’épaisseur à la notion de lieu de vie, rappelant quelque chose d’un foyer, au sens où quelque chose peut être cuit, réchauffé, préparé, et donner un rythme à la journée.
Atelier Café Ciné Burlesque grand format
Interdits de pratiquer dans la salle d’atelier trop petite pour respecter des distances « sociales », nous avons donc installé l’Atelier dans la salle commune. Sacré changement d’échelle ! Maintenant, la salle est ouverte aux quatre vents, ça circule d’un bout à l’autre pour traverser le pavillon, ça s’interpelle bruyamment à distance, ça crie, ça rit, s’invective. Certains font irruption smartphone à la main, écouteurs dans les oreilles, ou pas, demandent des cigarettes, passent un coup de fil, veulent qu’on aille dehors se promener…
Dans cette nouvelle ambiance, il faut reconquérir le terrain, l’occuper. Alors les propositions changent : non plus assis mais debout, répartis dans tout l’espace. Non plus des feuilles A4 pour les textes, mais un grand format et de très gros caractères. Et les lectures se font de plus en plus fortes, à très haute voix. Assez vite, nous mettons de la musique pour annoncer le début de l’atelier et signifier à tous que nous prenons possession de l’espace sonore, aussi dans l’espoir d’obtenir plus de respect et d’attention sur ce qui se passe. Non plus la petite discussion conviviale comme au coin du feu, mais une création appelant au mouvement des corps et à donner de la voix.
Cette salle est très inhospitalière pour la voix humaine : des surfaces lisses renvoyant un son déformé, avec beaucoup de résonances qui rendent assez difficile de se parler. Des dalles de plafond premier prix, absolument lisses et sans texture, à l’image de beaucoup de choses proposées ici. Des surfaces qui commandent le silence, ou l’irruption de voix désarticulées.
Et puis, au fil des ateliers on s’adapte, on s’y fait. C’est comme si l’espace sonore avait changé. On s’entend mieux. La voix a gagné en légitimité. Chacun peut s’essayer à donner de la voix.
La première fois que Catherine a fait ça, je me souviens parfaitement cette impression de transgression d’un interdit non-dit, brisant les convenances du lieu. L’effet libérateur et jubilatoire indique bien qu’une répression habite le lieu et les pensées.
Le plus remarquable est cette évidence avec laquelle l’Atelier s’est transposé dans ce nouvel espace.
Il y a encore quelques mois, on pouvait voir un médecin débarquer dans la salle en plein Atelier musique pour demander qu’on fasse moins de bruit ! Et aujourd’hui, notre petit tapage est devenu légitime, son rôle n’est plus questionné.
Il y a de l’étonnement, de l’amusement, de la joie, et beaucoup sont venus nous dire à quel point ils sont contents de ce qui se passe.
L’enjeu sera de continuer à faire vivre cet espace au-delà de cette crise et de continuer à tolérer qu’on y affiche quantité de choses témoignant de la créativité de tous.
Les « Nouvelles Des Confinés »
Malgré la redécouverte de nos moyens thérapeutiques à l’hôpital, ce confinement nous a quand même beaucoup isolés les uns des autres. En particulier des autres lieux de soins, du club thérapeutique, de l’hôpital de jour et du centre d’accueil thérapeutique (tous deux fermés durant cette période).
Dans le même temps certains professionnels étaient en retrait, confinés chez eux, telle Sandrine la psychologue de l’hôpital. Avec pour conséquence notamment l’arrêt de ses ateliers de création musicale.
Un fil Whattsapp avait été créé par le club thérapeutique pour réduire un peu l’isolement des participants du club, et la radio du secteur Radio Interval continuait d’enregistrer et diffuser.
Nous avons donc proposé un temps de lien chaque vendredi, avec les patients confinés, les collègues confinés et Radio Interval à écouter sur Soundcloud.
Patients et professionnels en confinement chez eux nous appellent, nous donnent et prennent des nouvelles. Des chansons sont créées, des projets se forment et croisent d’autres ateliers. Surprise, ce jour où un patient se joint à nous depuis sa « chambre fermée » à quelques mètres de là, à la réunion Zoom avec l’équipe de Radio Interval !
D’autre part, ce temps a aussi permis de recevoir des textes et des œuvres d’artistes en lien avec nous, et de les exposer dans le pavillon.
Sandrine a régulièrement participé à distance à ces Nouvelles des confinés, mettant en musique des textes écrits à l’hôpital ou nous proposant des textes, dont nous cherchions la musique avant de l’appeler pour la lui chanter.
À ce dispositif s’ajoute celui de Sybil, art-thérapeute, et notamment ses « Plateaux Créa » livrés en chambre, pour réduire un peu l’isolement culturel des patients en quatorzaine. Ou encore sa proposition de fabrication et d’écriture de cartes postales, que nous pouvions ensuite lire aux Nouvelles des confinés.
Ici s’esquisse un dispositif culturel à part entière réellement, d’ouverture et de circulation, au sein même du pavillon hospitalier. L’art est au centre de ces échanges.
Sérénité inattendue
Beaucoup se sont étonnés de l’apaisement progressif du pavillon durant toute cette période.
Il est vrai que les travaux de Paumelle ne sont malheureusement pas dans toutes les mémoires.
Cela montre peut-être qu’il est important de pouvoir réinventer et redécouvrir, plutôt que d’essayer d’appliquer une méthode.
Avant, l’équipe d’infirmiers et d’aides-soignants était très souvent accaparée par un ou deux patients très « aigus », maniaques par exemple, au détriment du temps restant disponible pour tous les autres et du travail institutionnel. En revanche, depuis le confinement le pavillon est devenu tellement calme et même serein que la nature du travail a changé.
Tandis que les quatorzaines et les mesures sanitaires étaient très chronophages, l’apaisement du pavillon a en revanche libéré du temps, et ce malgré l’effectif minimum.
Mais il semble que cette diminution du recours à l’isolement ait été une tendance sur tout notre hôpital, et pour tous les autres secteurs. On ne peut donc invoquer uniquement la bonne ambiance et ses effets de contenance psychique, même s’ils sont indéniables. Quelque chose de la sidération face à l’événement collectif du confinement expliquerait aussi le changement d’expression des symptômes.
Le sentiment de s’accrocher les uns aux autres, de faire face ensemble à un événement extérieur, explique sans doute aussi cet apaisement.
Néanmoins, pendant toute cette période les patients ont été assignés à résidence dans le pavillon et dépendaient de nous pour aller faire un tour. On aurait pu s’attendre à plus d’explosions de colère, de frustration, d’incompréhension. Il n’en a pas été ainsi.
D’autre part, ce confinement a aussi eu pour conséquences une diminution de l’errance, et donc une diminution de la malnutrition, de l’alcoolisation massive qui en sont les corollaires, une diminution également des circulations massives de drogues, une diminution des moyens d’échapper aux soins et aux soignants (d’échapper à soi). Avec dans le même temps une proposition thérapeutique sans doute plus dense qu’à l’accoutumée.
Cela a créé des obligations réciproques importantes qui sont à mon avis le ressort essentiel de l’amélioration de l’ambiance, des outils thérapeutiques et du quotidien, et donc de la sérénité du pavillon.
Cela doit nous conduire à réfléchir à la manière de poursuivre, sinon un certain confinement thérapeutique, en tout cas une offre suffisamment forte pour ne plus abandonner les patients à cette errance.
Pouvoirs
L’agencement habituel a été bougé. La chaîne de commandement et de responsabilité a vacillé. Et la répartition des contraintes et des jouissances ordinaires des « rôles-statuts-fonctions » (Oury, 2013) s’est modifiée. Ce qui explique les nombreuses réactions de colère, d’agacement, de passion, de faux pas qui ont émaillé cette période.
Soudain, face aux acteurs désignés du pouvoir, aux prises avec l’angoisse que ne leur échappe en partie l’organisation concrète du service, est apparu un autre type de pouvoir, du côté de l’acte lorsqu’il s’impose et fait consensus par la légitimité immédiate de sa réponse à des besoins culturels (et) vitaux.
Les meilleures réactions ont été du côté d’un certain lâcher-prise judicieux, permettant aux intéressés de se concentrer sur d’autres urgences.
Il avait déjà fallu une volonté politique pour que se forme lentement pendant plusieurs années cette sous-jacence dont nous parlions plus haut. Pour que ces outils puissent prendre toute leur place aujourd’hui. C’est donc bien sur des décisions passées et du travail légitimé dans le temps, par tous, que les trouvailles récentes ont pu apparaître aussi bienvenues et justifiées.
Grande précarité que la nôtre : une grande partie du dispositif que nous venons de décrire n’existerait tout simplement pas sans un chef déterminé à faire exister des ateliers d’artistes et un club thérapeutique dans un lieu d’aliénation sociale maximale et de privation de libertés. Et qui plus est dans un contexte politique ou ces pratiques ne sont pas encouragées.
C’est incontestablement un geste politique fort que d’avoir soutenu l’existence de lieux de culture ouverts, au sein même de lieux d’enfermeture.
À moins que tout ce que nous réussissons à mettre en œuvre ne soit déjà-là, en puissance, et toujours prêt à surgir. Et que cette oscillation entre une pratique et une autre ne soit qu’une séquence autour d’un front de lutte, de résistances (au sens guerrier comme psychanalytique). Dans ce cas, cette précarité ne serait qu’un trompe-l’œil.
Avec le confinement, beaucoup de changements nous ont été comme prescrits par un élément de réalité incontournable.
Il y a peu, l’encadrement nous disait :
« On ne peut pas demander ça aux gens », « C’est seulement sur la base du volontariat », « On ne peut pas le rendre obligatoire ».
Mais les changements soudains permis par le confinement font la preuve qu’il n’y a qu’à s’abstenir d’empêcher les gens de créer leurs outils pour qu’ils s’émancipent de certains carcans culturels et inventent une clinique beaucoup plus riche, car beaucoup plus nourrie par le désir. Certes, tous ne sont pas intéressés. Mais cela n’empêche pas d’organiser les conditions pérennes de ces outils. Le non-alignement exige de l’énergie et des positions fortes.
Le Coronavirus l’a fait ! Ou plutôt, nous l’avons fait. Contraints par un événement extérieur qui ne possède aucune intentionnalité ni subjectivité, et à quoi on aurait sans doute tort d’en prêter : un virus.
Si nous avons pu le faire, tous les uns et les autres, c’est qu’une sous-jacence était là, au travail depuis longtemps, un entraînement, un « athlétisme affectif » (Artaud) à l’œuvre pour que nous ayons basculé du côté intéressant de l’expérience.
Le virus n’a été qu’un accélérateur, un catalyseur d’une dynamique qui était vraiment en train de prendre.
Qu’il ait fallu une contrainte extraordinaire s’appliquant à tous, peut-être encore davantage aux professionnels qu’aux patients, pour enfin organiser une journée hospitalière digne de ce nom, cela fait un drôle d’effet !
À l’heure où j’écris ces lignes un seul patient a été malade du Covid-19 dans notre pavillon hospitalier Héloïse. Et nous avons réussi à maintenir une vie et une ambiance thérapeutique plus intenses qu’à l’accoutumée.
Quoi qu’il advienne, c’est incontestablement une fierté et une source d’espoir pour chacun d’y avoir participé.