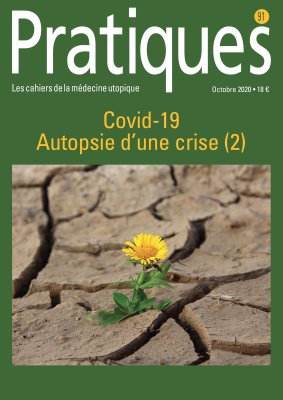Entretien avec Rony Brauman est médecin, D.U. de médecine tropicale et d’épidémiologie. Président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994.
Il est l’auteur de plusieurs livres et d’articles, portant principalement sur les questions politiques et éthiques soulevées par l’action humanitaire.
C’est en mêlant le politique, le géopolitique et ma vocation pour une médecine sociale que j’ai évolué sans feuille de route initiale. Je me suis glissé dans les évènements tels qu’ils se présentaient.
Rony Brauman : J’ai toujours voulu être médecin. Peut-être pour le caractère prestigieux, presque thaumaturge du médecin, l’idée de percer les secrets concernant la vie, la souffrance, la mort. Plusieurs hospitalisations dans l’enfance m’ont confirmé dans cet attrait pour la médecine.
J’ai connu le militantisme politique, adolescent, au moment de la guerre du Viêt-Nam, qui s’est amplifié en 1968 quand j’ai rejoint les « maos spontex » pour quelques années d’activisme ardent.
Je suis entré à la fac de médecine en 1967.
Quand il s’est agi de choisir le type de médecine que j’allais exercer, j’étais axé sur la médecine sociale, les bidonvilles, les populations marginalisées, les prisons, mais aussi la santé publique. Ce fut finalement Médecins sans frontières (MSF).
Ce type de pratique médicale dans des régions où, pour des raisons diverses, l’histoire s’accélérait, me permettait de m’investir non pas en militant politique, ni en voyageur passif, mais en acteur social utilisant mon savoir médical pour me rendre utile. MSF, que je regardais auparavant avec le plus grand dédain, m’attirait beaucoup à ce moment-là (en 1975), mais ma candidature ne les intéressait pas.
MSF, alors une toute petite association sans moyens, était de plus en butte à une forte hostilité à l’époque. L’idée que le soin médical avait sa place dans l’aide internationale était assez mal vue parce qu’elle était considérée comme relevant d’une mentalité coloniale ou missionnaire. Le monde de l’aide était dominé par l’idée positiviste selon laquelle une meilleure connaissance des fonctionnements sociaux, depuis la protection du puits contre les maladies de l’eau jusqu’à la vaccination, en passant par une bonne alimentation, une vie correcte, saine, un bon logement etc., allait permettre de venir à bout des pathologies infectieuses et parasitaires qui pesaient sur ces sociétés… Comme si le soin était superflu, la solution à ces problèmes-là étant le développement, et qu’on pouvait le décréter ou le susciter de manière volontariste. Dans ce contexte, une organisation se proposant de faire de la médecine était une intruse.
À la fin de mes études, retoqué par MSF, j’ai eu néanmoins la chance d’effectuer un remplacement dans un hôpital de mission catholique au Bénin. Ce fut une expérience fondatrice et j’ai adoré ce que j’y faisais. J’étais le seul médecin d’un petit hôpital de brousse, avec une équipe en partie française, en partie béninoise disposant d’un petit bloc chirurgical, d’un labo, d’une hospitalisation de soixante lits et d’un dispensaire… un hôpital de missionnaires catholiques qui faisaient du travail social sans chercher à convertir. Ils étaient vraiment très impressionnants, je me suis très bien entendu avec eux.
Ensuite, j’ai travaillé à Djibouti, je me suis formé en épidémiologie, j’ai été médecin sur des navires marchands, effectué quelques remplacements en médecine générale jusqu’à répondre à une annonce de MSF début 1978. Ça a été le tournant. J’ai effectué des missions d’abord en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie. Puis en Afrique (Tchad, Ouganda, Somalie notamment).
La fin des années 1970 a été un moment de bouleversement dans le tiers-monde, avec une série de conflits entraînant des fuites importantes de population dont une grande partie était regroupée dans des camps de réfugiés : en Asie du Sud-Est, avec l’arrivée de régimes communistes en Indochine. En Asie centrale, suite à l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée rouge qui provoque la fuite de plusieurs millions de personnes vers le Pakistan et l’Iran. Même phénomène en Afrique australe avec les indépendances du Zimbabwe, du Mozambique et de l’Angola et en Afrique de l’Est, avec les guerres d’Ogaden et d’Erythrée, à l’origine de camps de réfugiés immenses en Somalie et au Soudan. Enfin en Amérique centrale, la montée des guérillas entraîne également la formation de camps de réfugiés. On a cinq zones dans le monde dans lesquelles, en l’espace de quelques années, un nouveau territoire s’ouvre qui est celui des camps de réfugiés et des zones de guérilla.
C’est le moment où les équipes comme MSF sont devenues centrales dans les opérations d’aide internationale, alors qu’elles étaient jusqu’alors marginales.
Ayant déjà plusieurs années d’expérience de terrain, je me suis retrouvé propulsé dans la micro hiérarchie de MSF. Et là, notamment avec Claude Malhuret, Xavier Emmanuelli et Francis Charhon, présidents successifs du conseil d’administration entre 1977 et 1982, on a fait le choix de regrouper les quelques forces dont nous disposions (local, fichier, petit budget, notoriété) pour construire un savoir-faire, une expérience dans les mouvements de populations, les grands déplacements, les camps de réfugiés et les zones de guerre. On a commencé à travailler au Tchad chez Hissène Habré, en Angola dans les maquis de l’Unita, en Erythrée dans les maquis du front de libération, en Afghanistan avec les moudjahidines de l’époque, etc. Les camps de réfugiés et guérillas sont devenus notre terrain d’action principal et je m’y sentais bien. On se rendait utiles à des populations qui en avaient cruellement besoin du fait qu’elles étaient déracinées, plongées dans des situations critiques, coupées de leurs ressources habituelles. Et on était plongés dans le tumulte du monde, ses transformations politiques, ce qui me comblait tout autant. Le travail, souvent clandestin, avec des mouvements de guérilla me permettait des rencontres et des échanges qui me passionnaient.
En 1982, je suis devenu président de MSF et me suis impliqué avec notre petite équipe de l’époque dans la poursuite du développement de nos capacités opérationnelles, mais aussi d’une réflexion sur nos rapports avec le politique et la violence, au fil des expériences de terrain et de questions qu’elles posaient. Dans ce monde marqué par la guerre froide, MSF s’est clairement positionné dans le camp « antitotalitaire ».
Je trouvais dans la médecine humanitaire, dans la médecine de crise, tous les ingrédients qui me convenaient, même si à l’époque j’étais plutôt enclin à penser que les États, les organisations internationales finiraient par reprendre cela en charge. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé, bien au contraire. Le mouvement humanitaire n’a cessé de se développer, popularisant le terme organisation non gouvernementale (ONG) qui date de 1945. MSF et les organisations humanitaires, notamment en France, se sont multipliées, ont développé des moyens, engagé des volontaires, des nouveaux savoirs, des financements etc. C’est devenu une activité professionnelle en soi, ce qui n’était pas le cas en France, à l’exception de la Croix -Rouge. Dans le monde anglo-saxon, en revanche, existaient déjà de grands organismes d’aide datant des deux guerres mondiales.
J’ai été président de MSF jusqu’en 1994.
Pratiques : A quel moment as-tu participé au film Un spécialiste ?
C’est un cousin israélien récemment installé en France qui m’a proposé de faire un film avec des images du procès Eichmann. Il me l’avait proposé parce qu’il savait que Arendt et le procès Eichmann avaient joué un rôle important pour moi dans l’élucidation et la mise en forme de certains dilemmes qu’on rencontrait dans le cadre de MSF sur le terrain. La question des compromis avec le pouvoir, de la responsabilité qu’on nouait en devenant les exécuteurs d’une tâche que l’on n’approuvait pas forcément au motif qu’on voulait se tenir au côté des victimes ou alléger leur sort, la politique du moindre mal, bref, toutes ces questions qu’Arendt traite dans Eichmann à Jérusalem. Cela m’a occupé pendant cinq ans, jusqu’en 1999. Ce film s’appelle : Un spécialiste. Portrait d’un criminel moderne.
À la même époque, j’ai commencé à écrire, comme pour mettre mes idées en ordre et réfléchir sur les questions humanitaro-politiques. L’université commençant à s’intéresser au phénomène humanitaire, j’ai commencé à enseigner à Sciences Po. Par ailleurs, MSF m’a demandé de rester pour participer à la réflexion critique, à des formations, afin d’aider au positionnement public et opérationnel. J’y suis toujours, dans le cadre d’une structure qui existe depuis une vingtaine d’années, qui reste petite (nous sommes six). Il s’agit du CRASH, Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires, qui est un petit département de MSF voué à prodiguer conseils, analyses, aide à la décision. Chacun d’entre nous a une expérience pratique de terrain, de la conduite d’opérations et un intérêt pour le raisonnement sociologique ou anthropologique, pour le regard décalé que permettent les sciences sociales en général. C’est le mariage des deux, pratique et théorie, qui fait le sel de ce petit groupe. Nous sommes essentiellement des formateurs et des conseillers de MSF.
Tu n’as pas parlé des films que vous aviez faits avec Eyal Sivan sur la médecine en 1999.
Je n’en ai pas parlé parce que, malheureusement, ils sont introuvables. C’était une série d’émissions pour Arte qui s’appelait Scalpel, qui avait l’originalité de s’interroger sur les pratiques médicales, les pratiques sanitaires, là où en général on fait plutôt de la promotion. Mais la médecine, comme sujet de réflexion, n’avait aucune place à la télé, et d’ailleurs elle n’en a toujours pas, à quelques exceptions près. J’ai pu constater à quel point à la télé on est allergique à cette démarche-là. Notre productrice à Arte nous a beaucoup défendus, contre la volonté de presque tout le monde. Son influence de productrice expérimentée lui a permis de vaincre les résistances, mais, par contre, la suite n’a pas été du tout au rendez-vous. En fait les films de cette série (12 fois 52 minutes) ont été diffusés à 14 heures, des jours flottants, sur un canal hertzien quasi inconnu du public… un véritable sabotage, conscient ou non. Chaque épisode comprenait un petit sketch de fiction, un reportage documentaire avec un journaliste sur un sujet donné : le lobbying des labos, les alicaments ou la définition de la santé par les médecins... Ensuite, il y avait un débat contradictoire que j’animais avec une personne qui venait soit prolonger, soit contredire selon la nature plus ou moins polémique du thème. C’était une formule originale, soutenue par une réflexion, une philosophie critique de la médecine inspirée notamment de Canguilhem, Illitch, Foucault (pour ce que j’en comprenais !). Mais la médecine est encore une vache sacrée, on ne touche pas au fondement du discours médical. Je précise qu’il ne s’agissait pas d’anti-médecine – comme il y a eu une antipsychiatrie – mais une réflexion sur les limites et les prétentions scientistes de la médecine. De la même façon que je pouvais le faire pour l’humanitaire, sans pour autant jeter l’humanitaire à la poubelle, mais en critiquant un certain type de discours de toute puissance morale, de bon berger qui conduit ses ouailles. Il y a un côté pastoral dans l’humanitaire que je déteste, et qu’on retrouve dans la médecine.
On est au cœur du pouvoir médical.
Par exemple la décision sur le corps. Qui décide ? Au Bénin, dans ma toute première mission, je remplaçais un médecin-chirurgien. Heureusement, j’avais fini mes études avec une petite expérience de chirurgie générale. Et le premier patient chirurgical qui m’est arrivé avait une péritonite aiguë, donc a priori une urgence indiscutable, que j’ai voulu immédiatement passer au bloc. Mais, me dit-on, vous n’avez pas le droit de toucher à cette personne sans l’accord de la famille. Je dis : « Bon très bien, et l’accord de la famille il arrive quand ? » On me répond : « Il arrive quand il arrive. Il faut retourner au village et revenir, ça dépend de l’occasion qui se présente. » Une occasion c’est la voiture, le taxi-brousse, le camion qui va pouvoir vous emmener jusqu’à là-bas ; donc c’était entre trois jours et une semaine. Voilà le premier conflit sur lequel j’ai reculé malgré toute la fougue de mes 27 ans. Je m’indignais de ce que la vie ou la mort d’un patient dépende d’une décision non informée, lointaine, tardive alors que c’était pour moi la vie, la guérison qui devaient prévaloir. J’étais enfermé dans le fantasme qui m’avait conduit vers la médecine et qui était mis en échec par la pression sociale. Mais il était clair que si j’opérais, je mettais ma vie en danger, on me l’a fait clairement comprendre. J’ai donc attendu et procédé autrement. J’ai appliqué des glaçons, mis en route une antibiothérapie et une hydratation, et surveillé. Ça s’est très bien passé. Donc j’ai pu vérifier que la laparotomie d’urgence n’était pas l’unique réponse à la péritonite …. Mais surtout je me suis fait à l’idée que, bien que médecin, je n’étais pas le propriétaire du corps du patient. Si ce n’est pas moi, est-ce le patient lui-même ? Sans doute, mais quand il est inconscient ? Son entourage. Lequel, d’ailleurs, peut avoir son mot à dire également lorsque le patient est conscient. Cette interrogation sur le corps du patient reste actuelle, ses soubassements n’ont pas changé.
À bien y regarder, quelle que soit la société considérée, il y a plusieurs copropriétaires légitimes du corps : la société, le patient, l’entourage immédiat. À des degrés certes variables selon les époques et les lieux, on retrouve toujours cette distribution.
Tout le monde n’a pas le droit de vendre ses organes, on n’a pas le droit d’avorter au-delà d’une certaine limite et dans certains endroits, on n’a pas le droit d’avorter du tout. La loi régit une partie des corps, et la société se déclare légitimement capable de décider de ce qui est licite ou pas dans l’emploi de son corps… Donc, il y a différentes modalités selon lesquelles la société prend explicitement et visiblement possession du corps. Par ailleurs, on appartient plus ou moins fortement à son entourage selon le type d’organisation sociale, l’imaginaire collectif dans lequel on se trouve. La propriété individuelle du corps est plus ou moins développée, mais elle n’est jamais totalement nulle. Il y a donc un curseur qui se déplace entre une propriété individuelle et une propriété collective du corps.
Cela m’a servi de leçon et, quand j’interviens dans nos cycles de formation, où évidemment on parle d’éthique médicale, je commence par cette interrogation sur la propriété du corps.
La tentation du médecin, au-delà de son rôle de thérapeute individuel, est de prescrire des comportements avec la même légitimité que lorsqu’il prescrit des vaccins. Je ne me reconnais pas dans ce paternalisme…
Comment enseigne-t-on l’éthique en médecine ?
À l’occasion d’interventions dans des facultés de médecine, j’ai pu constater qu’elle est enseignée comme une sorte de déontologie balayant un peu plus large, un peu plus en profondeur, mais qui reste un code, un ensemble de prescriptions : il y a ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ne doit pas se faire. Je pense qu’Il y a des rappels très utiles dans cette codification, mais toute seule, sèchement, elle est très insuffisante. Il me semble que ce qu’il faut voir et qui éclaire la chose, c’est la compétition entre des valeurs concurrentes. L’éthique ce n’est pas le bien contre le mal, c’est plusieurs biens qui rentrent en conflit les uns avec les autres, et il faut déjà les situer dans les cadres de justification respectifs pour réfléchir à ce qu’ils contiennent et finalement trancher.
Que t’inspire la Covid ?
Ce qui la singularise en premier lieu, c’est le fait d’être une crise synchrone à l’échelle mondiale, présente dans tous les esprits où que l’on se trouve. C’est cela qui est inédit, et non sa contagiosité ou sa létalité qui, au demeurant, nourrissent le sentiment le plus répandu dans le monde : la peur de la maladie. C’est d’ailleurs pour moi, je le signale au passage, l’une des recettes du succès de MSF : nous apportons une réponse, certes très fragmentaire, très marginale, au besoin d’avoir un recours quand on tombe malade. La définition très canguihlemienne de la santé, ce n’est pas l’absence de maladie, c’est la conscience de pouvoir tomber malade et l’assurance de pouvoir s’en relever. Je reviens à la Covid : la pandémie vient à la rencontre d’un sentiment plus ou moins flottant, plus ou moins aigu de peur. Elle le cristallise. Et pour un certain nombre de sociétés, dont la nôtre, cette peur vient s’ajouter à d’autres nées de l’incertitude écologique et économique, et elle prend une intensité très forte.
Je suis frappé également par la virulence des controverses publiques. Le seul précédent à de telles empoignades sur fond de science en mouvement est le changement climatique, mais elles ont dans ce cas un caractère progressif, étiré dans le temps, qui contraste avec l’omniprésence et la violence des débats entre pairs scientifiques, avec prises de positions d’intellectuels, de célébrités, d’élus, parfois délirantes.
Ces controverses sont bien sûr en elles-mêmes inséparables du savoir scientifique, puisqu’il s’agit toujours de confrontations de savoirs existants, de mises en cause, de dépassements, de changements de paradigmes ou d’innovations. De plus, ce qui caractérise la controverse, c’est qu’avant de pouvoir déboucher éventuellement sur un nouveau consensus, elle passe par une phase de désordre total. Je suis un amateur de séries, notamment policières, et j’ai été frappé par le parallèle du déroulement de l’épidémie avec ces séries où l’on retrouve sous des formes diverses une succession de faux coupables, de faux suspects, de fausses preuves, toujours remises en question par de nouveaux coupables.
Voilà, pour moi la Covid évoque une enquête policière haletante. Ce qui en fait le sel, c’est que l’on rebondit de vérité en vérité, de coupable en coupable avec ses flics, ses justiciers, ses héros. Pour quiconque s’intéresse à l’histoire des sciences, c’est une scène fascinante. Pour autant, il ne s’agit pas d’un spectacle plaisant, et c’est d’abord la détresse, l’angoisse dans laquelle sont plongés tant de gens que j’ai en tête.
Ce qui est évident pour tous les gens qui s’intéressent aux épidémies, c’est le fait que nous sommes entrés depuis maintenant 20 ou 30 ans, voire 40 ans si on met le Sida comme porte d’entrée, dans l’ère des épidémies virales.
A l’époque à laquelle nous avons fait nos études, les uns et les autres, puisque nous sommes grosso modo de la même génération, on considérait les maladies infectieuses et tout ce qui tourne autour comme un problème appartenant pratiquement à l’histoire. La vaccination, les antibiotiques, l’hygiène allaient venir à bout de la tuberculose et la variole allait être vaincue, proclamée éradiquée à la fin de la décennie. Ce triomphalisme médical était la marque de l’après-guerre, période d’intenses progrès dans la thérapeutique et s’inscrivait plus largement dans un imaginaire optimiste, tant sur les plans social que scientifique. La confiance dans le progrès n’est plus de mise aujourd’hui pour de bonnes et de mauvaises raisons. En tous cas, avec le Sida et les nombreuses épidémies virales qui se sont succédé et ont pris de l’ampleur, la dengue, le chikungunya, le SARS, le MERS etc., on voit bien que l’on n’en a pas fini avec les germes pathogènes. La mobilité des populations, les transports aériens, la densité démographique, l’urbanisation, la misère sociale, le changement climatique sont autant de facteurs favorables à la circulation des virus et il faut s’y préparer. Mettre en garde contre le scientisme ne veut pas dire mettre en garde contre la science, parce qu’on a grand besoin de la science dans tous ses aspects : les sciences sociales, l’histoire, la géographie, la sociologie, l’anthropologie, la génomique, la virologie, l’épidémiologie… On a besoin des sciences, y compris fondamentales qui, dans l’époque utilitariste libérale que nous vivons, sont largement disqualifiées au profit de savoirs immédiatement disponibles et utilisables dans l’économie, pour les entreprises.
Ce qui nous rappelle que les épidémies, comme le changement climatique dont elles tendent à éclipser la menace, soulèvent le problème de nos modes d’existence, et qu’elles sont des moments de choix politiques essentiels.
Propos recueillis par Françoise Acker et Anne Perraut Soliveres
Principaux ouvrages :
– Guerres humanitaires ? Mensonges et intox, Textuel, 2018.
– La médecine humanitaire, Que Sais-je ?, PUF, 2009.
– Éloge de la désobéissance, avec Eyal Sivan, Le Pommier-poche, 2006.