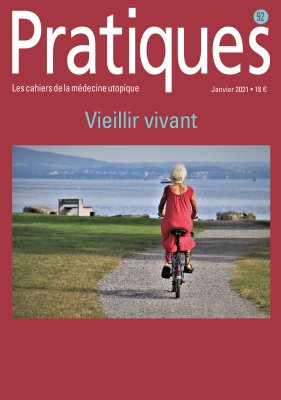Pas besoin d’être médecin pour lire le livre du docteur Didier Ménard paru aux éditions Anne Carrière en octobre 2020. Il s’adresse à tout le monde. C’est l’histoire tendre d’un gosse de banlieue devenu médecin. Mais pas que. Dès le début, on est embarqué sur les traces de la vie d’un homme de condition modeste qui accède à l’exercice de la médecine et qui s’interroge très vite sur la place du soin, de la santé et d’un cabinet au cœur d’une cité déshéritée. Le Franc-Moisin, dans le 9-3 comme ils disent.
Didier Ménard doit choisir entre la passion du sens et la passion de la gestion. La Covid-19 s’invite en toile de fond dans l’histoire pour révéler quelques travers de la gestion. Même si l’idée vient de l’éditeur, elle a le mérite de marquer le récit du sceau de l’actualité. En effet, le coronavirus agit comme un révélateur de notre système de santé et plus largement de notre société. Car c’est bien un virus de classe auquel nous avons à faire. Il démontre que les conditions sociales, psychiques et culturelles renforcent ou affaiblissent selon que l’on est d’un côté ou d’un autre de ce qui définit nos vies dans un système conditionné par la technique, la structure et la gestion. Par les nombres plus que les hommes en somme.
De sa dyslexie et de sa dysorthographie mal vécues dans l’école de la République, le jeune Didier Ménard se tire d’affaire. Puis, il voyage en Afrique. Cela lui servira plus tard pour décoder les plaintes de ses patients maliens, algériens, sénégalais, mauritaniens. Il milite aussi en politique. Il se forge une conscience citoyenne qui le fera œuvrer au service des plus démunis. Entre disséquer des souris et lire Camus, se faufile un destin, une orientation.
Son histoire, ses origines, son parcours, son engagement, ses hésitations, sa critique de la faculté et des stages et puis, la rencontre qui fait tilt. Un médecin qui lui tend la main, lui fait confiance. À l’époque, quand il était étudiant, interne, s’asseoir au chevet du patient et lui parler des choses de la vie semble mal vu. Déjà… Deux syndicats se font face. Le Syndicat de la médecine générale (SMG) et la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). Déjà… Y aurait-il d’un côté la médecine sociale et de l’autre la médecine curative ?
Le SMG, considéré comme non représentatif, est marginalisé par le gouvernement socialiste de l’époque (oui, oui) pour ne pas fâcher le second. Car le premier promeut une médecine générale spécifique, globale et compétente pour qui le médecin évalue le vécu du mal-être dans sa dimension physique, psychique et sociale et propose une démarche diagnostique, thérapeutique et relationnelle dans la continuité de la relation médecin patient. Le second se situe plus dans un système se référant au paiement à l’acte. Plus tu vas vite, plus tu gagnes de l’argent. Le système pousse à la multiplication des consultations et exclut le généraliste du débat public par manque de temps.
Persuadés qu’ils dispensent le bien, les médecins continuent de mener des interrogatoires quand la police, elle, consciente de ce qu’elle fait, édulcore la chose en auditions. Fine remarque, cher docteur !
Dans deux chapitres intitulés : Consultations 1 et 2, l’auteur illustre son propos par des exemples concrets. On y découvre ce que veut dire pour lui « être dans son rôle de médecin ». Des exemples pourraient faire dire à ceux qui prônent le flux tendu du paiement à l’acte qu’il « dépasse les bornes ». De la raison économique instituée ? Peut-être. Mais sûrement pas du souci de l’humain.
Dans le colloque singulier s’expriment les souffrances sociales et parfois « les caïds s’y cachent pour pleurer » précise joliment Didier Ménard. Dans la salle d’attente, on tricote du lien social. Pourtant, en 2008, la loi interdit d’avoir une salle d’attente commune entre différentes professions médicales. En 2009, la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) crée les Agences régionales de santé (ARS) et définit les maisons de santé pluriprofessionnelles.
Pour le militant, il s’agit de s’organiser pour bénéficier des apports d’un collectif, vaincre les solitudes, pour orienter des choix d’actions, d’actes professionnels, éviter le sentiment de doute en solitaire. Didier Ménard s’ingénie à décloisonner tout au long de sa carrière les professions soignantes, le système de santé et le système médico-social et social. Il promeut une médecine avec et non pour les plus vulnérables et les plus invisibles. Un modèle collaboratif pour une santé communautaire.
Présenté par Lionel Leroi-Cagniart
* Didier Ménard, Pour une médecine sociale, Ed. Anne Carrière, octobre 2020