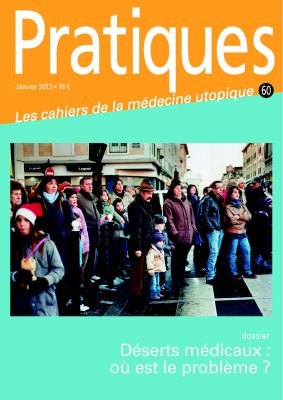Bertrand Riff
Médecin généraliste
Nous vivons dans une société de classes, voire de castes. Chaque classe a sa culture, voire ses cultures (langue, habitus...), il y a la culture de l’oral et celle de l’écrit, la culture du riche et celle du pauvre, la bonne et la mauvaise... La classe ouvrière a disparu, exit le prolétaire et les utopies, il nous reste le précaire et le réel.
Tous les diagnostics de santé sur quelque territoire que ce soit sont formels : en matière de santé, il vaut mieux être riche. Pas un champ où le pauvre fait mieux que le riche, pas un cancer, même pas les cancers de la peau. La santé publique s’est intéressée depuis quelque temps à la santé en Zone Urbaine Sensible (ZUS), tous les diagnostics territoriaux de santé faits en France dans les ZUS, à coût élevé mais par des experts, sont formels, les indicateurs sont mauvais. On ne s’y attendait pas !
La société française ne supporte pas cet état, pour la République, cela fait tache. Elle demande aux experts leur avis en vue de trouver des solutions. Pourquoi le pauvre est-il en mauvaise santé ?
Deux items sont récurrents et répétés en boucle, à tel point que cela en devient suspect :
— Il y a un problème d’accès aux soins.
— Le pauvre consomme de façon inconséquente tout et n’importe quoi, avec un sous-entendu permanent : le pauvre est un primitif qu’il faut éduquer.
Il nous faut réfléchir, démonter, déconstruire comme dirait Derrida
Le pauvre est un primitif qu’il faut éduquer.
Dans « Moulin », quartier en ZUS de Lille où je travaille, le collectif « santé ville » a tous les ans, depuis dix ans, le même constat : l’enfant du pauvre est trop gros, il mange mal, il faut agir : des goûters équilibrés à la cantine pour montrer l’exemple, des leçons éducatives d’achat au supermarché pour les mères, des formations à l’école, des groupes de mamans... Tous les ans, une nouvelle idée, cela fait vivre les intervenants. Et tous les ans le même constat, rien ne change, voire cela s’aggrave. La demande implicite faite au pauvre est : tout en restant pauvre, vous serait-il possible de vous conduire comme des riches, qui eux se conduisent bien, qui eux écoutent la bonne parole des préventologues, qui achètent judicieusement dans les supermarchés... Le pauvre est sommé d’imiter les riches, il le fait avec trente ans de retard, ainsi en 2011, 80 % des cadres et 46 % des ouvrières donnent le sein, mais ces chiffres étaient probablement inverses il y a quarante ans.
Et si le corps du pauvre était un des derniers lieux de résistance à sa disposition face à l’oppression ?
Surmorbidité et consommation
Si le pauvre est plus malade, c’est parce qu’il boit trop, fume trop, bouffe mal ! Le pauvre picole et le riche déguste, c’est bien connu !
Pourtant, des travaux d’Anglais comme de Français nous ont montré que ces surconsommations n’expliquent au mieux que 25 % de la surmortalité. Le reste ? Les Anglais parlent d’assujettissement et de stress, les Français de problématique de liens. On aimerait que la recherche se penche sur les déterminants de santé différemment qu’actuellement. Il faut quitter les déterminants évidents et bien utiles aux classes dominantes, car ils leur épargnent tout sentiment de responsabilité et leur permettent de dire : c’est de leur faute !
A Usinor-Dunkerque, la médecine du travail a fait une recherche sur la consommation de substances au boulot : plus les gens ont un travail où la mort est possible, plus ils arrivent « chargés » au boulot. Cette surconsommation serait une façon qu’a l’humain de s’adapter à l’inhumain.
Le plus sournois pour terminer : si le pauvre consomme plus de médecine, tout ira bien.
Est-ce parce que les riches ont accès à un pédiatre ou un gynécologue en secteur 2 qu’ils vivent vieux ? Est-ce parce que les riches pourraient aller autant de fois qu’ils le désirent rencontrer de la médecine ?
La corrélation entre consommation de soins et santé est loin d’être établie. L’idée qu’il suffirait de donner aux pauvres un accès plus facile aux soins pour relever le niveau de santé est courante ; pourtant, la CMU n’a pas grandement amélioré ce niveau en dix ans d’existence.
A Lille, il semblait important aux élus de trouver les moyens de fournir aux pauvres des quartiers en ZUS des spécialistes d’organes comme des gynécologues, des ophtalmologues, des pédiatres. Parmi les réponses possibles envisagées : permettre à des spécialistes libéraux d’avoir deux cabinets, l’un en secteur 1 dans un local social quelques heures par semaine, l’autre en secteur 2, ou demander au CHU de délocaliser probablement des internes ou chefs de clinique quelque heures par semaine leur permettant ainsi d’apprendre l’ambulatoire. Heureusement aucune des deux n’a été retenue. La seule réponse intelligente collectivement trouvée a été l’ouverture d’une maison de santé par des jeunes de la Maison Dispersée de Santé (MDS) afin de permettre aux populations de ce quartier d’avoir accès à un premier niveau haut de gamme, offrir à l’autre ce que l’on a de mieux.
Changer non pas la quantité, mais la qualité des soins. Faire en sorte que les meilleurs s’installent en ZUS. Offrir un premier recours haut de gamme.
L’Institut National des Études Démographiques avait montré en 80 que la seule façon de faire baisser la surnatalité des pauvres était d’augmenter leur niveau de vie. Des campagnes d’éducation, de planning, de délivrance de pilule... étaient sans effet sur la natalité alors qu’une augmentation du niveau de vie oui.
Et pourtant, la société nous demande à nous, et plus spécialement à nous maisons et pôles de santé pluriprofessionels de premier recours, de faire en sorte que les pauvres, tout en restant pauvres, soient aussi bien portants que les riches. A cette injonction absurde, la médecine est tentée de répondre affirmatif ! Dans les années 50, la médecine ne doutait de rien, à la question du bonheur pour tous, elle a synthétisé ce qui s’est appelé pilule du bonheur : les benzodiazépines, et elle en a déversé des caisses. Ne plus penser, est-ce cela le bonheur ? En 2012, la médecine ne doute toujours de rien et elle est prête à relever le défi. Lorsqu’une société demande des solutions médicales, voire médicamenteuses, à des problématiques socio-économiques, relevant en fait de décisions politiques, les réponses ne sont guère glorieuses ; je crains que dans le champ des différentiels de santé, il n’en soit de même, la différence d’espérance de vie à la naissance entre un cadre et un ouvrier n’a pas baissé depuis vingt-cinq ans et reste de 6,5 ans.
Nous devons tous être d’une grande vigilance et éviter de dire ou de laisser penser aux pauvres que s’ils ont un premier recours de grande qualité : nous, et s’ils font tout ce qu’on leur dit, alors ils vivront aussi vieux que les riches. Le différentiel ne bougera que lorsque les écarts de revenus bougeront.
Il n’est pas simple de renvoyer le politique dans ces réalités, là ou il aurait envie de croire qu’avec un peu de moyens et des professionnels dévoués, le tour serait joué ! De qui sommes-nous les alliés ?
Alors : ne rien faire ?
Certainement pas !
Faire de la médecine, c’est aussi faire de la politique, faire de la politique, c’est ne pas être dupe. Expérimenter
Les maisons, pôles et centres de santé doivent être des lieux permanents d’expérimentation.
— L’écriture d’une rencontre privé-public, dans le champ du financement, dans le champ du territoire, avec l’hôpital. La maladie est privée, la santé est publique.
— Nous sommes tous dépositaires d’une expertise, le patient, sa famille le médecin, l’infirmier, le kinésithérapeute... le soin n’est que la résultante de la confrontation de ces expertises. L’interculturalité procède de cette confrontation.
— Expérimenter des nouvelles formes de soin, les délégations de compétence en sont un exemple.
Redonner de la noblesse à l’autre
L’excellence pour tous nous oblige au singulier pour chacun. Pour cela, quitter dans le soin la notion de précarité, de pauvreté pour celle de vulnérabilité biopsycho-sociale. Nous ne sommes pas sociologues, nous sommes des travailleurs de la santé.
Pouvoir analyser ces vulnérabilités et les restituer au sujet, réfléchir avec lui sur les modalités, les possibilités de les réduire. La première des vulnérabilités est probablement la résignation.
L’intersubjectivité est source de diagnostics territoriaux de santé
Les réflexions constitutives à la création de la MDS avaient conclu à trois axes de travail à partir de notre analyse territoriale de santé issue de milliers de rencontres faites par l’ensemble des professionnels travaillant à la MDS :
— Accompagner le désordre dans les corps comme dans la société.
— Apaiser la souffrance psychique ordinaire.
Dans ce registre, nous avions deux propositions : une pour accompagner les femmes victimes de violences et l’autre pour la violence au travail ; pour ces deux projets, nous avons des propositions individuelles et collectives et nous avons à travailler avec des juristes. Quand le politique fait défaut, la justice peut pallier.
— Être un lieu relié donc reliant, afin de pouvoir relier l’autre, d’abord à lui même puis aux autres et enfin à la société.
L’excellence pour tous nous oblige au singulier pour chacun, être ni libéral ni libertaire, mais libérant, comme le dit Bernard Lubat.
Plus les gens ont un travail où la mort est possible, plus ils arrivent « chargés » au boulot.
* Intervention au colloque des Maisons de Santé des Zones Urbaines Sensibles du 19 octobre 2012 à Lille.