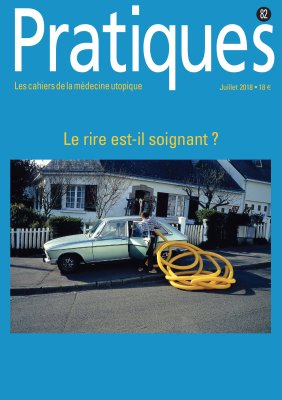Serge Sadois
Dossier médical ambulant
-
-
-
- Chirurgie digestive. En quatorze mois, j’y ai passé quatre semaines en trois séjours différents. À chaque fois, j’ai eu la même chambre, j’aurais pu y laisser mes pantoufles.
-
-
À peine arrivé : diète totale, lavement, rasage intégral pour être le lendemain matin à 10 heures au bloc opératoire.
Dès le départ, soucis chez les anesthésistes, pour poser une perfusion, veines petites, fragiles et fuyantes (Monsieur n’a pas de veine ! – rire jaune de ma part), guère mieux pour l’intubation, dans le nez, la glotte, rien n’est vraiment à la bonne place, autant de déviations qu’un rond-point en réfection.
Vu que le bloc s’impatientait, à peine intubé, pfuittt, salut Morphée, je n’ai pas vu la deuxième porte du sas.
Juste un petit bout avait promis le staff du bloc. Ils en ont enlevé un mètre, pile poil, résection colique et colectomie droite, pour être précis. Je n’ose pas imaginer la taille de la découpe s’ils avaient parlé d’un gros bout.
Effet de l’anesthésie plus longue que prévu, de l’opération ou du lit inconfortable (grand lit médicalisé articulé et petit matelas dans une enveloppe plastique pour l’hygiène font que, quelle que soit la position de départ, la gravité aidant, on se retrouve toujours, le matin, coincé au pied du lit), bref, je ne dormais pas vraiment ni la nuit, ni le jour.
Un ou deux matins plus tard, j’avais une mine cafardeuse pour accueillir l’infirmière et sa stagiaire de l’équipe du matin ; à leur regard, j’ai bien senti qu’elles attendaient mieux. De plus, la perfusion s’était bouchée, la veine avait explosé et mon bras bleuissait. En recherchant une nouvelle veine correcte, première observation : j’aurais dû appeler le service de nuit.
Mais, c’est votre somnifère qui est resté là ? Vous ne l’avez pas pris ? Pourquoi ? Et le niveau de la pompe à morphine n’a pas bougé ? Pourquoi ?
Et voilà que je me retrouve avec les deux qui me sermonnent. Une avait juste 20 ans et l’autre guère plus, cela me rappelait (en double) ma fille engueulant son vieux père.
Comme cela m’amusait quand même un peu, j’ai voulu défendre l’indéfendable, m’expliquer, que je n’avais pas si mal que ça, que des douleurs j’en avais connu d’autres, que le sommeil chimique ne me réussissait pas, que j’étais encore plus abruti qu’au naturel et qu’elles devaient me laisser tranquille parce que, dorénavant, j’étais un homme libre, que je n’avais plus de maître à supporter parce que, maintenant, j’étais… décolonisé !
Dit avec toute l’emphase possible, bien sûr.
Elles se sont regardées, se sont retournées vers moi et ont éclaté de rire.
- — S’il est capable de dire des trucs comme ça, c’est qu’il va bien ! a dit la chef.
Je ne veux surtout pas dire que les infirmières font la gueule et ne sourient pas mais, ce matin-là, ce ne fut pas le sourire habituel.
Ni le lendemain quand elles ont fait grève.
Enfin grève… c’est vite dit, à part la pancarte collée dans le dos avec grève écrit dessus, rien n’était changé, les soins étaient assurés comme d’habitude. Je me suis amusé à les prendre en photo et à les commenter sur les réseaux sociaux. Une partie du service est passée voir. Assurément mon jour de gloire. Je ne passais plus inaperçu dans les couloirs.
Un autre matin, j’ai fait un malaise en essayant de me laver, j’ai demandé de l’aide en actionnant la sonnette des toilettes, cinq personnes sont arrivées presqu’immédiatement, elles m’ont ramassé, remis au lit, fait les soins utiles. Normal. J’allais déjà mieux, je leur ai dit. Dans la chambre la tension retombait, c’est à ce moment-là que la stagiaire a balancé : C’est comme en Afrique, la décolonisation, c’est jamais simple.
Éclat de rire général. Plus aucune tension.
Que le rire soigne, je n’en suis pas certain, mais que ça aide à supporter la maladie, j’en suis vraiment sûr.