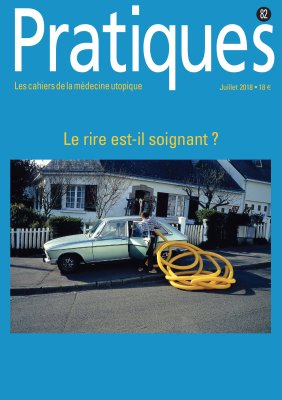Anne Perraut Soliveres
Cadre supérieur infirmier, praticien-chercheure
-
-
-
- Et si l’on riait surtout pour tenir le pire à distance, pour ne pas pleurer, pour survivre à l’injustice, à la peur, pour résister au déterminisme social d’une redoutable efficacité, pour manifester un minimum de liberté face aux mille et un pouvoirs dont nous souffrons d’être les objets maltraités ?
-
-
J’emploierai le « je » pour bien signifier que le rire se joue dans le rapport singulier de chacun à sa culture, au monde qu’il fréquente, même si beaucoup de soignants pourront se reconnaître dans certains faits ou ressentis. Nous n’avons pas tous le même rapport à l’humour ni les mêmes sensibilités face aux situations qui peuvent déclencher le rire. Si certaines circonstances peuvent nous contraindre à sourire malgré notre humeur, nul ne saurait nous obliger à rire. Pour autant, on rit rarement seul et le collectif est un support incontournable tant dans la production du rire que dans son écho. À la sempiternelle question : « Peut-on rire de tout et avec tout le monde », j’avais bien aimé une réponse de Jean-Michel Ribes qui disait que cela dépendait de qui parlait et comment il parlait. Ainsi la réaction ne tiendrait ni au sujet, plus ou moins délicat, ni à une population donnée, plus ou moins sensible à la moquerie, mais à ce que l’on perçoit de l’intention du locuteur. C’était avant que les censeurs de tout poil ne se saisissent du moindre prétexte pour faire taire nos velléités de légèreté. Je ne me souviens pas s’il l’avait ajouté ou si c’est ce que j’ai moi-même interprété, mais il faut y adjoindre la capacité de s’inclure dans ceux de qui on se moque. Pouvoir rire de soi est une sorte de garantie éthique de moindre malveillance, mais peut-être également un rempart à l’humiliation. Si je me fracasse le nez sur une porte vitrée, j’en rirai autant et sans me forcer que si je suis témoin de la même chose, une fois éliminée la surprise et pris en compte les effets plus ou moins traumatiques. J’ai, comme sans doute la plupart d’entre nous, quelques chutes spectaculaires à mon actif qui m’ont fait rire malgré la douleur.
- Désamorcer la colère
Lorsque j’étais enfant, mon frère cadet était extrêmement joueur et provocateur, donc instigateur permanent de farces dont j’étais souvent le sujet mortifié. Cependant, je faisais contre mauvaise fortune bon cœur pour mettre tout en œuvre avec lui pour essayer de faire rire notre mère, afin de désamorcer sa mauvaise humeur face à nos facéties et aux bêtises de notre nombreuse fratrie. C’était souvent hasardeux, mais quelle satisfaction quand ça marchait ! Elle se retenait autant que possible, mais finissait souvent par succomber malgré elle, convaincue qu’elle devait garder son sérieux en même temps que son autorité. J’ai donc compris très tôt la puissance de la dérision face au pouvoir, fût-il maternel. Au cours de ma longue activité syndicale, j’usais abondamment de l’humour pour contrer la grogne des directeurs d’hôpitaux auxquels j’étais régulièrement confrontée, car les exaspérations de mes débuts me menaient invariablement aux excès de langage qui me valurent de nombreux conflits stériles et usants. Je déclenchai même une péricardite de colère face à la mauvaise foi d’un chef de service qui m’avait mise hors de moi… J’ai donc appris à dire les mêmes choses sans m’énerver (enfin un peu moins…), en usant de métaphores humoristiques dans le but de mettre quelques rieurs de mon côté, ce qui a été un progrès manifeste dans mon efficacité syndicale et, sans aucun doute, pour ma santé…
- Conjurer la gêne
L’étudiante infirmière que j’ai été (en pleine période adolescente), bien que plutôt timorée, aimait bien jouer avec la langue si riche et imagée de la médecine, avec ses fausses pudeurs, ses euphémismes, sa morale féodale. Je posais invariablement les questions gênantes auxquelles les enseignants évitaient de répondre. Je me souviens d’un jeune médecin qui nous récitait son cours sur les maladies vénériennes et avait évoqué un chancre de la bouche, ce qui m’avait complètement interloquée. Innocemment, j’avais demandé comment c’était possible… Il s’est contenté de me demander de quitter le cours. Mon insistance avait fait ricaner toute la classe (140 élèves dont une immense majorité de filles), ce qui m’avait finalement permis de supposer quelque chose dont je n’avais pas la moindre expérience ni même l’idée. On nous parlait des maladies vénériennes sans avoir jamais abordé la question de la sexualité, ce qui ne manquait pas de sel eu égard à l’inexpérience de certaines d’entre nous à une époque où toute allusion à la sexualité était encore taboue. Je m’ennuyais ferme dans ces cours magistraux et ne ratais pas une occasion de détourner les textes ou les pratiques pour faire rire mes collègues. Je prolongeais ainsi mon enfance et développais mon appétence pour le théâtre de la vie tout en faisant avec une réalité qui n’était pas avare de surprises. Il faut dire que l’hôpital est un lieu qui peut rapidement vous faire perdre pied si vous n’avez pas la capacité de décoller du premier degré d’observation. En stage, ma timidité m’obligeait à « jouer » un rôle et l’humour me venait souvent en aide pour dépasser mes limites. D’ailleurs, le premier jour à l’Assistance publique de Paris, nous avions eu droit à la distribution de blouses et d’un costume uniforme dessiné par Christian Dior que nous avions l’obligation de porter en ville (petit tailleur, chapeau et manteau d’un bleu qui ne m’allait vraiment pas). Je fus punie de sortie de l’internat pendant plusieurs semaines pour avoir « déshonoré » l’uniforme, surprise dans la rue par une monitrice alors que je portais l’élastique du petit chapeau sous le menton et marchais dans les rues comme une paysanne pour faire rire les copines…
- Le rire salvateur
Ma tendance à la bonne humeur, mon plaisir du pas de côté, de la dérision, le ravissement de partager ces connivences avec ceux de mon entourage me disposaient à saisir toutes les occasions de laisser le sérieux de côté. Pas forcément bon public en général, je me prêtais volontiers aux mises en scène de comédies sans rime ni raison parfois. Je n’ose imaginer où je serais si je n’avais eu cette appétence pour le rire, si je n’avais pu me sauver maintes et maintes fois grâce à ces échappées, si je n’avais, sans rien y comprendre, usé de tous les stratagèmes afin de dédramatiser un quotidien qui m’atteignait de plein fouet. L’émotion toujours à fleur de peau, le tabou absolu des larmes en ces lieux de souffrance et de misère, ne laissait guère d’autre voie aux soignants que de s’échapper dans des facéties de plus ou moins bon goût, mais le plus souvent amicales, même si la moquerie y tenait une certaine place. Bien sûr, cela se passait dans le huis clos des salles de soins, jamais devant les patients et souvent en très petit comité. Mais ça aussi c’était avant un changement radical d’ambiance… Avant que le système hiérarchique ne cherche à éradiquer toute subjectivité des énoncés professionnels, ne traque le moindre faux pas par la mise en place de dispositifs destinés à « optimiser » l’objectivité. La suppression des moindres moments de rassemblement symbolisés par les « transmissions ciblées » était censée permettre de se passer de la rencontre des soignants et d’éviter tout « jugement » en imposant des mots-clés. La censure n’avait pas attendu ce dispositif pour sévir puisque j’avais déjà été convoquée à la fin des années soixante-dix par les médecins chefs du service pour me voir interdire d’émettre mes opinions ou mes états d’âme dans mes transmissions, dans lesquelles j’essayais de mettre un peu de légèreté à l’intention de l’équipe de jour. Quelques jours plus tard, je fus de nouveau convoquée pour me faire sermonner sur ma ponctuation qui, selon eux, en disait tout autant… J’ai alors institué un cahier que je nommai « petit parallèle » pour écrire ce que j’avais envie de communiquer à mes collègues et qui était désormais interdit sur le cahier noir officiel. Pour la petite histoire, beaucoup de soignants et médecins venaient le matin avant de prendre leur service (dont évidemment mes chefs de service…) afin de consulter et commenter ce fameux petit cahier dont le premier exemplaire disparut dès la première semaine, sans que personne ne sache comment… J’en amenai aussitôt un autre qui servit d’exutoire à toutes les équipes du service de réanimation et que tout le monde protégeait. On écrivait davantage la nuit, mais on ne faisait pas qu’y raconter des blagues, on y réfléchissait aussi sur les évènements heureux ou malheureux qui se passaient dans le service, sur les difficultés du métier et aussi sur les petits bonheurs quotidiens avec les patients. Nos états d’âme donc… Ce fut un élément de cohésion inattendu entre les différentes équipes, très consulté (d’aucuns se plaignaient lorsque nous n’écrivions pas…) qui dura une année, jusqu’à mon changement d’affectation.
- La transgression
Toutes les formes de rires ne sont pas bienvenues dans notre société de ressurgissement d’une censure morale qui se tenait tapie dans l’ombre depuis quelques décennies et s’épanouit de nouveau. Si tous les humoristes ne me font pas rire, ils font régulièrement l’objet de plaintes abusives, qu’il s’agisse des blagues jugées sexistes, homophobes, ou de toute autre moquerie tenant au religieux ou aux travers des multiples sociétés qui composent la nôtre. Or, les histoires juives, par exemple, ne sont jamais aussi féroces et drôles que lorsqu’elles sont racontées par les juifs eux-mêmes (Elie Kakou en avait fait sa cible) et si les Français se moquent abondamment des Belges et des Suisses, eux ne se privent pas de se moquer de nous. Ainsi les blagues que nous inspirent les Belges sont appliquées par eux aux Suisses et nos travers y sont judicieusement moqués. Cette sorte de jeu mutuel tend à marquer les distinctions, à affirmer des identités différentes, à nous singulariser pour ne pas être englobés dans un tout du seul fait que nous parlons la même langue.
Rire à l’hôpital peut apparaître incongru, d’autant que les situations des patients prêtent plutôt à la tristesse, voire à la désespérance si l’on reste collé aux faits. Si le langage à forte connotation sexuelle était fréquent lors de nos repas communs dans le service, jamais je n’ai ressenti de malaise ou de gêne ni eu le sentiment que quiconque s’en sentait blessé. J’ai d’ailleurs toujours été étonnée de constater que ce langage n’engageait rien de plus que le plaisir de manier une langue verte, voire grasse en totale connivence avec les autres, ce que je n’ai connu nulle part ailleurs. La réserve générale des infirmières (à quelques exceptions près) tranchait avec les allusions sexuelles qui surgissaient à tout propos, jeux de mots à défaut de réalisation. Nous riions souvent de bon cœur, voire parfois toute la nuit lorsque la fatigue mettait les défenses au plus bas, en essayant de ne pas faire trop de bruit, ce qui n’était pas facile vu la proximité des chambres du service de réanimation et de l’office ou de la salle de soins dans lesquels nous nous tenions entre les soins. Bien sûr, nous étions conscients que cela gênait les patients qui nous demandaient parfois ce qui pouvait nous faire rire ainsi… Une petite anecdote vient toutefois adoucir ma culpabilité : un malade que j’avais reçu en urgence au milieu de la nuit pour une décompensation cardiaque sévère et dont je m’étais beaucoup occupée, me dit le matin : « J’ai bien cru que j’allais mourir, mais le fait de vous entendre rire m‘a rassuré. Je me suis dit : Si j’allais aussi mal, elles ne riraient pas comme ça… ».
Certains médecins, la nuit, se prêtaient volontiers à cette ambiance comme Jean-Pierre, un des chefs de service. Lorsque j’étais infirmière et que nous travaillions ensemble, j’avais coutume, en silence, de lui envoyer une petite giclée d’alcool sur les mains pour lui rappeler de se les laver avant de toucher le patient, ce qui le faisait sourire et s’exécuter… je n’aurais jamais pu lui dire cela autrement. Ensuite, chaque fois qu’il était de garde, il m’appelait pour faire le point (j’étais devenue cadre) et me raconter les petites histoires drôles de son service afin de dédramatiser sa nuit. C’était un réanimateur très expérimenté et réputé en cardiologie et pneumologie, mais il était angoissé par la cancérologie et craignait toujours d’avoir à y intervenir.
Lorsqu’un autre chef de service, qui n’était pas réputé pour son humour, m’appela pour m’annoncer qu’il nous envoyait un malade atteint de priapisme, je prévins l’interne de garde qui se mit aussitôt en quête du traitement approprié et des informations concernant cette pathologie. En fait, ce malade n’existait pas et nous ne le vîmes jamais arriver.
Par contre, nous n’étions pas avares de blagues comme avec un médecin, pas très amical, qui émettait souvent des doutes sur la vigilance des soignants de nuit et que nous avons appelé après avoir collé des yeux ouverts sur nos paupières closes, faisant semblant de dormir.
- Le rire intempestif
Je mettrais à part le fou rire, évidemment intempestif, qui échappe à tout contrôle, voire parfois frôle l’hystérie et qui, une fois enclenché, a toutes les peines du monde à s’arrêter. J’ai quelques souvenirs malheureux de fous rires face aux remontrances de la directrice de mon école ou à quelques enterrements lorsque j’étais adolescente, mais également dans des situations de travail, plus délicates, face à certaines personnes dont le comportement était pour le moins incongru. Lorsque Madame M. est décédée, sa famille est arrivée au grand complet – huit enfants adultes, dont nous connaissions plusieurs qui travaillaient à l’hôpital – et s’est présentée dans le service. Ils marchaient en file indienne et la deuxième éclata en sanglots en arrivant vers moi. La première de la file se retourna et flanqua une gifle retentissante à sa sœur en lui disant : « Tu te tiens », me laissant sans voix, mais je sentis poindre une envie de rire que je refrénai tant bien que mal, demandant à une de mes collègues de les accompagner dans la chambre. Une fois dans la salle de soins, à l’abri des regards, je repris mon calme et pus ressortir pour voir avec eux les modalités de la suite. Nous pratiquions encore la toilette mortuaire et habillions les patients décédés. Je demandai donc à l’une des femmes d’aller chercher des vêtements pour sa maman. Ils habitaient le village voisin, aussi je la vis revenir rapidement avec le nécessaire et nous les fîmes sortir de la chambre pour pratiquer les derniers soins. La patiente était très lourde et nous eûmes besoin du lève-malade pour la soulever. Lorsque nous en fûmes à l’enfilage de la robe, force nous fut de constater qu’il manquait plusieurs tailles pour y insérer la défunte, mais nous nous sentions incapables de sortir pour annoncer à la famille éplorée une chose aussi futile. Nous ne savions comment nous sortir de l’impasse et fîmes le maximum pour mener la tâche à bien. Nous avions réussi à enfiler ses bras mais elle restait coincée dans le lève malade les bras au-dessus de la tête. Il faisait très chaud et nous transpirions abondamment tout en tirant de tous les côtés pour tenter l’impossible. Nous travaillions en silence et évitions de nous regarder, mais un seul regard a suffi à nous précipiter dans un fou rire muet et irrépressible et une culpabilité à la hauteur de la violence de la situation, sachant que toute la famille attendait derrière la porte. Cela nous prit de longues minutes, enfermées dans cette chambre, à suer sang et eau, jusqu’à ce que le tissu se déchire à l’arrière permettant un semblant de mission accomplie… Sortir de la chambre rouges et transpirantes nous paraissait insurmontable et chaque fois que l’une de nous posait la main sur la poignée de la porte, le rire repartait. Nous étions épuisées et honteuses, mais totalement incapables de nous contrôler. Cet épisode m’est resté en travers et m’a beaucoup questionnée, d’autant qu’on ne pouvait en parler qu’entre nous qui l’avions vécu. Il y eut quelques autres situations tout aussi délicates au cours de ma carrière, souvent liées à la mort, qui m’ont éclairée sur la fonction du rire dans ces situations émotionnellement fortes ou face à d’insolubles difficultés. Les situations incongrues ne manquent pas dans un hôpital mais, heureusement, ne donnent pas toutes lieu à ce genre de débordements.
- Juguler la peur
Lorsque je suis devenue infirmière de nuit, j’eus immédiatement conscience de l’énorme responsabilité qui m’incombait sitôt la nuit tombée et les collègues de jour parties. J’avais commencé ma carrière en réanimation chirurgicale où nous étions trois, même si nous assumions chacune la responsabilité de nos quatre patients. Mes collègues de cette époque n’étaient pas des rigolotes… Lorsque j’intégrai un poste en cancérologie dans un hôpital de la banlieue parisienne, je me suis retrouvée seule pour trois étages. Ma solitude n’avait d’égale que celle de mes patients et je riais parfois toute seule, une fois l’angoisse retombée, dans les longs couloirs sinistres devant les bruits multiples qui me paniquaient, comme une fenêtre qui claque, un hurlement dans la nuit ou le frottement de mon pantalon dans le silence du couloir. J’avais toujours l’impression d’être suivie et dès que je m’arrêtais et me retournais, le bruit cessait… Il me fallut un certain temps avant d’identifier la provenance du froutt froutt… Je me suis aperçue que j’étais terrorisée lors de mes déplacements pour les surveillances ou les soins prescrits, alors que lorsque j’étais appelée, je me déplaçais sans crainte du seul fait que j’étais attendue.
Je ne restai qu’un an dans ce service où je me sentais fragilisée, mais avais rapidement traversé le couloir qui séparait mon bâtiment de celui d’en face où plusieurs personnes travaillaient. Je repris un poste en réa plus adapté à mes compétences et où surtout je n’étais plus seule. L’humour m’a alors servi de mode d’accueil des urgences, comme pour conjurer le sort et cela fonctionnait bien la plupart du temps. Évidemment tout dépendait de la situation, mais les équipes du Samu ou les pompiers appréciaient également l’accueil : « C’est sympa de venir nous voir à cette heure tardive, vous vous ennuyiez ? » avec la réponse invariable du patient : « Je m’en serais bien passé » à quoi nous répondions tout aussi invariablement : « Eh bien merci… nous, on est contents de vous voir, on commençait à trouver le temps long… ». Pas de quoi fouetter un chat, mais aussitôt le ton était donné et la charge du patient s’allégeait.
Je n’ai jamais oublié cette nuit où l’on attendait de transférer un patient en hélicoptère qui était en train de rompre sa carotide, ce qui avait mis tout le monde en émoi. Pour avancer les choses, on l’avait préparé sur un brancard dans le couloir près de la sortie pour gagner du temps et je restais près de lui. Son angoisse était au paroxysme lorsqu’une quinte de toux lui fit projeter un caillot volumineux au milieu du couloir. Sans réfléchir, j’émis un petit sifflement et le félicitai de son exploit digne du livre des records, ce qui le fit rire. Il était un peu plus détendu lorsque le Samu est enfin arrivé pour le transfert.
- Rire avec les patients
Les patients ne sont pas en reste et il est très fréquent qu’ils mettent eux-mêmes l’ambiance, comme cette vieille femme à qui l’infirmière demandait si sa perfusion était bien en place : « J’ai l’impression que ça tire », à quoi la dame répondit : « Satyre ? Il y a un satyre ici » ? Puis, l’infirmière lui demandant si elle avait besoin d’autre chose, elle répondit : « Un bisou, c’est ça dont j’ai besoin, un petit bisou ».
Il arrive aussi que l’humour soit involontaire comme lorsque Madame D s’est extubée et que le réanimateur n’arrivait pas à remettre le tube dans sa trachée du fait de l’œdème provoqué par l’arrachement de la sonde. Bien que très suffocante, Madame D plaisantait avec le médecin qui était focalisé sur la nécessité absolue de la ventiler. Alors qu’il s’évertuait à tenter encore et encore l’intubation, la patiente se saisit de ses parties génitales et lui dit d’un air concupiscent : « Ah, vous êtes bien monté docteur », lequel docteur répondit horrifié : « Mais lâchez-moi Madame, voyons, lâchez-moi ». Cette patiente est décédée pendant la réanimation alors que son mari attendait dans le couloir, ce qui donnait à l’événement un air de comédie dramatique. Nous étions toujours profondément affectés par les échecs et nous eûmes beau essayer de le consoler en lui disant qu’il avait au moins apporté un dernier petit plaisir à cette femme, cela ne le fit pas rire du tout…
Le summum pour moi fut atteint par Gérard, un SDF tuberculeux et turbulent, que j’ai rencontré à la faveur d’une bagarre sur fond d’alcool au cours de laquelle il avait traversé une vitre avec son poing pour, disait-il, éviter de taper sur la gueule de son interlocuteur. L’animation était à son comble lorsque je suis arrivée dans le service et nous eûmes toutes les peines du monde à séparer les protagonistes. Tandis que les infirmières ramenaient le calme dans le service, que le garde empêchait l’autre patient de revenir à la charge, j’emmenai Gérard dans la salle de soins pour soigner sa main sanguinolente. Il m’expliqua la situation et me dit gentiment : « Fais gaffe je suis séropo », ce que j’appréciai à sa juste valeur. Je restai longtemps à l’écouter et lui promis d’intervenir afin de lui éviter de se faire renvoyer. Au matin, je fis comme convenu, mais en vain, il fut renvoyé de l’hôpital. Le soir, alors que je prenais mon service, une infirmière d’un autre secteur m’appelle affolée me signalant qu’un homme saoul était dans la chambre d’un de ses patients et qu’elle avait peur. A mon arrivée dans la chambre, suivie de l’interne, je vis Gérard affalé dans le fauteuil qui me reçut avec un grand sourire : « Ah, te voilà » dit-il d’un ton gouailleur et particulièrement appuyé, « j’ t’imagine avec un porte-jarretelles noir ! » ce qui, eu égard à mon âge, ma blouse et ma fonction était particulièrement incongru. L’interne, un grand africain, était plié de rire et j’eus toutes les peines du monde à garder mon sérieux pour leur faire la leçon et mettre en place un plan de sauvegarde pour la nuit. Je fus définitivement associée au porte-jarretelles noir par l’interne qui se marrait chaque fois qu’il me voyait…
- Se dépasser pour apprendre
Les quelques formations que j’ai mises en place au long de ma carrière m’ont amenée à prendre la mesure de l’inertie, voire des blocages insensés qui inhibaient, voire empêchaient toute progression. Nous étions sans cesse confrontés aux difficultés de mobilisation des patients dépendants, ce qui reste le problème majeur des soignants. Les formations n’existaient pas encore, sauf dans une clinique où un kiné particulièrement inventif avait mis cela en place. Je fis donc un stage dans cette clinique et revins dans mon service très enthousiaste et bien décidée à convaincre la direction du bien-fondé de cette démarche, censée diminuer la pénibilité et surtout le fléau des hôpitaux : les lombalgies. Je passe sur les détails de la mise en place et je fus détachée ponctuellement pour développer la formation de l’ensemble des soignants, en commençant par les volontaires. Cette formation permettait de prendre conscience de la nécessité d’entretenir le capital musculaire indispensable à l’exécution des différents gestes, en commençant la journée par une marche rapide dans les bois de l’hôpital et une séance de gymnastique centrée sur les mécanismes de verrouillage du dos avant d’attaquer les apprentissages et la réflexion sur les principes de sécurité et l’organisation du travail. Ma première surprise fut de constater que la plupart des personnes, quels que soient leur âge et leur fonction, n’avaient aucune pratique sportive et ne connaissaient pas grand-chose à leur propre dynamique corporelle, sans compter que certaines femmes, comme Maria, n’avaient même jamais mis un pantalon ni des chaussures de sport et qui, chaque fois qu’elle levait une jambe répétait en riant aux éclats : « Ah si mon mari voyait ça… ». Les premiers rires surgissaient lors des mouvements de gymnastique quand chacun constatait ses propres difficultés à les exécuter et était confronté aux gestes exécutés sur ses collègues qui alternaient dans le lit. Tout était alors énoncé, les problèmes posés par la proximité des corps, les angoisses par rapport à l’hygiène, la pudeur, les émotions contre-productives, et les plaintes des cobayes qui évaluaient la brutalité ou la douceur du geste. Je compris d’emblée que ce rire de détente était plutôt positif en ce qu’assez vite, chaque groupe établissait une solidarité face à l’échec et se marrait franchement chaque fois que ça ne marchait pas comme il se devait. Dès le deuxième jour, ils intervenaient collectivement auprès du collègue en difficulté pendant que je les filmais pour qu’ils puissent se voir agir. Cette formation eut très vite une excellente aura et les candidats se précipitaient pour s’inscrire à ce qu’ils appelaient « le stage de remise en forme ». Le plus étonnant fut lorsque je décidai de les familiariser avec le lève malade qui effrayait la grande majorité des soignants qui refusaient de s’en servir… Après avoir commencé par les installer dedans pour qu’ils prennent conscience de l’effet produit, ce qui n’allait franchement pas de soi, ils effectuaient la manœuvre et je leur donnais des indications ludiques de trajets destinées à leur faire manipuler l’engin dans toutes sortes de difficultés, installation dans les toilettes, les salles de bains et autres manœuvres plus aisées. Il fallait parfois un peu de patience pour convaincre certains de se prêter au jeu (deux personnes ont absolument refusé, au bord de la crise de nerfs…). Outre le plaisir de travailler dans la bonne humeur, la cohésion manifeste qu’amenait cette ambiance dans chaque groupe a permis que s’énoncent force difficultés indicibles ailleurs.
- Entretenir la vigilance
De temps en temps, une vague d’animations surgissait, comme pour rompre la monotonie, mettant en œuvre toute l’inventivité dont certains étaient capables. Il y avait celui qui se déguisait en « tumeur cérébrale », c’est-à-dire avec force bandages sanguinolents, et qui allait s’allonger dans les toilettes, après avoir sonné, pour effrayer sa collègue infirmière alors que nous étions tous planqués pour bénéficier du spectacle, ceux qui allaient sonner dans la chambre d’un mort dans le service de leur collègue, celles qui préparaient des truffes avec des excréments pour les offrir à une cadre odieuse, les batailles de flotte l’été qui inondaient le service et nous obligeaient à finir la nuit en pyjama, les croûtes de fromages malodorants dispersées dans différents tiroirs de l’office, dans l’espace micro du téléphone, derrière les radiateurs, sans compter la main en plastique soigneusement préparée avec de la sauce bolognaise dans un plateau-repas… Sachant que les « victimes » étaient évidemment les plus émotives, celles dont les réactions valaient l’investissement et qui, en fait, se prêtaient volontiers au jeu. Tout cela se déroulait sans que les soins aient à en souffrir, car cette équipe était, par ailleurs, particulièrement attentive à la qualité, celle d’avant la confiscation de ce mot par les comptables…
Ainsi, s’il fallait conclure, ces facéties, pas toujours de bon goût et dont nous n’étions pas très fiers, servaient manifestement d’exutoire quand la coupe était trop pleine et aidaient à la cohésion d’une équipe de nuit marginalisée. Si l’on n’a jamais mesuré son impact, faute de savoir comment et surtout eu égard au tabou dans lequel persiste à se tenir le rire en ces lieux mortifères, on peut sans conteste mesurer à grande échelle les effets de la suppression des espaces qui permettaient ces rencontres ludiques et la disqualification progressive du rire au travail. Ils se révèlent par un désenchantement sans précédent, par le burn-out, les arrêts de travail, les suicides et autres abandons…