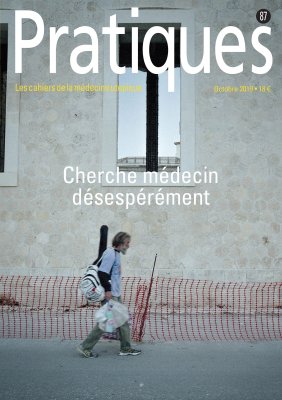Présenté par Martine Devries
Ce livre est dérangeant, il utilise des mots utilisés dans des sens inhabituels « traduction », « captation » « patch »… soit carrément des néologismes, très nombreux, « scalable » et moi, ça m’agace. Aussi parce qu’il mélange les genres et les disciplines : est-ce qu’on a affaire à une biologiste de l’évolution, une économiste, une sociologue, une ethnologue ? Une agronome ? Une photographe, une poète ? Qui emprunte les catégories et les nomenclatures des uns pour les appliquer à un autre, il n’y a aucune hiérarchisation, mais un entremêlement. Qu’est-ce qui est rigoureux, qu’est-ce qui est fantaisiste ? Mais le livre est écrit en chapitres courts, clairs et agréables, les photos d’ethnologue plus que de naturaliste, les dessins stylisés et discrets, et surtout la bienveillance de l’autrice pour ses sujets rendent la lecture finalement attrayante. Ce livre fait réfléchir, bouscule pas mal de catégories et de classifications, et il ouvre des portes ! La préface est d’Isabelle Stengers : « ... Apprendre à raconter des histoires amorales parce qu’à voix multiples, à conséquences en cascades, qui ne respectent pas la différence entre ce qui compte et ce qui peut être négligé, c’est peut-être apprendre à cultiver un savoir crucial s’il s’agit d’apprendre à vivre dans les ruines, là où tout idéalisme, tout attachement à des abstractions justifiant le pouvoir de simplifier, l’économie de l’art d’observer, mènent au désastre… »
Le champignon matsutake s’est développé au Japon au XIXe siècle car l’industrialisation et l’urbanisation du pays ont amené la destruction des zones forestières et la repousse anarchique de pins maritimes. Le champignon se développe en symbiose avec ce dernier. Il s’est mis à devenir rare lorsque les zones de forêt concernées furent exploitées « rationnellement », entraînant la disparition des pins et des champignons. Le champignon matsutake n’est pas seulement un mets recherché au Japon, c’est aussi un cadeau de prestige, une marque de sociabilité, et il est donc l’objet de recherche, de commerce, de don, de spéculation aussi, dans des proportions qui vont au-delà du raisonnable. Comme il est devenu rare au Japon, les cueillettes ailleurs dans l’hémisphère nord se sont multipliées, organisées et le commerce (international) aussi, notamment dans les forêts de l’Oregon, la Laponie, le Yunnan. Du fait de la valeur qu’il a acquise, en dehors même de sa valeur d’usage, l’autrice s’attache à étudier le circuit commercial, sa représentation et les populations qui s’y intéressent. Posant des questions englobées dans le sous-titre : « Survivre dans les ruines du capitalisme », elle se livre à des considérations économiques que je n’ai pas complètement suivies. Par ailleurs, elle est anthropologue, il se trouve qu’en Oregon, les cueilleurs sont des marginaux, souvent immigrés, notamment des populations du Sud-Est asiatique, venues en tribu à la fin de la guerre du Vietnam : Hmongs, et Mien, mais il y a également d’autres marginaux. Elle décrit et analyse leur mode de vie, leurs aspirations parfois contradictoires (liberté, enrichissement) et comment la récolte et le commerce des champignons, bien structurés, remplissent des besoins autres que les besoins économiques : la vie en tribu, l’affirmation de soi, la proximité de la nature.
L’autrice fait également un travail considérable de bibliographie sur la biologie du pin maritime et des matsutakes, et décrit les mesures prises dans des régions très éloignées, pour favoriser, non pas la culture, mais au moins la survenue des champignons, tant celle-ci est aléatoire et imprévisible. C’est aussi ce qui fait l’attrait de la cueillette, je suppose, et l’attrait, paradoxal, du livre.
Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde - Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Éditions La Découverte, 2017.