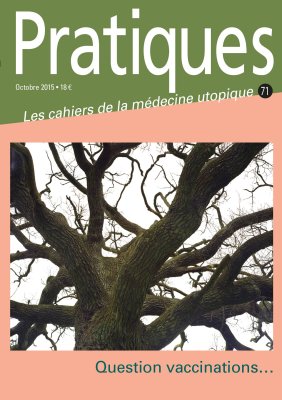Entretien avec Jacques Testart,
Critique de science.
http://jacques.testart.free.fr/
De la production d’excédents de lait à la fécondation in vitro, Jacques Testart partage ses questions sur l’intérêt et les limites de la recherche au service des citoyens.
Pratiques : À partir de votre parcours, quelles sont les pistes que vous privilégiez pour l’avenir ?
Jacques Testart : J’ai une formation d’agronome et biologiste, je ne suis pas médecin. J’ai commencé mon boulot de chercheur à l’INRA (Institut national de recherche agronomique) en 1964 sur un programme de la Commission européenne qui portait sur l’accélération de la sélection des vaches de bonne qualité laitière. J’ai fait ça pendant une dizaine d’années, j’ai eu les premiers succès en 1972 avec des veaux nés après transplantation d’embryons. Un vacher m’amenait la vache, on lavait le cul ensemble et je faisais ça tout seul. À ce moment-là j’ai réalisé que c’était idiot, car il y avait des excédents laitiers et on me demandait d’augmenter la production laitière… Je suis allé voir le Directeur général de l’INRA pour lui dire ce que j’en pensais et j’étais vraiment en colère. Comme j’étais sur le terrain, dans des coopératives d’élevage, j’avais vu des espèces de maquignons, des industriels de l’élevage mais aussi des petits paysans qui ne voyaient pas ça d’un très bon œil… Ce n’était pas vraiment fait pour eux. Le DG de l’INRA m’a engueulé me disant que je n’avais rien compris, qu’il ne s’agissait pas d’augmenter la production, mais la productivité… D’avoir des vaches compétitives… Depuis, ces deux termes de productivité et compétitivité m’ont fait un tilt politique. Dans cette période, j’avais rencontré un médecin, Émile Papiernik, patron du service de gynéco-obstétrique de l’hôpital Béclère, qui était venu faire un DEA (Diplôme d’études approfondies) d’immunologie sur le lapin, ce qui était rare à l’époque. Il était intéressé par ce que j’avais appris sur la reproduction mâle et femelle, et m’a invité à rejoindre un petit groupe qu’il avait créé avec deux chercheurs dans le but d’améliorer la fertilité humaine. J’ai donc quitté l’INRA pour l‘hôpital, ce qui sur le plan statutaire ne changeait rien. J’ai commencé à travailler sur la maturation du follicule et de l’ovule humain en travaillant sur les chutes, je faisais les poubelles… On ne savait rien et je me suis aperçu que les médecins ne savaient rien de la reproduction humaine. Du côté des Cecos (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme), on avait quelques données sur le sperme, mais chez la femme, les médecins ne connaissaient que les pathologies. À tel point que lorsqu’on a commencé la FIV (fécondation in vitro), on s’est aperçu que plein de femmes avaient été hémicastrées parce que les médecins prenaient pour des kystes les follicules pré-ovulatoires et retiraient l’ovaire à la faveur d’une intervention comme l’appendicite. Ils confondaient également le follicule et l’ovule. La FIV a au moins servi à faire comprendre la physiologie de la reproduction, qu’on enseigne désormais aux étudiants en médecine. À noter que les chercheurs compétents en ce domaine, ceux qui furent les pionniers de la FIV humaine, n’étaient jamais médecins, comme Edwards en Angleterre, qui était un biologiste généticien ou Trounson en Australie, qui était vétérinaire, en France il y avait moi. Ce qui est étrange, c’est que les médecins ne cherchaient pas…
Je suis arrivé à Béclère en 77. Lorsqu’on a su qu’Edwards – qui avait fait un certain nombre de tentatives in vitro pendant 13 ans – avait une grossesse en cours, Charles Thibault, mon ex-patron à l’INRA, qui avait pourtant lui même obtenu les premières FIV sur le lapin, était très méfiant. Les médecins eux étaient enthousiastes et m’ont demandé de m’y mettre, surtout Frydman, car Papiernik était plutôt réservé. Moi j’y croyais relativement et ça a pris quatre ans, puis est arrivée Amandine, née en 82 (premier enfant né par FIV en France). Cela a marqué le début de la rupture avec Frydman, car il a tellement tiré la couverture que c’est devenu intolérable. Ensuite, j’ai été contacté par des gens des sciences humaines, domaine que j’ignorais complètement, juristes, psychanalystes etc. Cela a donné lieu à un livre, Le magasin des enfants, ce qui a été pour moi une ouverture extraordinaire sur une réflexion qui venait de l’extérieur et qui n’avait pas lieu sur place… Il y avait un comité d’éthique, qui n’avait aucun moyen, présidé par Jean Bernard, mais cela n’amenait pas de réponse. C’était plutôt de la morale conservatrice. Moi je préférais la réflexion de gens plutôt hostiles à l’industrie de la procréation qui, par leur culture, leur façon de se questionner m’apportaient plein de choses.
Au départ, notre activité était vraiment expérimentale et s’adressait à des femmes stériles. Avec le développement de l’activité privée de Frydman, qui a ajouté à nos divergences, les patientes sont arrivées en masse, dont une partie aurait dû relever d’autres solutions que la FIV. Il est également arrivé des couples dont c’était l’homme qui était hypo fertile. In vitro cela pouvait marcher, mais on n’était pas vraiment outillés pour ça. J’étais assez réticent car parfois, il y avait peu de chances que ça marche, mais on les prenait quand même car il fallait remplir le service et ces gens étaient parfois très généreux avec le « grand docteur »… Moi, je n’avais pas de rapport hiérarchique avec Frydman, on n’était pas de la même administration, j’étais directeur de recherches à l’Inserm et j’avais un autre labo de recherche animale. Il y a eu de nouveaux développements techniques comme la congélation des embryons, on a repris la méthode que Jean-Paul Renard (celui qui réussit plus tard le clonage des bovins), avec qui j’avais un peu travaillé à l’INRA, avait mis au point sur les bovins. On l’a adaptée aux humains et ça a marché. C’est devenu la « French method » utilisée dans le monde entier jusqu’il y a quelques années. C’était une réelle avancée, qui a donné à réfléchir. Que fait-on des embryons si le couple se sépare, ou meurt, combien de temps peut-on les conserver etc. ? Cela a donné du grain à moudre au comité d’éthique. J’étais favorable, mais je m’intéressais à ces questions avec les gens qui réfléchissaient aux limites raisonnables. Je n’avais pas digéré l’emballement médiatique autour de la naissance d’Amandine, on nous avait traités comme des héros, comme si on était allés sur la lune, alors qu’on n’avait fait que reproduire ce qu’avaient fait les Anglais quatre ans auparavant. Frydman se prêtait volontiers à ça, mais moi j’étais gêné, car je venais du monde de la recherche où j’avais des copains qui travaillaient sur des mouches ou des souris et qui faisaient des choses bien plus compliquées, et qu’on ignorait.
Ce qui ressortait de toutes les discussions de l’époque, c’est qu’on avait séparé la sexualité de la procréation, or on connaissait le coït interrompu depuis l’antiquité et un tas d’autres méthodes, ce n’était pas nouveau. Moi, il m’a semblé que ce qui était radicalement nouveau, mais qui n’était dit nulle part, c’est une sorte de pré-naissance d’un enfant, neuf mois avant, car cet œuf conçu dans l’éprouvette était visible et on pouvait agir sur lui avec neuf mois d’avance sur la naissance. Vu le progrès de la génétique, on pouvait identifier parmi les embryons celui qui serait le plus favorable, voire agir dessus pour un projet quelconque du couple et un peu plus tard éventuellement de la société. J’ai donc commencé à m’intéresser à l’eugénisme et à écrire là-dessus, notamment quatre ans après la naissance d’Amandine. En 1986, j’ai publié L’œuf transparent, qui était un peu le récit de cette histoire et qui a connu un grand succès médiatique. Le titre lui-même était un message et ma conclusion était qu’il était impératif de mettre des limites si on ne voulait pas aller directement à l’eugénisme. Là, je me suis fait agresser par les généticiens qui cultivaient des cellules, mais ne voyaient pas plus loin que les chromosomes à l’époque. Ils ne partageaient pas ma méfiance de la technique qui peut être très puissante et qui peut donner des choses admirables, si on se limite à considérer l’aspect technique, mais qui peuvent être désastreuses pour la société.
Dans le monde médical il y avait des gens qui partageaient mon inquiétude ; mais qui ne s’exprimaient pas. Le DPI (Diagnostic pré-implantatoire) n’existait pas encore, mais je savais que des gens travaillaient dessus. Frydman disait que le DPI n’est qu’un DPN (Diagnostic prénatal) précoce, ce qui est absurde.
Dans le reste de la société, les gens exprimaient également une grande inquiétude, mais qui a totalement disparu. En trente ans, j’ai vu l’opinion changer et je me fais interpeller par des gens lors de mes conférences qui ne voient pas où est le problème et réclament le droit de choisir l’enfant à venir.
Il y a souvent confusion entre l’IVG (interruption volontaire de grossesse, précoce), le DPN et l’IMG (interruption médicale de grossesse, tardive). Dans l’IVG, la femme ne veut pas de cet enfant, on n’en connaît pas l’identité. Dans l’IMG, la souffrance peut être importante, alors que dans le DPI, il n’y a que des cellules dans des tubes et rien n’empêche de prendre le meilleur embryon. Pour moi, c’est là que se trouve la barrière, c’est la femme qui doit déterminer la limite et, dans le DPI, il n’y en a pas. Le vrai enjeu n’est pas discuté, c’est pourquoi j’étais opposé au DPI, mais les différents lobbies et le comité d’éthique de l’époque ont pris la décision de l’autoriser. En 1990, j’ai été viré de mon laboratoire de FIV par le Directeur général de l’Inserm, à l’instigation de Frydman, mais je n’étais pas à la rue et, avec d’autres gynécologues, nous avons monté un autre Centre de fivète à l’hôpital américain où nous avons continué à faire naître des bébés. Ma vie de fivétiste s’est arrêtée là.
Pour le volet sociopolitique, j’avais quand même été éveillé par cette histoire de vaches compétitives que j’ai retrouvée avec les lettres de vœux du Directeur général de l’Inserm qui disait : « Je veux des chercheurs compétitifs ». Je n’admettais pas vraiment ce système-là. Et ce qu’est devenue la recherche est dramatique, une compétition économique. Il y a un discours sur la beauté de la science, la collaboration des chercheurs, mais personne ne cherche la collaboration, chacun se bat dans son coin pour être le premier.
J’ai été militant politique à l’extrême gauche, jusqu’en 1976, parce que je suis allé un an aux États-Unis pour expliquer ma technique de transplantation de bovins et que je n’ai pas repris ensuite d’activité politique encartée. Mais j’ai continué à m’intéresser et surtout j’essayais de mêler la critique de la science avec la critique du capitalisme. Ça ne me paraît pas étranger. Donc j’ai développé ces idées-là un peu dans ma tête, puis finalement, en 2002, j’ai créé avec quelques autres l’association Sciences citoyennes qui a pour but de mettre la science en démocratie. C’est très ambitieux. On s’est bagarrés dès le début sur les lanceurs d’alerte, sur l’expertise, des thèmes qui sont devenus aujourd’hui d’une grande banalité, quoique pas résolus encore, mais on en parle même à l’Assemblée nationale. Nous, on continue à travailler là-dessus, mais on n’est plus les seuls. Par exemple, sur l’expertise, on travaille avec Tansparency International. On arrive à avoir des alliés sur « A quoi sert la science et comment les citoyens sont impliqués dedans ». Maintenant, je suis président d’honneur de cette association que j’ai co-créée. On n’est pas en train de révolutionner le monde, mais on arrive à amener des idées qui sont reprises par d’autres et qui font que l’industrie n’a plus les mêmes coudées franches qu’avant. On critique beaucoup le fait que c’est l’industrie qui détermine les programmes dans les laboratoires de recherche publique et quelquefois le pseudo-caritatif, comme le Téléthon. Sur mon site, il y a cinq-six ans, j’ai écrit un article très méchant sur le Téléthon (« Le plus grand cabaret du monde »), je crois qu’il est toujours valable.
Quand j’ai créé mon site Internet en 2007, j’ai mis en tête : Jacques Testart, critique de science, évidemment j’étais déjà critique de la médecine. J’ai toujours été un peu embêté quand mes collègues médecins me disaient : « Tu critiques la médecine parce que tu n’es pas médecin, tu es un frustré ». Or c’est drôle, au moment où j’ai été viré de mon labo de Clamart, on m’avait proposé un autre labo, à l’hôpital Cochin, où j’aurais été nommé prof de médecine. L’idée de devenir prof de médecine sans être médecin, je trouvais ça marrant, mais ça aurait été impossible à vivre car j’en avais vraiment marre de ce monde médical et que j’avais envie de paix. Je suis resté à ma place et je ne le regrette pas.
L’association Sciences citoyennes c’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup. Par exemple sur les lanceurs d’alerte, on travaille avec des gens, des juristes qui ne sont pas chez nous, pour faire ce travail spécialisé. On travaille beaucoup avec Marie-Angèle Hermitte, qui est directrice de recherche au CNRS. On avait proposé une loi pour défendre les lanceurs d’alerte, il y a six-sept ans et finalement les Verts s’en sont emparés quand ils sont arrivés assez puissants au parlement pour proposer leur première loi. Mais étant donné que le PS freinait des quatre fers sous la pression des différents lobbies, le truc a été complètement défiguré. Les lanceurs d’alerte ont été reconnus, mais dans chaque métier, dans l’environnement, dans la médecine. Donc on repart en guerre là-dessus. Sur l’expertise, c’est à peu près pareil : on demandait une Haute autorité de l’expertise et de l’alerte, parce que pour nous, l’expertise et l’alerte, c’est lié. On aurait interdit l’amiante au début du vingtième siècle, comme le demandaient déjà quelques médecins, combien de dizaines de milliers de vies auraient été économisées ! Donc ça vaudrait le coup qu’il y ait une structure qui examine les situations quand une alerte est lancée. D’autre part, on tient à dissocier deux aspects : on doit défendre la personne qui a lancé l’alerte, mais aussi mener l’investigation sur le fond. Et là il faut de l’expertise. Donc les deux aspects sont complètement liés. Or le souci de nos parlementaires, sous des pressions diverses, a toujours été de dissocier non seulement les lanceurs d’alerte par territoire, mais aussi de dissocier l’alerte de l’expertise, de couper ça en tout petits bouts. Alors, il y a cinq ou six lois sur les lanceurs d’alerte complètement inefficaces ! À tel point que des lanceurs d’alerte dont on parle aujourd’hui, aucun ne serait défendu par la loi : ni Frachon (Médiator®), ni Cicolella (éthers de glycols), ni Velo (plantes transgéniques). Ils ne rentrent pas dans le cadre.
On travaille beaucoup là-dessus, mais aussi, de façon carrément plus ambitieuse sur : « Qu’est-ce que c’est que la recherche et qui décide des programmes » ? Moi, c’est un truc qui m’intéresse, parce que cette histoire de vaches, faire une recherche pour que les vaches produisent plus de lait alors qu’il y avait des excédents, ça m’est resté en travers…
Notre combat, c’est d’avoir des moyens pour que la recherche ne soit pas décidée par l’industrie en collusion avec des apparatchiks de la recherche qui ne pensent qu’à agrandir leur territoire, ce qui est le cas aujourd’hui, de façon plus ou moins déguisée.
Et là, on a un outil qu’on a appelé « La convention de citoyens », qui est une rationalisation des conférences de citoyens inventées par le parlement danois en 1990 à peu près, donc ça fait vingt-cinq ans.
Il y a eu des milliers de conférences de citoyens de par le monde aujourd’hui, aux États-Unis, partout, mais chaque fois le protocole est différent. Donc je me suis dit : il y a un truc intéressant là-dedans, dès ma première expérience il y a quinze ans. En 2000, j’ai été nommé Président de la commission française du développement durable par Dominique Voynet, que je ne connaissais pas, qui voulait quelqu’un qui mette un peu les pieds dans le plat.
Dans cette commission, on parlait déjà de dérèglement climatique et on cherchait à y intéresser les citoyens. On avait choisi de faire une conférence de citoyens qui s’appelait « Changement climatique et citoyenneté ». Donc on était déjà dans les thèmes qui sont traités pour la Cop 21. C’était en 2002, et là j’ai été bluffé par les possibilités qu’offrait une conférence de citoyens. Pour moi, c’est un outil absolument fabuleux de rassembler quinze personnes tirées au sort et acceptant de jouer le jeu. Ceux qui ne veulent pas, on ne va pas les obliger, car c’est un gros boulot. Cela provoque une mutation de chaque personne qui devient intelligente, altruiste, c’est extraordinaire. C’est ce que j’ai appelé dans mon dernier bouquin « l’humanitude ». C’est-à-dire, qu’on a à la fois de l’intelligence collective, qui est souvent produite en groupe de travail, de gens très différents, mais en plus on a cette volonté de dépasser chacun son terrain individuel pour aller vers l’intérêt de l’humanité, de la planète, de ceux qui viendront après, c’est-à-dire un truc qu’on ne trouve nulle part, et surtout pas dans le monde politique.
Donc on a fait un projet de loi en 2007 pour des Conventions de citoyens, avec Marie-Angèle Hermitte, qui est un compagnon de route, Dominique Rousseau qui est professeur de droit constitutionnel et Michel Callon, qui est un sociologue de l’École des Mines et qui travaille sur la démocratie participative. Nous avons bossé pendant deux ans à décortiquer ce qui s’était fait dans le monde sous le terme « conférence de citoyens » et en avons tiré ce qui nous paraissait être les bonnes pistes, pour écrire un protocole qui soit fiable, reproductible qu’on a baptisé « convention de citoyens ». Dans la Convention de citoyens (CdC), le terme est neuf, on pouvait y mettre du neuf.
Le commanditaire doit apparaître clairement et être en capacité de prendre en compte les avis délivrés par la Convention de citoyens pour l’établissement des lois ou règlements. Il doit prévoir neuf mois pour finaliser une conférence.
Le sujet de la convention porte sur un sujet d’intérêt général suscitant des controverses. Son thème doit être circonscrit à une ou quelques questions précises.
Le panel de citoyens est constitué par un tirage au sort de 200 personnes environ sur liste électorale. Ce choix initial est suivi de plusieurs correctifs : s’assurer de la disponibilité, de l’indépendance et de l’intérêt des citoyens par rapport au thème, créer une diversité maximale et écarter les personnes impliquées à titre personnel.
Le comité d’organisation crée un comité de pilotage qui doit être indépendant du commanditaire pour assurer l’objectivité. Il doit comporter des spécialistes du débat public et des spécialistes du sujet en discussion. L’ensemble doit représenter une palette de savoirs et de positions variées sur le thème choisi.
Ce comité de pilotage doit établir le programme de formation des citoyens (thèmes, intervenants, cahiers d’acteurs…) par consensus afin que soient exposés/discutés aussi bien les principaux savoirs consensuels que les aspects controversés en éclairant sur les raisons de ces controverses.
On désigne un animateur qui doit être un professionnel de l’animation, n’ayant aucun lien avec le sujet traité, indépendant du commanditaire et de l’éventuel prestataire de services organisant les aspects matériels de la CdC.
La formation se déroule sur une période longue : au moins deux week-ends, séparés par plusieurs semaines, dont le premier est pédagogique (initiation) et le second fait intervenir des experts d’avis variés. Le troisième week-end, consacré au débat public, est élaboré par les citoyens qui doivent choisir eux-mêmes les personnalités et porteurs d’intérêts qu’ils souhaitent interroger. C’est à la suite de cela que les citoyens rédigent leur avis et en font part.
Tout au long du processus une rigueur procédurale doit être respectée : une neutralité absolue de l’animateur ; l’anonymat des citoyens ; éviter absolument tout contact non programmé entre les formateurs et porteurs d’intérêts et le panel de citoyens.
À toutes les étapes, la transparence est requise grâce à la vidéo du processus et à la publication de la procédure ; une évaluation indépendante de l’ensemble doit être réalisée a posteriori. Le public, et particulièrement les citoyens du panel, doivent être avertis de toutes les suites données à l’avis.
Il y a plein de sujets sur lesquels personne n’a la vérité, sur lesquels il y a plein d’incertitudes, or avec la position de citoyens qui sont neutres, bien informés et qui ont du bon sens, dans un collectif, on peut arriver à des solutions qui soient beaucoup plus près de ce qui est le bien commun. Tout le monde parle du bien commun, mais comment on le détermine ? Pour moi ni les experts, ni les politiques ne peuvent déterminer le bien commun. Donc les Conventions de citoyens font un peu un flop dans le milieu politique.
Pour répondre à votre question initiale, mon cheminement m’amène finalement à faire plutôt de la politique, complètement hors parti, et à dépasser les thèmes scientifiques et techniques pour imaginer qu’on pourrait aussi gérer la société autrement.
Propos recueillis par Françoise Acker et Anne Perraut Soliveres
Publications :
– Jacques Testart, L’humanitude au pouvoir - Comment les citoyens peuvent décider du bien commun, Seuil, 2015.
– Jacques Testart, Faire des enfants demain, Seuil, 2014.