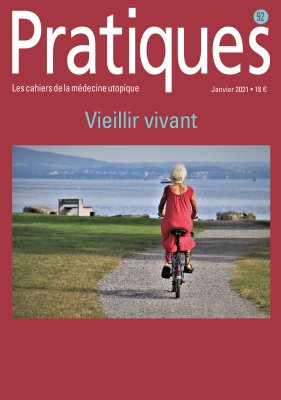Isabelle Canil
Orthophoniste
Le passage de vie à trépas, le dernier souffle, le dernier voyage, le moment où l’âme se rend, celui où l’on en vient à expirer, trépasser, décéder, succomber… ou clamser, claquer, crever… il est inscrit sur un certificat qui fera foi. Moi je n’en ai que faire. C’est long une mort.
Du plus loin que je me souvienne, j’ai entendu ma mère dire qu’elle tirerait sa dernière révérence dès qu’elle deviendrait un fardeau pour elle-même et pour les autres. L’idée de l’incontinence entre autres lui était intolérable, et semblait être la limite à ne pas atteindre.
Et moi, j’y ai toujours cru.
Quand elle en parlait, j’envoyais ça balader de la main, pour signifier qu’elle avait bien le temps, que ce n’était pas le moment… Mais j’y croyais. Comment ferait-elle, je ne voulais pas trop savoir, mais comme elle était diabétique, ça paraissait simple, elle disait souvent : « Une piqûre et hop au crématorium ». Elle en parlait très souvent, alors une fois j’ai demandé : « T’as peur ? Non », m’avait-elle répondu. « Mais c’est juste que je ne vous verrai plus quoi… » Elle avait tout de même pris quelques secondes avant de répondre, peut-être que la question n’était pas si facile.
Je savais quelle robe elle voulait porter, une fois dans la boîte, comme elle l’appelait. Sans manche avec des dessins multicolores genre mexicains, et la petite veste assortie pour cacher les bras. Oui, parce que la peau des bras devient flasque quand on vieillit. Cette robe, elle en avait même fait un tableau, et je regrette bien de ne pas savoir qui l’a acheté.
Ce scénario presque idéal, d’une mort annoncée, arrivant quand on la convoquerait, à point nommé, d’où est-ce que je sortais ça ?
Est-ce que je m’imaginais que la mort se contenterait d’égratigner, quand on la sonnerait à l’heure voulue ?
Pour ce qui est de la vie, j’ai toujours pensé qu’elle charrie un lot de tristesses, plutôt supérieur au lot de bonheurs, et qu’elle écorche plus qu’elle ne panse.
Et la mort alors ? Qu’est-ce que je pensais de la mort et de ce qu’elle trimbale avec elle ? Et d’abord, elle commence quand ?
Des années auparavant, j’avais été bouleversée par le livre de Noëlle Chatelet, La dernière leçon. Elle y raconte le compte à rebours précédant la mort volontaire de sa mère. La vieille dame se trouvait trop fatiguée, vraiment trop fatiguée. Elle voulait décider du moment de sa mort. Hors de question d’atteindre un état où elle ne pourrait peut-être plus rien maîtriser, ni du corps ni de l’esprit. Elle seule serait juge. Et l’auteure, sa fille, s’interroge : « Tout est dans la définition de l’indignité. Où celle-ci commençait-elle ? Selon quels critères ? Jusqu’à quelles limites de l’insupportable ? »
Un peu plus loin, elle essaie de se convaincre : « Qui d’autre que toi pouvait en effet les apprécier, dans leur réalité, les fameuses limites de l’insupportable […] Qui d’autre pouvait s’arroger le droit de contester ou de s’opposer à l’intime conviction de ta dignité ou de ton indignité ? »
Ce livre m’avait profondément marquée, je ne l’ai jamais oublié. Mais il restait un livre, que je pouvais ouvrir et refermer, et il ne parlait pas de ma maman à moi. Qui d’ailleurs était encore bien loin de mourir…
À 75 ans, ma mère fait encore une expo, mais c’est moi qui l’organise, elle ne peut plus s’en occuper. Ce sera la dernière. Mais elle est belle, comme toujours. Ça, c’est à insérer dans mon lot de bonheurs : j’aime beaucoup la peinture de ma mère, et c’est une grande chance, je trouve, parce que je peux être fière d’elle.
Elle vend presque tous les tableaux. Mais elle aura eu du mal à boucler ses toiles. Elle avait peint en soutenant son bras droit de la main gauche. Ma mère tombait souvent et se cassait régulièrement un os ou deux. La dernière fois, c’était le bras et l’épaule de droite et la mobilité n’était jamais bien revenue, il lui fallait accompagner le bras droit avec sa main gauche, même pour porter une fourchette à la bouche. Courageuse ma mère, quand il s’agissait de peindre !
Cette dernière expo marque sans doute une fin de quelque chose d’intensément vivant et de toujours merveilleux pour elle, une fin de créations, une fin des couleurs. Une espèce de mort de quelque chose. Cela s’appelle-t-il un renoncement, quand il n’est jamais accepté ?
Elle se met à bouger et marcher de plus en plus difficilement. Son moral est au plus bas. Elle ne peint plus et ceci explique sans doute cela.
À la place, elle lit. Je lui amène des sacs de livres sur lesquels elle inscrit une croix quand ça lui plaît. Mais pour elle, ça n’a rien à voir avec ses peintures, ses pinceaux… Je lui dis de peindre des aquarelles, ce qu’elle peut faire assise à une table dans la salle à manger, et qui lui demande moins de mouvements que de travailler dans son atelier sur ses grandes toiles, posées sur l’immense chevalet, avec tout l’attirail des couleurs, couteaux, chiffons, etc.
Mais ça ne marche pas… Il lui faut ses tubes tout écrabouillés, son tablier qui se tient tout raide de peinture, sa palette encrassée et sa petite chaise basse devant le chevalet majestueux. Un jour, croyant que ça lui ferait plaisir, je lui commande une aquarelle avec une paire de godasses à talons, que je voulais offrir pour Noël à une amie qui danse le tango. Malheur. Les deux godasses ne sont pas du même bleu, elle s’emmêle dans le dessin des lanières… elle n’y arrive plus.
Cette scène où elle me montre l’aquarelle ratée reste un vrai crève-cœur pour moi. Pour elle aussi évidemment. Mais sur un ton faussement énergique elle me dit : « Je vais la refaire ! » Nous n’en parlons plus jamais, je ne lui demanderai plus jamais de peindre.
Un jour, son compagnon me téléphone pour que je vienne vite (ça arrive de plus en plus). Soudainement, elle ne peut plus du tout se lever, ne parle plus. Elle nous regarde avec un pâle sourire. De temps en temps, elle lève un sourcil comme pour dire : « Je ne sais pas ce qui se passe, veuillez m’excuser… » Le médecin de garde appelle une ambulance, pensant à un AVC. Nous voilà parties à l’hôpital, pour en revenir vers 4 heures du matin : elle n’a qu’une infection urinaire. Mais moi, pendant quatre jours, je crois qu’elle va mourir d’une minute à l’autre entre mes mains, parce qu’elle est… moribonde. Un râle sort de ses lèvres quand j’essaie de la redresser pour la faire manger et, dans les livres, on dit que c’est la fin, le râle… Mais non. Ça repart, en moins bien, car elle ne s’est jamais remise complètement de cet épisode spectaculaire et malheureux.
Et lentement, mais sûrement, son état se dégrade, sans qu’on comprenne trop ce qui se passe.
Il lui reste encore deux ans.
Avant ce moment, je ne savais pas quoi inventer pour lui faire plaisir et la faire aller mieux. Pour l’obliger à aller mieux ! Mais à partir de là, les choses ont changé pour moi, parce que ma maman n’était plus tout à fait ma maman et sans doute ai-je commencé à lâcher quelque chose de mon désir à moi, qui s’entêtait, qui exigeait, qui refusait, qui s’aveuglait…
De temps en temps, elle disait des choses étranges, posait des questions comme pour fixer ses repères. « J’ai bien deux filles hein ? et Nino, c’est le fils de qui ? » Mais c’était juste de temps en temps, me répétais-je.
Quand elle parlait, ce qui arrivait de moins en moins, elle répétait en boucle qu’elle en avait marre, qu’elle était foutue, qu’elle ne servait plus à rien, qu’elle voulait que ça s’arrête, qu’elle voulait que ça s’arrête, qu’elle voulait que ça s’arrête. J’écoutais. Un jour, j’ai dit : « D’accord Maman. Je comprends. Je connais une fille super. Je vais lui demander si elle peut t’aider à mourir. » Silence. J’ai pensé qu’elle n’avait pas compris. Mais peut-être a-t-elle été horrifiée sans rien laisser paraître ? Cependant, je ne le pense pas. Il est possible qu’elle ait compris un peu, mais pas jusqu’au bout. Ou bien juste un quart. Ou bien à sa façon. Ou qu’elle y ait entendu une jolie formule, parce qu’aider à mourir, ça peut vouloir dire tant de choses ! Je pense que la comprenette des gens, y compris la mienne, n’a pas un fonctionnement binaire, qui ferait que soit on comprend et ça exclut qu’on ne comprenne pas, ou soit on ne comprend pas et ça exclut qu’on comprenne. Non non, ça ne marche pas comme ça parce que le langage est tout ce qu’on veut sauf binaire. Sans compter qu’avec des signifiants tels que vivre et mourir au milieu de nos phrases, infinies sont les possibilités de polysémie, de nuances, de métaphores… et de malentendus et malfagotages de nos pensées…
Alors moi j’ai téléphoné à une amie médecin, avec qui on avait déjà parlé de ces choses-là : « Pourrais-tu venir, je te paie le voyage, pour faire la piqûre à ma maman ? »
Elle a dit : « D’accord, mais pas ce week-end, c’est l’anniversaire de ma nièce. » Et nous avons rigolé. Ça m’a fait du bien.
Quand ma mère reprend son antienne, j’explique, la voix passablement étranglée, que ma copine pourrait lui faire une piqûre, qui la ferait mourir en douceur, tout en douceur. Je m’accroche très fort en pensée au livre La dernière leçon. Pas de réaction. Une semaine plus tard, elle me dit : « Ça me va pas ton système… Moi je veux juste fermer les yeux et que ça s’arrête. » Cette fois, elle avait bien compris. Je dis : « Oui… »
Maintenant, c’est cela qu’elle répète : « Je veux juste fermer les yeux et que ça s’arrête. » Et moi j’en ai marre. Je n’en peux plus d’entendre ça. « Mais c’est pas magique ! » lui ai-je crié un jour.
Son compagnon de son côté, pour un oui pour un non, pour les impôts, pour le chauffe-eau, pour une facture, clame sur un autre mode qu’il va se tirer une balle dans la tête et qu’on n’en parlera plus… Ce sont à peu près les seuls sujets de conversation.
Concrètement, il y a une foule de choses à mettre en place : des aides à domicile, une infirmière… Son compagnon refuse tout ! Elle, elle laisse couler… Elle est sale, la maison est sale. Ça sent mauvais dès qu’on franchit le seuil. J’achète une espèce de siège pivotant à poser sur la baignoire, et je tâche de venir plus souvent, pour la laver. Je n’aime pas laver ma mère, mais il m’est insupportable de la voir et la savoir sale. Insupportable.
J’y pense chez moi à deux cents kilomètres, « il faut que j’aille la laver, il faut que j’aille la laver… »
Après la douche, je lui passe de la crème sur ses jambes toutes craquelées, j’essaie de faire tourner quelques chétives boucles sur la brosse à cheveux et je lui mets du vernis à ongles. Tout cela me réconforte, je ne fais pas l’infirmière en faisant ça. Et pendant la toilette, je lui parle déjà de la crème, du brushing et du vernis, ça m’aide. Le vernis, on avait l’habitude de le fabriquer nous-mêmes avec ma mère. Pour les mains, on aimait bien un rose pâle et nacré. Et c’était rare d’en trouver dans les magasins. Alors on achetait un blanc ou un beige nacrés qu’on trouvait plus facilement, on y ajoutait une goutte de rouge, et on secouait… J’en ai raté plein ! Parce que je mettais trop de rouge.
« - T’as vu Maman comme il est bien celui-là ? Juste le rose qu’on aime.
- Oui, tu l’as bien réussi. »
C’est elle qui m’avait appris. Les couleurs, elle s’y connaissait. Je repartais un peu soulagée, elle était propre pour un jour, deux, trois jours. Et puis ça me reprenait. Je jonglais avec mon planning, « Il faut que j’y aille il faut que j’y aille… »
La dernière année, son compagnon décline d’un seul coup, et admet qu’effectivement il leur faut de l’aide. Oh il résiste encore, pousse fréquemment des gueulantes, mais petit à petit, des passages quotidiens d’auxiliaires de vie et d’infirmières s’installent.
J’ai eu de la chance, parce qu’après des débuts cahoteux, j’ai trouvé une Karine, auxiliaire de vie, et une Corinne, infirmière, toutes deux exceptionnelles. Sans elles… sans elles, je ne sais pas… Tout aurait été encore plus terrible. Au passage, le mot « auxiliaire de vie » quand il concerne Karine, me dérange beaucoup. Je dirais plutôt « pilier de vie ».
Les derniers six mois, ma mère ne se lève plus du tout. Plus du tout. Il faut la faire manger, des petits pots de bébé, et ça prend presque une heure. Elle ne parle pratiquement plus, dort tout le temps, ou reste les yeux dans le vague.
Chaque fois que j’arrivais pourtant, son visage s’éclairait et elle disait quelques phrases, « normales » parfois. Elle sortait sa main toute tremblotante de sous le drap, et m’attrapait le poignet. Moi je voulais bien rester là, à nous regarder, et nous sourire. Je parlais. Je sentais bien qu’elle comprenait, sans doute pas tout, mais je m’en arrangeais. Puis elle finissait par s’assoupir, et je ne savais plus que faire ici, plantée à côté du lit médicalisé…
Elle est morte en dormant.
Elle a donc fermé les yeux et ça s’est arrêté. Je crois que pendant ces six derniers mois-là, c’est ça qu’elle tâchait de faire. Que ça s’arrête. Quand le premier matin où Corinne l’infirmière n’a pas pu la lever, parce que ses jambes étaient devenues toutes molles alors que la veille encore, elles avaient pu la porter pour quelques pas, je me dis que c’est parce qu’elle avait décidé d’arrêter tout ce cirque. Elle a intimé à toutes ses fonctions d’effectuer une sorte de service minimal, jusqu’à ce qu’il se réduise et s’amenuise pour cesser enfin. Ma mère n’avait pas pu accepter la piqûre de ma copine, mais je crois que ça ne l’empêchait pas de souhaiter très fort que ça s’arrête.
Moi j’ai trouvé ces six mois terribles et éprouvants.
Dans un magnifique roman, La storia, voici ce qu’Elsa Morante écrit quand, à la dernière page s’éteint enfin Ida, neuf ans après la mort de son petit garçon : « À la vérité, je crois, moi, que cette petite personne sénile, […] n’a continué de vivre neuf années et plus, que pour les autres, c’est-à-dire selon le temps des autres. […] ce qui pour nous fut une durée de neuf ans, fut pour elle à peine le temps d’une pulsation. […] En réalité, elle était morte en même temps que son petit Useppe […] »
Je veux croire que les six derniers mois de ma maman sont passés comme le temps d’une pulsation…
Voilà. Elle avait 86 ans. C’était fini. On l’a mise dans la boîte, avec sa robe aux dessins mexicains et la petite veste pour cacher les bras.
Mais moi, il me semble que sa mort dure encore.
Le jour officiel du décès n’a pour le moment pas grand-chose à voir avec la fin de la mort de ma mère. Je sais je sais, tout cela est éminemment subjectif… Cela n’en a pas moins de force et de réalité…
J’ai tout de même réussi à écrire à son médecin, une vraie lettre à l’ancienne, sur papier, dans une enveloppe avec un timbre, pour le remercier avec gratitude de nous avoir toujours accompagnés, avec une espèce de simplicité, de tranquillité, de compréhension gentille, sans accumuler ni les examens, ni les hospitalisations… Un gars super. Qu’Hippocrate en soit fier.