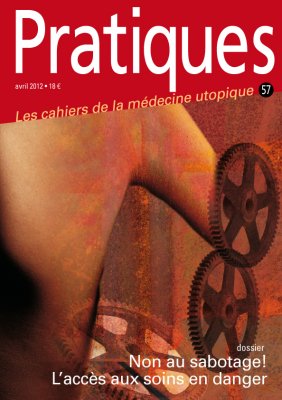Entretien avec Jérôme Host,
travailleur social à la Case de santé à Toulouse
Propos recueillis par Martine Lalande
www.casedesante.org
Pratiques : La Case de santé s’est souciée de l’accès aux soins dès son ouverture. Quels moyens vous êtes-vous donnés ?
Jérôme Host : Nous avons commencé petit, avec un médecin généraliste, deux travailleurs sociaux et une infirmière, pendant presque deux ans. On faisait comme si on était un centre de santé, même si on n’a eu l’agrément qu’en 2008. On faisait le tiers-payant parce que pour nous, la santé fait partie des besoins fondamentaux. On estime que l’accès à la santé devrait être libre et gratuit, facile. Avec le statut de centre de santé, le tiers-payant est obligatoire.
Le fait qu’il y ait des travailleurs sociaux était une évidence. Un lieu de santé de quartier comme celui qu’on projetait devait être en capacité à la fois d’être dans le soin, mais aussi d’avoir une perspective de santé globale et de prendre en charge les déterminants sociaux de la santé. Nous assurions un rôle d’accueil, de médiation et d’ouverture de droits. Mais c’était une charge de travail très importante et on a fini par recruter des médiateurs. Ce sont de vrais accueillants et nous sommes devenus de vrais travailleurs sociaux qui nous occupons de l’ouverture des droits des gens. Le rôle des médiateurs est d’assurer l’accueil des gens dans un climat de convivialité.
Nous sommes ouverts tous les jours : une vitrine sur une place publique, le quartier Arnaud Bernard à Toulouse. C’est très accessible, il suffit de passer la porte, il n’y a pas de sonnette, on trouve directement les accueillants. C’est du très bas seuil, il y a beaucoup de passages, de demandes différentes, nous sommes un lieu ressource sur le quartier. Les gens viennent chercher des renseignements, des orientations parce qu’ils ont des problèmes de droits, des problèmes avec la justice, avec la police... Nos médiateurs santé sont capables d’orienter les gens, ils connaissent le réseau médico-social de la ville, et aussi le réseau humanitaire, où on peut trouver à manger gratuit, où se vêtir...
Comment avez-vous recruté les médiateurs et quelles sont leurs missions ?
Tous les deux sont des anciens patients de la Case de santé. Ils ont une histoire avec le centre de santé, ils participaient aux activités collectives à une époque où on avait énormément de moments de convivialité avec les usagers. Ils étaient parmi les plus actifs, bénévolement, et intéressés par un certain nombre de questions ayant rapport à la santé. Ils n’avaient pas vocation au départ à travailler dans le domaine de la santé, mais on avait repéré cet intérêt-là chez eux. On a fait le pari de les former. Ce sont des personnes qui étaient plutôt loin de l’emploi, sans le bac. On les a embauchés sur des emplois aidés (80 % du salaire pris en charge par l’État) pendant 24 mois, en CDI. Cela nous a demandé un vrai effort de formation, de vigilance, d’accompagnement. Ils sont devenus des accueillants compétents, connus des usagers, qui font un boulot au-delà de la technique d’accueil avec les dossiers à créer, l’informatique... Ils font un énorme boulot de médiation sur le quartier, et nous ont permis d’entrer en contact avec des publics nouveaux. Nous sommes dans un quartier d’immigration et de centre ville, un peu l’équivalent de la Goutte d’or de Barbès à Paris — en plus petit —, un quartier où les primo-arrivants, notamment maghrébins, se rencontrent. C’est un point de ralliement, aussi de trafic de cigarettes, de stupéfiants, etc. Inès, qui est médiatrice et habite le quartier, a un contact très facile avec les gens, elle fait un travail d’éducatrice de rue, elle passe du temps dehors et a réussi à faire la médiation. Tous ces jeunes primo-arrivants migrants, qui n’avaient pas passé la porte, sont maintenant à l’aise chez nous, ils viennent quand il y a un problème. On a pu commencer un travail médical très intéressant autour des addictions. Des jeunes arrivaient avec une dépendance au Rivotril® qui avait débuté au pays, on a découvert qu’il y avait un gros trafic de ce médicament dans certaines villes d’Algérie. On a fait une campagne d’affichage, puis en consultation on expliquait les dangers du Rivotril® et on a réussi à modifier les traitements de pas mal d’entre eux. C’est de la santé communautaire.
Les activités collectives avec les usagers sont des moyens d’amener à la santé ?
Nous voulions offrir un accueil médico-social individuel aux habitants du quartier et aller vers des publics spécifiques comme les étrangers malades, les vieux migrants, les femmes, les sortants de prison. Nous sommes professionnels de santé, individuellement on peut faire des choses, mais on ne peut pas tout régler et il est important que les personnes aient l’occasion de prendre en main leur santé, en rencontrant des personnes qui sont dans la même situation qu’eux, qu’il se crée des solidarités. Cela leur donne la possibilité d’être acteurs de ce qui leur arrive. Dans le centre de santé, il y a une salle de consultation, une salle d’attente, et une salle de 80 m2 pour les activités collectives. On a fait plein de tentatives pour créer du collectif : par exemple pour que les mamans seules avec enfants se rencontrent et puissent poser leurs questions sur la santé des enfants dans un autre cadre que la santé individuelle. Il y a eu aussi dès le départ le groupe autour des Chibanis, les vieux migrants, et il existe toujours. Il y a eu des moments de convivialité, pas forcément très construit en termes d’objectifs santé, mais juste des moments pour que les gens se rencontrent en laissant de l’espace pour que puissent se concrétiser des choses qui partent d’eux. Les cantines mensuelles ouvertes à tous les usagers, avec la cuisine prise en charge par les usagers, a duré trois à quatre ans. Maintenant, on est passé à autre chose.
Inès, la médiatrice santé, avait constaté qu’on voyait beaucoup de femmes migrantes isolées vivant en foyers d’hébergement d’urgence. Elle a proposé une activité spécifique : elles se sont rencontrées une fois par semaine autour d’un repas. Cela a été l’occasion de parler de sexualité, de contraception et aussi de l’accès à des produits d’hygiène. Nous nous sommes rendu compte que les associations qui distribuent des colis alimentaires ne prévoient jamais les serviettes hygiéniques ou les tampons. Alors on a interpellé la Croix-rouge sur ça. Car c’est un problème de santé publique.
Comment choisissez-vous les thèmes sur lesquels vous organisez des activités ?
Pour les Chibani, on avait un objectif en organisant le café social. Des études montraient que ce public est clairement en situation d’inégalité sociale de santé, confronté à des tracasseries administratives, avec un accès à la santé plus compliqué, et qu’ils sont plus malades que les Français du même âge. On a regroupé des personnes, puis il est arrivé un évènement qui a soudé le groupe autour d’une injustice : les contrôles dont ils font l’objet, on leur demande de rembourser des sommes très importantes pour avoir passé trop de temps au pays, sur leurs retraites, etc. On a profité de ce groupe pour dire qu’il fallait se défendre, ils ont commencé à s’organiser collectivement. Quand il y a une lutte à mener, c’est plus facile de tenir une cohésion. Plutôt que faire un atelier qui relève purement de la santé, où les gens vont pouvoir venir chercher une information à un moment.
Sur la santé des femmes, c’est pareil.
Avec l’initiative d’Inès, elles sont allées elles-mêmes rencontrer les associations, elles ont mis en place un vestiaire avec du troc car il y a peu de vêtements pour les femmes un peu fortes. Ce sont des choses auxquelles on n’aurait pas pensé, nous soignants. On pense à des questions de santé publique, alors que quand on arrive à regrouper les gens, et à recueillir leur parole et leurs préoccupations, des questions émergent. Après il s’agit de donner des outils, les moyens de s’organiser, d’organiser un plaidoyer autour d’un problème, même s’il paraît peu important. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Existe-t-il des plans qu’on ne connaît pas, comment chercher, qui appeler ? C’est la mission des médiateurs santé. Après, les gens partent du foyer, on les perd de vue, il peut y avoir des conflits dans le groupe, cela s’étiole... on passe à autre chose. Aujourd’hui, on s’occupe des étrangers malades qui risquent de perdre leurs cartes de séjour avec la loi de 2011. Plein de gens au centre de santé sont concernés, ils sont venus nous questionner, angoissés. On a réagi en leur proposant du collectif : si vous voulez, on va organiser une réunion publique avec les gens concernés et on va expliquer ce qu’on a compris de cette loi-là, pour voir ce qu’on peut faire. Ils sont en train de s’organiser, ils veulent faire une manifestation pour se rendre visible, ils ont envie de s’exprimer, de dire qu’ils sont malades et qu’ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine.
La conclusion c’est qu’on essaye de s’appuyer sur les bagarres plus que d’avoir un plan de santé publique.