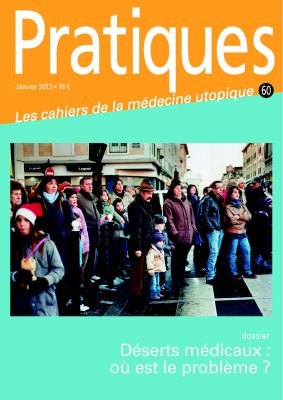Entretien avec Margot Kenigsberg,
médecin généraliste remplaçante.
Propos recueillis par Elisabeth Maurel-Arrighi
Pratiques : Pourquoi et comment avez-vous choisi la médecine générale ?
Margot Kenigsberg : Je me suis inscrite en fac pour faire de la médecine générale. A la Pitié-Salpêtrière, ma faculté d’origine, la médecine générale n’est quasiment pas abordée et aucun externe ne fait de stage en ville, ce qui n’est pas le cas dans d’autres CHU. Chaque année, j’ai demandé à faire un stage dans un cabinet de médecine générale, à la place par exemple d’un stage en chirurgie. Cela m’a été refusé. Entre la cinquième et sixième année de médecine, l’esprit de la fac parisienne a réussi à me « formater » pour que j’envisage une spécialité. J’ai fait un stage qui m’a beaucoup intéressée en gynécologie/endocrinologie, et je me suis alors dit je ferai de la gynécologie médicale. Il a fallu attendre la fin du concours, pour sortir la tête de l’eau, pour prendre le temps de réfléchir à ce pourquoi j’avais fait médecine. Pendant les études, on ne réfléchit pas en termes de métier, on réfléchit en termes de concours.
Avant le choix définitif, j’ai demandé à ma généraliste (qui est membre du comité de rédaction de Pratiques) si je pouvais passer une journée dans son cabinet. Ma première vraie rencontre avec la médecine générale après six ans d’études ! Au bout d’une heure, c’était sûr que j’étais faite pour cela, et non pour participer à des staffs (réunion hebdomadaire des médecins) bibliographiques dans un service hospitalier... J’ai été définitivement convaincue lors de mon stage ambulatoire de niveau un (en troisième semestre d’internat). J’ai passé six mois dans un cabinet à Gennevilliers qui regroupe trois généralistes. Mon maître de stage, un homme, professeur de médecine générale, installé depuis plus de trente ans et deux jeunes femmes qui venaient de s’installer quelques mois auparavant. Cette rencontre avec ces femmes médecins a été très importante. J’ai pu me projeter dans ma vie de femme, elles sont jeunes, avec des enfants, elles ont l’air d’être passionnées par leur métier, travaillent consciencieusement avec des horaires compatibles avec leur vie de famille. Elles travaillent chacune un jour par semaine dans un planning familial et gardent un jour par semaine pour leurs enfants, pour elles. Elles ont vraiment été un modèle, d’ailleurs j’ai baptisé l’une d’elle ma « marraine médicale ». Quant à mon maître de stage, j’ai adoré apprendre avec lui la consultation, l’écoute, la science. Son expérience et son souci de la transmission ont été formidables. Mais il ne pouvait pas me servir de modèle. De plus, elles deux sont amies, se font confiance, se soutiennent mutuellement, ce qui leur permet de se relayer auprès de leurs patients si besoin. Par ailleurs, dans cette ville, il y a un dynamisme très stimulant, des réunions régulières qui associent différents acteurs de santé pour un travail en réseau. J’ai terminé ces six mois de stage en me disant que c’était cela que je désirais faire. Ensuite, j’ai fait des stages de gériatrie puis de pédiatrie à l’hôpital, où j’ai gardé mon œil de généraliste pour comprendre quand et comment notre pratique peut s’articuler avec l’hôpital.
Quelles différences voyez-vous entre la médecine hospitalière et la médecine générale ?
Je trouve qu’il existe une autre temporalité dans la relation. Ce que j’aime, c’est suivre les gens au cours du temps. J’imagine, que sur des années, c’est génial de voir des enfants grandir et difficile de voir les gens vieillir et aller moins bien. Mais on les accompagne dans le temps. Je crois aussi qu’à l’hôpital, du fait de l’équipe, on ne parle pas des mêmes choses, il y a moins la place pour une rencontre de personne à personne. Même si j’aime travailler à plusieurs, cette relation particulière qui s’installe en consultation me convient mieux.
Pourquoi avez-vous fait le choix de travailler dans une banlieue défavorisée ?
Mon tout premier stage a été aux urgences de l’hôpital de Saint-Denis. Ce que j’y ai vu, c’est une violence plus importante que ce à quoi je m’attendais. À la fois la violence physique, mais aussi la misère, les difficultés d’accès aux soins.
La différence culturelle, cela demande plus de temps et sans doute plus d’énergie, mais c’est passionnant. Par exemple parler du diabète à quelqu’un qui n’a pas d’argent pour se nourrir de façon équilibrée, c’est plus compliqué. C’est un défi, mais cela ne me rebute absolument pas.
Le point négatif, c’est le manque de mixité sociale, contrairement au 18e arrondissement où j’ai travaillé aussi, où on rencontre des patients de toutes origines et conditions sociales.
Quelle est votre expérience entre le libéral et le salariat ?
J’ai connu le salariat en faisant un stage en centre municipal de santé une matinée par semaine. Je ne voyais que les urgences du jour, sans aucun suivi. Certes, je reconnais le confort de ne pas avoir à gérer la carte Vitale, à trier les examens, et la facilité de communication avec les infirmières qui sont au sein du centre.
J’ai eu l’occasion de remplacer à la Place Santé à Saint-Denis qui est un cabinet de type associatif. Ce lieu de soin m’a semblé très attractif. Ceux qui y travaillent sont des jeunes médecins salariés, qui ont eu la même formation que moi. C’est un lieu agréable, bien aménagé, dynamique avec des médiatrices qui sont des habitantesrelais. Cette structure organise régulièrement des ateliers santé. C’est une conception du soin dans sa globalité qui me plaît. C’est un choix d’y travailler car au niveau financier, c’est tout à fait confortable en tant que remplaçant, mais moins que certains remplacements au secteur 2 à honoraires libres, voire en secteur 1 à tarif remboursé, mais où on voit trente-cinq personnes dans la journée.
Quand pensez-vous vous installer ?
Je n’en sais rien, je voudrais tester sur les deux ou trois prochaines années le mode d’exercice qui me plaît, trouver le lieu et les gens avec qui j’ai envie de travailler. Je vais essayer de faire des remplacements fixes, de longue durée pour pouvoir assurer un suivi. Ce qui est prévu, pour les mois qui viennent, c’est un remplacement régulier dans un cabinet à l’Ile-Saint-Denis.
Ce que je sais, c’est que je ne m’installerai pas à la campagne. Je suis une citadine et je ne crains pas d’aller travailler en banlieue.
Quel message avez-vous envie de faire passer aux jeunes médecins en fin d’études ?
En médecine générale, on ne s’ennuie jamais. Chaque fois qu’on ouvre la porte pour le prochain patient, c’est différent. Il faut s’adapter aux gens. Selon le contexte, la même maladie n’est pas la même. C’est passionnant.
La question des modèles est primordiale. D’abord, les professeurs qui enseignent à l’hôpital n’ont jamais mis les pieds dans un cabinet de médecine générale. Souvent, ils méprisent complètement les généralistes. J’ai entendu un professeur me dire, au moment de mon choix que je ne ferai que « recopier des ordonnances ». Par ailleurs, il faut dire aussi qu’il y a une quantité de mauvais généralistes, vieux ou pas vieux, qui travaillent mal et qui font déconsidérer la profession.
Pour oser se lancer dans la médecine générale, il faut pouvoir rencontrer des médecins qui donnent envie et alors se projeter. Ma généraliste a 30 ans de médecine générale derrière elle, j’adore sa manière de travailler. Mais elle travaille seule, avec juste une remplaçante, et une amie kiné qui travaille à mi-temps dans un bureau à côté. Elle y passe beaucoup trop de temps et je la sens fatiguée. Je pense qu’il y a un équilibre à trouver pour être heureux dans ce métier difficile.
Mais même nous, les jeunes médecins motivés, nous ne voulons pas y passer notre vie. J’ai vu que c’était possible d’exercer ce métier, en travaillant consciencieusement, en prenant du temps pour les patients, et en ayant une qualité de vie tout à fait confortable, quitte à gagner moins d’argent. Ce que je veux, c’est travailler à plusieurs, participer à des groupes de pairs, apprendre en discutant avec d’autres, continuer à me former. Et je ne suis pas la seule à avoir envie de me lancer dans la médecine générale et à envisager de travailler dans des quartiers dits difficiles.