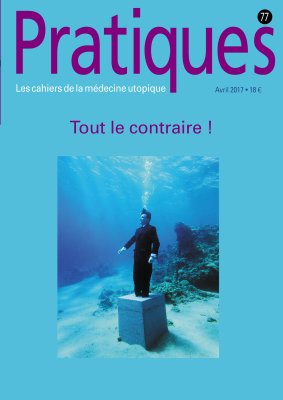Yacine Lamarche-Vadel
Médecin aux urgences, Fontainebleau
-
-
-
- Jeune étudiant en médecine, j’étais attentif et touché jusqu’au bouleversement par les patients en train de s’extraire des pires moments de leur existence. Et aujourd’hui ? Que me reste-t-il d’écoute si les soins ne risquent plus de me faire vaciller ?
-
-
La Médecine est une suite de meurtres ratés et d’apoptoses réussies.
En voulant y faire ma carrière, mon premier forfait devait être particulièrement odieux. Comme celui de tout candidat qui frappe à la porte d’un gang de Mareros et qui est prêt à tout pour se faire accepter d’une Honorable société. C’est ainsi que les Professeurs, membres de l’Académie et de la Faculté, me proposèrent de commencer par me tuer moi-même. L’offre ne se fit pas au grand jour. Pas d’ordre écrit ni de demande orale formelle. La nécessité de la réalisation de cette exécution devait s’imposer progressivement à mon esprit.
En étant sous la responsabilité des Sottocapi de la Cosa Nostra, en les voyant à l’œuvre et par leurs allusions, il fallait se rendre à l’évidence qu’il était impossible de continuer à vivre, avec à l’intérieur de soi un être sensible et fragile.
Régulièrement, je ressortais à genoux, abattu par ma propre colère et mon dégoût, à la sortie des interminables visites professorales ; car parfois tout, absolument tout, était pour moi un enchaînement d’horreurs et de maltraitances. Nous étions jusqu’à sept à entrer dans la chambre pour la visite des Grands Jours. Le Professeur, issu du Panthéon, le praticien hospitalier, divinité mortelle, le chef de clinique, mortel divinisé, déjà inaccessible, l’interne de la salle, le seul d’allure humaine mais probablement en cours de canonisation, et la plèbe : l’infirmière qui s’occupait de ce patient et nous, les trois étudiants en médecine, les externes ; car, comme au jardin d’enfants, présents seulement par demi-journées, trop petits pour pouvoir supporter des journées entières.
Lors de certaines perquisitions, je voyais des cas récalcitrants être épinglés comme des insectes sur leur lit au moyen de paroles ou d’examens nécessaires, réalisés avec « tact et mesure ». Nous assistions aux derniers mouvements de leurs pattes. L’assemblée d’entomologistes se retirait alors, laissant une odeur de naphtaline et passait à une autre boîte de la Collection.
Dans les services les plus difficiles où l’on ressortait les yeux rouges et la gorge nouée, les chefs blaguaient en nous mettant en garde contre la laryngite aiguë, aux symptômes similaires. Une des maladies de la crèche collective… mais qui, à un âge adulte, emporte les plus valétudinaires.
La traversée à gué de cette mer tourmentée risquait de nous briser la nuque. Les vertèbres Atlas et Odontoïde disloquées contre d’énormes vagues : les premières rencontres avec les corps malades, les mourants, les cris de la douleur, les regards de souffrance. Il nous arrivait aussi de tomber dans les baïnes, déséquilibrés par les coups de coude de nos futurs confrères, condamnés de ne pas avoir été à leur hauteur.
Ce fut une période pénible. J’étais blessé de voir des humains dépossédés de leurs forces. Il m’arrivait d’apprendre, parfois en même temps que le patient, la gravité de sa maladie. Le nom d’une affection sinistre était lancé, annonçant la fin d’une vie où le temps n’était pas compté. C’était l’évanouissement d’un corps fort qu’il fallait rapidement opérer. Je n’avais pas compris ce qu’il fallait extraire. C’était encore plus effrayant. Il fallait enlever une partie des chairs et il ressortirait dans un état inimaginable de cette chirurgie. J’étais le seul à être dans le même état d’effroi que le patient et nos regards finirent par se croiser. Pour ne pas tomber, il avait son lit, moi l’amidon de ma blouse blanche. Cela prenait plusieurs jours pour que la glu étouffante s’enlève de mes enveloppes fines et perméables, sensées me protéger, et que je puisse à nouveau me sentir sans menace.
Pour autant, nous devions être dociles et polis avec nos enseignants. Au travers de leurs discours hermétiques, ils suscitaient et espéraient chez nous l’émergence de liens confraternels.
J’étais tellement révolté et meurtri de pouvoir être apparenté à ce groupe balourd et brutal pénétrant sans frapper ni hésiter, sans salutation ni présentation, afin de s’adonner à un examen clinique collectif une fois le drap jeté à l’extrémité du lit, patient content, conscient ou pas.
Certains jours j’arrivais avec plus d’assurance. J’anticipais de toquer à la porte, de déclamer un grand « Bonjour », suivi d’un « Comment allez-vous ? », « Est-ce que nous pouvons vous examiner ? ». Mais toutes ces paroles se perdaient dans le brouhaha des discours de la conférence médicale qui envahissait la chambre.
Le patient restait silencieux ou répondait du mieux qu’il pouvait aux questions qui n’attendaient pas de réponse.
Le lendemain, le patient qui, tout au moins par son cas, avait été digne de l’intérêt de l’aréopage hospitalo-universitaire posait enfin toutes ses questions à l’étudiant ébouriffé.
En recoupant les réponses qu’il avait eues avec les infirmières du matin puis avec celles du soir, il se faisait une idée, d’après le niveau de concordance, de l’importance de ce qu’on lui cachait, et donc de la gravité du mal dont il était atteint.
Venait mon tour d’être interrogé. J’essayais d’expliquer au mieux, sans nous effrayer, ce que j’avais moi-même saisi et je promettais de transmettre ses demandes complémentaires auxquelles je ne savais pas répondre. Le patient m’ayant choisi comme Pythie, j’étais régulièrement dans les affres du conflit de loyauté craignant lors de mes oracles, ou de décevoir, ou d’enfreindre la règle de l’Omerta.
En retour, les patients étaient pleins de gratitude et certains participaient activement à notre formation, aguerris par plusieurs années de séjours à l’hôpital, leur deuxième maladie.
Nous étions parfois notés directement au lit du malade afin d’évaluer nos connaissances et notre habileté à pratiquer un examen clinique. Je me souviens qu’une de mes premières fois, j’étais resté complètement interdit sur la façon de rechercher le signe de Babinski. Le patient, qui ne devait pas en être à sa première mise en scène, avait alors discrètement fait glisser le drap et avait sorti son pied. Puis nonchalamment, il se mit à entreprendre le mouvement de lente et majestueuse extension du gros orteil, comme décrit dans les ouvrages.
Étudiants et malades, nous étions parfois ainsi complices. Notre manque commun d’existence et de savoir nous donnait régulièrement le sentiment d’être exclus et dévalorisés. Nous avions peur ensemble, nous pouvions défaillir aux mêmes moments ; partager les mêmes champs de pommes dans lesquels il nous arrivait de choir, renversés par les odeurs d’éther, la couleur vive de l’hémoglobine, et les petits craquements des ongles que le chirurgien ôtait d’un coup de pince de Kocher.
Je finis par quitter ces hôpitaux soumis aux règles des Mandarins, renonçant aux titres et aux médailles. Outre la récupération de mon indépendance, il me semblait, qu’avec les années, je supportais de mieux en mieux ce que je voyais. Je n’appréhendais plus d’entrer dans les chambres des malades. Peut-être plus focalisé par l’inquiétude de faire le bon diagnostic et de prescrire le traitement idoine.
Dans les hôpitaux de campagne, j’eus également des étudiants à encadrer, incertains, autant en construction de leur forme que de leur intérieur.
Certains malades du service étaient difficiles, proches de la mort, d’autres le corps en grande partie enseveli sous la douleur. Ils aimaient la compagnie de ces jeunes soignants. Ils se consolaient grâce à leur douceur et à leur innocence. Ils n’étaient ni jugés ni rejetés, ils étaient plaints et admirés.
Les jeunes apprentis sortaient parfois en pleurant des chambres des malades les plus durement atteints. Je laissais mes dossiers et le chariot. Acte dissident de l’hôpital central universitaire où l’on apprend à tomber droit, à se relever tout seul et sans plus savoir si on se fait mal. Je proposais aux jeunes éprouvés de marcher avec eux, mais je sentais que nous restions sur deux chemins distincts. J’avais quitté depuis longtemps le leur, fait d’un sol dur, pierreux qu’il fallait fendre et ameublir.
Je n’avais pas suivi la route balisée et je me sentais sur un layon de mercenaire. Je témoignais aux patients de ma préoccupation et de mon empathie. J’accompagnais même parfois mes paroles d’un geste, posant ma main sur leur avant-bras. Mais ce geste était autant réglé et maîtrisé que si je me coiffais d’un chèche. Un litham extrêmement bien mis, me protégeant contre les vents de poussières, ne laissant à l’autre que le regard accessible.
Auparavant, il y a… des années, j’avais laissé ma main hésitante aller jusqu’au creux de la paume, sèche et amaigrie. Comme deux fourmis sourdes et muettes, nous communiquions du bout de nos antennes. Dans cette alcôve minuscule, nous faisions persister l’essentiel des soins.
Références
– Institut Benjamenta. Robert Walser
– La Cathédrale. Sculpture de mains. Auguste Rodin