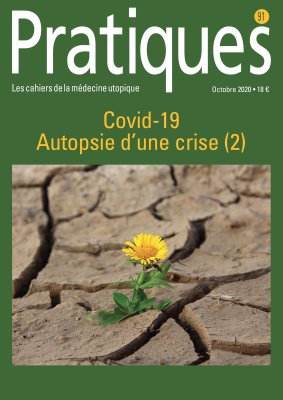Laurent Carrive
Philosophe, chercheur en psychopathologie, psychanalyste
La conjoncture sert trop souvent d’alibi pour nous faire céder en tout, à l’urgence, autrement dit à un certain pouvoir. Le temps d’arrêt de cette pandémie fut aussi l’occasion pour nous de répondre à une autre urgence : celle de penser le sens de notre vie et des pouvoirs qui la façonnent.
Aux hôpitaux surmenés, aux rues désertes, aux médias lancinants, le monde encore rongé d’inquiétude voit bientôt succéder l’après-coup et le temps du déchiffrage.
OCCASIONS ?
Des occasions ? Reste l’espoir, témoin d’une conscience commune
La parenthèse historique ouverte par la Covid-19 foisonnait d’occasions politiques, écologiques, philosophiques. Furent-elles manquées ? Peut-être. Mais l’espoir était, lui, bien tangible. Et cette aspiration commune à un nouvel horizon, reste, à elle seule, pleine de promesses.
On dit assez qu’un virus ne connaît pas de frontières, ni géographiques, ni sociales… Cette brèche ouverte dans l’ordre des pouvoirs nous a rappelé, à tous sans exception, l’enjeu irréductiblement commun du vivant. À l’image de la mutation climatique ou des guerres mondiales, la pandémie figure parmi ces rares évènements touchant l’humanité entière, tous les peuples (pan demos). De fait, une forme d’identité collective s’est fait jour, nous laissant entrevoir une conscience commune.
L’occasion de repenser le politique
Par ailleurs, le temps qu’a libéré ce confinement fut pour beaucoup l’occasion de penser. Ce temps d’arrêt a vu fleurir les ruminations introspectives et les errances existentielles, renvoyant parfois aux questions les plus redoutables, comme celle du sens de la vie, et dans ce monde ! Car cette pandémie a mis en relief les multiples contradictions structurelles dont souffrent nos institutions, le monde de la santé en tête. Le maintien des métiers essentiels a ranimé les conflits de classes. Quant aux dérives politiques, elles furent évidentes : résurgence du contrôle, lois d’urgence, « grignotage » continuel des libertés, télétravail et aggravation du délitement social ou encore recrudescence de violences conjugales. Et ce spectacle inquiétant fut justement pour certains une occasion concrète de repenser le politique, le « vivre ensemble » et le sens de notre vie.
PENSER LA VIE – INTRODUCTION AU POLITIQUE
Penser et agir
Agir, et vite, est souvent un impératif. Mais prendre le temps de comprendre en est un autre.
On accuse régulièrement les philosophes et les intellectuels de se complaire dans l’abstraction et l’inaction. Sans doute parce que les pensées des philosophes demandent du temps, un temps devenu trop rare. L’unique moyen de saisir la profondeur des concepts philosophiques est d’en retrouver patiemment le sens par soi même. Car ils ne se prouvent pas, mais s’éprouvent par l’expérience, seule en dernier lieu à faire autorité. Il en va de même pour la question du sens de la vie. Inciter autrui à se demander ce qu’est, ou pourrait être, le sens de sa vie, est une démarche souvent vaine. Car cette question nous vient de l’intérieur, de l’expérience, de la vie elle-même.
Donner un sens à sa vie. Piège ou aliénation sociale
Mais s’interroger sur le sens de la vie n’est pas seulement mettre en œuvre la puissance de l’intime et du singulier, c’est aussi déjouer de nombreux pièges, penser contre l’opinion et contre l’autre en soi. Aussi, la formule « Donne un sens à ta vie », incantatoire, est assez suspecte. Car elle peut évidemment viser l’intériorisation docile d’une demande sociale aliénante, celle de trouver à tout prix sa place dans l’arbre préétabli des tâches ou des rôles que propose la société. Les thèses sur la nature coercitive ou non de la division du travail (social) sont certes nombreuses et divergentes [1]. Mais chacun sait combien le grimage d’une « nécessité » collective en un vœu privé, cette opération qui prétend muer une contrainte en un souhait, peut s’avérer mortifère.
La puissance de la vie
Qu’importent les subterfuges de la complexité sociale puisqu’ils n’ont jamais eu raison de la vie qui sourd en nous. La nature humaine n’est pas infiniment élastique. C’est même là tout l’enjeu du politique et du « sens de la vie », non plus la prescription éculée, mais la question grave du désir d’être, sa force, sa vérité, la place et l’audience qu’on lui accorde en ce monde.
L’INTIME ENVERS DE L’UNIVERSEL
De l’intime vers l’universel
Contrairement aux idées reçues, le retrait dans l’intime ne détourne ni de l’autre, ni des choses publiques, encore moins de l’universel. Les vérités « universelles », ces clartés du sens qui croisent notre chemin avec tant d’évidence, n’apparaissent qu’à l’occasion d’évènements nécessairement singuliers. C’est l’expérience sensible et les affaires privées qui nous mènent aux vérités les plus générales, à la conscience philosophique comme au champ du politique.
La nécessité de la loi
La vérité subjective est incomplète, et liée à l’ordre où elle s’insère. Se soustraire à l’ordre, aux lois, n’a jamais été une option car l’homme est un être de langage, un animal politique. Sa crainte la plus flagrante est même de sombrer dans l’effrayante solitude du non sens. Mais cet ordre est-il nécessaire ? Les lois et les structures politiques n’ont pas toujours existé. Elles ont leur histoire, leur origine, leur contingence.
Le social forge l’intime. L’intime met le social à l’épreuve
Toute société suppose une réversibilité entre d’une part la conscience, la liberté individuelle et d’une autre, la structure de la contrainte sociale. La loi fournit aux sujets un espace et un langage de réalisation. Le sujet, quant à lui, réclame en permanence, consciemment ou non, l’ajustement des lois communes et du « vivre ensemble » à ses besoins singuliers. Et cette dialectique entre individuel et collectif, équilibre et palpitation à la fois, résulte de l’incomplétude du sujet autant que de celle de la structure sociale, sujet et société se modelant et s’historicisant mutuellement.
Intime psychanalytique et politique
En ce sens, la pratique psychanalytique se trouve de plain-pied dans le politique. Car l’intimité du cadre psychanalytique offre un retrait où, à distance des excès du monde, le sujet peut s’en faire le témoin et prendre conscience de ses assujettissements. Mais la psychanalyse est une cure par la parole et le langage, langage qui structure l’être comme l’inconscient. Et dans la trame du langage, la coercition sociale est si omniprésente et profondément inscrite qu’il serait irréaliste de vouloir en isoler et en comprendre tous les effets aliénants. Cette élucidation dépasse toute intelligence. C’est en définitive à l’acte manqué ou au symptôme qu’il reviendrait de nous adresser, dans le chiffrage dont ils ont seuls le génie, les signes d’une servitude contre nature, pour peu bien sûr qu’on veuille les lire.
Par cette logique, s’affirme, semble-t-il, la dimension politique de l’inconscient et à l’extrême la formule lacanienne « l’inconscient, c’est la politique ».
LA BOÉTIE, FREUD ET CLASTRES
Pour clore cette suite de réflexions, nous tenterons en guise d’illustration un rapprochement entre trois grands auteurs, La Boétie, Freud et Clastres, sur la question du pouvoir, sa nature, sa structure, son usage, mais aussi ses rapports avec l’Un.
La Boétie : l’Un, sa clôture, instrument dernier de la tyrannie
Dans son Discours de la servitude volontaire (1549), Étienne de La Boétie se demande comment un million d’hommes peuvent se laisser opprimer par un seul. Dans un premier temps, il nous explique que ces hommes restent la « tête sous le joug », parce qu’ils « […] sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient pas redouter – puisqu’il est seul – ni aimer – puisqu’il est envers eux tous, inhumain et cruel. » [2] La Boétie s’interroge ensuite, dans ce texte magistral, sur les modalités et ramifications de mise en œuvre du pouvoir de l’Un. Mais il refuse de considérer les systèmes hiérarchiques ou plus largement l’État, comme des fatalités, ni des « structures ontologiques de la société [3] ». Il les comprend comme des accidents de l’histoire qui ont dénaturé l’homme, « d’abord né pour vivre libre ». Considérant que le tyran ne tire son autorité que du consentement du peuple « à son mal », La Boétie estime qu’il suffirait à chacun de refuser cette oppression pour que cesse la tyrannie.
Cette thèse, toujours aussi actuelle, repose la question cruciale du libre arbitre. Mais La Boétie s’intéresse à la coercition des « machines sociales [4] » et non à une psychologie encore inexistante à son époque. On comprend mieux aujourd’hui, notamment à l’aune d’un capitalisme tentaculaire, combien nos constructions psychiques sont indissociables de nos systèmes sociaux. Il est même bien clair qu’au long des générations, les machineries sociales, successivement intériorisées par les hommes et sédimentées dans notre psychisme, ont eu une large part dans l’évolution de notre subjectivité vers sa conformation moderne. Penser la structure complexe des différents modes de domestication de nos pulsions à travers l’histoire est d’ailleurs une exploration-clé de la psychanalyse [5]. En fin de compte, la question de la coercition des structures politiques est inséparable de la question psychologique et historique de la logique masochiste suivant laquelle un sujet conscient accepte et finit même par vouloir se soumettre sans y être réellement contraint.
Freud : le pouvoir et le trait
Freud a essayé de comprendre pourquoi un individu agit différemment lorsqu’il fait partie d’une foule, jusqu’à renoncer à sa singularité. Son explication prolonge en quelque sorte la conception du « nom d’Un » hypnotique de La Boétie, par le concept de « trait ». Pour Freud, l’opposition entre psychologie individuelle et psychologie collective n’est qu’apparente. Selon lui, la cohésion de la foule tient, comme pour l’individu, des pulsions de vie, la sexualité, l’amour filial, mais aussi l’amour patriotique ou intellectuel. Une hypothèse à rapprocher de celle de Wilfred Trotter [6] pour qui la formation des foules est la « continuation biologique de la pluricellularité des organismes supérieurs. »
À la fin de Psychologie des foules et analyse du moi [7], texte de 1921, Freud articule précisément le collectif à l’individuel, en établissant un parallèle entre la structure du moi et celle de la foule. Il y explique que l’identification au chef dans le comportement des foules s’apparente à l’identification à l’autre. Or, cette identification à l’autre est pour Freud « l’expression première du lien affectif à une personne » par emprunt d’un trait particulier de cet autre. On retrouve ce trait dans le concept lacanien de trait unaire, à partir de quoi se constitue l’idéal du moi. Le trait unifiant est le support chez l’enfant de l’unification conceptuelle et imaginaire de son propre corps comme forme totale, à partir de l’image dans le miroir.
C’est la fonction de ce trait qui, pour Freud, explique comment plusieurs hommes, voire une multitude, parviennent à former le tout de la foule. Autrement dit, on peut dire que le passage de l’individuel au tout de la foule formant un Un a une structure similaire à celle du passage du morcelé à l’unifié chez l’enfant.
Notons que, le mot « ordre » renvoie à l’Un en deux sens : celui qui donne l’ordre est un Un qui commande et rassemble comme le chef, et qui unifie comme le trait. D’autre part, ce qui permet de ranger selon un ordre, est le canon de l’Un (l’unaire), qui de même que l’identification au chef, ôte sa singularité au sujet, ce dernier devenant alors, un un parmi d’autres, dans la foule. Et l’on retrouve une structure proche dans la réciprocité entre citoyenneté et constitution [8]. Soit la constitution, Une, organise les citoyens en un tout. Soit la citoyenneté de chaque un, et donc en somme celle unifiée de tous ces uns, constitue le tout de la Cité.
Pour interroger le collectif à partir de l’individuel, par extrapolation en quelque sorte, Freud s’en remet donc à l’instance de vie, à l’Éros et au « destin des pulsions » qui structure tout sujet. Or l’organisation des pulsions est un produit de civilisation qui résulte d’une genèse historique, collective et symbolique. Par conséquent, dans ce rapport individuel/collectif, la causalité est circulaire, reposant dans son principe sur l’adoption d’une « mythologie des pulsions ».
Clastres : le pouvoir mis sous verre
La dernière réflexion proposée ici concerne le pouvoir et le rapport nature/culture, offrant une forme d’alternative à la circularité précédente, par une figure purement décisoire. Elle aborde la question du refus du pouvoir, comme acte politique fondateur.
Pierre Clastres est un anthropologue qui s’est consacré aux problèmes de l’organisation politique des sociétés « primitives ». Son livre célèbre, La société conte l’État, traite de la question du politique dans les sociétés sans pouvoir ni État.
L’obstacle majeur à toute recherche anthropologique, rappelle-t-il, est l’ethnocentrisme, qui nous conduit à penser les sociétés sur le mode négatif du manque : sociétés sans écriture, sans classes, sans État. Pour rompre avec ces conceptions, Clastres veut montrer que les sociétés « primitives » ne manquent de rien, l’absence chez elles de structures politiques analogues aux nôtres étant plutôt le fait d’une défense « contre [9] » l’apparition de tels systèmes.
Clastres critique, au sein de l’ethnologie contemporaine, le préjugé occidental selon lequel toute autorité politique est coercitive. Cette conception du pouvoir repose selon lui sur une « philosophie de l’histoire » implicite, très discutable : le pouvoir aurait évolué de la forme primitive d’une caricature archaïque de pouvoir, celui des « sauvages », jusqu’à sa forme moderne dans les sociétés policées, comme réalisation de ce qui serait l’essence coercitive d’un pouvoir véritable.
Héritier de La Boétie, qu’il a lu et commenté, Clastres se situe hors de l’histoire pour penser l’apparition de la coercition politique et la naissance des sociétés tyranniques. Ce moment, cette malencontre, est un « […] accident tragique, malchance inaugurale dont les effets ne cessent de s’amplifier au point que s’abolit la mémoire de l’avant, au point que l’amour de la servitude s’est substitué au désir de liberté [10]. »
Les premiers découvreurs européens du Brésil constatèrent que les chefs indiens ne jouissaient d’aucun pouvoir ; des « gens sans foi, sans loi, sans roi. », disaient-ils. Clastres pu confirmer par lui-même au sein des chefferies amérindiennes où il vécut que le pouvoir s’y trouvait en effet « […] privé des moyens de s’exercer [11] », le chef ne possédant aucun pouvoir coercitif. Mais plutôt que de conclure à l’incapacité politique de ces sociétés prétendument archaïques et immatures, il mit en évidence le caractère séculaire, intentionnel et construit, inconscient ou non, de cette négation insolite du pouvoir.
Son raisonnement repose, dans les grandes lignes, sur une analyse des obligations premières du chef dans la tribu. Le chef indien doit remplir deux conditions : être généreux en biens, en cadeaux auprès de tous et être un bon orateur. D’autre part, il est polygyne et souvent le seul de la tribu à avoir plusieurs épouses. Or ces caractéristiques, note Clastres, renvoient aux biens, au langage (aux mots) et aux femmes, soit pour l’anthropologue les trois principaux éléments dont la circulation définit la société comme lieu de l’échange. Mais dans ces trois cas, Clastres remarque qu’au niveau du chef, donc au niveau de l’institution politique, la circulation est rompue. Le chef est d’abord le seul à être polygyne. Il est ensuite tenu de prononcer des discours quotidiens, d’adresser des mots sans en recevoir en retour. Enfin il ne peut refuser aucune demande de biens ou services et sa générosité est à sens unique. La sphère du pouvoir est donc associée à une négation de l’échange. L’échange étant l’essence du social, le pouvoir apparaît donc comme la négation de la société [12]. La fonction du chef peut alors être comprise comme la négation symbolique de son groupe. La disparition d’un chef entraînant souvent l’éclatement du groupe, la tribu a donc besoin de son propre contraire pour assurer sa cohésion.
Ce rejet du chef hors de la société, dans un espace symbolique, est proche d’une Aufhebung au sens hegelien, terme multivoque qui signifie poser quelque chose, la supprimer et la maintenir à la fois, la chose niée étant en réalité conservée comme détermination idéale.
La société primitive « […] sait, par nature, que la violence est l’essence du pouvoir » [13]. Elle conçoit le pouvoir comme une résurgence de la nature. Le moyen pour la culture de ces peuples de s’affirmer comme différence majeure de la nature est ainsi de rejeter ce pouvoir à l’extérieur de la société, tout en s’identifiant à ce refus [14].
Clastres divise les sociétés en deux sortes, les sociétés « primitives » sans État et les autres, à État. Contrairement à Engels, ce n’est pas pour lui la division des classes qui détermine l’apparition de l’État, mais l’apparition de la relation commandement/obéissance. À partir d’elle, ceux qui détiennent le pouvoir ont pu inventer le travail aliéné, soit l’obligation pour le peuple de payer un tribut au maître. Dans les sociétés à État, c’est donc la société qui est endettée par rapport au chef et au pouvoir politique. Chez les Indiens, au contraire, le chef est en dette envers son peuple, dette de parole, dette de biens. Le pouvoir est donc du côté du peuple, de la société et non du côté du chef, privé de moyens coercitifs.
CONCLUSION
Nos quelques explications ne font certes qu’effleurer la vaste question du politique. Mais ces grands auteurs restent d’inépuisables sources d’inspiration pour repenser les principes du pouvoir et les structures politiques vieillissantes de nos sociétés. Une des difficultés du questionnement politique provient de l’interrelation première entre pouvoir et principe. Le principe, en grec arkhê, ou en latin principium chez Augustin, est un mot qui a toujours eu deux sens noués l’un à l’autre [15] : « commencer » et « commander ». Commencer, prendre l’initiative, c’est commander, manière d’agir le premier. Inversement, commander, c’est prendre la décision « de ce par quoi les choses bougent » et décider d’un commencement. Or on peut définir le politique comme le « principe de cohésion, qui rend possibles les sociétés humaines ». En tant que principe, il est alors une interrogation sur ce qui lie le commencement au commandement, au sens notamment du rapport entre l’autogenèse du pouvoir et la souveraineté qu’il engendre.
Cette pandémie ne pourrait-elle pas finalement se concevoir aussi comme une diversion, nous rappelant la tâche urgente de cette interrogation politique première et nous incitant à travailler plus sérieusement à nos utopies ?