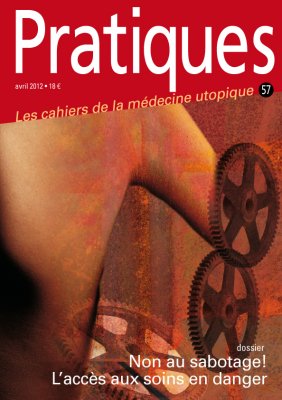Caroline Desprès,
médecin anthropologue, chercheur associé à l’IRDES
Le renoncement aux soins mesuré dans les enquêtes, notamment l’enquête Santé et protection sociale de l’IRDES constitue pour les pouvoirs publics un indicateur d’évaluation des capacités correctrices du système de protection sociale à l’égard de difficultés financières d’accès aux soins d’une partie de la population. Une recherche [1] menée en 2010-2011 montre que des logiques plurielles et intriquées président aux conduites relatives à la santé et notamment aux renoncements aux soins. Les résultats reposent sur l’analyse d’entretiens décrivant les parcours de soins au cours de la vie, chez des personnes vivant dans la région de Lille. Bien que notre étude ait porté sur des individus appartenant à des classes sociales différenciées, autorisant une dimension comparative, nous focalisons ici notre regard sur les personnes vivant des situations de précarité socioéconomique (une quarantaine) [2]. Incontestablement, de fortes contraintes budgétaires, bien qu’en parties compensées par les dispositifs tels que la CMU et l’ACS [3], expliquent le non-recours aux services ou à certains soins des plus pauvres et de ceux qui ont des ressources situées justes au-dessus des seuils. L’organisation de l’offre sur un territoire contribue et renforce les difficultés d’accès aux soins [4]. Des causes sociales et culturelles viennent orienter les conduites, telles que le rapport au corps, les représentations de la maladie et de la santé, ainsi que, et c’est la dimension que nous développerons ici, le rapport à la médecine.
Une partie des personnes dans cette recherche témoignent, par leurs actes et dans leurs discours, de leur distance à l’égard du système de soins et de la médecine [5]. Ainsi, Pascal gère ses problèmes de santé par lui-même et ne consulte plus que très rarement. Sonia (50 ans), bien que bénéficiaire de la CMU, n’a pas consulté de médecins ni de dentistes depuis plusieurs années. Les discours expriment cette distance à la médecine : « J’évite » (Sonia), « Je suis vraiment loin de la médecine en ce moment ! » (Pascal).
Ne pas consulter, mobiliser des solutions alternatives, attendre que ça passe, retarder le moment jusqu’à ce que la situation échappe sont des configurations diverses du rapport distancié aux soins, dont le renoncement constitue la forme la plus extrême. Souvent rapportées à des facteurs psychosociaux (faible estime de soi, honte par exemple), ces attitudes à l’égard du système de soins nous semblent largement déterminées par la place des individus dans l’ordre social et les effets de cet ordre social sur leur identité, les interactions entre un sujet et les institutions sociales, celles-ci faisant l’objet de règles et de normes.
Le rapport à la médecine peut être envisagé selon deux angles : celui d’un rapport à l’institution médicale dont les médecins (et d’autres professionnels de santé) sont les agents et qui doit être replacé dans le cadre du rapport à la société et en second lieu, celui d’un rapport entre deux individus dans leur singularité, mais aussi leur épaisseur sociale. Ces deux niveaux sont parfois dissociés mais, le plus souvent, ils interagissent, c’est-à-dire que le rapport à l’institution médicale imprègne la relation médecin patient. Nous aborderons essentiellement le premier qui nous est apparu prévalent [6] et le second ayant fait par ailleurs l’objet de nombreux travaux.
En préalable, rappelons que ne pas solliciter un médecin alors que l’on se sent malade est une attitude fréquente dans ces populations, expliqué par le rapport au corps et à la maladie, notamment le courage et la résistance (aux symptômes) constitutifs de l’identité masculine dans les milieux populaires. Ajoutons le risque de se voir assigner dans le cabinet de consultation une identité de malade qui s’oppose à l’identité du travailleur. Elle est vécue comme négative et le pousse à se maintenir le plus longtemps possible à distance de la médecine : par peur d’être déclaré malade alors que l’on se sent bien ou que tout au moins on gère d’éventuels désordres biologiques, par peur d’être mis en arrêt de travail ou de perdre son travail (notamment, pour tous les travailleurs qui ont des contrats précaires, travaillent en intérim).
Le rapport à la médecine s’inscrit dans un habitus, c’est-à-dire que la lecture des signes corporels qui doivent mériter une attention, les modes de gestion de ces désordres font l’objet d’un apprentissage et sont incorporés dans l’enfance dans le cadre de la socialisation des individus. Ils différent selon les classes sociales, les cultures et les sociétés. Par exemple, le moment où il est considéré légitime de solliciter une aide experte est socialement défini. « On n’allait pas chez le médecin pour un oui, pour un non ! Moi, je suis pareille. » explique Christiane. Muriel qui ne consultait pas pour des raisons financières vient d’obtenir la CMU, mais son attitude a peu évolué : « Toute seule prendre un rendez-vous pour aller voir le médecin, je l’ai jamais fait. (...) Parce que j’ai vécu sans, parce que j’ai pris l’habitude de pas le faire. Mais c’est vraiment une culture de non médecin, quoi ! Je reconnais que j’ai pas cette culture-là. J’ai pas le réflexe, j’ai pas l’habitude. »
Ces modèles de conduites évoluent en fonction de l’éducation, des connaissances acquises par divers moyens et notamment dans les rapports réguliers avec un médecin, mais aussi par les expériences concrètes de maladie. Ainsi, dans les trajectoires où survient une maladie chronique, l’individu s’approprie progressivement des savoirs sur sa maladie et la fréquentation régulière des professionnels de santé permet une familiarisation du rapport qu’il entretient avec eux.
Ce rapport à la médecine doit être replacé dans un contexte plus global, celui du rapport d’un individu à la société et aux institutions plus particulièrement. Les individus en bas de l’échelle sociale du fait de leur situation de précarité économique vivent au quotidien des processus de disqualification sociale : parce qu’ils n’ont pas d’emploi, qu’ils ne sont pas productifs et donc jugés inutiles par la société (Gaulejac, Taboada-Leonetti, 1994). Les situations d’humiliations ne sont pas rares quand ils entrent en contact avec des administrations [7], par le traitement dont ils font l’objet (tracasseries administratives, attitudes de soupçon quand ils réclament un droit, etc.) et les jugements moraux qu’ils subissent et que certains d’entre eux finissent par intérioriser, provoquant un sentiment de honte et le sentiment d’être un individu relégué par la société et de moindre valeur. La position de demandeur en soi, des décisions administratives parfois ressenties comme injustes pour des individus appartenant à des groupes sociaux où le fait de gouverner son existence constitue une valeur phare, est mal vécue et accroît le sentiment d’impuissance. Cela peut conduire à l’évitement de ce type d’interactions sociales afin de préserver leur image et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes, un repli sur la sphère privée. La position du malade à l’hôpital n’est pas meilleure ; il est plus souvent objet de soins que sujet, désarmé face aux décisions pour lesquelles il ne reçoit pas suffisamment d’information et auxquelles le plus souvent il ne participe pas. S. Fainzang (2006) a montré dans un cadre hospitalier et pour des maladies graves, en majorité des cancers, que l’information variait selon le groupe social auquel appartient le patient, délivrée de manière privilégiée aux membres des catégories sociales supérieures.
Le cabinet de consultation occupe un statut variable dans ce cadre. Les interactions apparaissent complexes, ambivalentes, souvent difficiles à gérer du fait d’incompréhensions et de malentendus réciproques. En effet, la consultation médicale reproduit les rapports de domination subis par ailleurs, parce que le médecin est celui qui détient le savoir légitime sur la maladie, savoir qui est aussi un pouvoir sur le malade (Foucault, 1976). Quand le médecin, consciemment ou non, ne fournit pas suffisamment d’informations et d’explications à son patient sur ce qu’il a, sur les effets d’un traitement, cela peut avoir des conséquences relativement directes sur le maintien dans le processus de soins. N’ayant pas bien compris les enjeux, le malade peut interrompre le traitement ou les soins. Carmen se fait opérer le lendemain de l’entretien et ne sait pas trop pourquoi. « On [8] m’a dit des « polites » (polypes) dans la gorge... J’ai jamais vu des polites, moi ! Je sais pas qu’est ce que c’est ! » Elle explique qu’elle n’a pas osé demander des explications. « Ben, parce que... Je fume de trop et il m’a dit : oui vous avez des polites (polypes). J’ai dit, c’est quoi ces trucs-là (interrogation intérieure), j’en ai jamais entendu parler, c’est la première fois... J’allais demander à mon médecin mais j’ai pas osé. (...) Je suis fort timide là-dessus... Alors je sais pas, c’est quoi comme « polite ». Mais je vais être opérée au niveau de là, il m’a dit à l’intérieur, ils vont ouvrir ma bouche, je sais pas comment ça va se passer... » Finalement, elle a attendu six mois avant de rappeler pour programmer une intervention et s’y rend en quelque sorte à l’aveuglette.
« Ne pas oser recouvre [donc] des réalités différentes. Ce peut être ne pas se permettre de franchir la barrière sociale, mais aussi ne pas vouloir prendre le temps des médecins dont on sait qu’il est précieux et qu’il leur manque. » (Fainzang, 2006).
Au déficit d’information, il faut mettre en regard les difficultés de certains patients à comprendre certains phénomènes qui touchent leur corps et à s’approprier les termes et le langage médical. En outre, une plus grande distance sociale rend l’échange plus difficile, chacun ayant ses propres références, au-delà des différences entre savoirs professionnels et savoirs profanes. La relation dissymétrique par essence, même si des travaux sociologiques ont montré que des formes de négociation étaient à l’œuvre au sein du cabinet de consultation (Freidson, 1984), l’est d’autant plus que le patient appartient à un groupe socialement dominé ou à une autre culture. Elle est de plus marquée par des rapports de classe, chaque protagoniste ayant une place définie dans un ordre social et se voyant attribuer une valeur, une place relative par l’autre. Aujourd’hui, de plus en plus deformes de contre-pouvoir ont émergé dans l’espace public et le modèle traditionnel paternaliste évolue depuis plusieurs décennies vers le modèle d’une « coopération guidée » (Collectif, 2008) mais il reste prégnant quand le patient appartient à une catégorie sociale défavorisée.
Le patient témoigne apparemment d’une forme de soumission dans l’interaction, ce qui n’empêche pas qu’il puisse opposer néanmoins une résistance. Pendant la consultation, il va éventuellement cacher des informations de manière à garder une forme de maîtrise du diagnostic et du traitement (Bazsanger, 1986 ; Fainzang, 2006). Par la suite, il choisira de suivre ou non les prescriptions, les conseils, de poursuivre le parcours de soins (examens complémentaires, orientation secondaire, etc.). Ces résistances visent à maintenir avant tout sa dignité et une identité positive.
Dans ce contexte difficile, les refus de soins à l’égard des bénéficiaires de la CMU, des traitements différenciés rapportés par ceux-ci renforcent la défiance à l’égard des médecins, des discours renvoyant à une position d’assisté. L’imposition de l’avance de frais pour être reçu constitue une négation de leurs difficultés à gérer le quotidien perçue comme une violence : « Mais si j’avais les moyens de faire l’avance de frais, j’aurais pas eu besoin de la CMU ! C’est complètement débile comme réponse ! » (Muriel) Ailleurs, ce sont des commentaires directs « Vous n’avez pas honte d’avoir la CMU » ou indirects « Ah ! vous êtes toujours à la CMU, c’est embêtant ça... L’air de dire, vous êtes à la CMU, c’est pas ici que vous devez vous faire soigner. Il va pas vous le dire ouvertement parce qu’il n’a pas le droit de refuser quelqu’un qui est à la CMU... ».
Dans certaines trajectoires de vie, la distance à la médecine se maintient, voire se renforce notamment pour des raisons économiques. À l’inverse, des rencontres peuvent transformer les relations de soins. L’instauration d’une relation singulière, la remise de soi par le sujet à son médecin, dans un contexte de maladie grave par exemple, peut transformer le rapport à la médecine. Certains parcours de soins montrent de quelle manière une rencontre entre deux personnes, un individu en quête de soin et un médecin particulier, peut réengager celui-ci dans un processus de soins. L’image du médecin de famille est encore prévalente dans ces milieux, incarnant le modèle type idéal, se référant à une forme de proximité sociale qui se construit dans le temps. Le médecin généraliste, « pas le médecin qui se prend la tête, qui se prend pour un grand seigneur ! » (Jean) incarne un intermédiaire entre la classe dominante et les classes populaires. Il constitue un médiateur entre deux mondes sociaux. Des relations de proximité voire d’amitié peuvent se nouer et nous ont été décrites comme pour Jean : « Je l’ai depuis qu’il s’est installé à N. en 1982. Je n’ai jamais changé. Ce gars me connaît mieux que moi. Il sait du premier cheveu jusqu’au petit orteil. » Cette confiance d’ordre relationnel est doublée d’une compétence. Jean souffre d’une obésité. Non seulement, le médecin le conseille, l’accompagne, mais il l’oriente vers une consultation d’endocrinologie, un nutritionniste et est en train d’évaluer l’opportunité de poser un anneau gastrique. Il a diagnostiqué également une dépression qu’il a traitée, et a su changer le traitement quand il ne convenait pas. C’est donc sa capacité à mettre à disposition de son patient les différents moyens qu’offre la médecine à un moment donné. Au-delà de l’aspect relationnel, l’efficacité de l’intervention médicale est évaluée de manière profane.
Les parcours de soins des individus visent en premier lieu à protéger une identité individuelle et sociale fragilisée, malmenée. Cela les amène à éviter des situations où ils pourraient subir des violences symboliques, comme affronter un refus ou une autre forme de discrimination qui sous-entendraient qu’ils seraient des « patients » de moindre valeur. Le monde de la maladie revêt un caractère dangereux, celui de la faiblesse, de la vulnérabilité. La médecine apparaît menaçante du fait d’une possible perte de maîtrise de son destin par le sujet, face aux professionnels qui peuvent le déclarer malade par devers lui ou parce qu’il doit se soumettre aux injonctions médicales. Il perd le contrôle de son statut dans la société. Enfin, éviter de consulter, refuser des tests de dépistage, ne pas suivre à la lettre les prescriptions constituent des formes de résistances au pouvoir des institutions sur le corps. « Au travers du silence, de la ruse, de la lutte, de la passivité, de l’humour ou de la dérision, les classes populaires savent résister aux idéologies, aux enseignements, aux prétentions de ceux qui entendent, soit dominer, soit faire le bonheur du peuple. » (Maffesoli, 1988, cité par Gaulejac et Taboada Léonetti, 1994 : p 227)
Le panel de personnes rencontrées montrent une grande diversité du rapport à la médecine, des modes d’agir avec les médecins, avec des nuances qu’il serait nécessaire d’apporter et de développer notamment selon les générations, les parcours migratoires, les parcours d’assistance sur la durée qui transforment le rapport aux institutions (Paugam, 1991). Les plus âgés, les migrants de fraîche date témoignent souvent d’une plus grande soumission et d’une meilleure observance, une délégation de leur santé au médecin, contrairement aux valeurs d’autonomie promues dans les catégories ouvrières, du Nord de la France, caractérisé notamment par un fort syndicalisme.
Références bibliographiques
Bazsanger I. (1986). « Les maladies chroniques et leur ordre négocié », Revue française de sociologie, XXVII, 3-27.
Fainzang S. (2006). La Relation médecins/malades : information et mensonge, Paris, PUF, « Ethnologies », 159 p.
Fainzang S. (2010). « L’automédication. Une pratique qui peut en cacher une autre », Anthropologie et sociétés, vol. 34, n° 1, 115-133.
Collectif (2008). « L’interaction entre médecins et malades productrice d’inégalités sociales de santé ? Le cas de l’obésité. », Groupe Intermède, Rapport final. Drees-Mire, Inserm, DGS, InVS, INCa, Canam, Irdes. Toulouse : Inserm U558, mai. 300 p.
Foucault M., (1976), Histoire de la sexualité. La volonté de savoir, Paris, Ed. Gallimard.
Freidson E. (1970). 1984 (traduction française), La profession médicale, Paris, Payot.
Gaulejac V. (de), Taboada Léonetti I. (1994). (nouvelle édition, 2007), La lutte des places. Insertion et désinsertion, Paris, Ed. Desclée de Brouwer, Coll. Sociologie clinique.
Paugam S. (1991). (4e édition, 2009), La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté, Paris, PUF, « Quadrige ».