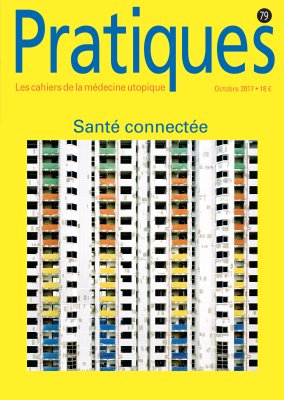Entretien avec Miguel Benasayag
Philosophe et psychanalyste
Auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels :
– Cerveau augmenté, homme diminué, Éditions La Découverte,
– La singularité du vivant à paraître en octobre 2017.
Il est membre du Collectif Malgré tout.
-
-
-
- Miguel Benasayag nous explique en quoi le projet transhumaniste et « augmentatif » est scientifiquement non viable et prépare un monde d’apartheid.
-
-
- Pratiques : Pouvez-vous nous parler des travaux de recherche qui vous ont amené à écrire Cerveau augmenté, homme diminué ?
Miguel Benasayag : J’ai commencé à travailler sur ces sujets il y a très longtemps à la Salpêtrière, avec le neurobiologiste et philosophe chilien Francisco Varela.
Ce livre fait parti d’une série de travaux. Un autre va paraître prochainement, La singularité du vivant. Je travaille en dialogue conflictuel, avec ceux qui font des recherches aujourd’hui en biologie moléculaire, sur « l’intelligence artificielle » et la « vie artificielle ».
Nous sommes dans un moment historique très particulier où les gens parlent de mécanisme du vivant, de mécanisme cérébral, de mécanisme biologique etc. Ils partent du principe, parfois implicite, parfois carrément exprimé, qu’il n’y a rien qu’on puisse appeler « la vie ».
Les fascinants développements de la biologie moléculaire, intimement associés au monde digital et à la modélisation, amènent à connaître nombre de mécanismes du vivant. Des portes s’ouvrent, ainsi que de nouvelles promesses : celle d’une « vie augmentée », d’une vie sans limite… Certains disent que nous sommes à la veille de tout connaître sur le prétendu secret du vivant, que l’on peut tout modifier, que tout est possible. En France, la figure de proue de ce mouvement est Laurent Alexandre, auteur du livre La mort de la mort.
J’ai écrit en dialogue conflictuel Fabriquer le vivant ? avec Pierre Henri Gouillon, un biologiste ; il énonce que l’ADN n’est qu’un code et qu’on peut donc l’appliquer à toute autre base, à toute autre matière ; sous-entendu : finalement, on peut dépasser les corps. J’ai lu des essais, des thèses, des articles innombrables dans lesquels les auteurs disent clairement qu’on va corriger les défauts de la nature.
C’est compliqué, car la recherche avance d’un côté avec bonne foi et de l’autre avec une mauvaise foi masquée. Le problème est que l’on confond très souvent la médecine de réparation avec une « médecine augmentative ». On va vous dire qu’on a toujours pratiqué ce type d’augmentation en médecine : on utilise des lunettes, des pacemakers etc., mais il s’agit d’une médecine de réparation, alors que la « médecine augmentative », c’est tout autre chose.
Avec Varela, j’ai fait des recherches en neurophysiologie, en particulier sur la question de l’implant cochléaire ; celui-ci est placé au niveau des terminaisons nerveuses auditives et on peut parler ici d’hybridation intrusive.
J’ai également étudié les travaux d’autres laboratoires pour savoir ce qui se passait dans les hybridations physiologiques quand un « réseau de fonctionnement » s’installe. Les chauffeurs de taxi, qui utilisent en permanence les GPS, ont leurs noyaux sous-corticaux (ceux gérant la cartographie temporo-spatiale) qui s’atrophient. Quand un enfant apprend une opération mathématique un peu complexe, on voit, grâce à l’imagerie médicale, l’architecture de son cerveau se complexifier, des neurones migrer, des réseaux s’établir ; mais si l’enfant a à sa disposition une calculette, cette architecture, cette complexification ne se font pas.
Nous sommes dans un monde qui fonctionne déjà dans un réseau hybridé, où des machines, des segments de machine et des segments de cerveau sont associés et produisent ensemble.
J’ai aussi travaillé sur la mémoire, beaucoup de crédits sont alloués pour développer des programmes de recherche sur la façon d’augmenter, modifier ou suppléer les mécanismes de la mémoire.
Ce qui apparaît en toile de fond, c’est que toutes ces recherches se font dans une indistinction totale entre les mécanismes biologiques prétendus augmentés, modifiés ou hybridés et les mécanismes technologiques appliqués ; tout se passe comme si effectivement aujourd’hui, on était convaincu que la fonction de calculabilité algorithmique était la base du fonctionnement du cerveau et que les mécanismes cellulaires, les modèles d’ADN représentaient à eux seuls le fonctionnement du cerveau.
Dans mon livre Cerveau augmenté, homme diminué, j’ai voulu parler de l’hybridation et émettre l’hypothèse que nous ne sommes pas en présence d’une vraie hybridation, mais d’une colonisation. Dans une vraie hybridation, il y a des organismes ou des entités de système qui se mélangent alors qu’ici, on passe sous silence le fait que le pôle biologique et le pôle technologique sont de nature totalement différente. Pour moi, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une vraie hybridation, mais bien d’une colonisation.
J’ai travaillé plutôt sur le cerveau parce que c’est ce que je connais et parce que le cerveau, en tous les cas en Occident, est considéré comme l’organe noble par excellence, là où il y a la pensée, les affects et les sensations. Le cerveau n’est cependant pas le seul à être « colonisé ». Toucher au cerveau, prétendre pouvoir modéliser la pensée, les affects et les sensations, c’est quelque chose de costaud ! C’est détisser toute singularité, toute frontière qui permettrait de dire : voilà ça, c’est le propre du biologique, ça, c’est le propre de la machine.
Il faut savoir que, d’après la « théorie de l’information » utilisée par le monde numérique, il est possible de recueillir toute l’information qui constitue un cerveau ou un organisme. C’est le fameux programme où les chercheurs disent : je peux modéliser et recueillir toute l’information qui est dans un cerveau, je la passe dans une machine, un disque dur, et je la mets avec des algorithmes capables d’apprendre. Concrètement, cela veut dire que, quand je modélise le cerveau de Robert, l’idée n’est pas de faire une bibliothèque où les gens pourraient venir se renseigner sur ce que pense Robert ; l’idée est, qu’avec des algorithmes capables d’apprendre, dans un système qui resterait ouvert à l’information, le Robert en question, passé à la machine, continuerait à apprendre sur l’évolution du monde, sur l’évolution de sa famille. La question qui se pose alors est : mais où est Robert ? Dans le cerveau biologique qui est en train de se corrompre ? Ou Robert n’est-il pas plutôt à « augmenter » à « améliorer » dans la machine ?
En dehors du monde de la recherche, ceci semble aujourd’hui de la science-fiction, mais, dans celui de la recherche, si on dit à n’importe quel collègue : « Tu ne peux pas modéliser entièrement un cerveau », la réponse est : « Pourquoi ? Au nom de quoi ? Tu es un ayatollah, Dieu t’en empêche ? » Ils ne disent pas que c’est fou, ils disent qu’on ne sait pas encore le faire.
La question que je pose à propos du cerveau, et à propos du vivant en général, est la suivante : est-il vrai qu’il n’y a rien qui structurellement résiste dans le cerveau, dans le vivant, à cette modélisation, à cette réduction ?
- Alors, est-il vrai qu’il n’y a rien qui résiste dans Robert à ce passage à la machine ?
M. B. : C’est vraiment une question centrale pour notre époque.
D’un côté, il y a les tenants de l’idéologie dominante qui affirment que tout est modélisable. On serait alors à l’époque d’une transformation incroyable des modes de vie sur terre parce qu’on assisterait à la possibilité d’une vie qui se passerait de corps, ces corps seraient dépassés et finalement, ce serait comme si la carte prenait la place du territoire parce qu’ils sont convaincus que le territoire n’est pas autre chose que le monde de la carte, c’est donc la dématérialisation totale. La modélisation numérique réussirait à découvrir les derniers secrets du vivant et le vivant se mettrait petit à petit à exister sous une autre forme, forme qui ne serait plus régie par ce que la biologie avec des corps connaissait jusque-là.
De l’autre côté, nous sommes une minorité de chercheurs, d’intellectuels, qui reconnaît qu’on est dans une époque dans laquelle il y a une puissance technologique formidable dont il faut se servir ; mais en même temps nous pensons que toutes ces avancées doivent apprendre à cohabiter avec des invariants et des structures biologiques et culturelles qui ne sont pas réductibles ou absorbables dans du digital.
Il y a là pour nous un vrai travail à mener : expliquer qu’il y a du non modélisable et qu’il y a une différence entre le cerveau matériel et le cerveau modélisé, et que cette différence ne se réduit pas seulement au fait que le cerveau matériel est de mauvaise qualité et va dysfonctionner. Nos contradicteurs disent qu’ils voient bien une différence : c’est que les cerveaux et les corps biologiques sont pleins de défauts et de limites, alors qu’avec la modélisation, ils vont eux vers un corps sublime.
Notre travail doit être mené sur deux plans. Il y a d’une part un travail de recherche scientifique et épistémologique, c’est ce que j’essaie de faire dans mon dernier livre et dans mon travail avec d’autres collègues, entre autres des biologistes que j’ai contactés pour créer un pôle de réflexion. Notre responsabilité historique est de bien nous renseigner si dans ce dépassement de la nature, du biologique, on n’est pas en train d’écraser quelque chose et que nous allons le regretter. Et d’autre part, il y a un travail anthropologique qui consiste à se rendre compte que le numérique va, dans un monde en crise, reformuler un système religieux de la promesse, celle de toujours, qu’elle soit platonicienne ou religieuse, qui affirme que la vraie vie est au-delà des corps, qu’elle se passe ailleurs et que les corps sont la prison de l’âme ou des algorithmes.
De mon point de vue, il y a urgence à mener ce travail : si on laisse tomber le côté scientifique et qu’on s’aperçoit, comme nous le pensons, que tout n’est pas modélisable, que la médecine Big Data qui remplace les patients par un profil est iatrogène, que le cerveau hybridé « augmenté » est un cerveau qui ne peut plus penser qui ne peut plus calculer et qu’alors c’est trop tard… ce serait vraiment dommage de ne pas avoir mené ce travail !
C’est un réel défi de comprendre maintenant qu’il y a quelque chose que les « augmentateurs », on peut les appeler ainsi, sont en train de laisser de côté. D’autant plus que du côté des « augmentateurs », il y a à la fois des gros sous, des gros intérêts et le côté « croyance », celle de la Singularity University [1] très liée à la Silicon Valley, cette croyance qu’effectivement on est dans un moment religieux où la vie va dépasser les corps. Dans un petit livre de dialogue avec le philosophe Jean-Michel Besnier, Laurent Alexandre parle des machines à faire l’amour et il dit : « Quelle est la différence si je peux avoir une machine avec laquelle je peux jouir, je peux dialoguer, si je peux provoquer les mêmes sensations. Si tout peut être reproduit avec les algorithmes, pourquoi pas ? » Si on n’est plus capable de dire quelle est la différence entre faire l’amour avec un partenaire et avec une machine, soit c’est fantastique, comme le dit Laurent Alexandre, soit c’est un symptôme grave de la crise que traverse notre culture, notre civilisation, notre société.
- Pouvez-vous nous donner des exemples à propos du « cerveau augmenté » et de sa différence avec le cerveau humain ?
M. B. : Je prendrai l’exemple des souvenirs. J’ai étudié deux programmes déjà très avancés pour tenter de modifier les souvenirs : à Buenos Aires, un biologiste César Antonio Izquierdo, fait des recherches sur un Béta bloquant et en Californie, un laboratoire travaille sur des modifications électriques des neurones.
Qu’est-ce qui fait l’identité d’un être vivant et d’un être humain en particulier ? Qu’est-ce qui fait par exemple que je sois le même aujourd’hui qu’il y a vingt ans lorsque nous avons fait ensemble ce débat sur l’exil ? Ce n’est certainement pas parce que j’ai les mêmes molécules et atomes, puisque le matériel qui compose un être vivant change en permanence. Ce qui fait cette identité, c’est cette mémoire incorporée, dans le sens qu’elle est intégrée dans le corps et dans le cerveau, c’est la mémoire active qui fait l’identité d’un être vivant.
D’un point de vue neurologique, qu’est-ce qu’une mémoire qui fonctionne bien ?
C’est d’abord une mémoire qui sélectionne les informations à mémoriser ; on ne peut pas se souvenir de tout car cela revient à ne se souvenir de rien ; je ne peux pas me rappeler la robe que vous aviez quand on s’est rencontré à la maison de l’Amérique latine et le contenu de la revue et la couleur de murs ! Une mémoire saine sélectionne ; elle le fait par rapport à un tas de données historiques personnelles et sociales : il y a des événements qui vont être des « saillances » par rapport à mon histoire personnelle et par rapport à l’histoire sociale dans laquelle je suis immergé. Une mémoire saine est aussi une mémoire qui modifie : les souvenirs ne restent pas emmagasinés dans un disque, ils sont tout le temps échangés, modifiés, articulés avec d’autres souvenirs. C’est enfin une mémoire qui oublie des pans entiers de souvenirs.
Ceux qui veulent modifier la mémoire disent : les souvenirs lourds qui te font avoir des insomnies, qui te font être névrosé, qui te font échouer, ces souvenirs-là, on va les effacer. Très bien, mais si les souvenirs sont pesants, ils le sont par rapport à un présent concret, mais après ils changent. La pire expérience subie peut devenir un trésor, parce que cette expérience-là est fondamentale dans notre vie. Si, au nom d’un confort immédiat, on efface le mauvais souvenir, on est en train de créer une sorte d’entité complètement bricolée qui n’a plus d’identité propre et qui devient donc un agrégat et si, de l’autre côté, on crée une mémoire accessible illimitée, on est dans une sorte de psychose : que serait quelqu’un qui ne pourrait ni oublier, ni modifier, ni sélectionner ses souvenirs ?
Ainsi quand des chercheurs parlent « d’augmenter » la mémoire, ils sont en train d’ignorer les invariants qui constituent la mémoire normale et saine d’un individu. C’est l’exemple même de ce qu’il faut éviter : qu’au nom de la modification, de « l’augmentation » et des nouveaux procédés techniques, on écrase ce qui constitue l’identité d’un être vivant. Ce n’est pas du tout une question de technophobie, ni de technophilie bien sûr, c’est simplement ne pas être dans cette croyance naïve, stupide et très dangereuse qui consiste à penser que « mémoire » veut dire se rappeler. Il faut faire la différence entre le mot mémoire pour un ordinateur et le mot mémoire pour un être vivant.
La problématique est la même par rapport aux émotions : certains chercheurs pensent que ce qu’on appelle amour, par exemple, correspond à tel type de fonctionnement neuronal qu’ils peuvent reproduire dans un circuit numérique sur lequel ils pourront ensuite agir pour le modifier, l’empêcher… l’hybridation, c’est cela.
Il y a un an, j’ai participé à une rencontre de neurosciences organisée par le journal Le Point à Nice à laquelle participait le Chinois qui avait joué au jeu de go contre un ordinateur. Il avait perdu, mais n’avait pas d’état d’âme parce qu’il travaillait maintenant pour la compagnie qui fabriquait les ordinateurs ; il était passé à l’ennemi ! Tout le monde disait : « L’ordinateur peut calculer des milliards et des milliards de choses ». Ils étaient tous d’accord qu’on allait tout modéliser, que l’ordinateur allait toujours gagner, qu’il était le meilleur et… arrive mon tour de prendre la parole, ils me disent « Miguel, qu’en pensez-vous ? » J’ai dit que je pensais que les ordinateurs gagnaient aux échecs depuis déjà vingt ans et que dorénavant, ils allaient gagner au go, qui est un jeu d’une complexité mille fois supérieure, mais qu’un ascenseur soulevait aussi beaucoup plus de poids qu’un bonhomme et que pour autant, je ne me disais pas que l’ascenseur remplaçait le bonhomme.
Il faut voir la question en amont : la machine n’a jamais joué au go, ce qu’on appelle vraiment jouer, elle n’a jamais gagné au go. Il n’y a aucune possibilité d’avoir une instance qui permette à la machine de se rendre compte qu’elle joue au go. La machine calcule sans aucun sens, hors de tout sens ; elle n’a pas le désir de jouer, c’est-à-dire le désir d’explorer les possibles de façon non immédiatement linéaire ou utilitaire ; elle n’a pas le besoin anthropologique, biologique de jouer, besoin partagé par les animaux et d’après certains travaux même par les plantes.
Une machine ne peut donc, ni désirer jouer au go, ni avoir besoin de jouer au go, elle ne peut ni gagner ni perdre ; c’est comme l’ascenseur : l’ascenseur ne m’a pas gagné, il n’a pas monté les valises plus vite que moi, en fait il n’a jamais monté des valises, parce que très concrètement l’ascenseur en tant qu’unité n’existe pas, c’est une série de machines assemblées. Est-ce qu’un ascenseur tout seul peut exister ? Non, lorsqu’on a un ascenseur, il faut un moteur. Est-ce qu’un ascenseur et un moteur peuvent exister ? Mais non, il faut un édifice. La machine n’a pas une unité propre qui permette de dire que cette unité-là a gagné au go face au Chinois.
Le problème de notre époque en biologie, mais aussi en anthropologie, c’est qu’on a du mal à comprendre que, pour qu’il y ait du sens, il faut qu’il y ait une unité vivante limitée, c’est-à-dire que le sens dépend de la limite : pour toute entité augmentable, modifiable, modulaire il n’y a plus de sens, or la vie est un phénomène de sens.
À Nice, il y a un an, les gens me regardaient avec gentillesse en se disant « le pauvre Miguel, il ne comprend pas ». Ils m’ont répondu : « Oui c’est vrai, il y a la question du sens, il va falloir qu’on puisse modéliser le sens », à aucun moment ils ne disent : « On a trouvé une barrière structurelle ». Quand j’ai publié Cerveau augmenté, j’ai pensé que la communauté de chercheurs en neurosciences allait me tomber dessus en disant : « Mais non, ce n’est pas exactement comme cela », mais la réponse était pire ! La réponse était : « C’est exactement comme cela et où est le problème ? C’est vrai le cerveau sera simplifié parce que le cerveau sera en circuit avec des machines intégrées et donc ce qui jusqu’à maintenant est fait par le cerveau va être fait par une machine, mais où est le problème ? » Je pense moi qu’il y a un problème.
- Quels sont les buts poursuivis par ceux qui pensent que la technologie va permettre d’augmenter toujours plus le cerveau ?
M. B. : Je ne pense pas qu’on puisse parler d’un seul but poursuivi. J’ai des amis chercheurs en robotique qui sont convaincus que petit à petit, et presque déjà maintenant, on pourrait avoir un ami robot. Il existe une application pour Smartphone, elle vous « profile » à travers une série de questions, à partir de microcomportements, puis elle reste ouverte c’est-à-dire qu’elle continue à vous profiler… Donc la machine dialogue avec vous et elle en vient à comprendre, beaucoup mieux que votre femme, que vous êtes un peu triste, que là cela ne va pas. Grâce au profilage, elle vous dit les mots que votre femme ne trouve pas, elle vous dit qu’elle vous comprend profondément… En plus, grâce au profilage et au fait d’être branchée sur le réseau, la machine peut vous proposer de lire ceci, de regarder cela… J’ai vraiment des amis roboticiens qui sont dans la recherche de pointe et qui me disent « Mais alors, où vois-tu le problème si une machine peut t’accompagner, peut être effectivement là auprès de toi et dialoguer avec toi ? »
Il ne s’agit plus là d’une machine qui nous rappelle, par exemple, qu’on doit prendre nos comprimés, mais d’une machine qui nous aide pour tout. Là, ce n’est pas un problème technologique qui se pose, mais un problème anthropologique si on n’est plus capable de savoir ce qu’on nommait amitié et quelle est la différence entre un ami et un robot si gentil, qui peut même devenir un partenaire sexuel extraordinaire, si on n’est plus capable de dire : toutes ces fonctions remplies n’ont rien à voir avec ce qu’on appelle amour, sexe ou amitié.
Aujourd’hui, anthropologiquement, notre société est incapable de dire cette frontière-là et ne croit même pas qu’elle existe. Tous ces mécanismes qu’on appelle connectés créent un monde d’individus isolés, déconnectés d’eux-mêmes et de tout autre.
Je ne vais pas dire à un chercheur en robotique : « Arrête ne fais pas un robot copain, parce que je m’interroge d’un point de vue psychologique, biologique et anthropologique… » mais je me dis : « Mais qu’est ce qu’on appelait amitié ? » Et bien aujourd’hui, on ne peut plus répondre en nommant quelque chose qui ne soit pas transformable en fonctions robotiques ou alors les réponses évoquent des thèses vitalistes ou des thèses spiritualistes qui ne sont donc pas recevables.
Il y a aussi des gens qui se scandalisent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point, dans leur vie quotidienne, ils fonctionnent déjà dans une hybridation. Nos contemporains n’ont pas encore les petits robots copains ou prostitués mais, sans qu’ils s’en rendent compte, ils sont avec leurs Smartphones dans une sorte de dialogue qui les formate, qui les referme sur eux-mêmes. Le problème qui existe d’un point de vue psychologique est qu’on ne se rend pas compte comment l’interaction, je ne dirai pas le dialogue, avec des machines « intelligentes », modélise très rapidement le mode de pensée, d’énoncé, d’imaginaire de la personne qui les utilise.
Le travail de création de robots humanoïdes est facilité parce que, parallèlement, l’humain en question se simplifie. Par simplification il ne faut pas entendre quelque chose de complotiste, d’horrible, c’est beaucoup plus simple : c’est le phénomène de la délégation des fonctions qui fait que le cerveau n’a plus à faire ce qui est fait par un autre organisme, de même que dans la coévolution et la cohabitation entre les espèces, il y a eu des échanges de fonction. Toutes les fonctions que le cerveau ne remplira plus seront remplies par la machine et, parallèlement, notre fonctionnement s’adaptera aux catégories de la machine. Dans cette création d’une « vie ou intelligence artificielle », il y a deux côtés : de l’un, on essaie de créer quelque chose qui ressemble au vivant et de l’autre, le vivant se simplifie.
Il s’agit vraiment de savoir s’il existe ou non une singularité du vivant, une singularité du cerveau. Par exemple, si l’ordinateur calcule des milliards de fois plus vite que le cerveau, ce dernier ne fait pas que calculer, seulement on a omis d’étudier ses autres fonctions. Les laboratoires de recherche travaillent d’abord vers là où vont les crédits et l’intérêt du plus grand nombre et laissent de côté les autres sujets ; il n’y a pas de programme sérieux et financé pour comprendre toutes les fonctions non calculantes non algorithmisables du cerveau.
Pour moi, quand on dit que le cerveau est une machine, on oublie au moins 70 % de son fonctionnement. Parallèlement, avec tous les travaux de la microbiologie actuelle, on se rend compte que les fonctions de production affective et perceptive ne sont pas exclusives du cerveau, mais qu’il y a une interdépendance avec la flore intestinale. Il y a vraiment un réductionnisme actuel qui ignore qu’on est en train de modéliser des couches de surface de processus linéaires qui sont certes très intéressants, mais n’ont rien à voir avec la complexité réelle du vivant.
La question que je me pose est la suivante : comment peut-on se servir des machines sans tomber dans la croyance religieuse à laquelle j’ai déjà fait référence que la machine ou l’algorithme sont la vérité du vivant ? Comment peut-on faire une réelle hybridation dans laquelle on reconnaisse la nature profondément différente entre la machine algorithmique et le vivant ?
C’est d’une part tout un travail anthropologique, parce qu’il est très important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un moment historique dans lequel des avancées technologiques objectives vont changer le monde, et qu’il faut s’y adapter et d’autre part, un travail en biologie et en épistémologie pour essayer de dégager s’il existe, comme je le crois, ces barrières.
- Dans ce numéro de septembre du Monde Diplomatique, il y a un article à propos de « La quête du soldat augmenté » et du complexe militaro industriel qui est derrière ces recherches.
M. B. : Ce qui est évident pour moi, c’est que tout le délire transhumaniste de l’homme augmenté, la réalité augmentée, le soldat augmenté, est loin d’être un monde neutre de la technique et de la science, c’est le monde du néolibéralisme, celui de l’empire, de l’écrasement de toute multiplicité et de toute différence.
Je connais beaucoup de chercheurs qui sont hyper enthousiastes dans leur travail et laissent de côté toute réflexion sur la signification historique, politique, philosophique, anthropologique de ce projet, mais le projet en lui-même est hautement réactionnaire parce que toute réalité augmentée, toute vie augmentée, tout homme transhumaniste, ne peut être que l’homme de l’apartheid, l’homme qui utilise les autres êtres humains, tout le vivant et l’ensemble du monde comme des matières premières pour leur profit.
Je vous donne un exemple : Laurent Alexandre a dit une fois dans une conférence : « Vous pouvez vivre mille ans », je parlais après lui et j’ai dit : « D’accord, admettons qu’une partie de vous puisse vivre mille ans, mais pour cela, il va falloir que vous consommiez toutes les matières premières de l’Afrique ».
Le transhumanisme et tout ce délire « augmentatif », non pas dans la tête des chercheurs concrets, mais dans la tendance générale et dans la tête bien concrète des Américains de la « Singularity University », c’est un projet de domination archiréactionnaire. En France, comme tout doit être faussement complexe, l’association transhumaniste essaie de vendre des concepts à la française et parle de « transhumanisme de gauche », concept qui ferait rire si le sujet n’était pas aussi grave.
Je pense que, au-delà de la naïveté et de l’ignorance des chercheurs, le projet transhumaniste et augmentatif est un projet scientifiquement non viable qui dessine un monde de domination, d’écrasement. C’est un projet pour une toute petite minorité, essentiellement réactionnaire et d’apartheid s’opposant à toute solidarité, à toute croissance partagée, à toute justice sociale. Ce projet dit : la vie c’est l’individu, on peut augmenter la vie de l’individu. Nous, nous disons : la vie c’est justement ce que nous partageons et qu’il faut protéger.