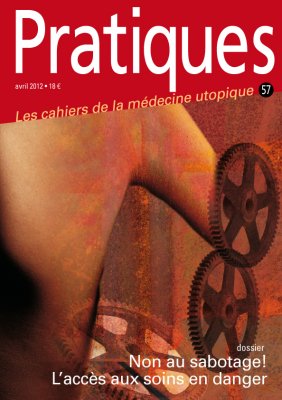Entretien avec Roland Gori,
psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie clinique à l’Université d’Aix-Marseille.
Dernier ouvrage publié : La dignité de penser, Paris, LLL, 2011.
Pratiques : Vous êtes un des initiateurs de l’Appel des appels, pouvez-vous nous parler de votre cheminement ?
Roland Gori : Mes recherches ont évolué ces dernières années. Après m’être intéressé aux conditions de validité des théories et des pratiques psychanalytiques, je me suis toujours plus préoccupé des rapports existant entre les formes de savoirs, les types de pratiques thérapeutiques en psychopathologie et les formes de pouvoir. Je suis donc passé d’un intérêt pour l’épistémologie des psychopathologies à des recherches davantage centrées sur le rapport aux politiques du soin. On n’est pas dans la même société selon les conceptions que l’on se fait du soin. Car le soin ne se déduit pas seulement des sciences qui contribuent à l’avancée de la médecine, il dépend de l’art du médecin et aussi de la culture des sociétés au sein desquelles il est mis en œuvre.
À l’époque moderne, la médecine n’est pas seulement une science et une pratique professionnelle, elle constitue aussi une pratique sociale qui participe à la direction des consciences individuelles et collectives. À la fin du XVIIIe siècle, l’effacement des grands récits, des grands messages qui donnaient une légitimité sacrée au pouvoir produit une crise de l’autorité. L’autorité n’étant plus assise sur du « religieux », le pouvoir se tourne vers les sciences, en particulier les sciences de la santé pour retrouver une légitimité. La médecine et les sciences psychologiques constituent des modalités de légitimation sociale des décisions politiques. Ces savoirs et ces pratiques, par l’utilité sociale qu’ils offrent, deviennent des modes de gouvernementalité des conduites des individus et des populations. Cette civilisation des mœurs, au nom de la raison sanitaire, conduit à une médicalisation de l’existence consistant à dire aux populations comment elles doivent se comporter pour bien se porter.
Avec la naissance de la psychiatrie moderne, un nouveau pas est franchi. C’est ainsi qu’au début du XIXe siècle se mettent en place des institutions de normalisation et de contrôle social auxquelles appartient la psychiatrie qui vient d’éclore comme savoir et comme discipline médicale. L’utilité sociale de la psychiatrie est d’essayer de répondre à la question que lui pose la société, c’est-à-dire comme le disait Foucault, « comment le criminel peut ressembler à son crime avant même de l’avoir commis ».
Le rêve positiviste de la fin du XIXe, celui d’administrer scientifiquement le vivant, vient nourrir tous les totalitarismes politiques du XXe siècle. Ce rêve se transforme en cauchemar lorsqu’au nom de la santé, les totalitarismes nazis et staliniens accomplissent les plus grandes barbaries, exécutent les plus grands crimes contre l’humanité. Cette alliance du politique et du sanitaire accompagne l’émergence d’une nouvelle figure anthropologique, celle d’un « homme économique », homme rationnel, productif dont les actes sont toujours plus rationalisés par l’hygiène et la physiologie. La rationalisation du temps, de l’espace et de l’usage des corps répond aux exigences de la production industrielle. Les patients sont conduits à se représenter leur corps comme une machine physiologique et une fabrique économique. Le rêve de l’« homme-machine » était sur le point de s’accomplir à la fin du XIXe siècle. Or, c’est justement à ce moment-là que la psychanalyse émerge à partir de la clinique de certains patients qui mettent leur corps « en panne », détournent leur fonction physiologique pour exprimer les blessures de mémoire de leur histoire. Ces « pannes », ces « grèves » des corps, ont valeur de symptômes. Ces symptômes n’obéissent pas à l’anatomie, à des causalités anatomophysiologiques, ils obéissent à d’autres formes d’expression, à des manières de parler de conflits intérieurs ou intersubjectifs. La découverte freudienne, dans son compagnonnage avec les patients hystériques, est la reconnaissance d’une vérité singulière qui vient s’opposer au savoir économique et médical de l’époque, à ce réductionnisme positiviste qui assure l’hégémonie de certaines formes de savoir, largement de retour aujourd’hui.
Il existe un malentendu fondamental qui vient du fait que l’on confond le savoir et la science. La science suppose une certaine ascèse dans la manière à la fois de procéder et d’interpréter les résultats. Par contre le savoir, c’est-à-dire « ce qui flotte dans la culture à un moment donné », est du côté des « genres » de discours acceptables, de la « grammaire » des discours admissibles par le social à une époque donnée. La sémiologie de Babinski est du côté de la science, mais la théorie qui à l’époque localise dans le cerveau l’origine des troubles psychiques provient des savoirs alors en vogue, ceux d’un homme-machine, machine physiologique autant qu’économique.
Un de mes axes actuels de recherche est de montrer le lien inséparable entre les formes de savoir, les formes de pouvoir et les pratiques sociales. Ce qui ne veut pas dire bien évidemment que les découvertes scientifiques soient des constructions sociales. Simplement, cela veut dire qu’à un moment donné et dans une société donnée, certaines formes de savoir sont favorisées ou empêchées et qu’elles ont ainsi un effet sur la diffusion, la promotion ou la censure des connaissances scientifiques. Aujourd’hui, par exemple, si on explique plus facilement le trouble de l’hyperactivité et de l’attention de l’enfant par des vulnérabilités génétiques, un tel savoir est privilégié dans une société sécuritaire qui traque les risques avec une profusion de technologie et une forte tendance à la médicalisation. En gommant les éléments d’histoire, de sens et de contexte, cette forme de savoir disculpe la société de la part qui est la sienne dans la fabrique des symptômes et, en particulier, la surstimulation que subissent les enfants, celle du spectacle et de la consommation. Il n’y a pas d’immaculée conception des savoirs et des pratiques.
Lorsqu’entre 1985 et 1992, aux États-Unis, la psychiatrie à la mode casse le diagnostic de « phobie sociale » au profit de celui de « trouble de l’anxiété sociale », on multiplie par six ou sept le nombre de patients pouvant bénéficier du Paxil® (Deroxat® en France) grâce à une forte campagne publicitaire des laboratoires pharmaceutiques et un accroissement toujours plus grand de l’intolérance sociale aux troubles du comportement. Voilà comment la psychiatrie et les industries de santé ont médicalisé nos émotions et comment, entre 1952 et 1994, on a multiplié par quatre le nombre des diagnostics psychiatriques et comment, entre 1979 et 1996, on a en France multiplié par sept le nombre de patients diagnostiqués dépressifs. Le diagnostic psychopathologique est moins le résultat de nouveaux procédés scientifiques que celui d’une véritable « transaction » entre les souffrances des patients, les seuils de tolérance sociale d’un pouvoir politique, les formes privilégiées de savoir alors en vogue, les préjugés, la formation et les modalités d’exercice des experts. C’est par l’évaluation des savoirs que passe aujourd’hui la censure sociale et celle des préjugés culturels.
Aujourd’hui, la censure politique va moins porter sur le contenu d’un discours que sur son genre et son canal de communication. Vous pouvez dire à peu près tout ce que vous voulez, mais on va vous obliger à passer par un canal de communication donné et une procédure obligée. En médecine et en psychologie, de manière générale chez les universitaires ou les soignants ou les enseignants, ce canal obligé, c’est la nouvelle forme prise par l’évaluation, c’est-à-dire celle des critères formels et quantitatifs. Vous pouvez pratiquer comme vous voulez, sauf que pour être accrédités, il nous faut répondre à un certain nombre de critères formels, quantitatifs, soi-disant objectifs, c’est cette « objectivité » purement formelle que j’appelle une « objectivité d’eunuque ». C’est-à-dire une objectivité qui semble ne pas prendre parti, mais qui pourtant ne va retenir comme valable que le quantitatif, le formel, la part bien souvent la plus technique, la plus conformiste des actes de soin et de connaissance. Les formes actuelles de l’évaluation se déduisent purement et simplement de ce que j’appelle une « pensée pratico-formelle », c’est-à-dire un mode de rationalité qui est celui du droit et des affaires. On ne mesure sûrement pas la valeur, on se contente d’évaluer le degré de conformité des procédures. C’est vrai pour le soin comme pour la recherche. On tyrannise aujourd’hui tous les champs professionnels de cette manière. Ce qui ne passe pas par le calibrage des canaux de communication, déterminés par cette manière de penser le monde, n’a pas d’existence. Les revues qui n’obéissent pas au mode de production formel exigé par la tyrannie des chiffres des experts n’existent pas, elles n’ont pas de valeur, ce qu’elles publient n’a aucune reconnaissance sociale. Il en est de même des actes de soin. C’est cela que je nomme avec Alain Abelhauser et Marie-Jean Sauret La folie évaluation (Paris, Mille et une nuits, 2011). Cette folie affecte principalement des savoirs et des pratiques qui prennent en compte l’histoire, le sens et le contexte des symptômes et se maintiennent à distance des traitements techniques et numériques de l’information très à la mode dans une médecine et une psychologie obsédées par l’épidémiologie, le dépistage des facteurs de risques des populations plus que soucieuses de la clinique individuelle.
Pour la première fois dans l’histoire depuis la naissance de la psychanalyse, on est face à une psychiatrie sans référence à une psychopathologie compréhensive du patient et de son histoire. Ce « massacre » a été accompli avec les versions III (1980) et IV (1994) du DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). En France, c’est vers la fin des années 1980 que la spécificité de la psychiatrie disparaît : l’internat en psychiatrie ne provient plus d’une vocation, mais est fonction du classement de l’étudiant en médecine aux ECN (Épreuves classantes nationales). C’est aussi à ce moment-là que disparaît la spécificité de la formation et de la fonction de l’infirmier psychiatrique. Il y a une espèce de gommage anthropologique de la souffrance psychique, de sa spécificité, de ses dimensions subjectives et sociales au profit d’une médicalisation qui commence par le changement de statut et de formation de ceux qui la prennent en charge.
La psychiatrie a toujours été au carrefour du politique, du médical, du social. Son « utilité sociale » est extrêmement importante, parce qu’elle fabrique des normes d’individuation et légitime des normes de comportement social. Au XIXe siècle, on commence à faire rentrer des psychiatres dans les prétoires. Là, ils ne tiennent pas un discours de psychiatres, ils n’ont pour but ni de diagnostiquer ni de guérir, ils tiennent un discours qui est en compliance avec les exigences des procédures du droit et des procédures pénales. Foucault montre comment les diagnostics répondent aux nouvelles exigences de la biopolitique des populations. C’est bien évidemment plus idéologique que scientifique. Par exemple, en ce qui concerne les mœurs, il suffit qu’en 1980 on retire l’homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel pour guérir du même coup des millions de « malades ». Les diagnostics psychopathologiques ne sont pas « naturels », ils résultent de « négociations », de « transactions » avec les exigences des savoirs qui participent à les fabriquer, lesquels émergent de la niche écologique d’une culture. Or il s’est passé quelque chose à cette époque-là qui a vu apparaître avec le DSM III cette nouvelle façon de penser le fait psychiatrique.
Il s’est passé quelque chose dans la culture depuis les années 80 dont on peut se demander si le DSM III ne serait pas le signe ? Mon hypothèse c’est que sa « réception » par la culture américaine des années 80 n’est pas du tout liée à un évènement scientifique majeur, mais aux conséquences d’une révolution anthropologique et culturelle en train de s’accomplir dans la nouvelle civilisation des mœurs. Cette révolution anthropologique est magnifiquement évoquée par Pasolini dans son article sur « la disparition des lucioles » de 1975. Pasolini prend la voie de la métaphore littéraire pour rendre compte d’une catastrophe politique en train de se produire en Italie. De même qu’insidieusement et à la suite d’une catastrophe écologique, les lucioles ont disparu en Italie, de même la « religion du marché » de la société de consommation a fini par remplacer toutes les religions et leurs éthiques traditionnelles. Il n’y a plus eu d’autre figure anthropologique que celle de l’« homme de la consommation ». Et avec Michel Foucault, on pourrait ajouter que le sujet se réduit dans le même mouvement à un individu « entrepreneur de lui-même ». C’est avec cette nouvelle civilisation des mœurs que se construit la « nouvelle » psychiatrie. Et elle le fait toujours plus à la lumière du sécuritaire. Ce avec quoi le pouvoir libéral a toujours eu le plus d’affinités électives, c’est bien avec le sécuritaire et ses dispositifs de surveillance et de normalisation sociales light.
Cette mutation dans la manière de penser la psychiatrie est d’autant plus aisée à ce moment-là que la médecine toute entière est en train d’évoluer vers les modes statistiques et probabilistes de raisonnement. Dans la statistique, le sujet n’existe pas, c’est un pur « segment de population ». Et les savoirs médicaux et psychologiques se recomposent en ce sens, en changeant leur manière de penser, en changeant les figures de la rationalité médicale. Ce n’est plus la prise en charge d’un malade par un médecin, dans le colloque singulier, à des fins de guérison, ou de traitement. On passe à la mise en place de dispositifs sanitaires prenant en charge des populations, déterminant leur degré de risque et accompagnant par différents moyens cette gestion des risques pour prévenir les maladies ou les risques de récidive. La remédicalisation de la psychiatrie va sérieusement appauvrir son champ et ses méthodes.
Quelles peuvent être les raisons d’espérer avec l’Appel des appels ?
Quand nous avons lancé l’Appel des appels, avec Stefan Chedri fin 2008, nous voulions partager et analyser avec d’autres praticiens et universitaires le « malaise » social et subjectif des professionnels. Nous sommes presque à 90 000 signataires aujourd’hui et les gens ont réagi très vite par rapport à nos analyses. Nous avons fait le constat que le pouvoir politique dans le monde occidental recomposait les savoirs et les pratiques, au nom de l’idéologie d’un « homme économique ». Ces savoirs recomposés vont modéliser les pratiques au moyen des nouvelles formes de l’évaluation dont rien ne nous dit qu’elles deviennent plus rentables économiquement, et qu’elles soient humainement acceptables. Que vous preniez les magistrats, les médecins, les infirmières, les chercheurs, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les enseignants, les journalistes, les acteurs culturels et j’en oublie, on constate qu’aujourd’hui, nous sommes dans une civilisation, qui demande à ces métiers de s’aligner sur une logique d’audimat, c’est-à-dire selon une logique d’évaluation chiffrée, quantitative, formelle. Ce dispositif est très conformiste, ce en quoi il répond aux exigences sécuritaires du pouvoir. Avec la culture du chiffre dans tous les domaines, vous avez finalement la mise en place d’un modèle très particulier de « donation » du monde et de la manière d’entrer en relation les uns avec les autres et avec soi-même. On s’aperçoit que dans ce modèle dominant, il s’agit finalement de rien d’autre qu’une façon de traiter l’homme et la nature comme un fonds énergétique à exploiter à l’infini.
Du coup, la psychanalyse, la phénoménologie, la philosophie critique, la sociologie critique, les médecines alternatives sont difficilement solubles dans ce modèle-là parce qu’elles ne portent pas les mêmes valeurs. Lorsqu’il faut cent interventions chirurgicales dans un service de chirurgie pédiatrique pour équilibrer le budget et qu’il n’y en a eu que cinquante, le nouveau « manager » qui dirige l’hôpital peut dire à l’équipe médicale qu’il en manque cinquante ! Alors que faut-il faire ? Aller écraser des gamins à la sortie des écoles ? On est « tombés » dans quelque chose de monstrueux, une sorte de « disparition des lucioles ». Je crois que l’Appel des appels a constitué, à un moment donné, une force de résistance à ces dispositifs de soumission sociale librement consentie, de servitude volontaire.
Canguilhem avait bien montré que l’horizon des sociétés de la norme n’était rien d’autre que l’organisation des sociétés animales au sein desquelles finalement chaque individu n’est rien d’autre qu’un segment de l’espèce, qu’une pièce fonctionnelle des exigences de la collectivité pour produire. Des choses tout aussi inutiles que l’art, le jeu, la poésie, l’amour, sont pourtant essentielles pour construire l’humain. Il est nécessaire de rappeler au pouvoir que les choses inutiles sont parfois essentielles pour le développement humain. Si un individu est réduit aux tâches qu’on exige de lui, si on ne se préoccupe que de son adaptation aux exigences de l’économie, on risque de le transformer au mieux en animal, au pire en machine ! Ce à quoi résistent les indignés. Ce qu’ils disent en gros, c’est qu’il y a une financiarisation de l’humain, qui fait que chacun d’entre nous risque de devenir un « surnuméraire ». C’est une posture morale et psychologique orpheline d’une volonté politique, qui vient nous rappeler le vieil impératif kantien : « une chose a un prix et un homme a sa dignité ».
Alors est-ce que cela peut durer, ça c’est un autre problème. Va-t-on aller vers un refondement de la démocratie ? Parce qu’au fond, la dictature des chiffres fait que la démocratie a été confisquée par la technocratie. Nous sommes dans une forme dégénérée de démocratie qui s’appelle la démocratie de l’expertise appuyée par une « démocratie d’opinion », fruit de la « société du spectacle ».
Pour avoir la paix, il faut la justice sociale, donc un système de répartition, un accès de tous à la santé et à l’éducation. Le néolibéralisme a détricoté depuis trente ans ce « bien commun » d’un État social qui s’était installé après la deuxième guerre mondiale. Cette nouvelle manière néolibérale de penser le monde nous a sidérés, tel un traumatisme. À l’université, à l’hôpital et ailleurs, paf ! C’est tombé. Aujourd’hui, nous sommes toujours plus nombreux à réagir à ce traumatisme, parce que justement, on a des concepts pour l’analyser et se déprendre de la sidération. Nous ne sommes pas encore guéris, nous avons le diagnostic, mais pas encore le traitement. Nous sommes aujourd’hui dans un système social qui confisque la pensée au profit du traitement numérique des données. Et franchement, je pense que l’on ne peut pas traiter cette nouvelle maladie de civilisation en dehors du champ d’une politique des métiers et de leur transmission.
Propos recueillis par Sylvie Cognard et Anne Perraut Soliveres