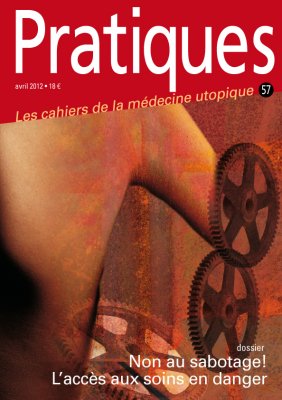Antoine Rode,
sociologue
Introduction
Diabète et hypertension. L’annonce du diagnostic tombe comme un couperet pour cet homme rencontré dans un centre d’examen de santé [1], lui qui avant expliquait « ne jamais fréquenter les médecins » et n’être « jamais malade ». La dernière fois qu’il a consulté un médecin généraliste, c’était il y a un peu plus de deux ans, pour une fracture au pied. Il ressentait bien une certaine fatigue chronique, mais qu’il mettait sur le compte de ses conditions de travail difficiles, propres selon lui au secteur du bâtiment. Sa situation n’est pas rare. Quel soignant n’a pas déjà eu à diagnostiquer, chez des personnes inconnues jusqu’à la consultation, des pathologies qui auraient dû être prises en charge plus tôt ? Toutes ces personnes « invisibles » du système de soins font l’objet, en France, d’une attention croissante de la part de professionnels de la santé, d’acteurs associatifs ou politiques. Plusieurs raisons expliquent pourquoi des acteurs aussi différents s’y intéressent et, pour certains, cherchent à agir dessus spécifiquement [2]. Suivant un gradient social [3], ces situations seraient notamment intolérables puisqu’elles contribueraient aux inégalités de santé [4] et témoigneraient de l’ineffectivité du droit aux soins, attribut de la citoyenneté sociale [5].
Dans ce contexte, la recherche en épidémiologie ou en sciences sociales, entre autres, est interpellée pour aider à identifier qui sont ceux éloignés du système de soins et pourquoi ils se retrouvent dans ces situations. C’est pour répondre à cette dernière question que nous avons mené une enquête sociologique. Partant du postulat que les individus concernés ont un certain savoir à reconnaître et à intégrer dans l’analyse, nous avons réalisé des entretiens avec ceux identifiés, par les partenaires de notre recherche [6], comme étant précaires et en non-recours aux soins [7]. La démarche a été celle de la sociologie dite compréhensive, la mieux à même de saisir les logiques d’action et de reconstruire le sens que les individus donnent à leurs situations et expériences
Faire face aux obstacles à l’accès aux soins
L’éloignement du système de soins est la conséquence, tout d’abord, des obstacles auxquels se heurte une personne lorsqu’elle exprime une demande de soins. Le coût des soins en est un, central, et rappelle le rôle important de la couverture maladie complémentaire — dont l’accès et la qualité sont très inégaux [8]. Les entretiens permettent de distinguer d’autres types d’obstacles, produits par la distance géographique, la stigmatisation ou les discriminations dont font l’objet certaines personnes. Les témoignages de refus de soins, par des professionnels de santé, en sont l’une des traductions. Chacun à leur manière, ces obstacles dissuadent ou empêchent concrètement de recourir aux soins. Mais ils génèrent également de la frustration pour les individus qui y sont confrontés. Celle-ci est liée à la conscience d’une restriction de consommation de soins, autrement dit au décalage entre le souhait et la réalisation de ces derniers. Il n’a pas été rare d’entendre, dans les entretiens, la critique d’un système de soins excluant, où « ceux qui subissent sont toujours ceux qui sont au plus bas niveau de la santé, et au niveau des revenus les plus bas ».
Le constat de ces difficultés, déjà documentées [9], arrive sans grande surprise. C’est la raison pour laquelle nous ne les développons pas plus.
Pour autant, le mythe de l’égalitarisme, qui veut que chacun puisse bénéficier du droit aux soins de manière égale, a la peau dure en France — un ancien ministre n’avait-il pas avancé récemment, lors du débat sur le bouclier sanitaire, « quel Français peut dire qu’il a dû renoncer à des soins pour des raisons financières ? Cela n’existe guère » [10] ? Une vigilance continue doit ainsi être exercée pour repérer les inégalités d’accès et de recours aux soins, liées à la configuration du système de soins, à son fonctionnement et aux changements qui l’affectent. Pensons à l’augmentation et à la diversification des frais de soins laissés aux usagers ou au durcissement des critères permettant aux populations vulnérables de bénéficier d’une couverture maladie, par exemple dans le droit à l’Aide Médicale de l’État. Les remontées d’informations de ceux qui sont les témoins directs et réguliers de ces difficultés, en particulier les médecins généralistes [11], sont à ce titre précieuses.
Automédication et recherche d’autonomie à l’égard de sa santé
Une chose est de pointer les obstacles provoqués par le système de soins, une autre est de penser que toute inégalité d’accès et de recours aux soins s’y résume. Prenons l’obstacle financier aux soins. Illustration parmi d’autres, les expériences de soins gratuits démontrent bien à leur manière en quoi, une fois levées les barrières de ce type, elles n’arrivaient pas toujours à toucher les personnes précaires, qu’elles visaient prioritairement. Comprendre l’éloignement du système de soins nécessite alors d’être attentif à la non-demande de soins. Le désir d’être autonome est, selon les personnes interrogées, une manière d’expliquer pourquoi elles n’ont pas eu de contact avec le système de soins au cours des dernières années. Nous l’observons dans la mise en avant de savoirs et de pratiques en matière de santé et de soins. Nombreuses ont été les personnes qui ont pris plaisir à nous raconter, de manière fine et détaillée, comment elles savaient « être [leur] propre médecin ». Les symptômes ressentis sont traités par le biais de l’automédication, qui se matérialise par exemple dans l’usage de réponses « naturelles » ou « biologiques » (les myrtilles pour la vue, le lait pour l’infarctus...), de médicaments sans prescription (puisque « un cachet c’est un cachet, ça marche pour tout ») ou d’autres « trucs de grand-mère ». On aurait pu faire tout un inventaire de ces pratiques jugées « efficaces » par les personnes rencontrées. Toutefois, il ne rendrait pas compte d’un principe défendu par ces dernières : avoir recours à de l’automédication, en lieu et place de la consultation d’un professionnel, ne signifie pas faire n’importe quoi avec sa santé. Certaines règles doivent être suivies. Parmi celles-ci, la transmission et l’acquisition des pratiques d’automédication apparaissent comme un gage de sérieux. Ainsi de cet homme qui utilise une infusion d’orties pour réduire son cholestérol, celui-ci étant « dans le rouge » d’après les examens réalisés il y a plus de trois ans. En nous donnant la « recette », apprise de son frère, cet homme insiste sur la nécessité de « faire comme je vous ai dit » pour qu’elle fonctionne et qu’elle n’entraîne pas d’effets indésirables.
Les trois significations de l’autonomie
La référence à l’autonomie permet de comprendre pourquoi une partie des personnes ne considèrent pas leur situation de non-recours comme étant un « problème » ou un « risque ». Elles veulent décider et intervenir seules sur ce qu’elles interprètent comme un symptôme ou un trouble, ou sur ce qui a été diagnostiqué par un professionnel de santé dans le passé. Dépassons à présent cette conception commune et sommaire de l’autonomie — celle d’agir de soi-même — pour aborder successivement trois de ses significations, telles qu’elles sont ressorties des entretiens.
Dans la première signification, si l’autonomie est présentée comme un choix par les personnes, c’est d’abord et avant tout un choix par défaut. Il s’agit de prendre en charge soi-même ses problèmes de santé parce que l’on ne peut pas faire autrement, faute de ressources financières suffisantes, ou parce que l’on ne veut plus entrer en contact avec les institutions de santé et leurs professionnels. Les expériences de fréquentations de ces derniers, par le passé, sont ici déterminantes. Le sentiment de ne pas avoir été entendu par les soignants ou, entre autres, d’avoir été mal (ou moins bien) traité que d’autres, nourrit un déficit de confiance dont les effets se font ressentir sur la valorisation de l’autonomie. C’est dans ce sens que l’on peut interpréter la situation d’une jeune fille qui insiste sur la volonté de se soigner elle-même, avec les huiles essentielles ou en « laissant le corps agir », plutôt que de recourir aux médecins. Elle retient des derniers contacts qu’elle a eus avec eux qu’ils font « du chiffre », ne prennent pas soin de leurs patients, ne sont « pas trop trop compréhensifs » et « bombardent trop de médicaments ». Ici, la confiance n’y est plus puisque la consultation éventuelle d’un médecin est synonyme d’une forte prise de risque (risque dans l’attitude et les compétences du soignant comme dans l’effet du traitement donné).
Deuxième aspect, le choix de gérer soi-même un symptôme plutôt que de consulter directement un professionnel de santé est expliqué, non plus parce qu’on ne peut faire autrement, mais parce qu’on « n’a jamais été très médecin », qu’on « n’aime pas aller » chez les médecins ou qu’on n’est pas « du genre à [y] aller toutes les cinq minutes ». Les personnes renvoient leur absence de contacts avec le système de soins à une préférence très personnelle. Lorsqu’on leur demande pourquoi elles ont ce type de préférence, il leur devient difficile de trouver une raison précise, objective. Il est question de manières d’être fortement intériorisées. Finalement, c’est parce que « je suis comme ça ». Toutefois, l’analyse des entretiens donne à voir autre chose que des choix très individuels. En demandant aux personnes comment elles étaient soignées étant jeunes, on s’aperçoit qu’elles étaient fortement exposées à des contraintes en matière d’accès aux soins, par exemple parce qu’elles vivaient dans une région ou un pays où l’offre de soins était rare ou parce que leur famille n’avait pas les ressources financières suffisantes pour soigner l’ensemble des enfants. Ce qui est intéressant, c’est que ces contraintes ne sont présentées qu’à propos du passé, pour justifier l’absence de soins donnés par les parents notamment. Mais elles ne le sont plus une fois qu’il est question de l’absence de soins à l’âge adulte. Pour le dire autrement, si les raisons objectives d’être en non-recours aux soins valent pour leurs parents, l’intériorisation progressive d’un rapport distant aux soins fait que, in fine, celui-ci n’est pas remis en cause par nos interlocuteurs. Les préférences ainsi exprimées sont à analyser comme le résultat de ce processus. Nous retrouvons ce qu’énonce Claude Martin, pour qui « les contraintes qui pèsent sur certaines couches sociales ou certains acteurs sociaux sont telles que le choix se résume bien souvent à une rationalisation a posteriori, compte tenu des faibles marges de manœuvre de l’acteur ». Et, poursuit-il, « telle est bien la limite du projet d’individualisation » [12].
L’autonomie prend enfin le sens d’une réponse aux injonctions faites à chacun d’être un acteur responsable de sa santé, en y portant une attention constante et en consultant un médecin uniquement quand c’est « nécessaire ». L’absence de contact avec le système de soins et la valorisation de l’automédication peuvent alors indiquer la volonté de participer à l’effort de lutte contre le déficit public de santé — « le trou de la Sécu, c’est pas moi ». Dans ce sens, « les effets que produit la conformité à une norme peuvent donc, paradoxalement, produire une déviance » [13] puisque les situations de non-recours sont ici le reflet de l’application d’une norme, l’autonomie, véhiculée en partie par certains professionnels de la santé. D’ailleurs, ajoutons que la recherche d’autonomie ne signifie pas une opposition systématique au médecin, mais bien parfois une complémentarité avec celui-ci, chacun ayant un rôle différent. Cela est très bien résumé par un homme qui n’a consulté ni médecin ni dentiste depuis sept ans, bien que le bilan de santé lui ait détecté plusieurs problèmes de santé. Selon lui, « c’est la même chose que pour une voiture, quand on pense qu’il y a un problème, on va d’abord voir sous le capot si c’est une petite panne et si on ne sait pas faire nous-mêmes », ce qui permet de ne « pas dépenser l’argent public ».
Conclusion
Que pouvons-nous retenir de cette enquête ? Au-delà de la diversité et de la complexité des déterminants du non-recours aux soins, restitués partiellement ici [14], un constat nous semble central. Il apparaît que, contrairement à ce que laissent entendre les termes de « non-recours » et « d’éloignement des soins », les personnes concernées ne font pas fatalement preuve de passivité à l’égard de leur santé. Les critiques que formulent certaines personnes à l’égard d’obstacles à l’accès aux soins, alors que la santé représente pour elles un moyen d’intégrer ou de se maintenir dans un travail, en sont une indication. Pour d’autres, il n’y a pas passivité dans le sens où elles mobilisent des pratiques de soins profanes lorsqu’un symptôme se fait ressentir, sortes d’alternatives au médecin. Pour formuler autrement ce dernier point, le non-recours aux soins médicalisés, tel qu’il a été défini et perçu par les différents acteurs qui s’en inquiètent, n’est pas synonyme d’absence de soins. L’autonomie défendue par plusieurs personnes est ressortie comme un angle original pour comprendre l’éloignement du système de soins. Elle permet de voir en quoi ces situations font parfois sens pour les personnes. L’autonomie peut être une manière de se protéger, par exemple lorsque le rapport au système de soins et à ces acteurs est vécu comme stigmatisant, ou une réponse à l’injonction d’être acteur de soi-même. Toutefois, terminons en évoquant l’un des pièges de l’autonomie. Ce piège serait de penser qu’elle ne serait que le reflet de préférences individuelles. Toute intervention publique destinée à aller chercher les personnes éloignées du système de soins pourrait alors paraître contraire à leurs libres choix, ce qui inviterait au laisser-faire en la matière. Or, comme nous l’avons vu dans les entretiens, les conditions qui amènent les personnes à revendiquer une autonomie rappellent en quoi « ce n’est pas parce que les choses semblent plus « personnelles » aujourd’hui qu’elles sont pour autant plus intérieures et moins sociales » [15]. Il ne faut pas se tromper. Si l’autonomie, avec ses différentes significations, mérite d’être pleinement prise en compte et soulève indéniablement des réflexions éthiques, elle ne doit pas conduire à laisser reposer toute la responsabilité des situations de non-recours sur le seul individu et ses choix.