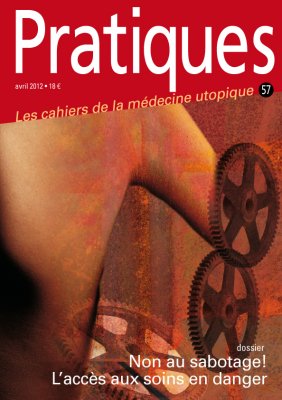Christiane Vollaire,
philosophe
France Culture :Une question sur la question : le mot « crise » est-il le bon mot pour désigner le moment que nous vivons ? Vous soutenez que ce terme de crise n’est pas très descriptif, mais plutôt occultant. Qu’est-ce qui se cache, selon vous, sous ce mot de « crise » ?
Christiane Vollaire : A mes yeux, il cache ce que j’appelle vraiment une naturalisation du politique, un terme que l’on peut employer dans beaucoup de domaines actuellement. Il suffit de revenir à l’origine du terme de « crise ». Cette origine n’est pas du tout économique ou politique. Elle est médicale : dans le Livre des épidémies d’Hippocrate, la crise est le moment où se fait le basculement de la vie à la mort, dans un sens ou dans l’autre. C’est le moment critique, la phase dans laquelle on ne sait pas si le malade va survivre ou mourir. Cette crise est un moment qui échappe complètement au contrôle médical. La crise ne relève pas de l’activité du médecin, mais d’un phénomène naturel qui se produit dans l’ordre biologique.
Mais alors en quoi n’est-ce pas adapté à ce que l’on vit ?
Parce que, tout simplement, ce que nous appelons « crise » est un phénomène entièrement culturel, politique et économique. C’est véritablement un conflit qui n’a rien de naturel, un conflit occulté par l’appellation « crise », afin qu’il soit naturalisé, et que les responsabilités qui s’exercent dans ce domaine soient effacées.
Est-ce que tout le récit médiatique des événements n’est pas fait aussi pour occulter la réalité ? Il n’y a pas que des mots, il y a aussi des informations générales sur des faits.
Il y a ce qu’on dit d’une part pour effrayer la population, et ce qu’on dit d’autre part à l’inverse pour présenter de façon euphémisée des situations de violence sociale où les gens perdent leurs moyens économiques, leur sécurité sociale. On décrit cette situation violente dans les termes d’un fatalisme, et pire encore dans des termes où ceux qui portent la responsabilité de cette violence, à savoir les acteurs politiques, sont présentés au contraire comme les bons docteurs, comme les médecins, ceux qui vont trouver des solutions. Les rencontres au sommet entre chefs d’État font partie de cette folle ronde médiatique, qui invente une théâtralisation de la crise pour occulter sa réalité.
Qu’est-ce que cette réalité ? Il y a quand même bien des événements qui produisent des difficultés. Comment les qualifieriez-vous, si vous ne voulez pas utiliser le mot crise ?
La réalité est celle d’une financiarisation du système économique, et des effets de la structure capitaliste elle-même (Marx le montrait déjà au XIXe siècle), qui va produire une forme d’abstraction des circuits économiques. Une abstraction qui se fait à l’encontre de la réalité des personnes. C’est ce que produit le système de la dette, et tous les autres effets comme par exemple le « trou » de la Sécurité sociale, pour favoriser des politiques de négation de la Sécurité sociale.
La revue Pratiques, les cahiers de la médecine utopique travaille actuellement sur ce sujet, en dénonçant les attaques massives portées contre le système de Sécurité sociale au nom de la crise et au nom d’une rationalité politique. Tout ce discours de la rationalité, tout ce discours du chiffre qui dit : « Attention la dette ! Attention le PIB et le PNB ! », est un discours profondément irrationnel. Je reprendrai une part des analyses de l’économiste Amartya Sen, selon lequel il y a un fanatisme du chiffre qui, loin d’être rationnel, est au contraire profondément destructeur et totalement absurde.
Quelle en est l’origine ?
Pour moi, c’est un effet pervers de la rationalité cartésienne, pourtant originellement juste. Je ne suis pas quelqu’un qui attaque la rationalité cartésienne. Mais elle a été violemment dévoyée pour aboutir à une espèce de culte des mathématiques, et à une mathématisation du politique qui est en fait sa véritable perversion : elle fait disparaître la dimension de la responsabilité sociale, et bien évidemment davantage encore la question de la solidarité. Il va donc y avoir un clivage entre une caste qui prétend à cette rationalité pour défendre en fait ses propres intérêts, et une population qui, elle, est livrée à cette forme de carnage.
Je résume vos propos sur l’usage du concept de crise : processus de naturalisation du politique qui permet à la fois sa neutralisation, et l’émergence d’une sorte de « fatalisme effaré qui pousse à la soumission. » Fatalisme, effarement, soumission : comment en est-on arrivé là ?
C’est un état tétanisé dans lequel le mot crise devient un mot fétiche. Un mot fétiche qui terrorise, qui fait peur. On voit, les uns après les autres, tomber les pays européens menacés. Il y a une espèce de jeu de dominos dans lequel chacun se sent progressivement menacé. Et ceux qui se sentent menacés font appel, pour protecteurs, à ceux qui sont à l’origine même de leur situation, c’est-à-dire les responsables politiques qui favorisent les options néolibérales.
Est-ce que c’est le chiffre qui amène la soumission ? On ne peut rien faire contre.
Le chiffre est effectivement égarant et tétanisant. Mais ce qui l’est plus encore, c’est ce qu’on voit : un processus de dégradation sociale, la perte du statut et de la stabilité socioprofessionnelle, et une disparition progressive des classes moyennes.
Vous dites qu’il y a une capacité organique, non pas à surmonter la crise, puisqu’elle est structurelle, mais à lui survivre, à introduire dans le système même les modifications qui permettent qu’une part au moins des fauteurs en soient aussi les bénéficiaires. Comment se manifeste ce processus ?
Ce phénomène d’occultation et de neutralisation va permettre que ce qui se produit réellement ne soit pas vu. Donc que les responsabilités soient occultées : d’une part les responsabilités économiques avec le jeu ahurissant de la finance, et le jeu du politique soumis à ce diktat. Et puis un autre jeu, rarement évoqué à propos de la crise, celui des mafias. À la suite de la chute des blocs dans les années 1990, il y a eu une expansion de la puissance des mafias en Europe, à partir de la Russie en particulier. Cette puissance exponentielle a permis aussi un nouveau rapport au politique. On sous-estime cette puissance actuelle de la corruption qui a produit des responsables politiques, et la façon dont elle peut permettre l’arrivée sur le devant de la scène de gens qui sont intégralement soumis à ce système-là. C’est ce qu’on voit avec le système Berlusconi en Italie, mais aussi en France. Or Berlusconi une fois tombé, par qui est-il relayé ? Mario Monti et Goldman Sachs : les fauteurs deviennent les bénéficiaires. C’est ce que La Boétie décrivait comme une servitude volontaire : le fait que dans le moment même où l’on est le plus soumis, inféodé et attaqué, on peut considérer comme un sauveur celui-là même qui est responsable de la violence que l’on subit.