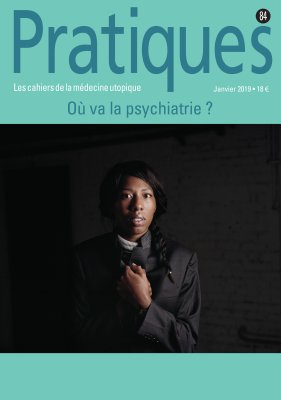Adeline Hazan
Contrôleure générale des lieux de privation de liberté
-
-
-
- Adeline Hazan a interpellé les pouvoirs politiques sur les pratiques scandaleuses de contention ou d’isolement en psychiatrie. Lanceur d’alerte, l’institution qu’elle dirige, rapporte aussi la dérive sécuritaire psychiatrique et l’enfermement abusif des mineurs en centre de rétention.
-
-
Pratiques : Comment devient-on contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ?
Adeline Hazan : Le contrôleur général est une autorité administrative indépendante. Sa nomination se fait sur décision du président de la République et après validation du Sénat et de l’Assemblée nationale. Le contrôleur général est nommé pour un mandat de six ans non révocable et non renouvelable. En 2014, j’ai succédé à Monsieur Jean-Marie Delarue, conseiller d’État. Les crédits de l’institution sont directement votés au Parlement, nous avons une indépendance totale pour mener à bien nos missions et interpeller les ministres en conséquence. Ils sont alors dans l’obligation de nous répondre.
Que faisiez-vous avant cela ?
Je suis magistrate de formation. J’ai exercé tout d’abord comme juge d’application des peines et juge des enfants au tribunal de Nanterre pendant quinze ans. Puis j’ai travaillé pour la délégation interministérielle à l’intégration et à la Ville, sur la prévention de la délinquance. Je me suis engagée en politique durant vingt ans, au secrétariat général du parti socialiste sur des questions de société : justice, immigration et droits des femmes. J’ai été conseillère régionale en Champagne Ardennes, puis élue maire de Reims de 2008 à 2014. Battue cette année-là, j’ai candidaté pour le poste de CGLPL. Mon engagement à la fois professionnel, syndical et politique a toujours été tenu par le fil des questions de société et plus précisément celles de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des droits. Je ne fais plus de politique depuis 2014, ma fonction actuelle interdisant tout mandat politique. Cela ne me gêne pas, ce que nous faisons ici est une façon de faire bouger les choses sur un plan politique aussi.
Dans quel contexte politique a été créé le CGLPL ?
Cette institution a une double origine. En France, au début des années 2000 et surtout au détour de la parution du livre de Véronique Vasseur [1] et du rapport Canivet [2], il y a eu une vraie volonté d’améliorer le contrôle des établissements pénitentiaires. En parallèle, un protocole additionnel au traité de lutte contre la torture de l’ONU a été signé en 2002, demandant aux pays membres de créer un « mécanisme national de prévention », c’est-à-dire un organisme indépendant de contrôle. La France a ratifié ce protocole en 2008, après la création du CGLPL en 2007.
Comment définissez-vous les missions du CGLPL ?
Nous vérifions que les personnes privées de liberté par une décision de l’autorité publique, judiciaire ou administrative, soient respectées et traitées dignement. Je parle des situations de garde à vue dans les commissariats et gendarmeries, d’hospitalisation sous contrainte, d’emprisonnement, de séjours en centre éducatif fermé ou prison pour mineurs, en centre de rétention administrative pour les étrangers en voie d’éloignement. Depuis une loi de 2014, nous sommes également compétents pour accompagner les étrangers jusqu’à leur remise aux autorités du pays d’origine. Le CGLPL réalise en tout cent cinquante visites d’établissements par an.
Avec qui travaillez-vous, dans votre équipe et avec quels partenaires ?
Le CGLPL comprend une quarantaine de contrôleurs. La pluridisciplinarité est le fondement de l’institution. Je recrute des magistrats, des commissaires de police, des médecins, des psychiatres, des éducateurs, des associatifs. Les visites d’établissements sont inopinées ou pas, la décision m’incombe. Pour la visite d’une prison ou d’un hôpital, six ou sept contrôleurs sont en immersion totale durant une semaine. On ne peut rien leur refuser, ni lieu, ni document. La loi de 2014 a étendu nos pouvoirs, comme la possibilité de consulter un dossier médical sous réserve de l’accord du patient, par l’un de nos contrôleurs médecins.
Comment se passe une journée de travail du CGLPL ?
Un contrôleur est en visite quinze jours par mois. Le reste du temps, il rédige son rapport au siège. Pour ma part, c’est un peu différent, j’effectue une visite mensuelle d’une semaine. Étant responsable de l’institution, j’ai un planning chargé entre les interviews, les interventions devant le parlement, les réunions avec les syndicats professionnels, la rédaction et la diffusion des rapports. Nous rédigeons un rapport annuel d’activité extrêmement détaillé, complété par la parution de deux, voire trois rapports thématiques par an. Le premier paru est justement celui sur l’isolement et la contention en psychiatrie. Il a beaucoup fait parler de lui. Il paraît que dans les hôpitaux on l’appelle le petit livre bleu [3], c’était le premier du genre et je dois dire que ça a bien fonctionné.
Êtes-vous souvent saisis ?
Nous avons un pôle de sept permanents répondant aux quatre mille saisies écrites annuelles. Au début de ma prise de fonction, la majorité des saisines provenaient des détenus ou de leurs proches. Aujourd’hui, la psychiatrie représente 10 % des saisines provenant de patients, de leurs familles, mais aussi de professionnels amenés à dénoncer ce qui se passe dans leur établissement. Ce qui prouve la souffrance des praticiens et que nous sommes identifiés comme instance de recours.
Cela prouve que les praticiens ne sont pas entendus ou qu’ils ne trouvent pas de recours in situ.
En effet cela pose question. Vous savez, pour l’hôpital de Bourg-en-Bresse il y a deux ans et le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne cet hiver, nous avons fait des recommandations en urgence. Dans les deux cas, la Haute autorité de santé (HAS) était passée dans ces établissements pour la certification, aucun problème n’avait été décelé. L’Agence régionale de santé (ARS) n’avait jamais entendu parler de telles pratiques. Cela pose question, non ? Au centre hospitalier de Saint-Étienne, depuis des années, lorsque des personnes venaient se faire soigner aux urgences, y compris librement, elles se retrouvaient attachés sur des lits. Et à Bourg-en-Bresse, des patients étaient à l’isolement, parfois même sans que les praticiens, ni le personnel ne puissent dire depuis combien de temps.
Comment comprenez-vous que ces abus ne fassent sourciller personne. Peut-on parler de déni « institutionnalisé » ?
Je parlerais de perte de sens. Pour donner un exemple, à l’hôpital de Saint-Étienne, les professionnels que nous avons rencontrés disaient : « On a toujours fait comme cela. Quand on est arrivé, c’était déjà comme ça. » A contrario, lors de visites d’hôpitaux psychiatriques, les équipes nous interpellent : « C’est vraiment intéressant que vous veniez, ça nous oblige à réinterroger nos pratiques, parfois on fait des choses dont on n’interroge plus le sens ». À Bourg-en-Bresse comme à Saint-Étienne, les modes de fonctionnement, les moyens d’action et les pratiques ont été revus. L’un des intérêts de notre travail est d’arriver à faire bouger les lignes.
Quelles ont été les réactions de l’ARS et de l’HAS ?
L’ARS à Bourg-en-Bresse s’est retranchée au motif de n’avoir jamais été saisie. Quant à l’HAS, il faut que je pose la question au plus haut niveau, parce que là, vraiment, je ne comprends pas. Lorsque nous sommes en mission, nous examinons toutes sortes de rapports. Ceux de l’HAS sont très administratifs. Pour l’hôpital de Saint-Étienne, l’HAS était passée le mois précédant notre visite, durant une semaine.
L’HAS est à l’affût du respect des « bonnes pratiques », et non du bon sens clinique. Ils prennent un dossier, ils vérifient s’il est bien rempli, loin de s’enquérir du bien-être des patients ou du personnel.
Oui, c’est cela, ils ne regardent que les normes. En même temps, je trouve que depuis deux ans, ils ont quand même fait un bon boulot dans les recommandations, notamment sur l’isolement et la contention. Ils ont sorti des recommandations qui sont les mêmes que les nôtres. Mais lorsqu’ils sont dans les services, je ne comprends pas ce qu’ils recherchent et ce qu’ils voient.
Il faudrait le leur demander.
Oui, oui, je vais leur poser la question.
Du côté des praticiens, cela a été très important que vous puissiez pointer tout cela.
Oui, bien sûr. À la suite de la parution de notre rapport thématique sur l’isolement et la contention, j’ai été invitée à de nombreux colloques au cours desquels certains soignants nous reprochaient de ne pas tenir compte de la souffrance au travail. Bien au contraire, les pratiques d’isolement ou de contention renvoient à un manque de personnel ou de formation. Mais c’est également une question de culture d’établissement et de service. Lors de ma visite à l’hôpital Sainte-Anne, j’ai été frappée par la disparité des pratiques. Un service où il n’y avait ni contention ni isolement ne comptait pas plus de médecins ou d’infirmiers auprès de malades aux pathologies comparables à d’autres services. Figurez-vous que cela a conduit à un effet pervers, puisque les patients déclaraient une fausse adresse pour être dans ce service-là, sachant qu’ils ne seraient ni attachés ni isolés.
Comment préparez-vous une visite ? Vous travaillez avec votre staff au préalable, ou au contraire sans information hormis la saisine ?
Pour les prisons, les centres de rétention, les centres éducatifs fermés ou prisons pour mineurs, nous effectuons désormais un cycle de contre-visites. Elles ont lieu deux à trois ans après la première visite. Pour les hôpitaux psychiatriques, seuls 40 % d’entre eux avaient été visités, lors de mon arrivée. Je me suis fixée de tous les visiter durant mon mandat. Pour les centres hospitaliers spécialisés, je préviens quelques jours seulement avant notre arrivée. Sur place, nous examinons les rapports écrits et rencontrons le maximum de personnes, patients comme professionnels. L’accueil des familles, les droits des personnes en dehors même de l’isolement et de la contention, tout est étudié. Au bout de trois mois, nous faisons un pré-rapport adressé au directeur de l’établissement. À l’issue de cette procédure, un rapport définitif est envoyé au ministre de tutelle de l’établissement, qui y répond.
À propos, la ministre de la Santé n’a toujours pas répondu publiquement à vos rapports sur l’augmentation et la généralisation des pratiques de contention en psychiatrie adulte. A-t-elle répondu directement au CGLPL ?
Elle a répondu deux jours après la publication de nos recommandations en urgence relatives au CHU de Saint-Étienne, sa réponse est accessible sur notre site Internet. Au moment de la publication, elle n’avait pas répondu. Nous avons été un peu surpris car les pratiques de contention des urgences du CHU de Saint-Étienne étaient vraiment inimaginables. Par contre, au moment de la publication de la recommandation en urgence de l’hôpital de Bourg-en Bresse, Marie-Sol Touraine avait répondu immédiatement, donnant des instructions à la direction. À l’hôpital de Saint-Étienne, le directeur a répondu tout de suite, pour fluidifier le circuit des urgences. La question de fond est pourquoi ne l’a-t-il pas fait avant. Même si les hôpitaux sont plus réactifs que les prisons, on se dit : mais si nous n’étions pas venus, cela aurait continué.
Comment comprenez-vous que des infirmiers psy aient dû entamer une grève de la faim pour être entendus dans leurs revendications proches de vos recommandations ? Pourquoi une telle inertie sur le plan national ?
Oui, je les ai rencontrés lors d’un colloque à Villejuif, ils venaient juste de terminer leur grève. Ils m’ont dit des choses inimaginables sur le plan local. Pour répondre sur le plan national, la loi du 26 janvier 2016 a quand même permis de créer un cadre pour l’isolement et la contention. Cela doit être une prescription de dernier recours. Mais il a fallu attendre mars 2017 pour que la circulaire d’application soit publiée. Et je lisais hier encore plusieurs rapports de contrôles d’hôpitaux qui ne l’appliquent toujours pas. Des prescriptions de contention ou d’isolement « si besoin » persistent alors que la loi l’interdit. Je ne comprends pas que les ARS ne surveillent pas plus ces situations. Les commissions départementales de soins psychiatriques pourraient également y veiller.
Racontez-moi votre visite de la clinique de La Borde à Blois ?
J’ai trouvé ce lieu extraordinaire. D’abord j’ai eu la confirmation qu’il ne s’agissait pas « de petites maladies tranquilles ». J’ai compris qu’il y avait plus de 80 à 90 % de patients atteints de psychoses graves, envoyés par des hôpitaux en situation d’échec thérapeutique. J’ai trouvé incroyable leur façon de travailler avec les patients sur un pied d’égalité. A mon arrivée, j’ai déjeuné avec des médecins qui m’ont amenée ensuite à une de leurs réunions quotidiennes médecins/patients. A la question « On vous présente Adeline Hazan qui voudrait visiter les lieux, qui veut l’accompagner ? » Plusieurs personnes ont levé la main. La visite des lieux s’est donc effectuée avec des patients « pilotes » ! Pour ma part, ce fut une visite passionnante de trois heures. Les malades m’ont parlé de leur vie, de leur pathologie, de façon clairvoyante et authentique. Là-bas, j’ai observé une manière de travailler que je n’avais jamais vue auparavant. L’autonomie, la responsabilisation des patients y est centrale. Je suis sortie de là en me disant qu’il y a vraiment deux mondes en psychiatrie.
C’est cela la psychothérapie institutionnelle, ça consiste à faire participer les patients à la vie quotidienne d’une institution. Mais la plupart des patients hospitalisés en psychiatrie sont soumis à une passivité terrible.
Absolument, c’est une des choses que l’on dénonce également : le manque d’activité. J’ai justement vu tout le contraire à La Borde. Les patients ne sont dans leur chambre que la nuit, le soin est fondé sur l’activité. D’ailleurs, pour la petite histoire, des patients lors de ma visite ont demandé à venir à la conférence à laquelle je participais le soir même, à Blois. Un infirmier a donné son accord et un car a été affrété pour une quinzaine de patients. Fait inimaginable à l’hôpital. Je connaissais La Borde sur le papier, j’ai vraiment découvert un autre monde ce jour-là.
Qu’est-ce qui sépare ces deux mondes ? L’argument économique mis sans cesse au-devant de la scène masque un débat de fond, éthico-politique ?
À mon sens, le nerf de la guerre reste l’argument économique, et non une volonté d’enfermer de plus en plus. Mais il ne demeure pas moins qu’il y a une banalisation de l’acte, cette idée qu’enfermer n’est finalement pas si grave. Je me souviens lorsque nous étions en visite dans un hôpital, on a commencé le jour où le collectif des 39 a sorti dans Libération cet article « Contention : la dérive sécuritaire ». La direction jugeait scandaleuse cette position radicale. Leur argument « on ne peut pas faire autrement » revenait sans cesse. Alors que si, on peut faire autrement. A La Borde, les médecins m’ont confirmé que leur prix de journée était de 150 €, plutôt que 350 € ailleurs. Donc, en plus, cela ferait faire des économies.
Changement de décor, parlons un peu des enfants migrants dans les centres de rétention, c’est quand même d’actualité.
Nous avons récemment rendu un avis, avec un certain succès, comme vous l’avez peut-être lu.
Vous avez fait part de la réponse du ministre de l’Intérieur qui dit en substance : on peut améliorer les conditions de vie en centre de rétention administrative (CRA), mais on ne peut pas faire autrement que d’enfermer les enfants en voie d’expulsion. Ne craignez-vous pas que les rapports du CGLPL servent de bonne conscience aux politiques ?
J’ai vu des parlementaires vraiment embêtés et choqués, y compris ceux de la majorité actuelle, qui avaient bien envie d’intervenir. Ils se sont finalement rangés à l’instruction de vote, ce qui est bien triste.
Sur le plan européen, tous les pays n’enferment pas les enfants de migrants dans des centres de rétention.
Non, mais il y en a quand même un certain nombre. Leur motif est de dire : « Si on ne le fait pas, cela va faire un appel d’air ». La loi dit, d’ailleurs, priorité à l’assignation à résidence. En cas de volonté de ne pas partir, ou si l’intérêt de l’enfant le justifie, il y a la possibilité d’un placement en centre rétention. Quelques préfectures appliquent la loi, notamment Nancy et Metz. Appliquer la loi ne fait pas d’appel d’air, elle évite aux enfants des expériences terribles. La CIMADE a repéré, cet été, une famille avec de petits enfants enfermée depuis 20 jours. Selon les attendus ministériels, ces séjours ne doivent pas excéder quelques jours. Les psychiatres interrogés soutiennent : « Même pas longtemps, une rétention pour un enfant de 6 mois ou de deux ans, les cris, les haut-parleurs qui hurlent toute la journée, c’est un vrai traumatisme ».
À propos, visitez-vous des lieux d’hospitalisation pour enfants ?
Oui, nous les visitons régulièrement, du moment qu’il s’agit de lieux fermés. Nous avons d’ailleurs consacré un rapport thématique à la question des droits des mineurs hospitalisés en psychiatrie.
Vous avez vu des choses inquiétantes ?
En premier lieu, nous avons rencontré beaucoup de jeunes dans des services d’adultes, soumis eux aussi à des pratiques d’isolement. Nous avons également repéré une certaine ambiguïté concernant la place, le rôle des parents et le respect de l’autorité parentale. C’est un point fort du rapport. Enfin, nous avons vu des choses inquiétantes, comme une tentation de psychiatriser des débuts de radicalisation chez les jeunes. Ces derniers mois, j’ai principalement été sollicitée et me suis beaucoup entretenue avec des psychiatres. Ils rapportent une intrusion grandissante du ministère de l’Intérieur au sein de la psychiatrie, concernant les questions de radicalisation. Des psychiatres m’ont dit avoir reçu des appels pour savoir si monsieur untel était suivi ou pas ! Une psychiatre m’a raconté ceci : un jour, un homme s’assied dans la salle d’attente. On vient lui demander s’il a rendez-vous. Sa réponse : « Non, non, je suis des RG. » Il était là pour regarder qui venait en consultation. C’est quand même fou !
Dernière question… freudienne, à quoi rêvez-vous ?
Je fais le constat depuis 2008 d’un vrai changement de perception vis-à-vis de personnes qui ne sont pas complètement dans la norme, les délinquants, les malades psychiatriques… Il y a une volonté de la société à vouloir les enfermer et les isoler. Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est que cela correspond à une demande de sécurité de plus en plus grande de la part de l’opinion publique. Donc pour répondre à votre question, je rêve d’une société qui enferme moins et qui pense l’enfermement comme dernier recours, afin de privilégier des solutions alternatives. Dans le prochain plan santé, concernant la santé mentale, j’attendrai de la ministre une impulsion forte à ce type de pratique, la psychothérapie institutionnelle. Une hospitalisation ouverte et citoyenne. C’est une pratique dont on n’entend jamais parler en haut lieu. Sans compter que cela coûterait beaucoup moins cher à l’État.
Propos recueillis par Sandrine Deloche , médecin pédopsychiatre