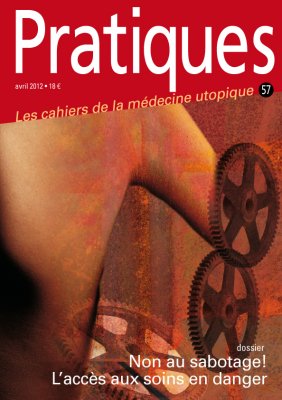Véronique Thireau,
médecin alcoologue et
Noëlle Lasne,
médecin du travail
J’ai recours depuis vingt-cinq ans aux services du même médecin alcoologue. Mais il y a vingt-cinq ans, j’adressais un patient à une consœur. Aujourd’hui, je demande une faveur à une amie. Je ne fais pas le numéro de l’hôpital. Je l’appelle sur son portable. Je sais par avance qu’elle autorisera les accidents de parcours que je pressens déjà : un patient qui ne vient pas au rendez-vous, un patient qui surgit un soir à n’importe quelle heure, un patient qui n’arrête pas de boire dans les délais impartis, un patient qui parle de tout sauf de l’alcool. Je sais que chaque fois qu’elle ne pourra pas protéger le patient au sein du système de soins, elle le fera dans un circuit parallèle. Je sais qu’elle ne le lâchera pas. Il nous est devenu impossible à l’une et à l’autre de soigner nos patients comme nous le souhaitons au sein de l’hôpital public. Que s’est-il passé ? Nos patients sont les mêmes et ont les mêmes besoins. Pourquoi ne parviennent-ils pas à intégrer le système de soins ou, plus exactement, un système qui les soigne ?
Au cœur de cette transformation radicale se trouve le système de tarification à l’acte. La mise en place de ce système s’est faite progressivement dans les services d’alcoologie de l’hôpital public. Ce n’est pas un simple mécanisme comptable, mais une nouvelle façon de raisonner que doit s’approprier l’équipe soignante. Ce système met en scène des intervenants chargés de promouvoir une nouvelle culture et d’évaluer le contrôle des acquis par les soignants. L’hospitalisation d’un patient alcoolique obéit aujourd’hui à des règles strictes et n’a plus grand-chose à voir avec l’observation d’un état clinique, susceptible de changements imprévisibles, et nécessitant une adaptation permanente du soignant.
Avant toute chose, il est nécessaire de savoir si le patient a besoin d’un sevrage « simple » ou d’un sevrage « complexe. » Un sevrage simple implique une hospitalisation de huit jours et est réalisé en service de médecine. Certains services de médecine ont des lits « dédiés » au sevrage, mais un lit de sevrage doit néanmoins être négocié et ne peut donc en aucun cas être obtenu en urgence. Un sevrage complexe est coté différemment et nécessite un agrément du service d’alcoologie. Il ouvre droit à une hospitalisation d’une durée de quinze jours, pas un de plus. Il s’agit donc de faire le tri dans les propositions standardisées de l’hôpital, et de ne pas frapper à la mauvaise porte.
Dès que le malade est hospitalisé, tout diagnostic porté par les médecins aura des conséquences immédiates en termes de tarification à l’acte : en effet, ce diagnostic entraîne des examens complémentaires eux aussi tarifés sur une grille, qui justifient à leur tour des actes cotés. Au terme de l’hospitalisation, l’addition sera faite. C’est le compte rendu d’hospitalisation qui effectuera cette addition en justifiant les actes réalisés, et donc le remboursement par la Sécurité sociale. Ce remboursement peut être refusé si, après contrôle de la Sécurité sociale, les examens réalisés ne sont pas considérés comme légitimes en regard du compte rendu diagnostic. Ces contrôles se font tous les ans sur un certain nombre de dossiers, avec demande des documents justificatifs.
Devant ce danger de se voir refuser un remboursement pour certaines hospitalisations par la Sécurité sociale, ou de se voir mis à l’amende, la direction de l’hôpital a donc entrepris de former les médecins à jongler avec ces nouveaux concepts : diagnostic prioritaire, diagnostic associé et autres subtilités qui peuvent modifier la cotation des actes. Des « médecins DIM » (Département d’Information Médicale) sont chargés de recueillir, contrôler, et transmettre toutes les informations médicalisées structurées et codées depuis les établissements d’hospitalisation vers les organismes payeurs et contrôleurs. Ils font le lien entre les soignants et le service comptable de l’hôpital et se rendent dans les services pour jouer le rôle de traducteur : ils recommandent de prescrire aux malades alcooliques hospitalisés des examens tels que doppler, épreuves fonctionnelles respiratoires, fibroscopie, échographies, soit sur la base de problèmes de santé identifiés, soit sur la base de leur existence vraisemblable. Ceci permettra d’établir un ou plusieurs diagnostics supplémentaires, donc d’augmenter la cotation.
Par ailleurs, il ne suffit plus que l’équipe soignante d’alcoologues et d’infirmiers constate l’émergence d’un état dépressif lors du sevrage ou relève des propos suicidaires pour prolonger l’hospitalisation. Ces troubles doivent être évalués par un psychiatre qui les consignera dans le dossier. Seul cet écrit permettra de justifier la durée du séjour, mais aussi un diagnostic avec une cotation plus élevée. Des psychiatres ont donc été recrutés dans certains services d’alcoologie, qui n’ont aucun lit en charge et n’effectuent pas de suivi des patients, mais sont présents pour évaluer ponctuellement un état psychique. Leur avis, consigné dans le dossier, amène une plus-value de cotation et permettra de ne pas payer d’amende à la Sécurité sociale. Que se passe-t-il dans ce contexte lorsqu’un patient alcoolique rechute dès sa sortie ? Il faut « remettre les compteurs à zéro » et donc attendre quarante-huit heures. Le patient peut alors être réhospitalisé pour bénéficier à nouveau d’un séjour de durée limitée. En revanche, tous les examens complémentaires ayant déjà été réalisés lors de la première hospitalisation, il faudra « jouer » sur le diagnostic psychiatrique pour légitimer ce second séjour, par exemple mentionner dans son dossier des troubles importants de la personnalité.
Il n’est bien sûr plus question dans ce contexte de rester à l’hôpital dans l’attente d’une place dans un établissement pour postcure, dont chacun sait à quel point elle est souvent nécessaire. Le patient est déclaré sortant au terme du sevrage, et sera réhospitalisé quarante-huit heures avant le départ en postcure, où il sera transporté directement à partir de l’hôpital. C’est ainsi que la logique de la tarification à l’acte évacue le débat clinique, en orientant le regard et la concentration sur ce qui peut être coté. Une réunion de synthèse sur un patient alcoolique pour réfléchir ensemble à son parcours ne peut pas être cotée.
La question des consultations d’alcoologie ne résiste pas à la grille de la tarification à l’activité. Si l’on examine le coût réel du personnel et des infrastructures qui permettent le déroulement de ces consultations, il s’avère qu’il reste à la seule charge de l’hôpital. Et surtout, que ces consultations ne débouchent qu’incidemment sur des hospitalisations, donc sur des actes susceptibles d’être remboursés. Ces consultations n’ont donc tout simplement pas de sens pour l’hôpital. Un malade alcoolique qui prend contact avec un alcoologue hospitalier coûte de l’argent, mais en rapporte peu. Ainsi un sevrage peut donner lieu dans certains cas uniquement à un traitement par anxiolytiques, des vitamines, éventuellement une échographie ou au maximum une fibroscopie. Il y aura donc des journées entières d’hospitalisation qui s’écouleront sans aucun examen, et ne seront faites que de soins infirmiers ou d’échanges avec le patient. Ces hospitalisations-là représentent un véritable manque à gagner pour le système hôpital.
On pourrait comparer ce système à l’accueil de clients dans un restaurant : chaque acte doit être comptabilisé chaque jour, en temps réel, et l’addition doit être prévisible. Au moment où le serveur prend la commande, l’addition se fabrique, et au moment où les gens se lèvent de table, on sait très exactement, table par table, à combien se chiffre la recette. De même, on souhaite connaître à tout moment le montant de ce qu’il faut demander en remboursement à la Sécurité sociale, patient par patient, lit par lit. Chaque service hospitalier devant générer un certain revenu, il préférera les clients qui choisissent entrée, fromage et dessert à ceux qui se contentent d’un sandwich et occupent une table de façon prolongée, dans lesquels chacun reconnaîtra les patients alcooliques.
M. B., veilleur de nuit, fait partie de ces patients qui occupent une table de façon prolongée. Il a commencé par trois ou quatre allers et retours en service de médecine pour des cures de sevrage. Il se remettait à boire dès le lendemain. Sur sa demande, je suis parvenue à le faire admettre dans un service d’alcoologie. Lorsqu’il a stoppé toute consommation d’alcool, il a déclenché un état dépressif très grave. Il a pu attendre au sein du service d’alcoologie une place dans un centre de soins psychothérapeutique qui associait une double prise en charge, où il a pu rester six mois de plus. Chacune de ces étapes a nécessité un combat contre l’institution hospitalière et un rapport de force constant, pour qu’il ne soit pas déclaré « sortant » inopinément. Pendant toute cette période, je me suis efforcée, en tant que médecin du travail, d’obtenir qu’il perçoive son plein salaire, même lorsque je ne pouvais communiquer avec lui que par téléphone. Il ne boit plus depuis deux ans, participe à un groupe d’anciens buveurs, poursuit une psychothérapie et retravaille à temps plein. Il retourne quelquefois voir le médecin alcoologue qui l’a accueilli au début de son histoire, deux ans auparavant, peut-être afin de mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. Nous ne sommes pas trop de deux, et nous ignorons l’une et l’autre la tarification de cet acte de soin.