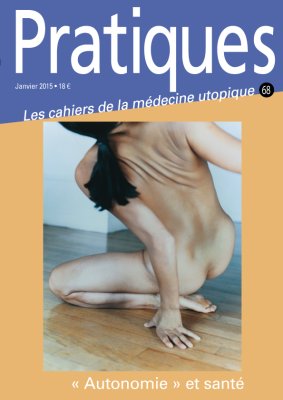Didier Ménard, médecin généraliste
Propos recueillis par Anne Perraut Soliveres et Philippe Lorrain
C’est un destin improbable qui a amené Didier Ménard à exercer la médecine durant plus de trente-trois ans dans la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis dans le 9-3 où il n’a cessé d’essayer d’inventer des modes de fonctionnement qui permettent de s’occuper au mieux de la santé de ceux de la cité.
Je n’étais pas destiné à faire médecine
Du quartier HLM Lorilleux à Puteaux où j’ai passé mon enfance, à la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis où j’exerce la médecine générale depuis plus de 33 ans, la cité, je la connais bien.
La médecine, ce n’était pas programmé.
Dans ma famille, qui a su profiter des Trente Glorieuses, on restait ouvrier. Mon père avait vingt ans en quarante, donc une jeunesse un peu perturbée, il était mécanicien d’aviation. Mon oncle était mécanicien auto et mes grands-parents des gens de maison, cuisinière et jardinier de grands bourgeois. Du côté maternel, mon grand-père était menuisier dans les services de l’Etat et ma grand-mère était brocheuse : elle brochait des livres. Après la guerre, les conditions de vie étaient un peu difficiles, mon père a repris des études au CNAM, il a gravi des échelons, mais tout en restant dans sa culture ouvrière.
On était tous destinés à passer le certificat d’études et à apprendre un vrai métier, donc un métier manuel. Mon frère est devenu chauffeur poids lourd et c’était un peu mon destin. Et puis, je suis né avec un certain nombre de handicaps, je n’avais ni goût ni odorat, mais ce n’est pas ce qui me gênait le plus. J’avais une dyslexie faramineuse qui a rendu mon parcours à l’école primaire particulièrement chaotique puisque je n‘étais pas capable d’écrire les mots comme on me le demandait. Je me souviens des dictées : des vingt fautes qui valaient autant de coups de règles sur les doigts, de l’humiliation de la dictée honteuse accrochée autour du cou par des pinces à linge et que je devais promener de classe en classe, accompagné par un délégué. Je devais monter sur l’estrade, où un autre élève lisait ma dictée… et tout le monde se bidonnait. Les jours où on avait dictée, c’était l’horreur, j’avais mal au ventre et je ne voulais pas aller à l’école… L’enfer. Alors pour m’en sortir, je repérais celui qui rigolait le plus dans la classe et à la récréation je lui bourrais la gueule. Je suis devenu caractériel, bagarreur, violent et donc mauvais élève, ça a duré pendant toute l’école primaire… D’autant qu’un appareil d’orthodontie me faisait zozoter, ce qui aggravait ma situation.
C’est en allant chez le dentiste pour faire régler mon appareil que ma mère découvre dans la salle d’attente un article de la Vie Catholique sur la dyslexie : c’est un déclic. Pour les maîtres peu informés sur la dyslexie à l’époque, je ne faisais pas assez attention, et il me fallait recopier à l’infini des textes… je crois en devoir encore à l’instituteur de CM1… Le mauvais élève rencontre enfin une orthophoniste : le trouble est sévère, je fus le sujet d’une étude et pour tout le monde j’étais un cas ! Il n’y avait pas trente-six solutions : ou je quittais l’école et je devenais arpète, ou j’étais pris en charge par les orthophonistes en promotion de leur nouvelle discipline. Comme je n’avais pas ma place en sixième classique, j’entrai dans une école spécialisée, mais payante. Cours traditionnel le matin, rééducation l’après-midi. Les membres de la famille se sont cotisés pour faire face aux frais de scolarité. Après quatre ans de programme scolaire et de rééducation, je suis reçu au brevet, ce qui m’ouvre la porte d’une seconde générale. J’étais toujours nul en orthographe, mais suffisamment rééduqué pour pouvoir suivre un cursus. J’ai passé le baccalauréat, je l’ai eu au rattrapage pour un point. Je suis le premier de la famille à être arrivé à ce niveau d’étude et, pour moi, le cursus s’arrêtait là. Je pensais trouver du travail, un métier manuel, mais avant je voulais un peu profiter de la vie, c’était l’époque où beaucoup faisaient la route…
Le bac en poche, je ne savais qu’en faire…
Je me suis retrouvé sur les quais de Douarnenez, en Bretagne, où j’ai dégoté un embarquement sur un langoustier pour une campagne de pêche de plusieurs mois au large de l’Afrique… Ce fut mon premier grand « stage » d’apprentissage de la relation humaine. Ce que je découvris avec cet équipage me servira dans l’exercice de la médecine bien plus que les cours au CHU sur la relation médecin malade.
Pendant que je pêchais la langouste, mon père prenait des avis, la libraire qui était un peu l’intellectuelle de la cité le convainc qu’il fallait que je fasse des études. « Avec un bac D (bio) on fait médecine ». Il m’inscrit donc en médecine. À mon retour, il m’informe que je suis inscrit à la fac, ce qui me paraît impossible. « Qui peut le plus peut le moins ! » telle était sa devise… « Essaie, tu verras bien ». Mais après trois mois, je me sentais perdu dans ce monde tout nouveau pour moi dont je n’arrivais pas à comprendre les codes. J’arrête alors et je reprends mon sac à dos. Je pars pour plusieurs mois en stop en Afrique, je traverse le Sahara et je découvre les pays du Sahel à un moment où c’était encore facile… Gao, Kidal… autre stage de formation qui me servira beaucoup pour le travail aux Francs-Moisins.
À mon retour, mon père me repose la question des études de médecine. Il a vu avec la libraire… dont la nièce, coup de bol, entre en médecine. Il me suggère de voir avec elle si on peut s’aider… Je la rencontre et elle me propose de travailler avec elle et son amie pour préparer le concours. Je n’ai pas dit non et pendant deux ans, j’ai bossé comme un malade, elles m’ont fait souffrir, mais grâce à elles, j’ai réussi les concours des deux premières années. Je n’aurais jamais cru pouvoir travailler autant.
Je me retrouve en troisième année et en stage à l’hôpital : je m’y sens mal, je ne trouve pas ma place, je suis moqué pour mon langage de la cité, pour mon appartenance au milieu populaire. J’étais très loubard, très « blouson noir », très castagne, une tout autre culture que la fac de médecine… Au bout d’un an, j’ai craqué, convaincu que ce n’était vraiment pas pour moi. La confrontation à ce monde très bourgeois m’était insupportable. Je me suis fâché avec un chef de service qui me prenait pour un con et je lui ai foutu une baffe…
Je me retrouve à Besançon, c’est la grande époque des « LIP », je milite dans le comité de soutien pour la solidarité avec la classe ouvrière en lutte. Je suis plus à l’aise et je travaille en intérim à l’usine, et comme afficheur. Grande période militante, le Larzac aidant je deviens anti militariste et me lance dans l’activisme… ce qui n’est pas très malin quand on n’a pas fait son service militaire…
Et l’armée ne m’oublie pas ! N’étant plus inscrit en fac, mon sursis est annulé… je suis incorporé en Allemagne, je rejoins le « comité de soldats ». J’étais déjà un peu connu avant d’arriver… au premier tract distribué dans la caserne, qui n’était d’ailleurs pas de mon fait… c’est le mitard, puis le transfert en section disciplinaire, au 17e d’infanterie de marine à Perpignan. Je me retrouve au soleil alors que je venais d’Allemagne. C’était un peu spécial, mais j’appréciais la vie au grand air, la montagne et la mer. Je suis resté là un peu plus longtemps du fait de la prison qui augmente le temps d’incorporation. Les stages commando, un peu de solidarité avec les viticulteurs en lutte, de nouveau tracas avec la sécurité militaire… Là encore, une grande fraternité avec mes « copains de régiment ».
De retour dans la cité, je m’inscris au chômage et n’ai aucune envie de reprendre des études… Et puis, la rencontre dans le hall d’une cage d’escalier de la mère d’un copain de la cité change le parcours de ma vie… Elle me questionne sur mon avenir, elle n’est pas d’accord pour que je choisisse le retour à l’usine : « Mais alors, on n’aura jamais des docteurs qui savent nous soigner, nous, dans la cité ? ». Et là, je prends une grande baffe, à la fois une révélation et une grande émotion… cette ferme prise de position fait déclic, et bien plus puisqu’elle fait sens : être médecin dans une cité populaire, super défi ! en phase avec mes espérances. Je me réinscris en médecine, sans problème puisque j’étais parti mais n’avais pas échoué, et j’arrive avec un mois de retard dans le seul stage d’externe non pourvu, en ORL à Neuilly. Ça commence mal, l’accueil est glacial car ils attendent l’externe depuis un mois… J’attends le médecin responsable de la formation des étudiants à la sortie du bloc opératoire, je me présente, il me demande pourquoi ce retard d’un mois. J’explique que je sors du service militaire et je lui balance toute l’histoire… Je suis très tendu, pas sûr que ça marche… Il me regarde d’un œil bizarre, je suis prêt à partir… Un silence, puis un sourire, un regard pénétrant et il dit ; « La médecine a besoin de gens comme toi… Il faut que tu réussisses. Demain, tu viendras le matin à huit heures et on reverra la médecine ensemble. On refait le programme, je t’apprendrai ce qu’il est utile de savoir ».
Pendant six mois, le Dr Larget m’a remis le pied à l’étrier, il m’a formé m’a guidé ensuite vers ce qui était important et m’a fait rattraper ce que j’avais perdu. Il m’a également fait un petit parcours au sein de l’université afin de m’éviter les services à fort risque de confrontation… Dans le même temps, j’ai pris un peu de bouteille, je me suis calmé, je fais moins banlieue… moins cité…
Entre le déclic qui me fait retourner à la fac et le compagnonnage de mon patron, mon parcours de formation a été parsemé de ces rencontres, de ces soutiens que j’accepte, qui me poussent vers un horizon qui s’ouvre.
C’est comme ça que j’ai fini mes études de médecine.
Entre-temps, j’avais rencontré Malou, les enfants arrivent, Malika, Pierre-Antoine puis Martin. Je reste très politisé.
Je me souviens alors du Groupe Information Santé que j’avais rencontré à Besançon qui faisait des avortements clandestins et je rejoins le SMG qui était sur les mêmes positions.
C’est la rencontre avec Patrick Nochy à Gennevilliers, Dominique Huez à Nanterre, les gens du SMG de l’époque. Je soutiens ma thèse sur « médecine générale et prévention ».
Au Samu, tout se passe bien, j’organise et je me mêle peut-être un peu de ce qui ne me regarde pas tout à fait… Après six mois, mon patron me signifie qu’il ne me reprend pas : « Vous n’êtes pas fait pour travailler dans un système hiérarchique ».
On me fait part d’une petite annonce reçue au local du SMG. Le docteur Alain Paknadel cherchait un associé à la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. On s’est rencontrés le vendredi midi en sortant de ma garde du Samu. Ce fut vite décidé, le lundi 5 octobre 1980, je recevais mes premiers consultants (les pauvres !) au cabinet, à 500 mètres de celui de Gilles Bardelay, un autre du SMG et de la revue Pratiques, qui commence, lui, à ce moment-là, l’aventure de la revue Prescrire.
On tentait de fonctionner un peu comme les USB prônées par le SMG, avec honoraires en masse commune, dossiers partagés… Ce n’était pas forcément encore très satisfaisant, mais je me sentais à l’aise dans la cité. On a construit petit à petit une vie aux Francs-Moisins, tournée vers les valeurs du SMG, pas seulement le soin, mais aussi la santé. Les comités d’usagers, ça ne marchait pas très bien, même si on le faisait avec les copains engagés, des instits, des militants du cadre de vie… une bande de copains tous militants qui venaient encourager notre démarche de santé.
C’est en 1986 que le grand projet démarre : dans le cadre de la politique de la Ville, la ville de Saint-Denis propose une évaluation diagnostique de santé aux Francs-Moisins, une des premières « recherche-action ». Arrivent Antoine Lazarus, médecin de santé publique et son équipe, et quatre sociologues de l’équipe de Michel Joubert, il y avait Fernando Bertholoto… les sociologues habitaient sur place… c’était passionnant, ça a duré quatre ans. Marc Schoene était directeur de la santé de la Ville de Saint-Denis, il fondera l’Institut Théophraste Renaudot, s’intéressant à la santé communautaire. Les idées directrices sont en place. Ce moment est important, car s’appuyant sur une base politique, des valeurs et une idéologie, la santé communautaire, l’exercice de la médecine en milieu populaire passe du concept à la réalité. Je n’aurai de cesse d’explorer cette spécificité de l’exercice de la médecine auprès d’une population précaire et vulnérable mais, ô combien, solidaire et fraternelle.
En 1992, l’Association Communautaire Santé Bien Être est créée (ACSBE), une vraie association de santé communautaire. Nous faisons une visite au Québec avec le SMG (les CLSC, Centres Locaux de Santé Communautaire) et on se retrouve à un congrès du SMG à Tournai, avec les médecins des Maisons Médicales Belges : j’étudie ailleurs ce qui s’expérimente et marche déjà. En Belgique, je viens accompagné de l’association, Fatima la secrétaire, une sociologue et surtout les femmes relais. Nous avons obtenu que leur expérience soit reconnue comme validante. Un nouveau métier est né : médiatrice en santé.
Je consulte toujours au cabinet médical, mais à temps partiel avec Alain mon associé, pour ne pas être débordés : cette activité de soins et de santé, je ne l’ai jamais interrompue, c’est de celle-ci que je tire ma légitimité pour entreprendre le reste.
1990, c’est aussi les années Sida, la création avec Denis Méchali, infectiologue à l’Hôpital Delafontaine à Saint-Denis, du réseau Ville Hôpital 93 Ouest. La toxicomanie est la première cause de mortalité dans la cité, notamment du fait de la transmission du virus HIV. L’important, ce n’était pas seulement de soigner avec le peu de connaissances et de moyens que nous avions, c’était surtout le programme d’échange des seringues, la substitution opiacée pour les héroïnomanes, le bus santé… Il faut structurer les réseaux : médecins coordinateurs, travailleurs sociaux et ensemble bousculer les représentations qui pénalisent la population des Francs-Moisins
Le ministre Douste Blazy a une vision très institutionnelle des « réseaux Soubie » : la récupération est en marche et elle dénature l’objet réseau.
C’est lors d’une longue randonnée pédestre que j’imagine le devenir de cet objet atypique que nous venons de créer : les réseaux. C’est long à traverser les Pyrénées et on s’ennuie un peu… on a le temps de réfléchir et j’avais besoin de grand air, le paysage était magnifique…
Avec d’autres des réseaux, Patrick De Lasselle du réseau Val de Bièvre, Bernard Elghozi à Créteil, Jean-Pierre Aubert à Paris Nord, Vincent Pachabezian du réseau rive Gauche, nous avons fondé la Coordination Nationale des Réseaux, (CNR) créée en 1997 et soutenue par le Directeur Général de la Santé, Jean-François Girard.
La précarité et les difficultés d’accès aux soins de la population apparaissent comme les facteurs principaux d’atteinte de la santé. Avec d’autres, Catherine Lepetit du GISTI, Esmeralda Luccioli puis Noëlle Lasne de la mission France de MSF, d’autres des associations Remède et COMEDE, nous menons une réflexion et nous intervenons au niveau politique pour la mise en place d’un système de protection sociale performant, avec ouverture immédiate des droits sur simple critère de résidence et de ressources, qui deviendra la CMU en 1999 (gouvernement Jospin).
Entre-temps, la première PASS, la consultation Baudelaire, a été créée à l’hôpital Saint-Antoine à Paris par Jacques Lebas, de Médecins du Monde, pour en finir avec « l’hôpital hors la loi », qui refusait les malades dont l’ouverture des droits sociaux n’était pas démontrée
Au cours de l’entretien le mot « avec » revient tout le temps. Et il nous mitraille des noms de celles et ceux qu’il croise et avec lesquels « il fait ». Celles et ceux-là œuvrent le plus souvent au sein d’associations, et il nous balance leurs sigles nominatifs. Nous vous les livrons. En fait, à Pratiques ils sont des gens connus, des compagnons, c’est logique qu’ils trouvent ici leur place : on ne peut pas vous présenter Didier Ménard sans le représenter dans une nébuleuse de réseaux…
J’ai beaucoup discuté avec Patrice Muller, aussi, c’était très enrichissant… ah oui !
Lors de la discussion de la loi Kouchner de 2002, avec François Bourdillon, nous donnons une nouvelle définition des réseaux, celle après laquelle les institutions courent aujourd’hui ! Il fallait en finir avec les réseaux thématiques pour aller vers des réseaux de santé. Naïvement, je pense que tout va bien, mais j’assiste à une reprise de contrôle des réseaux par les hospitaliers. Je quitte la CNR en 2003.
C’est avec le SMG, que je souhaite relancer le « passage du soin à la santé ». Je suis élu président au congrès de Nantes en 2008.
Et il faut poursuivre le travail entrepris aux Francs-Moisins, les consultations au cabinet et la présidence de l’ACSBE. En 2008, l’association de santé communautaire est en crise, pour des raisons multiples, financières d’abord : il y a un décalage entre les modalités de financement, jamais pérennes, toujours à réinventer, jamais suffisantes face à la réalité des besoins de terrain. Paradoxalement, la professionnalisation des savoir-faire des médiatrices, qui avait été obtenue de haute lutte, aboutit à un décalage entre posture professionnelle et population… Et puis, tout ce petit monde de l’offre de soins a démarré en même temps aux Francs-Moisins : se pose alors la question de la relève, quand ce sera le moment de la retraite.
Il faut anticiper, inventer encore de nouvelles modalités de fonctionnement.
Nous lançons avec l’ACSBE un projet de maison de santé.
Maîtres de stage, nous recevons des internes au cabinet médical. Sur la vingtaine que nous formons en dix ans, trois se passionnent pour le projet. Le projet initial est modifié, il s’agira d’un centre de santé communautaire : la Place Santé. Les médecins ne seront pas libéraux, mais salariés, trente-cinq heures par semaine, dont cinq heures de prévention et éducation sanitaire.
La Place Santé est inaugurée le 7 novembre 2011, avec cinq médecins. C’est le centre de santé de l’association. Existe aussi le Comité des Habitants Usagers Citoyens, les ateliers de musicothérapie, le yoga, les ateliers cuisine, estime de soi… La promotion de la santé ne saurait se contenter de la médecine, même au sein d’un centre de santé qui inclut d’autres professionnels que des médecins et des soignants. Cela fait vingt salariés, autant de fiches de paye, difficiles à financer, beaucoup de « contrats aidés », du personnel moins qualifié, dont il faut assurer la formation et l’encadrement. Le budget avoisine le million d’euros, dont 35 % seulement sont assurés par le versement du montant à l’acte des actes médicaux. Il faut continuer à inventer en permanence, trouver des financements, jamais pérennes, convaincre les administrations que financer du « hors soin », c’est contribuer à la santé de la population.
Toujours essayer de convaincre, se voir reprocher : « Tu fais trop de politique » quand justement la santé des populations est une affaire politique et pas seulement médicale. Comme je me suis autrefois vu reprocher « de faire du social », quand à l’évidence c’était nécessaire pour pouvoir faire un peu de médical.
On a fini ensemble, avec Alain, le 31 décembre 2013, après que j’aie passé toute ma vie professionnelle avec lui.
Depuis que j’ai pris ma retraite, je suis toujours fourré là-bas, et les gens rigolent : « Alors ça va bien ta fausse retraite ». En 2015, j’ai quitté la présidence du SMG, mais je suis entré au bureau de la Fédération Française des Maisons de Santé. On continue à me reprocher d’être « trop politique » et je suis suspect, à la fois auprès des libéraux des Maisons de Santé pour présider un centre de santé, et comme médecin généraliste libéral pour les acteurs des Centres de Santé.
À la fin de mes études, mes patrons hospitaliers me trouvaient déjà suspect lorsque j’affirmais vouloir faire de la médecine générale dans un quartier populaire.
À refuser les cadres établis qui ne collaient pas à la réalité, aux besoins du terrain, j’ai toujours été considéré comme suspect, mais j’ai continué avec opiniâtreté de tracer mon sillon, vers les horizons qui s’ouvraient parce que pour moi, c’est vital. Je suis bien persuadé que cette opposition idéologique est de plus en plus archaïque et qu’il vaudrait mieux travailler à l’union qu’à la division, notre avenir étant commun au service de la population.
En vingt ans, pour me changer les idées, j’ai rénové une bâtisse en Ardèche, le paysage y est magnifique et j’aime y prendre l’air avec ma famille et mes amis.
Note :
Retrouvez régulièrement Didier Ménard sur le site de la revue. Ses « billets d’humeur » sont décapants : témoignages sur les souffrances qu’il rencontre, colère exprimée, mais aussi tendresse envers la population solidaire des cités où il a vécu et soigné, constat accablant sur l’inanité des politiques, ce qui n’empêche pas une pointe d’humour...