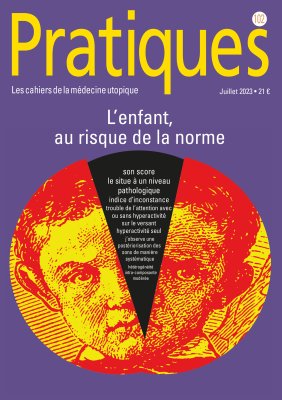Alice Desbiolles, médecin de santé publique
Pratiques : Qu’est-ce qui vous a amenée à la santé publique ?
Alice Desbiolles : Mon appétence pour la pluridisciplinarité et pour les savoirs, qu’ils soient scientifiques, littéraires, ou encore sociologiques...
Par ailleurs, j’ai toujours été sensible aux questions d’injustice, d’atteinte aux plus vulnérables, notamment aux enfants. Les notions du juste et de l’injuste constituent quelque chose d’important pour moi. Au final, ce qui m’animait, en m’engageant en médecine, était l’intention et les valeurs qui régissaient selon moi cette profession. Des valeurs de soins, d’empathie, de justice et d’utilité sociale. J’étais aussi attirée par l’enseignement que je pensais voir délivré dans les facultés de médecine et que j’imaginais riche et varié, à l’image du sujet d’étude : l’humain et son fonctionnement biologique, comportemental et social.
Hélas, loin de l’héritage d’Avicenne, de Maïmonide et d’autres médecins qui ont marqué l’histoire de la médecine par leur curiosité, leur richesse intellectuelle et leurs travaux dans lesquels les sciences, plus ou moins tâtonnantes, côtoyaient la philosophie, la théologie, l’éthique, la linguistique… je me suis retrouvée dans un cursus quasi-exclusivement « biomédical ». Ce « biomédicalisme » réduit l’individu à des paramètres cliniques, biologiques voire radiologiques et ne s’inquiète pas du sujet dans sa globalité, de son lien avec la société qui l’entoure. Les individus ne sont plus des personnes, ils sont réduits à leur pression artérielle, leur glycémie à jeun ou une masse à l’échographie. À côté de l’enseignement théorique, que je trouvais intéressant mais très incomplet, j’ai été également mal à l’aise avec la pratique médicale telle que j’ai pu l’expérimenter à l’hôpital : des services à flux tendu, une pensée algorithmique et une pratique de plus en plus déshumanisée. Je ne me suis pas retrouvée dans cette praxis. J’ai fini par considérer que le système était lui-même malade. Je n’ai pas souhaité y prendre part, le cautionner. En revanche, mes constats et expériences m’ont donné envie de contribuer à son amélioration. Pour y parvenir, il était important pour moi de connaître les parties prenantes qui le constituent, les institutions, les enjeux, les défis. Je me suis donc orientée vers la santé publique, seule spécialité à mes yeux à même de me donner l’opportunité de toucher du doigt ces différents aspects. Il me semble également important de replacer les enjeux de santé et de bien-être dans le cadre sociétal et démocratique, comme nous l’a montré la séquence de la Covid. La santé publique me semble à ce titre une discipline clé.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?
Au moment d’entreprendre des études supérieures, j’ai longuement hésité entre la médecine et le droit. Je suis finalement entrée en médecine à l’Université Paris VI, Pierre et Marie Curie, qui compte notamment les hôpitaux parisiens de La Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, etc.
Durant mes études, je suis partie un an en Allemagne, à Hambourg, où j’ai réalisé ma quatrième année de médecine. Séjour qui m’a permis de découvrir une autre manière d’enseigner la médecine et de l’aborder. L’enseignement y était, selon moi, beaucoup plus pédagogique, varié et ouvert. Il était par exemple possible de suivre un cours très généraliste sur l’acupuncture et d’effleurer cette pratique, ce qui ne m’a jamais été proposé dans mon cursus français, où toute médecine autre que la médecine allopathique occidentale n’est pas considérée. J’ai également apprécié, en Allemagne, que les mises en situation se fassent d’abord sur la base de simulations (acteurs qui jouent des patients, chambre de réanimation dédiée à l’enseignement avec un mannequin amélioré faisant office de patient) afin d’arriver mieux formée auprès des patients. En France, les étudiants sont « lâchés » auprès des patients dès le début de leur cursus, avec un niveau de formation, théorique, pratique et relationnel, très léger. Cette immersion très précoce en vie réelle ne se fait pas sens heurts, inquiétude et difficultés, tant pour les étudiants que les patients et leurs aidants.
À mon retour d’Erasmus a commencé la préparation du concours de sixième année – l’« Examen classant national » à l’époque – laquelle a renforcé l’acuité de mes questionnements quant au cursus dans lequel je m’étais engagée. Après un échange déterminant pour la suite de mon parcours avec une médecin disponible pour les étudiants perdus ou malheureux en médecine – dont j’étais, et pas la seule –, j’ai su que je m’orienterai en santé publique. Après le concours, j’ai donc navigué dans plusieurs lieux durant mon internat : Institut Pasteur, ministère de la Santé, je suis aussi partie six mois à Chiang Mai en Thaïlande dans un laboratoire d’épidémiologie internationale. J’ai travaillé au Centre d’éthique clinique à Cochin et dans des agences sanitaires publiques. Ce parcours varié m’a confortée dans mon choix. Ayant toujours eu une appétence pour les sujets relatifs à l’environnement au sens large et aux atteintes aux plus vulnérables : les enfants, les femmes, les personnes en situation de précarité les plus précaires, mais également les sans-voix : animaux, végétaux, écosystèmes... j’ai soutenu ma thèse sur un sujet de santé environnemental avec Santé publique France et ai notamment passé un diplôme universitaire en prévention, promotion de la santé et lutte contre les inégalités.
Une fois mon internat terminé, j’ai pris un poste dans une agence de santé publique. J’ai travaillé à l’Institut national du cancer, sur les sujets d’organisation et de parcours de soins puis de prévention, de santé environnementale et d’expositions professionnelles. C’est également durant cette période que j’ai commencé à écrire mon premier livre sur l’écoanxiété, qui a été publié aux éditions Fayard en 2020, avant de sortie en poche au printemps 2023. J’ai finalement deux casquettes : une casquette institutionnelle et une casquette de « personnalité publique », de plaidoyer, sur des sujets qui me tiennent à cœur.
La Covid a justement été un bel exemple de la difficulté de penser la santé globale, d’envisager la santé publique en l’absence de discussions, de pluridisciplinarité, d’informations claires et complètes, d’autant plus lorsqu’on n’est pas outillés et qu’il n’y a pas de débat. Vous, vous étiez au cœur de la tourmente, ça ne devait pas être simple ?
Avoir un esprit libre, critique, penser par soi-même constituent à mes yeux autant de marqueurs d’une bonne santé psychique et incarnent également le propre d’un esprit scientifique, lequel doit questionner, douter, interroger les théories en place. Et non faire preuve d’un psittacisme stérile.
Durant la Covid, je me suis donc autorisée à avoir un avis personnel au-delà de la ligne qui était présentée, pour ne pas dire imposée. D’autant que je me sentais particulièrement légitime puisque les enjeux se situaient pour une large partie dans mon domaine d’expertise. En tant que médecin de santé publique, titulaire notamment d’un Master 2 en méthodologie, recherche clinique et biostatistiques, et d’un diplôme interuniversitaire de vaccinologie, prévention des maladies infectieuses, j’étais parfaitement outillée scientifiquement pour me forger un regard documenté sur la gestion de crise. Les modalités de réponse apportées pour faire face à cette pandémie m’ont interpellée, comme de nombreux autres professionnels et pairs. Nous avons été sidérés, pris au dépourvu. Nous n’étions pas préparés à de telles modalités de fonctionnement (conseil scientifique, quasi-absence de débat contradictoire, confinement, couvre-feu, pass…) et nous n’étions pas forcément tous en lien les uns avec les autres. Cette connexion s’est faite au fur et à mesure et continue de se développer. Finalement, différentes visions de la médecine et de la santé publique se sont affrontées durant cette période. La vision dominante, et qui avait le pouvoir, soutenait une ligne essentiellement biomédicale, hygiéniste, paternaliste et pour le moins autoritaire.
Je ne me reconnaissais pas dans cette approche. J’ai donc essayé de faire entendre une autre voix, malgré les difficultés. Au fur et à mesure, j’ai gagné en audience, ce qui m’a permis de me faire une – petite – place dans le débat public. Au regard des nombreux soutiens et messages de remerciements que je recevais après chaque intervention, j’en ai conclu ne pas être la seule à ne pas me retrouver dans l’idéologie dominante et les politiques publiques qui en découlaient. Ces (très) nombreux soutiens ont été cruciaux, je ne vous cache pas que la période était assez compliquée. Je remercie d’ailleurs toutes ces personnes à la fin de mon livre, que j’ai aussi écrit pour elles.
Vous avez défendu le trépied : indépendance, respect et nuance. Comment peut-on maintenir cette position ?
Votre question m’évoque plusieurs points.
Le premier porte sur la légitimité du savoir. À mon sens, le savoir académique n’est pas le seul savoir légitime. Les titulaires de diplômes et de titres, les « experts » en d’autres termes, ne sont pas les seuls dépositaires du savoir. Au côté de ce savoir académique se trouve le savoir expérientiel : un patient avec un parcours de soin, un enfant placé, une femme victime de violences conjugales, une infirmière à l’hôpital, une assistante sociale, disposent toutes et tous d’un savoir lié à leur expérience, qu’elle soit de vie ou professionnelle. Ce savoir est important et mérite considération.
Gardons-nous du règne des experts académiques, car personne ne devrait avoir le monopole du savoir légitime.
Par ailleurs, il convient d’accepter que l’on ne sache ni ne maîtrise tout. L’imperméabilité entre les champs de connaissances empêche le surgissement d’une pensée complexe, l’émergence des véritables problèmes et des véritables solutions. Ce cloisonnement des disciplines aboutit, selon Edgar Morin, à la production d’ignorance, et donc d’« ignorantisme ». Cet ignorantisme est évidemment dommageable puisque l’on en arrive à ce que nos propres contemporains, ainsi que des experts et des savants, deviennent « ignorants de leur propre ignorance ».
Vous soulignez l’absence de débat contradictoire. Il s’agit en effet d’un élément qui devrait collectivement nous interroger. L’intolérance, de plus en plus forte, à une pensée différente ou contradictoire, m’inquiète. C’est oublier que le contradictoire et le conflit, à condition qu’ils soient ritualisés et organisés, peuvent être constructifs comme le rappelle le philosophe Paul Ricœur avec son éthique du dissensus. Pour lui, « le dissensus doit être pensé non pas comme le mal, mais comme la structure même du débat ». La tolérance de points de vue différents, notamment sur des questions de stratégie de santé publique, constitue à mes yeux un marqueur de la bonne santé d’une démocratie.
Vous appelez clairement à faire un bilan de tout ce qui s’est passé. Si cela devait se reproduire, quelles seraient selon vous les possibilités de vivre les choses autrement et d’avoir un débat serein ?
Un premier élément de réponse porte à mon sens sur l’éducation, sur la manière dont les enseignements sont délivrés. Ivan Illich, un philosophe à mes yeux très inspirant, a écrit en 1971 un livre : Une société sans école. Il considère que l’école de notre époque moderne entrave la pensée plus qu’elle ne l’élève, qu’elle n’est finalement que le lieu de l’apprentissage de la discipline, au lieu de contribuer à l’émancipation, au foisonnement de l’esprit et à une véritable pensée complexe et critique. Une autre piste à explorer est celle de l’art de la « disputatio ». La disputatio est une pratique qui remonte au Moyen-Âge où elle était pratiquée à l’université à Paris. Elle consistait à faire débattre en public les étudiants d’une question posée par le maître, à partir d’un texte étudié en amont. L’objectif de la disputatio n’est pas d’annihiler l’adversaire pour imposer sa propre thèse et démontrer que l’on a raison. Cette pratique vise plutôt à approfondir la réflexion et le questionnement de manière collégiale ; la discussion argumentée est le moyen de cheminer ensemble vers une vérité satisfaisante pour les deux parties. Selon la philosophe Nathalie Sarthou-Lajus, cette « élaboration collective du savoir permet d’honorer ce que dit l’adversaire et non de le considérer comme un ennemi à faire taire » [1]. Dans le dispositif de la disputatio, les groupes de disputants « pro » et « contra » sont tirés au sort, ce qui suppose « une capacité à prendre de la distance avec ses convictions et à se mettre à la place de celui qui ne pense pas comme vous, c’est salutaire ». Si l’art de la disputatio ne constitue pas la panacée, il peut néanmoins s’avérer utile, notamment en temps de crise et de controverses. Il représente un remède face au déclin de la démocratie sanitaire et de la confiance dans les institutions. Il aiderait à ne pas se laisser enfermer dans un dogme, quel qu’il soit.
Un autre garde-fou serait de ne pas confondre Science et Vérité. D’ailleurs, qu’est-ce que la science ? Qu’est-ce que la vérité ? Tout savoir, même scientifique, peut évoluer. La science est avant tout une démarche, dont le doute et l’erreur font pleinement partie. Le risque que je voie poindre est de transformer la science en idéologie voire en religion : il s’agit du scientisme dont je parle dans mon livre Réparer la santé (Rue de l’échiquier, 2023). Gardons-nous d’une société, et surtout d’un pouvoir, qui légitimerait toutes ses décisions, même les plus iniques, au nom de la science.
A ce titre, rappelons-nous des mots d’Edgar Morin, qui nous dit lors d’une interview à la télévision : « On n’a jamais autant développé de savoirs, d’experts de plus en plus précis dans leur domaine, mais, paradoxalement, on n’a jamais produit autant d’ignorance ». Paradoxalement, alors que nous n’avons jamais eu autant d’informations et de savoirs à notre disposition, notamment grâce à Internet, se développe en regard une croissance de l’enfermement, du confinement et de l’appauvrissement de la pensée.
Vous avez visité plusieurs systèmes de santé, et travaillé autour de la question de la santé planétaire, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
La santé humaine n’est pas seulement une affaire de soignants, d’hôpitaux, de système de santé. Si l’offre et l’organisation des soins constituent un déterminant essentiel de la santé, cette dernière est aussi liée à l’environnement (social, habitat, climat familial, pollutions, profession…). La santé planétaire est un concept qui invite à replacer la santé humaine dans le respect des limites planétaires (climat, utilisation de l’eau douce, des sols, érosion de la biodiversité...) et qui considère que la santé humaine ne pourra pas se maintenir et se développer sans s’inscrire dans le respect de l’environnement. C’est aussi ma vision de la santé publique : démocratique, humaniste et dans toutes les dimensions humaines, physique, mentale, sociale, environnementale... C’est en raisonnant ainsi que nous pourrons améliorer ensemble la santé individuelle et la santé publique.
On continue pourtant à penser la santé comme une absence de maladie. Quand on écrit sur la santé, on écrit plutôt sur le soin. On a du mal à penser la santé parce qu’elle est toujours connotée « médicale », parce que la médecine s’est emparée à un moment donné de toutes ces questions et se les est appropriées. Mais on aimerait penser une santé publique qui soit une chose à laquelle chacun aspire.
Exactement. Pour rappel, la définition de la santé selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) inclue la notion de bien-être : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l’absence de maladie ou à l’absence d’infirmité ». Aussi, la santé publique se doit de promouvoir le bien-être des individus comme des communautés. Pour se faire, les politiques publiques associées doivent, à mon sens, être soutenables et désirables. C’est le balayage de ces deux notions qui m’a mobilisée pendant la Covid. Au-delà du fait que nombre de discours allaient à l’encontre des principaux principes méthodologiques, scientifiques, éthiques et démocratiques, j’ai tout de suite perçu que les types d’interventions mobilisés n’étaient ni désirables ni soutenables. L’idée maîtresse d’un projet de société étant selon moi de se diriger vers plus de bien-être, de démocratie et de justice. L’idéologie médicale qui imposait ses vues n’empruntait hélas pas cette voie, sans parler des dommages collatéraux des politiques mises en place à l’époque, notamment sur les enfants, la santé mentale, ou encore les inégalités. Loin d’une approche descendante, rigide, pour ne pas dire autoritaire, comme nous l’avons expérimentée durant la Covid, je prône, pour ma part, une approche démocratique et émancipatrice de la santé publique.
Comment pourrait-on, finalement, faire valoir un aspect extrêmement positif de la santé publique qui n’existe pas pour l’instant ? Elle a des fondements, mais quand on parle de cet état de complet bien-être, ça passe par une attention aux humains, qu’on est en train de gommer complètement.
La santé publique, avec toutes les disciplines qu’elle relie – épidémiologie, économie de la santé, organisation du parcours de soin, prévention, etc. – constitue un formidable champ de réflexion et un laboratoire pour inventer et dessiner les contours de la société dans laquelle nous souhaitons évoluer, tant individuellement que collectivement. Quasiment tous les domaines de notre société présentent un impact sur la santé, qu’il s’agisse de la politique de transport, d’urbanisation, d’enseignement ou encore d’accès aux services publics. C’est ce que l’OMS appelle « la santé dans toutes les politiques ». Par exemple, si à chaque fois que l’on construisait une crèche, une école ou un EHPAD, on prenait en compte des indicateurs de santé et de santé planétaire, on ne construirait pas les locaux de la même manière. Dans les écoles, les cours de récréation seraient beaucoup plus végétalisées et ombragées. Les espaces verts, les espaces bleus y auraient toute leur place. L’aménagement intérieur et extérieur serait propice au lien social, à la convivialité, et à la santé comme au bien-être des occupants – qu’ils soient élèves, enseignants ou autres professionnels – et à la santé planétaire.
La santé publique peut apporter ce regard, cette philosophie, qui inviterait à considérer des indicateurs sanitaires, de santé planétaire et de bien-être pour tout projet collectif. Cette ambition n’est possible que si nous partageons une culture commune de ce qu’est vraiment la santé publique.
Le fait que de nombreuses personnes se soient interrogées pendant la Covid représente par ailleurs un terreau très fertile pour redessiner les contours d’une société plus désirable et plus soutenable, et aussi pour prévenir des dérives que nous pourrions voir advenir sur d’autres enjeux. Ce point est, pour moi, positif.
On ne soigne pas en surplomb une personne qui devient un objet, en fait, de bienfaisance, et vous mettez bien en tension, dans votre ouvrage, la bienfaisance et l’émancipation.
Longtemps, en médecine, le principe de bienfaisance a prévalu sur celui de l’autonomie. Le passage progressif d’une société paternaliste à une société émancipatrice implique que le principe d’autonomie de l’individu l’emporte – un peu – sur le principe de bienfaisance : on ne peut pas faire ce que l’on pense être « le bien » ou prendre soin de quelqu’un contre son gré. Le souci de l’autre ne doit pas s’épuiser dans une lutte thérapeutique acharnée, mais s’illustrer dans le respect de la dignité et du consentement.
Il y a trente ans, le Syndicat de la médecine générale (SMG) proposait les unités sanitaires de base qui étaient le premier lieu de l’élaboration des politiques de santé, en fait !
Une politique est d’autant plus pertinente, efficace et acceptée qu’elle est construite, voire pensée, d’abord par les premiers intéressés : les citoyens, les professionnels de terrain, les usagers. Les approches uniquement descendantes sont rarement sources de succès…
Je crois également en la puissance du local, du collectif. Il me semble important de se réapproprier les savoirs, les compétences, notre territoire, les gens qui y travaillent pour favoriser la proximité, les réseaux et l’autonomie. Certes, ce n’est pas la tendance actuelle, qui va plutôt dans le sens des énormes CHU anonymes dans les grandes villes. Mais il me semble que nous devrions interroger cette mouvance. Quand nous (re)valoriserons l’engagement, le temps long, l’expérience, le lien, l’ancrage dans une structure ou un territoire, je pense que nous aurons collectivement fait un grand pas.
Comment concrètement ?
En favorisant l’ancrage des professionnels sur leur territoire, en valorisant la pérennité, l’engagement sur le temps long des professionnels. Ce qui signifie notamment limiter le recours à l’Intérim, criant dans certaines structures comme l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et de plus en plus, hélas, à l’hôpital, offrir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, favoriser la pluridisciplinarité, la formation, l’exigence… Et remettre la dimension administrative à sa juste place : une place de gestion des aspects pratiques (ressources humaines, fonciers…) laquelle devrait constituer un soutien aux acteurs de terrain et non se transformer en un Léviathan déshumanisé et contre-productif.
Les gens de plus en plus cherchent des manières de se reconnecter, c’est quelque chose qui est à l’œuvre et qui doit être accompagné. Il y a quand même une attente de la population, des gens du commun qui se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas, il y a un début de prise de conscience. Ça ne va pas jusqu’à faire la révolution, parce que les gens continuent à penser que ça va venir d’ailleurs, mais en attendant, il y a une évolution et il n’appartient qu’à nous de la pousser, de la bricoler, de la travailler, de la rouvrir.
Oui, je suis d’accord… Se mobiliser pour un avenir vers lequel on a envie de tendre, c’est, personnellement, ce qui m’anime. Rendre réelle notre utopie doit être la boussole.
Comment repenser la formation en santé publique, en médecine ?
Le biomédicalisme qui gouverne l’idéologie médicale actuelle s’enseigne dès les bancs de la faculté. Il gagnerait à se voir nuancé et enrichi par l’apport d’autres disciplines. Si certaines sont considérées aujourd’hui comme essentielles à un enseignement médical digne de ce nom (anatomie, histologie, chimie, physiologie, biochimie…), puisse-t-il en être de même demain pour les sciences sociales et les humanités, telles la sociologie, l’anthropologie, l’éthique, l’épistémologie, l’histoire ou encore la philosophie. Seule la réconciliation de la médecine dite moderne avec la globalité et la complexité des individus, des épreuves de la vie et des savoirs, ouvrira la voie à la performance, non pas (uniquement) technique et quantitative, mais (aussi) holistique et profondément humaniste.
Quels pourraient être les lieux de débats à promouvoir ?
Les médias, l’école, les universités devraient se prêter à cet exercice. Diffuser des concours d’éloquence et des séquences de disputatio est aussi une piste que nous devrions explorer. Un « The Voice » du débat contradictoire en quelque sorte…