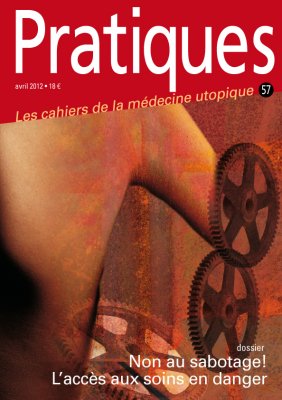Eric Bogaert,
psychiatre
Dimanche, ciel bleu, plein soleil, la surface du plan d’eau encore gelée, des plaques de neige par-ci par-là. J’écris ces lignes alors que je devais assister à la diada de l’os — la fête de l’ours — à Prats de Mollo. Des quintes de toux depuis l’apparition du grand froid, que j’ai tardé à soigner, ont amené mes proches à me demander de ne pas m’y risquer. Et le quinteux que je suis depuis tout petit les a écoutés. Mais pourquoi n’ai-je pas soigné cette toux, « grasse, productive », d’une sinusite chronique devenue laryngite, faisant du lever et du coucher un enfer guttural ?
Sans doute pour les mêmes raisons que les fumeurs ont bien du mal à arrêter de pratiquer leur vice : on l’a dans la peau, comme le chante Fréhel amoureuse de son « gringalet aussi laid qu’un basset ». C’est-à-dire : ça participe à la consistance de l’être, corps et psyché.
Mais cette toux, ce n’est pas normal, ce n’est pas raisonnable, c’est dangereux voire : aggravation, complication, et je pourrais en mourir, contagion et ce sont les autres qui en pâtiraient.
Toux, consommation de tabac, ou d’autres maux ou comportements, plus que symptômes d’un envahissement du corps par un agent pathogène externe ou de la psyché par une forme de pattern social, peuvent ainsi faire partie de l’identité du patient, de son essence.
Dès lors, faut-il éradiquer le symptôme, au motif de l’hygiène, de la bonne santé du patient et des citoyens ? Faut-il amputer le patient d’une partie de lui-même, même de mauvaise réputation ? De ce point de vue, quelle différence y a-t-il entre le SDF qui refuse de rejoindre un hébergement d’urgence à l’aube d’une nuit glaciale, l’homme alcoolisé qui conduit sa voiture à tombeau ouvert — le sien ou, pire, celui d’un « innocent » —, la jeune toxicomane qui se prostitue pour satisfaire ses douleurs exquises sans avoir le courage de parler du sida à son compagnon à temps partiel, et Djinn qui dit être le fils d’un couple d’une île d’Europe du nord, le spermatozoïde paternel étant tombé par hasard, au cours de son voyage céleste, dans le vagin d’une femme maghrébine qui ne peut être sa mère, tout au plus un utérus d’accueil ? Les trois premiers ne se verront pas contraints de se soigner, tandis que le troisième l’est, sur demande du représentant de l’État.
Monique était une jeune femme qui tentait d’élever seule la fille qu’elle avait eue d’un homme plus âgé qu’elle, petit et gros, alcoolique et marginal. Une psychose lui compliquait la tâche : elle était devinée et commandée par des voix. L’interne en psychiatrie que j’étais tentait de la soulager de ces voix en maintenant un traitement injectable retard d’halopéridol, et Monique acceptait de venir me voir au Centre Médico-Psychologique distant de quelques stations SNCF et arrêts de bus. À cet effet ? Jusqu’à ce qu’elle n’en pût plus : elle était devenue apragmatique, clinophile et n’est pas venue à la consultation prévue. Jeune et donc serviable — mais c’était aussi un temps, il y a trente ans, où la « file active » ne nuisait pas à la disponibilité—, je suis allé la voir chez elle, en visite à domicile. Je la trouvai pâle et fatiguée, mais pas le moins du monde réticente, au fond de son lit : « Docteur, je suis livide... s’il vous plaît, arrêtez-moi cet halopéridol », m’implora-t-elle, parlant probablement davantage de sa solitude que de son teint. J’ai accepté de baisser la posologie, la qualité de la relation me semblant permettre de supporter quelques phénomènes psychotiques, même si alors, jeune psychiatre, leur fréquentation pouvait m’angoisser. Et Monique est sortie de son apragmatisme, à défaut de sa psychose.
Mohamed était possédé par le diable, et avait trouvé un peu de paix en faisant de moi, son psychiatre traitant, un diable. Quelques jours après que j’aie quitté ce service pour prendre des fonctions de praticien hospitalier en province, il s’est défenestré. Il devait tenir à son diable.
L’OMS définit la santé mentale comme « l’état d’équilibre psychique d’une personne à un moment donné sous l’influence de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux qui agissent sur la personne elle-même et la communauté. » La « maladie mentale », autrement dit la folie, est consubstantielle à la nature humaine, c’est une modalité de santé mentale.
« Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît », a écrit François Tosquelles, et est-il écrit au fronton de l’hôpital psychiatrique qui porte son nom, à Saint-Alban, en Lozère, où a pris forme la pratique appelée ensuite psychothérapie institutionnelle. Cette phrase est dite, et redite, et sans cesse contredite par les actes des législateurs, des administrateurs de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, et même de soignants, capables de l’entendre voire de la dire eux-mêmes, sans jamais apporter l’argumentation qui l’invaliderait, et justifierait leurs actes.
Joseph — in memoriam — était grand, la barbe sage, le cheveu gris, âgé de 70 ans, un patriarche, aussi en ce qu’il était attaché à des valeurs archaïques — la terre, la fidélité, le devoir, la probité... Menant certes à la baguette sa femme et ses enfants, respecté et craint par eux, tout comme ses affaires rurales et sa vie, il s’était aussi occupé de la moitié de l’héritage familial qui jouxtait son bien et dont son frère était propriétaire : métayer en quelque sorte de cet industriel cosmopolite, à l’épouse exotique, parti faire fortune à l’étranger ; mais aussi frère. Le retour de l’industriel mondialisé a donné lieu à un choc des cultures, Joseph vivant mal que son frère modernise le domaine — il en avait les moyens — et sans lui en parler, mais surtout l’aura de ce frère qui a séduit sa femme et ses enfants, leur ouvrant les portes d’un monde qu’ils connaissaient, bien sûr, mais dont les valeurs de Joseph les tenaient à l’écart, du moins officiellement. Et un jour, le patriarche est parti, avec son bâton fabriqué de sa main et son chien, se dévêtant jusqu’à ne garder que son caleçon, arpentant des heures durant ses terres, en proie à un combat intérieur entre son désir de mourir pour fuir la fin de son monde et la honte de ne trouver d’issue plus honorable. Je l’ai rencontré aux urgences, le soir, le corps balafré par les ronces, la peau rougie par le soleil d’automne, fermé du dépit de n’avoir rien réglé et en rage contre lui-même, sa famille, les gendarmes qui l’ont amené aux urgences, le monde entier. Nous ne nous connaissions pas, il ne fit pas d’effort pour m’aider à résister à sa famille, en désarroi face à la détermination et la force de cet homme qui n’entendait pas transiger sur ses valeurs, et maintenait son désir d’en finir. Après bien des hésitations, j’ai participé à une hospitalisation sur demande d’un tiers familial à l’hôpital psychiatrique départemental, lieu honni pour la population locale parce que marqué du sceau de la perte de son âme (le nom de la ville où est sis cet hôpital rimant avec le mot âme dans le patois d’un dicton d’ici : « Si tu as perdu l’âme, va la chercher à Lame »). Quelques jours après, nanti de la prescription à dose filée d’un antipsychotique destiné à araser les traits paranoïaques de sa personnalité, il sortait de l’unité intersectorielle — où les patients en soins sous contrainte échappent à l’équipe de leur secteur pour être soignés en toute sécurité et avec le confort d’une architecture et d’une technicité adaptées aux besoins de... de quoi au juste ? — pour rentrer chez lui. Quelques consultations au Centre Médico-Psychologique (CMP) du secteur, après des excuses pour son comportement, une rancune réfrénée d’avoir été hospitalisé sous contrainte dans ce lieu d’infamie (d’autant que cette hospitalisation avait retardé l’installation de panneaux photovoltaïques : le patriarche pouvait donc envisager de se moderniser, mais l’hospitalisation l’en a empêché), une certaine bonne volonté à envisager qu’il avait peut-être été un peu trop exigeant avec ses proches, mais aussi avec lui-même, une levée de la sortie d’essai, et un arrêt du traitement décidé unilatéralement et caché à son psychiatre, il a interrompu l’élaboration dialectique de sa position en disant qu’il allait maintenant très bien. Quelques soubresauts familiaux signalés téléphoniquement par la famille dans les semaines qui ont suivi, mais celle-ci n’a pas accepté ma proposition de venir à la maison pour en parler ensemble, et avec Joseph : « On va régler ça nous-mêmes ». Un an plus tard, même scénario, avec moins de tensions toutefois : Joseph n’était pas passé par sa ballade biblique, et il ne s’agissait plus de la modernisation du domaine, mais de ce que sa famille passait plus de temps le week-end avec le frère moderne qu’avec le patriarche. Il leur avait envoyé par La Poste une mise en demeure : « Je vous invite dimanche prochain, et si vous ne venez pas, je me tue. » Ils ne sont pas venus, il avait attaché la veille une corde devant la porte de son frère, et a été de ce fait amené aux urgences à quelques heures de la fin de l’ultimatum. On se connaissait, les échanges ont pu être plus fructueux que lors de notre première rencontre, Joseph s’excusait d’avoir été encore une fois trop loin, redoutait et refusait une nouvelle hospitalisation ; il était malheureux que sa famille manifeste plus d’enthousiasme à la fréquentation de son frère qu’à la sienne, et acceptait qu’on ait des échanges à ce sujet au CMP. Sa famille exigeait une hospitalisation : après de longs palabres, des pressions, et quelques menaces, où sans cesse revenait la question : « Vous trouvez ça normal, docteur ? », au sujet de divers propos et gestes de Joseph, j’ai refusé de participer à une hospitalisation sous contrainte, qu’ils demandaient, sans toutefois pouvoir/vouloir recourir à leur médecin généraliste pour faire le certificat médical réglementaire. Joseph est rentré chez lui, avec un rendez-vous rapproché au CMP, et m’a envoyé un courrier, que j’ai reçu le jour du rendez-vous, dans lequel il m’apprenait que depuis son retour à la maison, il avait été seul chez lui avec sa chienne, sans nouvelles de sa femme, et avait décidé de se pendre : il m’écrivait ce courrier, disait-il, parce qu’il pensait que sa famille allait m’en vouloir, et espérait par ce courrier m’éviter des ennuis. Il s’est pendu la veille du rendez-vous. Sa famille m’en a effectivement voulu (le faire-part de décès que j’ai reçu en attestait), mais elle ne m’a pas fait d’ennui.
Alors certes, Joseph a disparu. Mais pas son humanité : il a pu en disposer jusqu’au bout.
Je n’ai pas posé le diagnostic d’une maladie mentale. On pourrait me le reprocher : il s’est suicidé, et il y avait aussi l’idée que sa femme l’avait trompé quelques années plus tôt. Mais il s’agissait là du remaniement critique d’un groupe qui affectait particulièrement le psychisme de cet homme, certes maladroit et embarrassé avec certaines questions personnelles — que nous n’avons pas eu le temps d’aborder, sa mort ayant fait avorter le préalable de la mise en place d’un dispositif propice à cela —. Fallait-il d’abord vaincre l’humanité de cet homme à coup d’hospitalisations sous contrainte, ou proposer aux membres de ce groupe de s’interroger avec eux sur ce qu’ils faisaient ensemble ? Qu’est-ce que l’humanité ? Ma mort ne fait-elle pas partie de mon humanité ? Y a-t-il une humanité normale ?
Le médecin est-il celui qui, sans certitude de ce qu’est l’humanité du patient, voire de l’humanité en général, même s’il en a une idée, son idée, peut lui imposer des normes d’humanité ? Qui fixe les normes de l’humanité, la loi, l’État, le médecin... ? Si le médecin a cette fonction, comment le patient peut-il ensuite lui confier son humanité, pour qu’ils la traitent ensemble ?
Joseph devait-il supporter le remaniement du groupe familial auquel a donné lieu le retour du frère prodige [1] ? Fallait-il le lui imposer à tout prix, y compris à celui de ré-hospitalisations sous contrainte ? Peut-être, me dis-je depuis qu’il est mort, mais de son vivant, le risque d’une mort psychique me semblait plus prégnant que celui d’une mort physique. Le psychiatre est celui qui aide le patient à garder en vie son humanité, fût-elle de folie. Il n’est pas là pour juger de ce qui est bon ou mauvais pour le patient, et le lui imposer, celui-ci serait-il fou. Il est là pour traiter avec lui les failles qui se créent dans son psychisme, et que sa folie ne lui échappe pas. Ce qui suppose de pouvoir se confronter à la folie des patients, mais aussi à la sienne, plutôt que de l’éradiquer en la niant ou en la noyant dans les psychotropes (qui, comme l’eau, peuvent aider à vivre ou tuer). Ceci témoigne que la pratique psychiatrique est une chose grave et terrible, où le patient peut perdre la vie, ou son humanité. Que l’humanité n’est pas affaire de normes (accréditation, protocoles, évidence, bonnes pratiques...). Que la personne du psychiatre peut se trouver parfois partie constituante de l’humanité du patient, du patient lui-même. Et que le psychiatre se trouve confronté à plusieurs failles et concerné par elles : celle d’abord entre affects et pensée, celle entre folie et raison ensuite, celle entre individu et société enfin, sans qu’il puisse privilégier l’un ou l’autre des bords de ces failles, occupé à les attraper et les tenir les uns et les autres à bras-le-corps.
Dès lors, comment se positionner comme psychiatre (médecin ? mais c’est peut-être autre chose, je ne peux le dire, peu assuré finalement d’être un médecin, en tout cas comme on l’entend aujourd’hui) s’il faut à la fois faire une place à la folie du patient, à ce versant de son humanité, et en même temps lui imposer par contrainte de taire sa folie au nom de normes fixées par une haute autorité sanitaire et les pouvoirs publics ? Bien entendu, le psychiatre se trouve pris et par la folie et par les règles de vie, qu’elles proviennent de lois physiques, physiologiques, symboliques ou sociales (c’est-à-dire imaginaires, même si elles sont à visée symbolique par leur effet structurant), mais il est « l’ambassadeur » et de la folie auprès de la Cité et de la Cité auprès de la folie, et il doit donc bénéficier de l’immunité diplomatique, et non se trouver en position d’être le bras armé qui va enfermer la folie.
Quel effet — sur la possibilité d’un soin psychique, mais également au-delà sur la Cité — pourrait avoir le soin psychiatrique dès lors qu’il serait utilisé comme une telle arme ?
La loi du 5 juillet 2011, conçue comme une arme dans le discours qui a soutenu son instauration, pourrait dans son application mettre en demeure le soin psychiatrique de devenir une arme, ici ou là anecdotiquement, voire partout politiquement, contre... les maladies mentales fixées par décret d’État. Vous trouvez ça normal ?