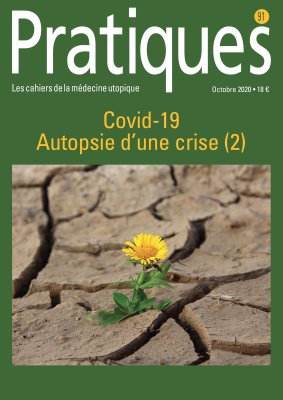Denis Labayle
Médecin gastro-entérologue
Depuis des décennies, la politique de restriction tous azimuts, planifiée par les « Hautes » instances sanitaires et hospitalières nationales et régionales, est basée sur un raisonnement assez simpliste : la réduction de l’offre de soins réduira les dépenses de santé.
La crise de la Covid-19 a eu, au moins, trois mérites : tout d’abord, prouver à la population que les soignants hospitaliers s’avéraient capables de s’unir pour gérer une crise sanitaire, marginalisant par la même occasion une bureaucratie devenue toute-puissante ; révéler ensuite la gravité de la situation dans laquelle se trouve l’hôpital public, saigné de son personnel soignant depuis plusieurs dizaines d’année ; enfin, mettre en évidence les conséquences dramatiques de la réduction des lits d’hospitalisation depuis une quarantaine d’années.
Soyons clairs : cette politique absurde ne date pas d’hier. Toutes les insuffisances révélées par la pandémie ont été dénoncées depuis longtemps. Déjà, en 2002, dans mon livre Tempête sur l’hôpital (Seuil), j’annonçais que l’hôpital public serait incapable de répondre à une véritable crise sanitaire. La canicule de 2003 en a été la première confirmation : 15 000 morts en moins d’un mois. Mais ce drame n’a pas modifié les orientations des gestionnaires de la santé publique : ils n’en ont tiré aucune conclusion. Quelques années plus tard, en 2010, Martine Schachtel, une infirmière, cadre soignante, publiait L’hôpital à la dérive (Albin Michel) et tirait de nouveau la sonnette d’alarme. Mais rien ! Le démantèlement du système hospitalier s’est poursuivi de façon méthodique avec la complicité d’une bureaucratie administrative, formée à l’École nationale de la santé publique de Rennes. Là-bas, non seulement on enseigne aux futurs administrateurs qu’il faut mettre les médecins au pas, mais on leur affirme depuis longtemps que l’hôpital doit être géré comme une entreprise dont ils seraient les nouveaux managers. Étranges chefs d’entreprise qui, à la sortie de l’école, ignorent l’essentiel de l’objectif de cette soi-disant « entreprise » : le soin. Pratiquement rien sur la finalité de l’hôpital au programme des études de ces futurs « managers. » D’où, un esprit de caste, des habitudes de méfiance vis-à-vis des soignants, une crainte d’aller sur un terrain mal connu, une gestion à distance et, au total, une rotation rapide des postes de direction, incompatible avec une évaluation sérieuse des chantiers entrepris. Depuis 1941, date de la création du poste de directeur d’hôpital, toutes les lois sans exception (et elles ont été nombreuses) ont renforcé le pouvoir des directions, sans obtenir les résultats escomptés ni sur la gestion, ni sur la qualité des soins.
Parmi toutes les erreurs développées depuis quarante ans, j’insisterai sur trois pour illustrer la destruction programmée de notre organisation sanitaire et en particulier de l’hôpital public.
L’une des premières causes de la destruction planifiée de notre système de santé fut la réduction drastique et incontrôlée du nombre de médecins formés annuellement, ce que l’on appelle : le numerus clausus. Entre les années quatre-vingt et la fin des années quatre-vingt-dix, on est passé d’une formation de huit mille médecins par an à trois mille cinq cents. Un chiffre qui remontera lentement à sept mille huit cents à la fin des années 2010, et restera stable depuis. Entre 1970 – date de création du numerus clausus – et 2001, c’est-à-dire pendant trente ans, il ne sera réalisé aucune étude de la démographie médicale et de ses conséquences pour l’avenir. La première étude remonte à 2001. Le rapport Kouchner tire pour la première fois la sonnette d’alarme. À la diminution drastique du nombre de médecins formés, il faudra bientôt ajouter l’augmentation importante du nombre de départs en retraite et le nombre croissant de diplômés n’exerçant pas (25 % des nouveaux formés). Et pourtant, pendant que l’on réduisait le nombre de médecins, les besoins sanitaires augmentaient avec le vieillissement de la population. L’intense désertification médicale que l’on observe aujourd’hui touche non seulement le monde rural, mais également les grandes villes. À Paris, entre 2007 et 2017, la capitale a perdu 25 % de généralistes et 25 % de spécialistes. D’où, une incapacité de la médecine libérale d’assurer une prise en charge sérieuse des patients en ambulatoire et un afflux ininterrompu de malades aux urgences hospitalières.
Deuxième cause de la crise actuelle de l’hôpital public : la réduction drastique du nombre de lits d’hospitalisation. L’hôpital public a perdu plus de 40 % de ses capacités d’accueil en quarante ans : nous sommes ainsi passés de 10,4 lits d’hospitalisation pour 100 000 habitants à 6,4 lits pour 100 000 habitants. Le résultat est évident : une incapacité chronique de l’hôpital public à répondre aux besoins de la population, et pire encore en période aiguë.
Finalement, la crise des urgences est assez simple à comprendre : d’un côté, on augmente graduellement le flux des malades aux urgences, de l’autre on réduit le nombre de lits capables de les accueillir. Ceci est particulièrement vrai pour la médecine. D’où un embouteillage massif de malades aux urgences, des attentes infernales, des malades sur des brancards, une organisation inhumaine indigne d’un pays riche et développé. Quand j’ai pris mes fonctions à l’hôpital Louise Michel d’Évry en 1982, le service de gastro-entérologie où je travaillais disposait de quarante lits pour accueillir les malades, en 2007, le même service avait été réduit à quinze lits. Certes, nous avions ouvert six lits d’hôpital de jour pour réaliser les endoscopies en ambulatoire, mais nous étions devenus incapables de répondre aux besoins des urgences, tous les malades hospitalisés nécessitant des soins très lourds. C’en était fini des hospitalisations pour sevrage d’alcool ou de drogue, finie la possibilité d’accompagner tous nos patients en fin de vie comme l’exigeait notre éthique.
Troisième preuve de la volonté politique de détruire progressivement l’hôpital public : le changement du mode de financement jusqu’à l’introduction de la T2A, autrement dit le paiement à l’activité (encore faut-il qu’elle soit réellement évaluable). Objectif affiché : appliquer les mêmes règles de financement au secteur public et au secteur privé. Comme si ces deux secteurs avaient le même cahier des charges. Une totale hypocrisie ! Pour comprendre ces égarements économiques, il est bon de rappeler que le financement des hôpitaux a évolué en trois étapes. Pour mémoire, rappelons qu’après la guerre de 40, les budgets hospitaliers dépendaient du nombre de lits occupés. D’où l’ordre, à l’époque, des administratifs aux soignants : « Il faut remplir les lits. » Un système totalement inflationniste qui durera tout de même une trentaine d’années. Il faudra ensuite vingt ans supplémentaires pour que le nouveau système – le budget global (à chaque hôpital une enveloppe fixe quelle que soit la réalité de son activité) – aboutisse à une nouvelle impasse. Avec la T2A, il faudra de nouveau attendre vingt ans pour que nos économistes de la santé admettent l’évidence : la facturation à l’activité favorise le secteur privé capable de s’adapter rapidement à la prise en charge des maladies les plus rentables et pénalise un secteur public en charge de toutes les pathologies, quelles que soient les conditions sociales des patients. Ce système est devenu rapidement inflationniste pour les soins techniquement rentables (prothèse de hanches, cataracte, pose de stents…) et inapplicables à la médecine des polypathologies, hospitalisées essentiellement dans le secteur public. Là encore, les conséquences étaient prévisibles. Je me souviens avoir été invité en 2001 à une commission ministérielle sur la mise en place de la T2A – je venais de publier Tempête sur l’hôpital – et m’être fait rabrouer par les grands penseurs de la santé publique pour avoir annoncé les effets pervers évidents de ce système. Mon invitation n’a pas été renouvelée. Il aura donc fallu attendre vingt ans et la crise de la Covid-19 pour que l’on écoute enfin les soignants de l’hôpital public qui dénoncent unanimement ce système inique.
La crise est-elle devenue vraiment évidente pour les politiques ? Va-t-on vraiment changer de cap ? Rien n’est moins sûr. Pour l’instant, les réformes annoncées portent principalement sur un rattrapage des salaires. Une façon de calmer ces blouses blanches devenues trop populaires. Mais sur la réforme profonde de l’hôpital : pas grand-chose. L’augmentation du nombre de lits ? Quatre mille de prévus, mais uniquement mobilisés en cas de besoins ! Une promesse totalement insuffisante quand on sait qu’au cours des trois dernières années de ce gouvernement, on a supprimé quatre mille sept cents lits d’hôpital ! Les malades vont encore attendre longtemps aux urgences. Quant au nombre de soignants, on ne voit pas se dessiner une réelle politique pour corriger les erreurs passées : la précédente ministre de la Santé a affirmé avoir enterré le numerus clausus, sans avancer d’autres chiffres. Pour les infirmières et les aides-soignantes, même constat : on annonce une augmentation du recrutement, mais les nouveaux salaires et les conditions de travail seront-ils suffisamment attractifs ?
Le financement de l’hôpital ? On évoque enfin un système mixte : un peu de budget global et un peu de T2A, mais dans quelle proportion ? Quant à la nouvelle gouvernance pour contrecarrer la toute-puissance administrative, on l’évoque, mais rien n’est sérieusement envisagé.
En réalité, on sent un besoin de la part des hommes politiques de calmer la fronde en augmentant les salaires, sans désir réel de réformer en profondeur l’organisation hospitalière.
Bref, je crains que la réforme de l’hôpital public ne soit pas pour demain. Rendez-vous à la prochaine pandémie…